
Michaël Neuman & Fabrice Weissman

Directeur d'études au Crash depuis 2010, Michaël Neuman est diplômé d'Histoire contemporaine et de Relations Internationales (Université Paris-I). Il s'est engagé auprès de Médecins sans Frontières en 1999 et a alterné missions sur le terrain (Balkans, Soudan, Caucase, Afrique de l'Ouest notamment) et postes au siège (à New York ainsi qu'à Paris en tant qu'adjoint responsable de programmes). Il a également participé à des projets d'analyses politiques sur les questions d'immigration. Il a été membre des conseils d'administration des sections française et étatsunienne de 2008 à 2010. Il a codirigé "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de MSF" (La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (CNRS Editions, 2016).

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.
3. Pratiques
La charge d’un chef de mission
Entretien avec Delphine Chedorge, coordinatrice d’urgence pour MSF en République centrafricaine, réalisé par Michaël NeumanCe texte est le produit d’entretiens menés entre mai et juillet 2015.

Pays enclavé de quatre millions d’habitants, très faiblement pourvu en infrastructures de santé, la République centrafricaine (RCA) est, en volume financier, le premier pays d’intervention pour la section française et le troisième pour l’ensemble du mouvement MSF après la république démocratique du Congo et le Soudan du Sud. C’est aussi l’un des plus dangereux. Depuis 2007, quatre employés de l’association y ont perdu la vie du fait d’actes de guerre. MSF y a mené en 2014 jusqu’à une vingtaine de projets médicaux employant trois cents volontaires internationaux et plus de deux mille cinq cents employés centrafricains.
Coordinatrice d’urgence pour MSF, Delphine Chedorge a dirigé les opérations de la section française en RCA entre janvier et décembre 2014. Elle répond aux questions de Michaël Neuman sur le quotidien d’un chef de mission responsable de la sécurité des équipes. Son interview est précédée d’un rappel des événements récents ayant ensanglanté la RCA.
La crise de 2013‑2014 en RCA
La République centrafricaine connaît depuis trois ans un cycle de violences sans précédent dans son histoire postcoloniale. En mars 2013, les combattants de la Seleka, coalition de mouvements d’opposition armés, s’emparaient du pouvoir et portaient Michel Djotodia à la présidence. Dans les mois qui suivirent, les violences du nouveau régime à l’encontre de la population et des forces de l’ancien gouvernement entraînèrent la formation de milices populaires. Résultat d’une alliance entre milices paysannes d’autodéfense et membres de l’ancienne armée nationale, les « anti-Balaka » se firent les vecteurs de la colère grandissante de la population à l’encontre d’un pouvoir de plus en plus identifié comme « étranger » et « musulmanVoir notamment Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Centrafrique : Ils doivent tous partir ou mourir, juin 2014. ».
Face à la montée des tensions et à la crainte de massacres intercommunautaires, le Conseil de sécurité des Nations unies vota, le 5 décembre 2013, le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca), chargée de rétablir l’autorité de l’État et de protéger les civils. Placée sous la houlette de l’Union africaine, la Misca devait être appuyée par une force française, à travers l’opération Sangaris. Ce même jour, une offensive d’ampleur des anti-Balaka contre Bangui échoua à renverser le régime, mais entraîna la fuite des ex-SelekaOn parlera d’ex-Seleka pour évoquer les forces de la Seleka toujours actives après sa dissolution décidée en septembre 2013 par Michel Djotodia à la suite de l’augmentation des violences et des exactions.
et l’accélération du déploiement militaire international. Aux violences débridées des ex-Seleka en déroute succédèrent les pillages et massacres commis par les anti-Balaka et une partie de la population à l’encontre des populations musulmanes de Bangui laissées « sans protecteursVoir notamment Human Rights Watch, « Ils sont venus pour nous tuer. Escalade des atrocités en République centrafricaine », 19 décembre 2013. ».
Acculé et sous la pression internationale, Michel Djotodia quitta le pouvoir le 10 janvier 2014. La nomination d’un régime de transition n’entraîna pas l’apaisement escompté : les ex-Seleka poursuivirent leur retraite ponctuée d’exactions sanglantes vers les pays frontaliers en direction du nord, de l’est et de l’ouest du pays, pourchassés par les groupes anti-Balaka. Ces derniers encourageaient ou dirigeaient les tueries de populations musulmanes, contraintes à l’exode vers les pays voisins ou vers quelques enclaves en RCA protégées par les forces internationales. Une enquête de mortalité rétrospective menée en avril 2014 par MSF auprès des réfugiés centrafricains arrivés à Sido au Tchad révéla que 8 % de la population d’origine était morte entre novembre 2013 et avril 2014, dont 91 % du fait d’actes de violence lors de la campagne de persécutions des minorités musulmanes.
Au moment de la tentative de coup d’État du 5 décembre 2013, la section française de MSF comptait trois projets dans le pays. Dans la sous-préfecture de Paoua, dans le nord-ouest, où elle était active depuis 2006, MSF-France menait des activités de soins de santé primaires et secondaires. À Carnot et Bria, elle gérait une activité pédiatrique. Dès le mois de décembre, une intervention d’urgence fut mise en place par la section française, en particulier à Bangui, afin de prendre en charge les victimes de violences. Également présentes en RCA, les sections espagnole et hollandaise étaient rejointes début 2014 par les sections suisse et belge.
Michaël Neuman : Dans quelles circonstances as-tu démarré ta mission ?
Delphine Chedorge : Ma première mission en Centrafrique remonte à l’été 2007. J’y suis retournée plusieurs fois, dont trois mois en 2012, puis pour un an au début de l’année 2014 : d’abord comme coordinatrice d’urgence, puis, à partir d’avril, comme chef de mission. Or le conflit actuel a démarré en décembre 2012 et s’est intensifié après la prise de pouvoir par les Seleka en mars 2013, qui avait provoqué la désagrégation des forces de sécurité du pays. J’avais donc, en quelque sorte, « raté » un peu plus d’un an d’évolution du conflit. Dans les premières semaines, j’ai eu du mal à mesurer précisément les enjeux sécuritaires. De plus, j’avais une connaissance du pays très locale, centrée sur le nord-ouest, où la plupart des activités de MSF-France étaient historiquement concentrées. J’ai mis du temps à prendre la mesure de ce qui se passait ailleurs. Et je ne m’attendais pas non plus à ce qu’un conflit communautaire aussi violent se mette en place.
Quels étaient les principaux problèmes de sécurité à Bangui à ton arrivée ?
Quand j’ai débarqué à Bangui en janvier 2014, il y avait des tirs très fréquents en ville, y compris autour de l’Hôpital communautaire, où nous prenions en charge des blessés, ainsi qu’autour de nos bases de vie et de nos bureaux qui se situaient dans le même quartier. Nous étions au milieu de la guerre urbaine.
Notre passage vers les enclaves ou quartiers musulmans était également très difficile. Pour aller chercher des blessés, nous avons tenté à plusieurs reprises, en janvier et février, de nous rendre vers le quartier dit de PK12, où étaient regroupés des musulmans qui souhaitaient fuir, mais vivaient sous les attaques permanentes de milices particulièrement excitées. Le quartier était également marqué par sa proximité avec un camp de cantonnement d’ex-Seleka. Des forces internationales y étaient positionnées pour protéger les civils et les ex-Seleka, ce qui en faisait un lieu de très haute tension. Il a fallu parfois rebrousser chemin devant l’agressivité de nos interlocuteurs.
Le personnel, national ou international, était très exposé au danger. Il devait souvent négocier avec des personnes armées et agressives qui entraient dans l’hôpital pour aller chercher un patient ou exiger d’être soignées avant les autres. Il était directement témoin de l’intensité de la violence dont il prenait en charge les conséquences : le nombre de blessés, le type de blessures. À plusieurs reprises, l’équipe de l’hôpital a dû se replier au bloc chirurgical à cause de la proximité des combats. Le bloc était à l’épreuve des balles, mais pas les tentes d’hospitalisation où étaient les patients. La fatigue physique et nerveuse a été très importante. Il n’y a pas eu de casse physique, mais le risque était élevé. Personne n’a demandé à quitter le projet, ce qui aurait été très compréhensible. Nous avons fait venir des psychiatres et des psychologues pour débriefer les équipes.
Quelles mesures étaient prises pour limiter l’exposition au danger ?
À mon arrivée, le « référent sécurité » du siège était déjà sur place pour aider les équipes, entre autres, à se protéger des balles perdues qui tombaient dans les maisons – il y en avait eu plusieurs depuis décembre. Il a mis en place des pièces sécurisées où les équipes se regroupaient en cas de combats proches. Par ailleurs, l’équipe de l’hôpital avait peur de rester sur place, la nuit en particulier. Nous avons décidé qu’elle ne pouvait y travailler que de 8 heures à 16 heures. Nous étions bien obligés d’assumer cette carence de soins.
Nous avons parfois orienté les activités dans un sens qui nous semblait accroître notre sécurité, en tentant d’établir une confiance plus grande avec les groupes armés et les habitants, la distinction entre les deux étant parfois difficile à établir. Ainsi, lors de la prise en charge des victimes des violences dans le quartier de Fatima en mai et juin, qui avaient fait entre quinze et vingt blessés parmi la population déplacée, nous avons déployé des activités de cliniques mobiles dans les quartiers chrétiens voisins. Elles étaient médicalement utiles bien sûr – pour la prise en charge des cas de paludisme infantile par exemple –, mais la motivation première était de se protéger de certaines accusations de ne travailler qu’avec les musulmans, même si bien sûr notre centre de santé dans le quartier à majorité musulmane de PK5 prenait aussi en charge les chrétiens.
Ensuite, il s’agissait de travailler très activement au recueil d’informations. La première source était le personnel national, dont je connaissais la plupart des membres depuis longtemps. Ils me décrivaient la situation dans les quartiers, ainsi que l’attitude des groupes, leur armement, les propos qu’ils tenaient, les rumeurs qu’ils diffusaient et menaces qu’ils adressaient. Ils me permettaient également d’identifier les rues problématiques. Je ne connaissais pas les rues de Bangui ; auparavant, on n’y travaillait pas. Il fallait adopter une lecture micropolitique des dynamiques de quartiers en ville. On circulait beaucoup ; on observait. On prenait un chauffeur qui se disait à l’aise pour circuler dans certains quartiers et pour décrire la situation en passant.
Nous travaillions plutôt bien avec les autres sections de MSF présentes à Bangui, l’une ayant des relations de travail établies avec les ex-Seleka, une autre des liens plus récents avec les groupes anti-Balaka, du fait de son travail dans le camp de déplacés de M’PokoÀ la suite des violences du mois de décembre 2013, plusieurs dizaines de milliers de déplacés originaires de Bangui se sont regroupés sur le site de l’aéroport de la ville, Bangui-M’Poko.. Dans les premiers temps de ma mission, nous étions assez dépendants de ces contacts ; nous agissions en confiance – disons une confiance informée, pas aveugle. Ça me coûtait, mais il y avait une logique : je ne pouvais pas multiplier tous les contacts. À partir du mois d’avril, j’ai repris la main sur les contacts en collaboration avec mes collègues des autres sections.
Pouvais-tu t’appuyer également sur des informations de l’extérieur, de journalistes, d’autres ONG qui travaillent dans le pays ?
Nos principaux interlocuteurs en matière de recueil d’informations étaient le réseau des missionnaires, le réseau du personnel médical du ministère de la Santé, ainsi que le réseau des volontaires de la Croix-Rouge nationale. Tous ont été très actifs dans la protection des civils ou dans la fourniture de secours pendant la période où le conflit était le plus intense. Nous avions également des contacts réguliers avec de vieilles connaissances, des responsables politiques de tous bords, d’anciens rebelles, des chefs de quartier. Par ailleurs, la chef de mission en poste à mon arrivée avait son réseau auprès des responsables de certaines ONG présentes en Centrafrique, et nous échangions avec quelques agences des Nations unies, ou certaines personnes en leur sein.
Dans les débuts, il y avait peu d’organisations qui menaient des activités de secours et circulaient en ville et dans le reste du pays. Les Nations unies, l’armée française, puis la force européenne Eufor, et plus tard une ONG, Inso, chargée de travailler spécifiquement sur la sécurité, ont progressivement mis en place des dispositifs d’information à destination des organisations humanitaires. Leurs informations étaient le plus souvent parcellaires et peu fiables. Les organisations dont la responsabilité est d’éviter d’exposer les autres – c’est particulièrement vrai pour les militaires – vont dire « évitez d’aller ici ou là », ou « prenez des escortes armées ». Il n’est pas inutile de considérer sérieusement leur point de vue. Mais il était important de garder notre autonomie dans les prises de décision. Finalement, ce qui était instructif était moins l’information elle-même – parfois des rumeurs transmises sans recul – que ce qu’elle nous apprenait sur la qualité de l’émetteur et sur ce qu’il était prêt à transmettre ou pas.
Y avait-il des questions de sécurité ou des demandes spécifiques pour le personnel national ?
À Bangui, les membres du personnel centrafricain, qui en grande majorité habitaient dans des quartiers particulièrement affectés par le conflit, avaient très peur de se déplacer. En décembre 2013, beaucoup ne venaient plus au bureau. La coordination avait mis en place un système de navette pour organiser le transport du personnel. Ce système s’est interrompu début février 2014, alors que l’intensité des combats en ville avait beaucoup diminué et que les taxis s’étaient remis à circuler. Malgré cela, des employés restaient régulièrement dormir dans nos bureaux ou nos maisons, faute de pouvoir rentrer chez eux. À partir de septembre, être identifié comme un employé de MSF avait cessé d’être un facteur de protection pour devenir un facteur de risque, pour des personnes salariées, donc solvables. Et leur sécurité a pâti bien évidemment beaucoup plus que la nôtre de la gangstérisation de Bangui. Plus dramatique encore, l’intégralité de nos employés de confession musulmane a quitté la ville, et sans doute pour la majorité d’entre eux, le pays. Nous sommes sans nouvelles de beaucoup.
Quels étaient les principaux problèmes de sécurité à l’extérieur de Bangui ?
Jusqu’au mois d’octobre, on parvenait parfois à circuler par route à l’intérieur du pays malgré les incidents. Certes, il arrivait que les employés des ONG et des Nations unies soient pris pour cibles, mais c’était surtout le matériel qui l’était. En janvier 2014, un groupe d’ex-Seleka nous a pris une voiture : ils nous ont arrêtés, nous ont expliqué avoir besoin de la voiture pour un jour ou deux, ont enlevé les identifications MSF, la radio, fait décharger la voiture. Après quelques pressions sur les commandants, on l’a récupérée. Elle avait servi aux combats. Il s’est passé la même chose lorsqu’un groupe d’anti-Balaka nous a « confisqué » un camion, avec son équipage, avant de le restituer quelques jours plus tard. Il avait également servi aux combats. Ce « respect », tout relatif, a progressivement disparu au cours de l’année. C’était sur la route que les risques étaient les plus importants : les barrages anti-Balaka et leurs combattants saouls, drogués et sans réelle hiérarchie. Nous avons dû limiter notre circulation par la route et avons loué un avion supplémentaire pour assurer la rotation des équipes et l’approvisionnement des projets. Ça nous semblait la seule option permettant de travailler dans des conditions de sécurité que nous jugions acceptables. Cette pratique était pourtant au coeur de discussions régulières et fatigantes avec le siège, qui estimait que l’avion coûtait trop cher.
Nous travaillions alors dans trois localités, à Paoua, dans le nord-ouest, à Carnot, dans l’ouest, et à Bria, dans l’est. Comment les conditions de sécurité ont-elles évolué sur ces trois sites ?
On s’attendait à ce que Bria et Paoua, qui avaient été touchées par les conflits des années 2000, soient plus exposées. C’est finalement à Carnot que ça a été le plus terrible. Il y a eu de nombreux accrochages entre des civils, des anti-Balaka, des ex-Seleka, puis les forces camerounaises de la Misca qui faisaient tampon entre, d’un côté, les anti-Balaka et les habitants de Carnot, et, de l’autre, les musulmans piégés dans cette enclave et réfugiés dans l’église. L’équipe a assisté à plusieurs reprises à des massacres de musulmans, au cours du mois de janvier en particulier, où nous avons dû demander une intervention des forces camerounaises de la Misca, basées à quelques heures de route plus au nord, afin d’interrompre la chasse aux musulmans au coeur de leurs habitations et les tueries.
L’accès aux soins pour les musulmans déplacés était très risqué ; beaucoup refusaient de se rendre dans les hôpitaux du fait de l’extrême danger associé aux trajets. Toutefois, l’équipe a pu négocier avec les milices anti-Balaka et certains habitants le passage de l’ambulance MSF avec des musulmans et des soldats de la Misca blessés pour les évacuer par avion vers Bangui.
En juillet 2014, à la suite d’affrontements entre forces internationales et anti-Balaka, un patient d’origine peuhl est lynché à l’intérieur de l’hôpital de Carnot. Cet événement est l’un des plus graves auxquels nos projets ont été confrontés. Vous avez ensuite lancé une « campagne de mobilisation », locale, puis nationale, appelant à la protection des structures de santé. Qu’attendait-on de la communication publique sur un incident de sécurité ?
On aurait sans doute pu s’y prendre plus tôt. Parce qu’on s’est rendu compte que certains soignants n’étaient finalement pas surpris qu’on vienne régler des comptes communautaires dans l’enceinte d’une structure de santé. Le message était : l’hôpital est un lieu de soins pour tous, et nous ne pouvons y tolérer de violence, sous peine d’avoir à s’en retirer. Localement, l’équipe est allée voir toutes les autorités sanitaires et politiques, les groupes armés, la population, les chefs de quartier afin d’utiliser tous les relais possibles pour dire que ça n’était pas normal. Il y a eu une bonne réception de ce message-là.
Puis, en discutant avec l’équipe et les autres sections, on s’est dit que ce qui était arrivé à Carnot pouvait arriver partout. C’est pourquoi nous avons décidé de mener une campagne nationale, à base d’affichage et de messages diffusés à la radio, y compris sur les lieux des autres projets, afin d’appeler à la protection de la mission médicale.
Cette campagne appelant à protéger les structures de santé au nom des principes humanitaires n’était-elle pas un peu vaine ?
Il n’est pas inutile de rappeler les mots magiques, à condition de les accompagner d’une discussion et de négociations beaucoup plus concrètes. Lorsqu’un incident survient, on essaie d’identifier la cause du problème et quel rôle on joue. On tente de voir comment continuer d’exister, d’apporter des secours, dans notre environnement. En l’occurrence, à Carnot, il était de l’intérêt de tous que nous restions. Mais nos prises de parole ne se sont pas limitées à cette campagne. En Centrafrique, l’ensemble des communications publiques qui ont suivi des incidents de sécurité ont été reprises dans la presse locale. Malgré, le plus souvent, l’absence de réactions politiques publiques, certains de nos interlocuteurs nous appelaient – au moins pour prendre des nouvelles. Cette communication permettait aussi de contester un discours institutionnel sur la « normalisation » de la situation, qui a été développé à la fin de l’année 2014 par les responsables centrafricains et les intervenants internationaux, la France au premier chef. C’est ce qui s’est passé, à la suite de la multiplication de braquages des maisons et bureaux des autres sections de MSF présentes dans le pays, mais aussi d’un certain nombre de véhicules sur les routes, de la séquestration et du racket des camions de nos transporteurs : il était important de marquer le coup.
La Centrafrique est le dernier pays dans lequel un volontaire international de la section française de MSF a été tué, en juin 2007. Il s’agit d’Elsa Serfass, qui était logisticienne sur le projet de Paoua. Tu as réalisé ta première mission en RCA dans les jours et semaines qui ont suivi cet événement tragique. A-t-il eu des conséquences dans ta gestion de la sécurité lors de ta dernière mission ?
Ma première crainte a toujours été le décès d’un membre de nos équipes. Le décès d’Elsa était quelque chose que j’évoquais lors de mes briefings des volontaires. Faire référence à cette histoire permettait de rappeler la circulation d’armes, l’état de chaos du pays. C’était important car, même en 2014, dans un contexte de violence extrême, certains pouvaient vite perdre de vue qu’il s’agissait d’un pays dangereux, dès qu’une période calme prenait place quelques jours. Il s’agit également d’avoir un minimum d’honnêteté vis-à-vis des individus qui arrivent sur une mission. Il faut discuter des exemples concrets : les meurtres, les viols, les patients lynchés.
Je considère qu’il est inadmissible de voir des gens arrivant sur un terrain à qui on a caché des événements graves. Et je me suis retrouvée moi-même à ne pas avoir les informations concernant des incidents graves contre des personnes, y compris des agressions sexuelles commises sur des collègues des autres sections. Cela a été la cause de discussions tendues. Parfois, au nom de la dignité des victimes, des responsables sont enclins à cacher des informations qui sont pourtant indispensables pour juger de l’évolution de la nature des risques auxquels les équipes s’exposent. Le risque est également de banaliser la violence. Plongés dans un environnement dangereux où l’on se retrouve confrontés à des incidents à répétition, le risque est qu’on s’y habitue, et qu’on finisse par ne plus réagir, considérant que la violence à laquelle nous sommes exposés est normale.
Quelles sont les circonstances qui t’ont amenée à suspendre les activités ou à évacuer des équipes au cours de ta mission ?
En 2014, nous avons réalisé plusieurs évacuations préventives, afin de réduire la surface d’exposition, lorsque nous pensions que la situation pouvait sérieusement se dégrader. Par exemple, au moment des violences du mois d’octobre à Bangui, nous avons décidé de l’évacuation de vingt-quatre personnes en trois jours, via trois pays limitrophes, par route ou par bateau. Et puis il y a eu l’attaque contre l’hôpital de Boguila, qui a fait dix-neuf morts dont trois employés centrafricains de MSF-Hollande en avril. Avec les chefs de mission des cinq sections présentes, nous avons beaucoup discuté de la réaction à adopter. Deux positions s’affrontaient : l’une selon laquelle il fallait fermer tous les projets dans le pays pendant un certain temps, dans le mince espoir que cette décision extrême entraîne une réaction des groupes armés ; l’autre, plus modérée – notamment défendue par le chef de mission de MSF-Hollande –, proposait l’évacuation des équipes internationales et « délocaliséesNous faisons ici référence au personnel centrafricain embauché à l’extérieur des projets – principalement à Bangui – et que MSF « délocalise ».
» de Boguila. Finalement, l’option retenue, minimale, fut de réduire les activités à la seule prise en charge de cas urgents pendant une semaine et sur tous les projets. À l’exception de celui de Boguila, où les employés expatriés et délocalisés furent évacués sur une longue période, et remplacés par des visites irrégulières. Nous avions identifié le responsable de la tuerie – un responsable d’un groupe d’ex-Seleka. Mais nous n’en avons fait aucune utilisation publique. Nous nous sommes contentés de nous plaindre à ses supérieurs en comptant sur une réaction de leur part. Ça n’a servi à rien ; il court toujours.
En définitive, c’est à Paoua, projet le plus préservé des violences de guerre, que nous avons suspendu nos activités pendant la période la plus longue. Quelle en était la raison ?
À partir du mois d’août, nos employés centrafricains ont posé une série de réclamations (augmentation de salaire, prime de transport) appuyées par une journée de grève. Lors de la journée d’action en septembre, des piquets de grève ont été mis en place et certains employés ont gravement menacé ceux qui voulaient travailler. Les autorités locales qui acceptèrent de jouer les médiateurs furent accusées d’être des traîtres. La situation s’est détériorée au point que des menaces de mort ont été proférées à l’encontre du personnel international. L’équipe a été évacuée. Elle n’est progressivement revenue qu’à la toute fin de l’année.
MSF travaille à Paoua depuis 2006. Qu’est-ce qui explique cette dégradation ?
Le premier facteur est lié au contexte spécifique centrafricain, la détérioration des relations sociales du fait des violences dans la région depuis des années, la disparition de représentants de l’État et des autorités locales ayant un pouvoir de médiation – tout ça sur fond de crise économique. D’ailleurs, d’autres organisations ont fait face à des conflits sociaux très durs. Le second facteur est interne à MSF : cinq personnes se sont succédé au poste de coordinateur de projet à Paoua sur l’année, et ce manque de continuité a certainement pesé sur notre capacité à évaluer cette dégradation de la situation, notamment sociale. De plus, absorbés par les autres projets dont nous estimions qu’ils portaient une part de risque beaucoup plus élevée pour les équipes, nous avons sans doute, au sein de l’équipe de coordination, insuffisamment suivi la situation.
De manière générale, quelle est la marge d’appréciation et de manoeuvre laissée aux coordinateurs de projet en matière de sécurité ?
Elle dépend de chacun et des relations qui s’instituent entre nous. Tous n’ont pas la même expérience, la même capacité d’analyse de leur contexte. Lorsque j’estime ne pas avoir d’explications convaincantes, par exemple, sur les raisons motivant un déplacement et sur les précautions prises, je peux annuler celui-ci. Quand tu sens que ton responsable d’équipe sait gérer ça, tu lui accordes une plus grande autonomie.
Selon un modèle peu fréquent aujourd’hui à MSF, nous avons aussi délégué en partie la sécurité d’une équipe à un autre acteur, des missionnaires catholiques en l’occurrence. Fin janvier 2014, nous avons laissé pour quelques jours une petite équipe de deux personnes, une anesthésiste et une chirurgienne, à Bossemptélé, au nord-ouest de Bangui, sans voiture ni moyens de communication propres. C’était dans le contexte de la fuite des ex-Seleka et des représailles violentes des anti-Balaka contre les musulmans de la ville. Il y avait beaucoup de blessés. Le médecin centrafricain de l’hôpital missionnaire manquait de moyens, les blessures s’infectaient. Et nous avons décidé d’envoyer deux personnes pour donner un coup de main.
C’était un cadre spécifique. La mission catholique y était très active dans la défense et l’assistance des musulmans. Le prêtre avait l’habitude d’interagir avec tous les groupes armés ; des soeurs missionnaires étaient également présentes. L’enceinte de la mission était relativement protégée. J’ai laissé l’équipe sans voiture : à ce moment-là, avoir une voiture MSF en bon état aurait attiré les milices, ne pas en avoir était un gage de sécurité ; l’équipe était quasi invisible. Néanmoins, l’ensemble des groupes politico-militaires était au courant de leur présence, nous n’agissions pas clandestinement.
En Centrafrique, comme sur d’autres terrains ces dernières années, MSF en est venu à interdire l’accès de certains projets à certains volontaires, en fonction de leur nationalité et couleur de peau. Comment en est-on arrivé à cela ?
Il y a deux situations dans lesquelles nous avons fait ce choix. À Bria, en avril 2014, un logisticien a été agressé par un individu lui reprochant d’être blanc et français. Les forces françaises de l’opération Sangaris, vues comme prenant part au conflit contre les musulmans, étaient dans la zone. Nous courions le risque d’y être amalgamés. La première mesure fut de faire sortir du terrain le volontaire en question. Puis nous avons décidé de ne plus envoyer du tout de Blancs, qui pouvaient être assimilés à des Français. Nous avons rapidement compris qu’il s’agissait d’un incident isolé – l’agresseur était un individu excédé, en colère après le décès de son fils à la suite de combats. Par ailleurs, de nombreuses personnes ont rapidement
pris la défense de ce logisticien.
Néanmoins, des cas comme celui-là, il pouvait y en avoir d’autres ; en discussion avec l’équipe, nous avons donc maintenu la décision plusieurs mois. Vu notre volume opérationnel d’ensemble, et le nombre d’expatriés dans le pays, on se simplifiait la tâche. Mais les visites de l’équipe de coordination de Bangui n’étaient pas interdites ou limitées et elles se sont multipliées, à tel point que cette mesure a fini par perdre tout sens. Nous aurions pu certainement renvoyer des Blancs plus rapidement.
Ensuite, la question s’est également posée pour les profils musulmans. Nous avons adopté une attitude hyperpragmatique, considérant que les Maghrébins seraient considérés comme des Blancs par les anti-Balaka et qu’il n’y aurait donc pas de problèmes. Concernant les Africains, certains ont modifié leur prénom, au profit d’un nom à consonance non musulmane. C’était des décisions individuelles. En revanche, j’ai moi-même préféré refuser qu’un poste de chef de mission adjoint soit occupé par un Malien touareg, considérant qu’il aurait été amené à s’exposer, lors des déplacements nécessités par sa fonction, dans l’ensemble des quartiers de Bangui.
Parmi les questions relatives à la sécurité en Centrafrique, il a été beaucoup question de la surface d’exposition. Pour beaucoup, nous étions trop volumineux : trois cents employés internationaux dont quatre-vingt pour la seule section française, deux mille cinq cents nationaux pour l’ensemble des sections MSF. Comment t’es-tu située dans cette discussion-là ?
Il faut rappeler que Bangui est la ville la plus dangereuse de RCA. Or c’est là que la coordination se trouve. C’est également là que l’équipe est la plus nombreuse. Si l’on rajoute à l’équipe de coordination celles de l’hôpital et de notre centre de santé dans le quartier de PK5, il y a eu plus de quarante-cinq employés internationaux à certains moments.
En plus, la position du siège appelant à réduire la voilure opérationnelle pour limiter l’exposition aux dangers contredisait sa politique de déploiement d’expatriés « première mission » sur le terrain : dans un environnement instable au mieux, et franchement dangereux la plupart du temps, on a créé des postes qui ne répondaient pas à des besoins opérationnels immédiats, mais au projet de formation de nouveaux volontaires. C’était complètement contradictoire et cela s’est fait sans mon accord. Ainsi, à Paoua, il y avait deux personnes dans ce cas, sur un total de huit, que j’ai dû faire évacuer dans des conditions périlleuses vers le Tchad après les violences d’octobre à Bangui.
Au début de notre entretien, tu as évoqué le rôle du référent sécurité – une nouveauté au sein de la section française qui date de 2013. Sa nomination a coïncidé avec l’introduction ou la systématisation, au sein des opérations, du recours à des « outils de gestion de la sécurité », tels que la grille d’analyse des risques, ou le système de collecte et d’archivage des incidents de sécurité baptisé Sindy. Que penses-tu de ces mesures ?
Le relevé des incidents se produisant dans nos zones d’intervention (logbooks), les guides, les briefings, la communication publique de crise à la suite d’incidents n’étaient pas des nouveautés. Le référent sécurité nous a apporté un soutien afin de sensibiliser les équipes à l’environnement, a contribué aux briefings, notamment des logisticiens chargés de la mise en place des mesures de sécurité (en matière de communication, des salles « sécurisées », du suivi des mouvements). C’était utile de ce point de vue-là. Puis, revenu au siège à Paris, il a insisté pour qu’on tienne à jour la base de données SindyVoir le chapitre 4, encadré « Quantification et occultation des incidents de sécurité à MSF », p. 127., un système d’archivage centralisé des rapports d’incidents de sécurité touchant uniquement MSF. Sur ce point, nous avions un désaccord : j’estimais que cela n’avait pas d’utilité directe pour le terrain. Nous avions déjà nos propres journaux de bord et relevés d’incidents où étaient consignés les événements importants à prendre en compte dans l’analyse de l’environnement. Pour MSF en tant qu’institution, il est très certainement utile de comptabiliser et d’archiver les rapports des incidents les plus graves. Mais dans la mesure où nous étions déjà très occupés, je n’estimais pas nécessaire de faire le secrétariat du siège. Ce qui est important, c’est de travailler avec les équipes sur la gestion des incidents et de partager l’information avec les autres sections. En outre, le danger d’utiliser Sindy sur le terrain, c’est que les gens ne voient plus le problème qu’au travers de MSF et oublient les incidents affectant les autres acteurs.
Pour revenir à l’analyse des risques, n’y a-t-il pas quelque chose d’anxiogène à faire la liste des menaces, de manière exhaustive, auxquelles on peut être confrontés ?
Je me pose effectivement cette question. Mais d’expérience, je m’aperçois qu’à l’occasion des briefings où j’utilise l’analyse des risques, les personnes auxquelles je parle sont, au fur et à mesure, de plus en plus calmes et concentrées ; leurs yeux s’ouvrent. Elles prennent conscience de leur environnement. Au final, au terme de ces discussions, les gens sont équipés et surtout confiants de savoir que la situation a été pensée. L’idée est que les personnes restent vigilantes. Il faut un équilibre entre banalisation et dramatisation.
Il y a, à MSF et dans d’autres organisations, une certaine contestation de l’accumulation de règles de sécurité sur les terrains. Un de tes collègues chef de mission qui a passé quelques semaines à Bangui notait que « les règles de couvre-feu participent à infantiliser les volontaires et encouragent les détournements »…
Il y a évidemment des détournements : les règles en entraînent mécaniquement. Pourtant, les volontaires ne m’ont pas semblé particulièrement rétifs à respecter ces règles. Et lorsqu’ils les ont détournées, c’était d’une manière qui ne les a pas trop exposés. C’est ce qu’on demande aux gens : quand on viole une règle, savoir pourquoi et comment. Si besoin, on en rediscute. Si besoin, on réadapte.
Quand, par exemple, tu interdis à tes équipes de se rendre au marché artisanal de Bangui, crains-tu des problèmes sérieux ou d’avoir à gérer un vol de sac d’un volontaire imprudent ?
Ce qui s’est passé en l’occurrence, c’est que les petits voleurs habituels se sont équipés de grenades. Ils se lâchaient de plus en plus sur la violence. Par ailleurs, on ne gère pas dix ou quarante expatriés de la même manière : on ne peut pas discuter avec chacun, tout peser, etc. Les règles n’auraient certainement pas été les mêmes si on avait été cinq ou dix à Bangui, mais on était quarante ou cinquante. C’est ce qui explique aussi quelque chose qui a été parfois discuté : avoir instauré des horaires de couvre-feu différents les jours de semaine (21 heures) et les week-ends (22 heures), dès lors que la situation en ville est redevenue suffisamment calme pour envisager des sorties sociales. Je n’ai jamais estimé que la ville était moins dangereuse le week-end. En revanche, je ne pouvais pas me permettre, d’un point de vue personnel, pour une simple question de gestion de la fatigue, d’être appelée tous les soirs de la semaine pour régler le passage à un check point de la police d’une voiture qui rentre du restaurant. On peut regretter que les équipes ne soient pas en mesure de gérer ces petits incidents sans aide extérieure, mais ce ne fut pas toujours le cas. Disons que le week-end, j’étais d’accord pour être disponible une heure plus tard en cas de problème, afin de laisser un peu plus de liberté. Avec ces consignes, je me simplifiais la vie : c’était davantage de la gestion de ressources humaines que de la sécurité.
***
Encart - Les raisons de la colère : Le cas des « patients dangereux » dans le gouvernorat d’Amran au Yémen
Michaël Neuman
Pour la présentation complète de l’étude, voir Michaël Neuman, « “No patients, no problems”. Exposure to risk of medical personnel working in MSF project in Yemen’s governorate of Amran », Journal of Humanitarian Affairs, février 2014, https://sites.tufts.edu/jha/archives/2040.
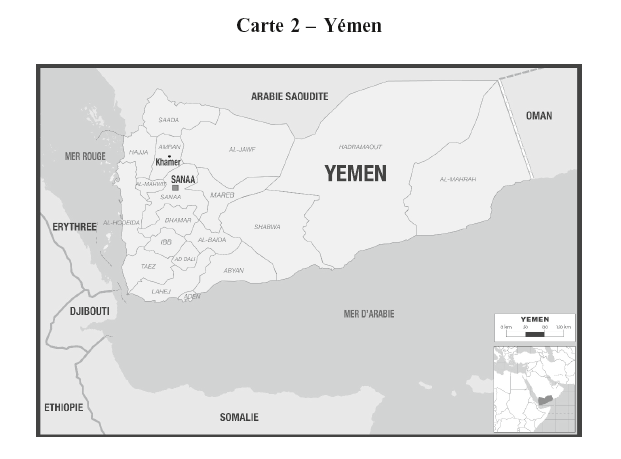
« Je ne voudrais pas être médecin iciCoordinateur de projet, Amran.»
Bien avant que le Yémen ne s’engouffre, en 2015, dans une guerre sans merci entre les rebelles houthis et la coalition sous commandement saoudien, les projets ouverts par MSF en 2010 dans le gouvernorat d’AmranSitué dans le nord du pays, le gouvernorat compte environ 1 million d’habitants.
étaient déjà considérés comme très dangereux par le personnel national et international.
Khamer, où MSF gère l’ensemble des services hospitaliers à l’exception du service ambulatoire, administré par le ministère de la Santé, était une ville d’apparence paisible, où, hormis la nuit à cause des chiens errants, le personnel international se déplaçait librement. Pourtant, entre le 17 avril 2010 et le 15 juin 2013, pas moins de 23 incidents avaient été enregistrés à Khamer et dans la ville voisine de Huth par les coordinateurs de projet successifs de MSF. Aucun décès ni enlèvement d’employés n’étaient à déplorer. Mais les intimidations verbales étaient quotidiennes et les menaces par armes, fusillades dans l’enceinte de l’hôpital et braquages de voitures étaient courants. Si les employés internationaux ne furent généralement pas touchés, le personnel médical yéménite était exposé – et celui de la salle d’urgences davantage que celui du service d’hospitalisation. L’incident le plus grave fut un règlement de comptes entraînant la mort d’un patient à l’hôpital en 2011.
Ces incidents conduisirent plusieurs médecins yéménites à quitter leur poste. Sur la seule année 2012, un chirurgien menacé verbalement par un proche d’une personne qu’il avait opérée, un médecin contraint de soigner un patient sous la menace d’une arme et un autre ayant reçu une gifle quittèrent le projet. En 2013, un médecin yéménite déclarait : « Il y a 20 % de chances que je sois tué à l’hôpital, 80 % de chances que j’en sorte indemne. »
Face à cette situation, la responsable des programmes au Yémen commandita une enquête sur le climat de violence et sur les réactions du personnel de MSF et du ministère de la Santé. Les conclusions de cette enquête, réalisée en juillet 2013 sur la base d’entretiens avec les patients, le personnel et les autorités locales, ainsi que d’archives du projet et de travaux de recherche consacrés au Yémen, sont présentées ci-dessous.
L’orientation des patients pour des raisons de sécurité : « Certains patients sont dangereux, nous le savons
Entretien avec un membre de la direction de l’hôpital, Khamer.»
Lors des entretiens, la plupart des médecins yéménites et internationaux attribuèrent l’insécurité à un manque d’éducation des patients et de leur famille, ainsi qu’à un « système tribal archaïque encouragé par l’absence de réglementation gouvernementale, permettant à n’importe quel membre d’une tribu de faire exactement ce qui lui plaîtEntretien avec un directeur d’hôpital, Sanaa.». Les habitants des villages entourant Khamer – premiers bénéficiaires du projet – étaient considérés comme les principaux fauteurs de troubles. Les médecins reconnaissaient que cette vision des choses influençait leur pratique, comme l’expliquait l’un d’entre eux :
Quand les patients viennent de communautés avec lesquelles nous avons eu des problèmes, la tension s’accroît et alors, les décisions thérapeutiques n’ont plus aucune rationalité médicale ni scientifique. Il est assez courant d’entendre des commentaires du type : « celui-là
est de telle famille », « c’est le fils d’Untel », « il vient de telle région », etc. Cela a un impact significatifEntretien avec un médecin expatrié, Khamer..
En réalité, il n’était pas rare que des patients ayant un profil prétendument « dangereux » soient orientés vers d’autres établissements à Amran ou à Sanaa, quand bien même leur état de santé ne le justifiait pas. La grande majorité du personnel yéménite et international s’accordait pour dire que « si le patient présent[ait] un risque en termes de sécurité, mieux va[lait] l’orienter ailleursEntretien avec un médecin yéménite, MSF, Khamer.
». Dans certains cas, la décision était laissée à la discrétion du superviseur de nuit, membre du personnel non médical qui « connai[ssait] tout et tout le mondeEntretien avec un médecin yéménite, MSF, Khamer.
».
Les relations avec les cheikhs : « Les promesses ne sont pas suivies d’effet
Entretien avec un médecin yéménite, ancien employé de MSF, Sanaa.»
En cas d’incident grave, la réaction de MSF consistait souvent à solliciter la médiation des autorités tribales localesLes concepts de « tribu », de « sous-tribu » et de « famille » dans le contexte yéménite font l’objet d’un débat parmi les chercheurs. Comme l’explique Paul Dresch dans « Tribalisme et démocratie au Yémen » (Chroniques yéménites, 2, 1994), « à l’évidence, les tribus ne constituent pas des groupements très solides ». Bien qu’elles jouent un rôle central dans la compréhension des dynamiques sociales et politiques, c’est un concept malléable : « Il existe de ce fait une souplesse potentielle très importante en matière de conflits et d’alliances. », et parfois à suspendre ses activités pour faire pression sur elles et sur les populations qui en dépendaient. Dans la plupart des cas, après une période de suspension allant de un jour à six mois, la médiation portait ses fruits, une compensation était versée – argent, bétail ou armes – et une « cérémonie d’excuses » (apology ceremony) avait lieu. Certains employés critiquèrent l’inefficacité de cette approche réactive de l’insécurité. Compte tenu du peu de protection que les médecins pouvaient attendre des institutions locales, le personnel réclamait que MSF jouât un rôle plus ferme dans le maintien de la sécurité. Comme le remarquait un médecin yéménite auparavant employé par MSF :
« Notre action ces derniers temps se résume ainsi : incident, cérémonie d’excuses, incident, cérémonie d’excuses, incident, etc. Nous devons aborder le problème différemment.»
L’équipe internationale semblait croire à la toute-puissance des cheikhs, à condition de trouver le bon. « Il fait ce qu’il veut des siens », affirmait un membre du personnel international. Cependant, certains chercheurs remettent en cause cette affirmation, faisant ainsi écho à la vision de nombreux employés yéménites. Le politologue Laurent Bonnefoy explique ainsi qu’« il est illusoire d’attendre d’un cheikh qu’il empêche la violence de se produire : le contrôle de la violence dans le nord du Yémen repose sur l’“atténuation” et la “régulation” plutôt que sur la “prévention”, afin que les conflits ne prennent pas une ampleur disproportionnée et restent dans des limites acceptablesEntretien, juin 2013. Voir également Nadwa al-Dawsari, « Tribal governance and stability in Yemen », Carnegie Endowment for International Peace, 2012.
».
« Les médecins sont des “parasites” qui se nourrissent de sang humain
« Yemeni doctors can cause more harm than good », National Yemen, 18 juillet 2012.»
Il apparut que, dans sa réaction à la violence, MSF négligeait la source de tension que constituait la piètre qualité des relations entre le corps médical et les patients. Dans l’ensemble, les médecins semblaient pâtir au Yémen d’une image très dégradée, comme l’illustre un article publié dans National Yémen en juillet 2012 et intitulé « Les médecins yéménites peuvent faire plus de mal que de bien » :
« Des milliers de Yéménites sont victimes d’erreurs médicales commises par des médecins, dont les titres et les diplômes usurpés et immérités sont les seules choses qui les relient à la pratique de la médecine. […] De nombreux Yéménites expriment leur insatisfaction à l’égard des médecins de leur pays, dont ils estiment qu’ils font mal leur travail et ne voient dans leur vénérable profession qu’une façon de faire de l’argent. Beaucoup vont jusqu’à comparer les médecins à des « parasites » qui se nourrissent de sang humainIbid. [traduction de l’auteur.]. »
Dans ce contexte, certains aspects du dispositif opérationnel semblent avoir contribué à exacerber la méfiance. Le manque de clarté dans les critères d’admission aux urgences fut souvent mentionné comme facteur de tension, tant par le personnel soignant que par les patients. Le service des urgences acceptait environ la moitié des patients reçus à l’accueil – entre 1 500 et 2 500 personnes par mois –, tandis que l’autre moitié était orientée vers le service ambulatoire géré par le ministère de la Santé, payant et assuré par trois médecins de l’ex-Union soviétique.De nombreux patients refusaient d’être envoyés dans ce service et faisaient pression sur le personnel médical pour être soignés par MSF. Comme l’expliqua une des personnes interrogées : « Plus les patients donnent de la voix, plus ils ont de chances d’être reçus par le médecin de MSF. » Beaucoup considéraient cette discrimination injustifiée sur le plan médical comme la source de la plupart des problèmes rencontrés par le personnel de l’hôpital. En outre, comme le confia un médecin yéménite de MSF : « Nos employés, nos gardiens, nos infirmières et nos aides-soignantes font venir leurs amis et leur famille pour les soigner. Parfois nous refusons, nous les médecins, parfois non. »
Certains patients ne comprenaient pas pourquoi MSF assurait principalement des soins d’urgence, à l’exclusion par exemple des soins pour maladies chroniques ou des actes chirurgicaux non urgentsLes services de maternité, de pédiatrie et de médecine pour adultes admettent des patients non urgents ; les malades atteints de leishmaniose et de rachitisme reçoivent également un traitement non urgent.
et pourquoi ils devaient être orientés vers d’autres établissements où les soins étaient payants. Le fait que les médecins discriminent communément les patients en fonction de leur lieu d’origine, de leur famille et de leur affiliation tribale ajoutait encore à la tension. À quoi bon avoir un hôpital si l’on ne pouvait y être admis ?
La configuration de l’établissement posait également problème, car elle contribuait à des tensions à l’intérieur et aux alentours de la maternité :
« Le problème réside en partie dans le fait qu’il n’y a pas de salle d’attente à la maternité, le bâtiment est trop petit. Par conséquent, les familles attendent généralement à l’extérieur pendant les accouchements. Cela peut durer des heures, pendant lesquelles les familles, si la sage-femme ne prend pas le temps de sortir pour leur parler, restent dans l’ignoranceEntretien avec une sage-femme expatriée, Amran.. »
Une brève analyse des incidents auxquels le personnel de MSF fut confronté révèle leur extrême diversité, tant en termes d’origine que de manifestation. En fin de compte, les problèmes rencontrés par MSF à Amran entre 2010 et 2013 découlent pour la plupart d’une exigence très comparable à celle que l’organisation et les professionnels de santé rencontrent dans les hôpitaux du monde entier : celle d’une relation de qualité entre les patients et le personnel soignant. À l’hôpital de Khamer, MSF opérait dans un cadre où cette attente se heurtait à la réalité du terrain. La région environnante connaît un haut degré de violence qui semble globalement accepté, et l’intimidation fait partie intégrante de la régulation sociale. Cette étude montre que les organisations humanitaires ne doivent pas se considérer comme des victimes passives, ni percevoir les patients yéménites comme intrinsèquement dangereux.
Traduit de l’anglais par Anne Le Bot
***
Qabassin, Syrie: Une mission MSF en terre de djihad
Judith Soussan
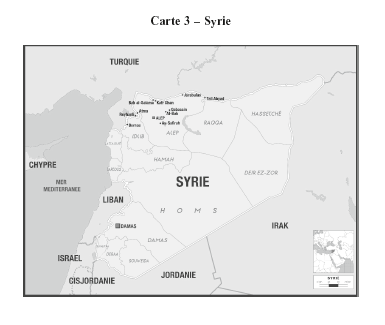
Le 11 mai 2013, dans un courriel adressé à son équipe de coordination en Turquie, le coordinateur de projet de Qabassin annonçait l’ouverture de l’hôpital MSF le matin même :
« Jusqu’ici tout va bien », résumait-il sobrement. Excès de modestie sans doute, car il y avait de quoi être fier : il s’agissait du premier hôpital monté par une ONG avec la présence d’expatriés qui soit situé au coeur de la zone tenue par l’opposition syrienne, et non collé à la frontière avec la Turquie à l’instar des autres projets alors gérés par MSF : l’hôpital d’Atma (MSF-France), à quelques kilomètres à vol d’oiseau de Reyhanli en Turquie, où était l’équipe de coordination, ou ceux de Bab al-Salama (MSF-Espagne), Bernas (MSF-Belgique) et Tall Abyad (MSF-Hollande). Il avait fallu six semaines d’intense réhabilitation pour faire d’un local vide ce lieu propre, bien équipé, avec un bloc opératoire, une maternité, une salle d’urgences, et vingt-cinq lits d’hospitalisation.
Le petit événement qu’était l’ouverture de l’hôpital de Qabassin n’eut pourtant pas l’attention méritée. Ce même jour en effet, une bombe explosait à Reyhanli, faisant cinquante et un morts et plus de cent cinquante blessés, tandis que la veille, à Atma, un expatrié suédois était violemment pris à partie, accusé d’espionnage et menacé de mort par des hommes en armes. Il devait comparaître devant le tribunal islamique local. Par contraste, Qabassin apparaissait comme une sorte de havre : les membres de l’équipe sur place, tous nouvellement arrivés, faisaient pendant leurs heures de repos l’expérience d’un quotidien paisible, se promenant à pied dans le bourg, allant au marché, ou étant invités à boire le thé, et comprenaient mal les appels à la vigilance de la coordination. « Ils étaient trop à l’aise, ils avaient oublié où ils étaient », se souvient le chef de mission de l’époque. Car la guerre était bien là tout autour.
Ce chapitre raconte l’histoire de cette mission sous l’angle de la sécurité. Il s’intéresse aux regards et aux pratiques des membres de l’équipe de terrain (à commencer par les coordinateurs de projet, qui se succédèrent à un rythme soutenu), et de la coordination en Turquie avec laquelle ceux-ci furent en permanence en lienAfin de réduire la confusion que peuvent induire les remplacements successifs, nous préciserons en note la période pendant laquelle le coordinateur de projet ou chef de mission cités étaient présents.. Comment ces personnes ont-elles analysé leur situation, les risques existants, les événements au fur et à mesure de leur survenue ? Quelles attitudes ont-elles adoptées face aux dangers, depuis les règles et les procédures (instaurées, modifiées ou oubliées) jusqu’aux stratégies diverses en vue de « réduire l’exposition » ou d’« améliorer l’“acceptanceConformément à l’usage le plus courant au sein des équipes, nous utiliserons le terme anglais. Seule une minorité préfère parler d’« acceptation ».” », selon les expressions couramment utilisées ? Une attention particulière est portée aux moments de désaccords, dans lesquels s’affrontent et s’explicitent souvent les significations complexes mises par chacun derrière le mot « sécuritéPour l’examen de ces questions, nous avons consulté l’ensemble de la littérature produite par la mission de Qabassin : rapports de terrain (« sitrep »), documents relatifs à la sécurité (« Security Guideline ») et surtout courriels quotidiens entre le terrain et la coordination. Par ailleurs, des entretiens ont été menés entre janvier et juin 2015 avec plus d’une vingtaine d’acteurs du terrain, de la coordination et du siège parisien. Qu’ils soient remerciés pour leur disponibilité et leur confiance. On n’entendra pas ici la voix du personnel syrien de l’équipe, bien qu’il eût été passionnant d’avoir accès à leur regard sur les situations, les décisions prises, les attitudes des uns et des autres. Cela n’a pas été possible pour des questions de faisabilité.
».
Trouver sa place dans la guerre (mi-2011-début 2013)
Exploration (Comment se protéger des bombes ?)
Être présent dans la guerre civile syrienne au plus près des victimes sans faire courir des risques inconsidérés aux équipes ni trop transiger sur la qualité des soins : dès les premières tentatives d’intervention en Syrie à la mi-2011, c’est sous la forme de ce dilemme typique que MSF-France se posa la question de son positionnement opérationnel.
Il fallut ainsi bien des tâtonnements, de la patience, plusieurs missions exploratoires restées sans suite à cause de risques jugés excessifs, et enfin quelques rencontres déterminantes pour qu’en juin 2012 le premier projet de MSF-France puisse ouvrir, dans le village d’Atma. MSF y était « embedded », comme on dit : l’hôpital, la maison où logeaient les expatriés, leur sécurité, tout était assuré par un notable d’Atma très influent, médecin, et membre de l’une des brigades composant localement l’Armée syrienne libre (ASL). De la patiente stratégie mise en oeuvre pendant les mois de prospection et d’approche dans un contexte de forte suspicion d’espionnage envers les étrangers demeurerait un mot d’ordre : faire « profil bas ».
Le projet d’Atma ouvert, les artisans de la mission Syrie cherchaient à se rapprocher des zones les plus touchées par la guerre. Le responsable des urgences avait notamment les yeux rivés sur Alep, coupée en deux, avec une zone gouvernementale et une zone tenue par l’ASL, et constamment bombardée. Mais après une mission exploratoire, en août 2012, on renonça à l’idée d’y établir une présence expatriée, jugée trop risquée en raison notamment du ciblage des hôpitaux de campagne par l’armée loyalisteFinalement, c’est MSF-Espagne qui ouvrira en juillet 2013 un projet en banlieue d’Alep, dans la « cité industrielle ».. L’automne 2012 vit avorter deux autres tentatives d’intervention. À Kafr Ghan, près de la frontière turque, un projet hospitalier monté en partenariat avec des médecins syriens dut fermer au bout de trois semaines en raison de désaccords profonds entre les médecins syriens et MSF sur la gestion de l’hôpital. Puis à Al-Bab, ville de cent trente mille habitants à une trentaine de kilomètres d’Alep, sur la route d’évacuation de ses blessés : alors que le projet était très avancé, une série de bombardements frappa la ville à répétition en janvier 2013 et la coordination fit évacuer l’équipe en Turquie. « Je leur ai dit : “Nous sommes comme les Syriens, nous ne sommes pas protégés. Il nous faut donc trouver un endroit plus sûr” », se rappelle le chef de mission5. Entretien avec le chef de mission présent de janvier à juin 2013, 17 juin 2015..
La base de données qu’il avait créée montrait que, parmi les localités situées dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour d’Al-Bab, la petite ville de Qabassin n’avait jamais été bombardée. L’équipe avait par ailleurs entendu que la ville de vingt mille habitants, caractérisée par sa population mixte (Kurdes et Arabes), comptait une proportion non négligeable de personnes favorables au régime. Contrairement à Atma où paradaient des islamistes étrangers en noir dans leurs pick-up, aucun groupe militaire n’y avait de présence visible. Pour toutes ces raisons, disait-on, Qabassin était épargnée par les troubles et les bombardements du régime. Le 27 janvier, soit dès le lendemain de leur évacuation, deux membres de la petite équipe s’y rendaient.
Ouverture (Comment se faire accepter ?)
Les membres de l’équipe entreprirent de prolonger le travail d’identification et de rencontre des interlocuteurs clés effectué pendant les deux mois qu’ils avaient passés à Al-Bab. Outre les représentants des grandes familles, ils avaient rencontré ceux des jeunes institutions de la révolution : le conseil local, sorte d’administration civile chargée notamment de la santé, et la cour islamique, qui s’occupait des questions de justice et de police. Le coordinateur de projet avait également vu les représentants de groupes politico-militaires locaux : brigades affiliées à l’Armée syrienne libre, groupes islamistes tels Ahrar al-Sham (« Libres du Sham ») ou le Front al-Nosra, tous deux affiliés à Al-Qaïda. Tout en maintenant ces contacts à Al-Bab, ils se familiarisèrent avec le petit monde de Qabassin. Ils connurent les notables locaux, membres pour certains du conseil local (la ville ne possédait pas alors de cour islamique), les représentants du parti kurde affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK« Sitrep Bravo [Qabassin] », semaines 7‑8, 15‑28 février 2013.). « Du thé, c’est vrai que j’en ai bu beaucoup à cette période… », sourit le coordinateur de projet.
Les concepteurs du projet de Qabassin souhaitèrent se démarquer du projet d’Atma – ne pas être à la merci d’un protecteur – comme de celui mort-né de Kafr Ghan – ne pas partager la gestion avec d’autres. L’hôpital serait donc « 100 % MSF ». Pour les activités, en revanche, le projet ressemblerait aux précédents : la chirurgie en serait le coeur afin de prendre en charge les blessés qui arriveraient d’Alep via Al-Bab. On décida d’y adjoindre une offre de soins médicaux et chirurgicaux destinés à la population générale avec, selon les documents rédigés à l’époque, un objectif essentiellement tactique : ne pas apparaître comme un hôpital pour combattants et minimiser ainsi le risque d’être ciblé par les bombardements du régime ; obtenir une meilleure « acceptance de la part de la communauté« Sitrep Bravo », semaines 3‑4, janvier 2013.
» en apaisant ses éventuelles inquiétudes quant aux risques associés à l’installation d’un hôpital dans la ville, et en lui proposant des services (tels les soins materno-infantiles ou les consultations externes) répondant à ses probables attentes. L’autre volet important du projet serait l’identification de petites structures médicales situées plus près des combats (y compris à Alep, auquel on ne renonçait pas) et que MSF pourrait soutenir au gré de l’évolution de la situation. Ces activités dites « périphériques » permettraient également de drainer des malades et blessés vers l’hôpital de Qabassin et de suivre l’évolution des besoins associés aux dynamiques politico-militaires locales.
Tandis que progressaient les préparatifs, l’équipe mit par écrit une analyse des risques et des règles de sécurité précises. Selon le « Security Guideline » validé en mars 2013, les principaux risques affectant Qabassin étaient liés au trafic routier et à l’« impact psychologique », c’est-à-dire au stress« Security guideline », annexe 3, « Risk analysis Bravo », 26 mars 2013.. À côté de ces dangers à probabilité « forte », les bombardements et tirs croisés étaient associés à une probabilité « moyenne » et le risque lié aux armes chimiques à une probabilité « faible à moyenne ». Quant au risque d’enlèvement, il se voyait attribuer – en dépit du kidnapping le 13 mars de deux membres de l’ONG Acted à Atma – une probabilité « faible », « car nous sommes bien connus dans la communauté et bien acceptés« Security guideline », annexe 2, « Rules Bravo », 26 mars 2013.
».
Les règles de sécurité comportaient des procédures classiques, par exemple pour les mouvements : en voiture, porter la ceinture de sécurité, avoir sur soi ses documents, laisser le chauffeur syrien gérer la relation avec les personnes tenant un check point ; à pied, avoir noté préalablement sa destination sur un tableau, ne pas se déplacer seul ni de nuit. S’y ajoutaient des prescriptions de comportement particulièrement précises et strictes :
« 1. Avoir un comportement correct avec le personnel/les gens est la toute première étape en termes de sécurité. Ne pas crier, ne pas s’adresser agressivement aux gens. […] Pas de flirt/relation sexuelle entre expat/national. 2. Rire à voix haute peut donner l’impression que vous êtes sous l’emprise de l’alcool. […] 4. AUCUN CONTACT PHYSIQUE entre hommes et femmes (pas de poignée de main, etc.). […] AUCUNE photo, car cela peut nous faire passer pour des espions/journalistes« Memo secu Bravo », résumé de règles joint au « Security guideline », 26 mars 2013.. Les femmes ne doivent pas fumer en public. […] L’alcool, les drogues, la marijuana ne doivent être ni consommés ni même mentionnés avec les Syriens. Ne pas parler de sujets politiques ou religieux. Tenue correcte à l’extérieur de l’hôpital à tout moment (hommes = pas de short, femmes = couvrir la tête, les bras, les formes, les jambesAnnexe 2 du « Security guideline ».). »
Il s’agissait en somme d’une déclinaison concrète de la nécessité de faire profil bas sur laquelle tous s’accordaient et dont découlerait une meilleure « acceptance », ainsi que l’indiquait la formule qui venait conclure ces prescriptions : « meilleure acceptance de la communauté = sécurité accrue ». On notera au passage que cette notion, introduite à MSF par le truchement des manuels de sécuritéVoir le chapitre 5, p. 135., était utilisée couramment par les membres de la mission pour désigner des pratiques et attitudes extrêmement variées : ne pas fumer en public, mettre en place des soins de santé maternelle ou rencontrer les autorités locales.
Début mars, alors que devaient commencer les travaux d’aménagement de l’hôpital, un incident fit craindre qu’à nouveau il faille renoncer : une délégation d’habitants de Qabassin fit connaître au coordinateur de projet son opposition à l’ouverture d’un hôpital de crainte que la ville, jusqu’ici épargnée, ne devienne la cible des bombardements du régime. Avec en tête l’échec du projet de Kafr Ghan, ouvert précipitamment, le coordinateur de projet veilla à prendre le temps de comprendre et de s’assurer de ses soutiens : entre le 9 et le 16 mars, il multiplia les réunions. Il en ressortit que la plainte était autant motivée par la peur que par des frustrations nées de la « distribution » inégale des bénéfices que les grandes familles allaient tirer du projet de MSF. Avec une semaine de retard, les travaux purent commencer, ainsi que le recrutement. Confortée par l’incident dans son idée d’organiser un processus de sélection aussi objectif et transparent que possible, l’équipe conduisit trois cents entretiens, du chirurgien jusqu’aux personnes chargées du ménage. Dans le même temps, elle veilla à respecter un équilibre entre les différentes familles et appartenances pour les postes ne nécessitant pas de compétences spécifiques.
Une paisible petite ville ?
Réseau I (Comment et pourquoi construire un réseau de contacts)
Après l’ouverture de l’hôpital le 11 mai 2013, l’équipe médicale s’absorba dans le développement des activités. Si Qabassin demeurait calme, les bombardements ainsi que le largage de tonneaux bourrés de TNT par des hélicoptères du régime étaient en revanche quotidiens dans le gouvernorat d’Alep. Des rumeurs d’utilisation d’armes chimiques ailleurs dans le pays revenaient périodiquement. Ce fut d’ailleurs cette question spécifique qui motiva la visite en Syrie du tout nouveau (et tout premier) référent sécurité de MSF en mai 2013.
Dans ce contexte, un différend grandissait de jour en jour entre le chef de mission et le nouveau coordinateur de projet arrivé mi-avril. Le premier se plaignait d’un « manque de visibilité » sur le contexte, qu’il attribuait à une communication insuffisante de la part du coordinateur de projetEntretien avec le chef de mission (janvier-juin 2013), 17 juin 2015, et le chef de mission adjoint (présent en juin 2013), 6 février 2015.. Aussi lui demandait-il de prouver, notamment par l’usage d’outils et de procédures, qu’il prêtait une attention suffisante à la sécurité. Un « contact sécu » matin et soir fut instauré, et les accrocs dans sa mise en oeuvre donnèrent lieu à des tensionsÉchange de courriels entre le coordinateur logistique basé en Turquie et le coordinateur de projet des 4 juin, 6 juin, 9 juin, etc. Un tel contact n’avait pas été établi auparavant, à l’ouverture du projet : « À quoi bon ? de toute façon on se parlait tout le temps », rapporte le premier coordinateur de projet de Qabassin (décembre 2012-avril 2013).. Le chef de mission reprocha au coordinateur de projet de ne pas utiliser les outils de suivi (la base de données des incidents qu’il avait créée ; le tableau de suivi des mouvements qui permettait de savoir où était chaque membre de l’équipe). Surtout, il lui demanda d’affiner sa description du contexte et d’améliorer son travail de « réseau » : connaître les gens qui tenaient les check points et avoir leurs numéros de téléphone, maintenir le lien avec les différents acteurs, rencontrer les nouveaux venus – car outre le Front al-Nosra, déjà présent aux abords de Qabassin, d’autres groupes salafistes commençaient en juin 2013 à installer leurs bureaux. « Il faut que tu communiques, que tu construises ton réseau », lui dit le chef de mission. Dans le contexte syrien d’« espionnite » aiguë et en l’absence de sujet spécifique à discuter, le coordinateur de projet pour sa part était convaincu qu’il était préférable de s’abstenir :
« Il y a quelque chose qui m’est apparu nécessaire : arrêter de poser trop de questions aux gens. […] C’est ma conviction. Je trouve parfois déplacée la manière [qu’on a de] débarquer chez les gens et leur poser des questions… […]
Et puis, il y a des choses que je sais [du fait d’être musulman] concernant les gens un peu conservateurs, radicalistes (sic) : tu es un hôte, moins tu leur poses de questions, plus tu as de chances d’être acceptéEntretien avec le coordinateur de projet présent d’avril à juillet 2013, 17 juin 2015.. »
De même aux check points : « Notre laissez-passer fonctionnait partout : si on nous laissait passer, pourquoi poser des questions ? » Il lui semblait plus approprié d’observer, de « solidifier [son] entourage direct », composé de trois ou quatre contacts réguliers auprès desquels il avait eu confirmation que « si [l’équipe] restait dans les clous, personne ne [la] toucherait ». Loin de se résoudre avec le départ du chef de mission fin juin, le différend s’aggrava au contraire avec son remplaçant, particulièrement porté sur la documentation du contexte politique et militaire.
Inquiétudes (Comment interpréter les informations ?)
Tandis que des rumeurs concernant une grande « bataille d’Alep » circulaient depuis fin mai, ce furent en réalité les tensions et incidents au sein même des forces d’opposition qui marquèrent les mois de juin et juillet : altercations entre forces kurdes de Qabassin et forces de police diligentées par la cour islamique d’Al-Bab, suivies d’une prise de contrôle provisoire de la ville par le parti kurde lié au PKK ; explosion d’une bombe dans la base du Front al-Nosra à l’entrée de Qabassin. On notait également des échauffourées à des check points entre brigades de l’ASL et combattants d’un groupe apparu récemment dans le paysage, dont on savait qu’il émanait d’Al-Qaïda en Irak et n’était pas en très bons termes avec le Front al-Nosra : l’État islamique en Irak et au Levant (EIILC’est en juin 2014 que l’EIIL prendrait son nom actuel d’« État islamique » (EI).).
Fin juillet, le coordinateur de projet rapportait ces troubles et notait que si Qabassin était à présent « vraiment calme », en revanche, plus au nord, à Jarabulus, des groupes islamistes dont l’EIIL et le Front al-Nosra annonçaient leur intention de « mettre en place un État islamique » et avaient « déclaré que les ONG étrangères [étaient] infidèles et, de ce fait, pas les bienvenues en Syrie ». Il précisait : « À Qabassin, nous avons tous ces groupes« Sitrep Bravo », semaines 26‑27, 25 juillet 2013.. »
Le 30 juillet, il terminait sa mission. Une semaine plus tard, un nouveau coordinateur de projet – le troisième, montage du projet inclus – arrivait. Il jugea d’emblée très préoccupante la situation qu’il découvrit, contrastant fortement avec l’impression tirée de son briefing à Paris. Outre les tensions croissantes entre les différents groupes d’opposition, deux sérieux incidents s’étaient produits en quelques jours. Aux abords de Qabassin, la voiture qui ramenait l’administrateur depuis la frontière turque à son retour de vacances s’était fait braquer par des hommes en armes. Après avoir semble-t‑il hésité à enlever l’administrateur, ils étaient finalement partis avec les paies de fin de mois qu’il rapportait avec lui. Et à Alep, une voiture de MSF-Espagne avait été interceptée par un groupe armé : ses occupants (un logisticien syrien de MSF et deux personnes extérieures, présentées comme un prestataire de services turc et sa compagne américaine) étaient toujours détenus.
Mi-août, dans les courriels désormais très fournis qu’adressait le terrain à la coordination, un sujet d’inquiétude chassait l’autre : impréparation de l’équipe à une éventuelle attaque chimique, nouvelles déclarations anti-ONG étrangères à Jarabulus de la part de l’EIIL, rumeurs concernant un groupe pratiquant des kidnappings ciblant les Britanniques… Le coordinateur de projet fit part à la coordination de son souhait de réduire immédiatement la taille de l’équipe expatriée. Le chef de mission était d’accord, sans toutefois partager son empressement. Les 15 et 16 août, des affrontements eurent lieu en différents endroits du Nord syrien entre forces kurdes et ASL/islamistes. Le 17 août, c’est à Qabassin que des combats se produisaient. Le soir, le coordinateur de projet écrivait au chef de mission : « Tout le monde est en sécurité à la maison. […] L’EIIL contrôle désormais la villeCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 17 août 2013.. »
Une mission de MSF dans « les griffes de l’État islamique en Irak et au Levant »
Le premier contact avec l’EIIL eut lieu à l’hôpital de MSF où se présentèrent quelques combattants à l’issue des combats de ce 17 août. Deux étaient blessés, un troisième venait pour une douleur à l’estomac : « Quand nous lui avons demandé de retirer sa veste, il nous a dit qu’elle était explosive et qu’il ne pouvait l’enleverRapport de fin de mission du coordinateur de projet présent en août et septembre 2013.. »
Les combats avaient duré une journée. Dès le 18 août, le calme était revenu. À la maison MSF, le coordinateur de projet et la médecin en charge de la supervision des activités médicalesQue nous désignerons dans la suite du texte par l’expression « médecin référente », en usage à MSF.
entreprirent d’avoir un entretien avec chaque expatrié. Étaient-ils volontaires pour rester dans un contexte où « désormais Al-Qaïda, en l’occurrence un de ses affiliés, l’EIIL, accédait aux pleins pouvoirs à QabassinRapport de fin de mission du coordinateur de projet présent en août et septembre 2013. » ? Neuf des quatorze membres de l’équipe décidèrent de quitter la missionTard dans la nuit après avoir entendu chacun, ils s’appliquèrent l’exercice à eux-mêmes puis s’interviewèrent mutuellement, afin de ne pas préjuger de leurs décisions respectives (discussions avec le coordinateur de projet, mars 2015).
; le 19 août ils étaient en Turquie. L’arrivée de l’EIIL avait ainsi permis au coordinateur de projet de réaliser de façon drastique son souhait de réduire l’équipe.
À Qabassin demeuraient cinq expatriés, qui n’excluaient pas de suivre sous peu le même chemin que les autres : « Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’ils commencent à exécuter nos patients contre le mur derrière l’hôpital ? », questionnait l’infirmièreEntretien avec le coordinateur de projet (août-septembre 2013), 23 juin 2015.. Avec la coordination s’échangeaient des pronostics divergents : selon un membre du personnel syrien, « ils veulent mettre en place l’État islamique à [Qabassin] », rapportait le coordinateur de projet. « Cela n’exclut pas obligatoirement la présence de MSF, répondait le chef de mission, ça dépend du niveau de tolérance du groupe en général puis du commandant sur place. » À quoi le coordinateur de projet rétorquait : « Peux-tu me donner un exemple où ils ont l’exclusivité du pouvoir, proclamé l’État, et où des gens comme nous sont longtemps tolérésÉchange de courriels entre le coordinateur de projet et le chef de mission, 19 août 2013.
? » Se référant à ses vingt-cinq ans d’expérience à MSF (dont huit à sa présidence), le coordinateur de projet n’était pas porté à l’optimisme. Les recherches qu’il effectua confirmèrent ce sentiment : « J’ai regardé leurs comportements de ces dernières années dans la presse en ligne. C’est juste la plus meurtrière des branches d’Al-Qaïda du point de vue des civils », écrivait-il quelques jours plus tardCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 25 août 2013. En plus de la consultation d’Internet, le coordinateur de projet demanda à la médecin référente de l’initier à l’utilisation de Twitter afin de pouvoir suivre les déclarations et rumeurs qui y circulaient..
Le 19 août néanmoins, le nouveau représentant de l’EIIL à Qabassin rendait visite au coordinateur de projet, l’assurait que MSF pouvait rester et travailler en toute sécurité, et consentait à confirmer cet engagement par écrit :
« Au nom d’Allah le Bienfaisant, le Miséricordieux,
Louanges à Allah, paix et bénédictions sur son prophète Mahomet.
À partir de maintenant, l’hôpital de MSF continue à traiter tous les cas, sans partialité envers aucune partie. MSF consulte l’État islamique à Qabassin en cas de problème dans l’hôpital. L’État islamique prend la responsabilité de protéger l’hôpital si un danger devait survenir. Tous les médecins, hommes et femmes, continuent à travailler dans l’hôpitalLettre de l’EIIL, courriel du coordinateur de projet au chef de mission, 20 août 2013.. »
Réseau II (Que signifie « boire le thé » ?)
MSF avait également reçu des soutiens écrits spontanés de la part d’interlocuteurs importants tels le conseil local ou la cour islamique d’Al-Bab, dont les divers membres voyaient d’un oeil méfiant la prise de pouvoir de l’EIIL à Qabassin. Le coordinateur de projet avait dès son arrivée multiplié les rencontres, jusqu’à établir des relations d’ordre amical avec certains contacts – un juge militaire de la cour d’Al-Bab, lié au groupe islamiste Ahrar al-Sham, un notable de Qabassin membre de l’ASL… –, qui parfois se présentaient spontanément à la maison pour discuter. « Je n’ai pas vraiment créé de nouveaux contacts, mais je les ai peut-être traités différemment », explique le coordinateur de projetEntretien avec le coordinateur de projet présent en août-septembre, 23 juin 2015.. Ainsi, lorsque le conseil local ou la cour islamique le sollicitaient par exemple pour un soutien matériel à des déplacés, il répondait : « D’accord, on va aller voir cela », et « [ils] passai[en]t comme ça des bouts de journée ensemble. » Aux yeux du coordinateur de projet, il ne s’agissait pas là de sécurité, mais du projet. Toutefois, ces moments permettaient une meilleure compréhension de la situation – des besoins, des dynamiques politiques –, qui constituait bien selon lui « l’étape numéro un de [l]a sécurité ». Soirées ou vendredis après-midi furent également partagés avec ces contacts. Dans ces contextes plus informels, « on ne jouait pas aux neutres ». On échangeait, on les écoutait « raconter les débuts de la révolution… »
« Dans les normes de politesse en Syrie, quand c’est toi qui te déplaces, tu marques un point. […] Si tu réponds à une invitation, tu honores ton hôte. Ça crée un lien, où tu peux solliciter toi-même, être sollicité, c’est du donnant-donnant : est-ce que tu veux t’inscrire dans une économie d’échange ? Dans ce cas-là il faut bien créer des liens, en connaissant les codes de politesse […] Et effectivement les gens te demandent des services, mais toi-même tu n’arrêtes pas d’en demander ! Cela fonctionnait dans les deux sens, et c’est absolument indispensable que ça fonctionneIbid.. »
Saisissant contraste avec la position de son prédécesseur :
« Je ne vais pas manger chez les gens. Tu sais, il faut faire attention quand tu acceptes une invitation. Parfois c’est du donnant-donnant, et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Donc je les remercie d’être [invité], et voilà, on se respecte. Il faut garder ses distances – je peux boire le thé avec eux au bureau, discuter à l’hôpital, dans la rue, sans être obligé d’entrer chez eux. Et comme on ne savait pas comment la situation allait évoluer… en arabe on dit : « N’oublie pas que tu as mangé le sel chez moi. » […] C’était lié au fait d’être coordinateur de projet. Je voulais qu’il y ait cet espace qui me permette de dire le jour où il y a un truc : « Je ne te dois rien et tu ne me dois rienEntretien avec le coordinateur de projet présent d’avril à juillet 2013, 17 juin 2015.. ».
Ainsi, derrière l’expression consensuelle de « boire le thé » se déployaient des pratiques à l’opposé les unes des autres.
Désaccords sur l’analyse
Malgré les assurances obtenues de ses contacts et de l’EIIL, le coordinateur de projet restait préoccupé par l’avenir du projet. Que coordination en Turquie et siège parisien aient l’air plutôt rassurés indiquait à ses yeux qu’ils ne prenaient pas la mesure du danger. Ce fut notamment le cas à propos de plusieurs questions de ressources humaines. Le remplacement de l’administrateur, seul arabophone et musulman parmi les expatriés et pilier en termes de contacts et de recueil d’informations du fait de ses liens au sein du petit monde de Qabassin, fut au coeur d’âpres discussions. À la coordination qui souhaitait qu’il termine sa mission comme prévu fin août, le coordinateur de projet opposait que l’administrateur était disposé à rester davantage et que son départ mettrait sérieusement en danger la mission. Les questions du nombre et du profil des expatriés suscitèrent d’autres désaccords. Alors que l’équipe était remontée à neuf personnes afin de reprendre les activités chirurgicales, Paris souhaitait envoyer d’autres expatriés, ainsi que des visiteurs du siège. Enfin, un médecin américain arrivé fin août déclara au détour d’une conversation être juif. On lui demanda une discrétion absolue sur ses origines – déjà début août, avant même l’arrivée de l’EIIL, le coordinateur de projet avait dû renvoyer un médecin sri lankais ayant créé l’émoi parmi le personnel et les patients de la salle d’urgence en révélant qu’il était bouddhiste« Être bouddhiste, pour certains des groupes qu’il y a dans le paysage, c’est vraiment comme être yézidi… […] ça peut dégénérer. » Entretien avec le coordinateur de projet, 23 juin 2015..
Au milieu de ces préoccupations, on apprenait le 21 août le bombardement à l’arme chimique de la Ghouta (banlieue de Damas) par le régime : se concrétisait de façon spectaculaire une menace ayant occupé les esprits depuis plusieurs mois. Le terrain demanda à la coordination l’envoi de traitements pour faire face à un éventuel afflux de patients contaminés et répondre aux demandes des responsables sanitaires du conseil local, très inquiets. Il fut particulièrement choqué qu’on lui réponde dans un premier temps que son stock, prévu pour quelques dizaines de patients, suffisait. Par ailleurs, il fallait se préparer à l’éventualité – certes mince à leurs yeux – d’une attaque chimique contre Qabassin ou Al-Bab. Or les dispositifs de protection (combinaisons, masques, gants, bottes) étaient un casse-tête organisationnel, car difficiles d’utilisation, encombrants et coûteux. Un choix avait donc été fait par l’institution : le terrain disposait d’un peu plus d’équipements protecteurs que d’expatriés. Cette implicite hiérarchie des vies à protéger (que ferait-on des employés, de leurs familles, des patients ?) fut difficile à accepter pour plus d’un« J’imaginais plein de monde taper à la porte en train de crever », se souvient le kinésithérapeute d’Atma, où la question se posa de façon similaire (entretien, 11 février 2015)..
Ajustements (Comment justifier la présence au regard des risques ?)
« Nous sommes invités par l’EIIL à continuer à travailler à Qabassin avec une équipe internationale. Ce qui est à la fois dangereux et peu utileCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, document joint, 23 août 2013.
», jugeait le coordinateur de projet à l’aune de l’activité de l’hôpital. Le nombre d’accouchements lui semblait faible (dix par semaine en moyenne) ; l’hôpital recevait très peu de blessés, la plupart étant pris en charge dans les hôpitaux de campagne créés par différents groupes militaires (l’EIIL avait également sa structure, dont on ignora toujours la localisation). Ainsi l’essentiel des procédures au bloc opératoire concernait des cas de brûlés (vingt-quatre nouveaux cas par semaine en moyenne), y compris des cas très graves dont le coordinateur de projet pensait qu’ils seraient mieux pris en charge en Turquie qu’à l’hôpital géré par MSF. Aussi proposait-il de « sortir l’équipe internationale des griffes de l’EIIL avant que cela ne se termine mal », de déplacer le projet à Al-Bab (où existait un équilibre des forces qu’exprimait la composition de la cour islamique) et de transférer la responsabilité de l’hôpital de Qabassin au personnel nationalCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 25 août 2013. Deux semaines plus tard, d’importants troubles à Al-Bab impliquant plusieurs groupes politiques dont l’EIIL (en train de s’y implanter fortement) rompirent l’équilibre des forces, diminuant en conséquence l’attrait de cette option.« Je n’étais pas d’accord ! », se souvient le président de MSF. Responsable des urgences au moment du montage du projet d’Atma, il était toujours en contact avec des commandants militaires rencontrés à l’époque, dont un djihadiste tchétchène, membre alors des Mouhajirine (« Exilés »), devenus une branche importante de l’EIIL. Ce dernier lui avait renouvelé l’assurance que MSF n’était pas en danger à QabassinEntretien avec le président de MSF (ex-responsable des urgences), 20 mai 2015.. Quant au chef de mission, il contestait que le bilan de Qabassin fût si mauvais, mais donnait son feu vert au coordinateur de projet pour explorer plus avant les propositions de réorientation.
En attendant, l’équipe entreprit de rendre plus satisfaisant le rapport entre risques et activités en développant ces dernières. Arrivé début août, le médecin chargé des activités périphériques fut encouragé par le coordinateur de projet à évaluer des localités accueillant des déplacés – déjà visitées par son prédécesseur mais n’ayant pas donné lieu à une intervention –, telle As-Safirah, au sud de Qabassin. Dans cette zone constamment bombardée, abandonnée de tous, se mirent en place de petites opérations de distribution de matériel médical, tentes et produits de première nécessité qui donnèrent à l’équipe la sensation d’être « là où il fautEntretien avec le médecin chargé des activités périphériques, 28 janvier 2015 ; discussion informelle avec le coordinateur de projet, mars 2015.
».
La procédure pour les mouvements vers As-Safirah consistait en un contact la veille avec les interlocuteurs syriens sur place (un médecin et le responsable des déplacés), puis la collecte d’informations le matin même, via Twitter notamment. Si le mouvement était décidé, le médecin de MSF retrouvait les deux Syriens à l’entrée de la zone bombardée. « Tu ne t’éloignes pas du gars qui a le talkie-walkie. Il a les informations militaires en temps réel », lui avait donné pour consigne le coordinateur de projetDiscussion informelle, 20 janvier 2015. « Je n’ai jamais vu la sécurité comme liée au positionnement géographique, précise-t‑il. La question, c’est de trouver le bon réseau. ». Le médecin de MSF s’exposait là à des risques que « dans l’absolu », disait-il, il n’était pas prêt à prendre. « Je me réservais une heure chaque vendredi pour me demander si cela valait le coup d’être là », confie-t‑il. Chaque semaine, il répondait par l’affirmative. Ainsi, c’était paradoxalement en augmentant le volume d’activité et en menant des opérations plus risquées, mais plus pertinentes aux yeux de l’équipe, que les dangers identifiés devenaient acceptables.
La cohésion de celle-ci à ce moment joua sans doute un rôle dans sa capacité à prendre ces risques : le coordinateur de projet partageait quotidiennement avec ses collègues le contenu de ses rencontres, mais aussi ses interprétations et ses doutes. Selon la médecin référente, cette approche différait de celle du précédent coordinateur de projet, pour qui « personne n’a[vait] le droit de s’impliquer dans la sécurité parce que c’[était] son rôle. […] Cela donnait un peu le sentiment qu’il ne voulait pas parler de sécurité pour ne pas inquiéter les gens : “laissez-moi me préoccuper de la sécurité, et inquiétez-vous des problèmes médicaux.” » Or, et c’est une constante dans les témoignages, c’est bien en étant davantage informés des dangers qui les entouraient que les membres de l’équipe se sentaient plus « à l’aise » : ils avaient alors le sentiment que les risques étaient mesurés, pris en considération, et pouvaient observer les efforts déployés afin de les minimiser autant que possible. Sans doute aussi appréciaient-ils de pouvoir, en sachant à quoi ils s’exposaient, juger par eux-mêmes si cela en valait la peine.
Par ailleurs, le quotidien de l’équipe n’avait pas été affecté par la prise de pouvoir de l’EIIL. Ses hommes s’étaient faits discrets, laissant le conseil local et la cour islamique de Qabassin continuer à gérer les affaires courantes. Hormis la destruction du tombeau d’un saint soufi, l’EIIL n’avait pas eu de geste hostile aux coutumes locales ni pris de mesures allant à leur encontre. Les expatriées femmes, portant déjà voile et robe longue, n’eurent pas à modifier leur tenue. Et le coordinateur de projet, qui avait interdit les mouvements à pied au lendemain de la prise de Qabassin, jugea fin août qu’il était temps de mettre fin au « syndrome du bunker » et d’encourager les expatriés à sortir, se socialiser« Sitrep Bravo », août 2013.. Eu égard à son expérience des groupes djihadistes, il pensait toutefois que la « lune de miel » entre l’État islamique en Irak et au Levant et MSF serait de courte durée. Après cette phase de séduction de la population et donc de respect envers MSF viendrait le temps de la « dégradation« MSF au pays d’Al-Qaïda », document attaché à un courriel du coordinateur de projet au chef de mission, 23 août 2013.
». Mais comment anticiper l’instant où cela deviendrait beaucoup trop dangereux ?
D’une garantie l’autre : incidents, négociations, rupture
Lignes rouges (Qu’est-ce qu’un incident grave ?)
Le 2 septembre, un chirurgien syrien du projet de Bab al-Salama était enlevé en pleine nuit dans la maison réservée au personnel syrien de MSF-Espagne. Il fut torturé et assassiné. Aucun groupe ne revendiqua le meurtre, mais il ne faisait pas de doute pour les responsables de MSF-Espagne que celui-ci était lié aux positions ouvertement athées prises par le chirurgienIl avait même fait l’objet d’une fatwa par un groupe affilié à l’ASL, et envoyé en Turquie par MSF-Espagne ; au bout de deux mois, souhaitant rentrer et affirmant que la fatwa avait été levée sous conditions de comportement conforme, il était revenu – mais il apparaissait qu’il avait continué d’afficher ses convictions athées sur Facebook.
: il s’agissait d’une affaire personnelle qui ne visait pas l’association « en tant que telle », conclut la section espagnoleRapport d’incident, MSF-Espagne, 7 septembre 2013.. D’importantes tensions entre sections MSF s’ensuivirent. À Qabassin, à Reyhanli et à Paris, au diapason pour une fois, on s’indigna que, comme lors de l’interception d’une de ses voitures et de l’enlèvement de ses occupants kidnapping du mois d’août à Alep, la section espagnole semblât rechigner à communiquer aux autres les éléments en sa possession (ou à défaut ses hypothèses sur les auteurs de l’acte). Par ailleurs, l’équipe expatriée de Bab al-Salama avait été évacuée sans que les autres projets de MSF en soient informés, ce qui témoignait selon le coordinateur de projet de Qabassin d’un manque total d’égards « pour les équipes sur le terrain qui attendent de l’info pour assurer leur sécuritéCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 7 septembre 2013.
».
Le 19 septembre, l’EIIL s’emparait d’Azaz, faisant passer le projet de Bab al-Salama de MSF-Espagne sous son contrôleC’était ainsi le quatrième projet de MSF sous l’autorité de l’EIIL, avec Qabassin (MSF-F, gouvernorat d’Alep), Tall Abyad (MSF-Hollande, gouvernorat de Raqqa) et Bernas (MSF-Belgique, gouvernorat d’Idlib, passé sous le contrôle de l’EIIL le 26 août).. Le 25 septembre, enfin, on apprenait sur le terrain que depuis une semaine se multipliaient sur les réseaux sociaux les réactions à un tweet émis le 18 par un membre de l’EIIL montrant la photo d’un expatrié de MSF et affirmant : « #ISISAcronyme anglais de l’État islamique en Irak et au Levant.
publie une carte des bases des médecins espions missionnaires qui travaillent pour MSF. » Les membres de MSF qui relayaient l’information recommandaient de ne pas réagir. « Il est facile de décider de ne pas répondre quand ce n’est pas toi qui es exposé », commenta le coordinateur de projet excédé, qui proposait une contre-campagne sur les réseaux sociaux en publiant notamment les lettres de soutien de l’EIIL à MSFCourriel du coordinateur de projet à la chef de mission, 25 septembre 2013.. Sa mission s’achevait quelques jours plus tard.
Le 12 octobre, après un intérim de dix jours, un nouveau coordinateur de projet arriva pour un mois. Le 13, un sérieux incident se produisit au bloc opératoire de l’hôpital : parmi des blessés amenés à la suite d’une altercation avec des hommes de la cour islamique d’Al-Bab venus les arrêter, trois furent emmenés par ceux-ci afin d’être jugés. Deux d’entre eux décédèrent dans les jours qui suivirent, faute de soins appropriés ; le corps du troisième, exécuté par balle, fut ramené à l’hôpital de MSF le 18 octobre par les hommes de la cour islamique.
S’amorça alors entre le coordinateur de projet et la coordination en Turquie un dialogue de sourds portant sur la signification de l’incident et la manière dont MSF devait réagir. Pour le coordinateur de projet, les hommes de la cour islamique, qui n’avaient pas été agressifs, avaient « simplement fait ce qu’ils avaient à faire en fonction de leur objectif ». « Aucun de nous n’est à l’aise avec cela, mais nous sommes conscients que nous ne pouvions pas faire grand-chose d’autres », ajoutait-il. Du moins, « le pire a[vait]-il été évité jusqu’ici, à savoir des tirs dans ou autour de l’hôpital ». Il s’agissait maintenant de rencontrer « les cours d’Al-Bab et de Qabassin pour discuter de ce qui se passera[it] à l’avenir si des suspects [étaient] amenés dans l’hôpital » et de « réaffirmer régulièrement auprès de tous les groupes rencontrés le principe du bannissement des armes dans l’hôpitalRapport d’incident du 13 octobre 2013.
». La chef de missionÀ ce poste de mi-septembre à mi-novembre 2013, présente depuis août comme adjointe.
estima la réaction du coordinateur de projet insuffisante et s’inquiéta de ses tentatives de temporisationCourriel du nouveau coordinateur de projet à la chef de mission, 21 octobre 2013, dans lequel il juge excessif le niveau de stress au sein de l’équipe au regard de la situation ; et courriels de la chef de mission au coordinateur de projet, 22 octobre 2013.. Le 22 octobre, la direction des opérations à Paris s’emparait de l’affaire et insistait : l’atteinte à l’intégrité physique des patients devait être considérée comme une « ligne rouge » justifiant d’exprimer son indignation et de redemander des garanties aux autorités. On demanda au coordinateur de projet de retourner voir ses interlocuteurs afin de « mettre les cartes sur la tableEntretien avec la chef de mission (mi-septembre-mi-novembre), 25 février 2015.
».
Au même moment, dans le reste de l’équipe, une certaine insouciance avait cours : presque tous nouvellement arrivés, nombreux (à nouveau une quinzaine), les expatriés n’étaient pas tenus au fait des discussions entre coordinateur de projet et coordination. Seul le médecin chargé des activités périphériques, présent depuis août, restait très inquietEntretien, 27 janvier 2015.. Aussi tous furent-ils perplexes (et lui soulagé) quand, à la suite d’une information du ministère des Affaires étrangères français concernant un risque d’enlèvement de « deux médecins français de MSF », la coordination demanda une réduction d’équipe immédiate (le médecin était du voyage). Elle ordonna également la restriction des mouvements et recommanda la sortie prochaine des Français encore en poste. Comme cela avait été le cas précédemment pour les Américains, il fut décidé qu’on n’enverrait plus de Français à Qabassin.
Après cette découverte soudaine des dangers l’entourant, l’équipe bascula dans l’inquiétude le 4 novembre. Ce jour-là, trois combattants de l’EIIL se présentaient à MSF et réquisitionnaient une ambulance, promettant de la restituer sous quatre ou cinq jours. La médecin référente rapporte qu’elle prit conscience alors du risque d’enlèvement : « Je me suis dit : “Aujourd’hui ils prennent la voiture, ce soir ils peuvent venir à la maison me prendreEntretien avec la médecin référente présente en octobre et novembre 2013, 4 juin 2015..” »
(Re)négocier, jusqu’à quand ?
À la suite de ces événements, le président de MSF-France fit le déplacement jusqu’en Syrie. Il se rendit à Qabassin accompagné du nouveau chef de mission (le quatrième depuis le début du projet, arrivé début novembre) pour tenter de rencontrer, outre l’émir de l’EIIL de Qabassin, celui d’Al-Bab, un « Soudanais qui faisait peur à tout le monde ». Celui-ci les reçut et leur accorda les garanties qu’ils demandaient quant à la présence de MSF et notamment de personnel international, y compris français. L’émir de Qabassin pour sa part consentit à nommer un intermédiaire civil pour convoyer de futures demandes de l’EIIL. Sur le chemin du retour, le président rencontra son interlocuteur tchétchène d’Atma et chercha confirmation des garanties obtenues : « Il me dit : “Arrête de t’inquiéter ! Puisque je te dis que vous pouvez travaillerEntretien, 20 mai 2015..” »
Fort de ces réassurances, le nouveau chef de mission estimait possible de traiter les demandes de l’EIIL sur un mode plus apaisé : procéder ponctuellement à des donations de médicaments ou de petit matériel était à ses yeux le prix à payer pour maintenir le dialogue avec l’autorité de fait. Il s’opposait en cela à la chef de mission qui l’avait précédé (qui avait jugé inacceptables d’éventuelles donations à ce « groupe arméÉchange de courriels du 22 octobre 2013 entre la chef de mission et le coordinateur de projet.
») ainsi qu’au nouveau coordinateur de projet, dubitatif sur la possibilité de travailler avec l’EIILCoordinateur de projet présent de décembre à février (le cinquième de la mission). Ayant déjà travaillé à Qabassin comme logisticien en août, puis en coordination en octobre et novembre, il faisait partie des « pessimistes ».. La saisie d’une deuxième ambulance appartenant à MSF le 18 décembre accrut donc les divergences, l’un y voyant une ligne rouge, l’autre temporisant : « On ne part pas à cause d’une ambulance […] ; pour une ambulance, tu renégocies. » Trois jours plus tard, le véhicule était restitué – équipé de nouveaux pneus – et les débats se poursuivaient : jusqu’à quand rester, jusqu’où aller ? Le coordinateur logistique résuma la réponse implicitement donnée par l’institution à cette question :
« Je pense que ce n’est que dans des circonstances extrêmes que le collectif décidera de mettre fin à ses activités : kidnapping ou attaque d’un expatrié par exemple. Pour la plupart des autres incidents, il s’agit d’une négociation avec tous les acteurs impliqués pour voir comment continuer les activités, et non si nous devons les continuer Courriel du coordinateur logistique au coordinateur de projet, 23 décembre 2013..»
L’enlèvement
Le 2 janvier, à Bernas, dans le gouvernorat d’Idlib, cinq expatriés du projet de MSF-Belgique étaient enlevés par des combattants de l’État islamique en Irak et au Levant, alors sous la pression d’autres groupes islamistes et de brigades de l’ASL qui, dès le lendemain, déclenchaient une vaste offensive à son encontre. Le 4 janvier à Qabassin, un interlocuteur de confiance informait le coordinateur de projet que ces mêmes groupes d’opposition avaient décidé d’en finir avec l’EIIL sur place. Il conseillait à MSF de se mettre à l’abri quelque temps. Le lendemain, tous les expatriés étaient en Turquie.
MSF-Belgique demanda à toutes les sections de maintenir leurs activités en Syrie tant que duraient les négociations en vue de la libération des otages. Le projet de Qabassin continua de fonctionner avec le seul personnel syrien et un coordinateur de projet basé en Turquie. Les incidents affectant le personnel national se multiplièrent, incluant détentions et intimidations. Certains employés quittèrent la ville. C’en était fini de la période de séduction de la population.
Au printemps 2014, après cinq mois de captivité, les otages étaient libérés. À Qabassin, les représentants de l’EIIL demandaient à MSF de revenir, arguant qu’ils étaient punis pour la faute commise par leurs homologues à Bernas. Mais à la suite de la rupture de confiance causée par l’enlèvement lui-même, par le traitement réservé aux otages et les contreparties exigées pour leur libération, MSF réclamait des explications et de nouvelles garanties au plus haut niveau de l’organisation. Plusieurs lettres furent adressées à son « premier cercle » ; aucune ne reçut de réponse. Le 21 août 2014, MSF annonçait officiellement l’arrêt de toutes ses activités en territoire contrôlé par l’État islamique.
Deux jours plus tôt, les images de l’exécution du journaliste américain James Foley avaient été diffusées. Quatre otages occidentaux dont trois travailleurs humanitaires seraient décapités avant la fin de l’année. Le 6 février 2015, l’État islamique annonçait la mort de la travailleuse humanitaire Kayla Mueller : il s’agissait de la jeune femme enlevée dans le véhicule de MSF-Espagne en août 2013.
Il est extrêmement difficile de porter sur l’histoire de la mission de Qabassin un regard qui ne soit pas parasité par ce que nous savons aujourd’hui de la suite des événements pour MSF et, surtout, de l’État islamique. Ce groupe dont le seul nom suscite l’effroi était en 2013 peu connu et, pour les plus renseignés, perçu comme une sorte d’« Al-Qaïda bis ». Jusqu’à son arrivée, les affrontements entre groupes armés, mais par-dessus tout les bombardements du régime, avaient été (à juste titre) la menace majeure aux yeux des équipes de Qabassin. Quant à la menace d’enlèvement, des kidnappings de journalistes avaient bien eu lieu dès 2012 et avaient suscité une attention variable selon les chefs de mission successifs. Mais à Qabassin en 2013, cette menace fut considérée avec constance comme lointaine du fait de la bienveillance dont bénéficiait le projet, et ce jusqu’au mois d’août, avec l’arrivée du troisième coordinateur de projet, suivie de peu par la prise de pouvoir par l’État islamique en Irak et au Levant. Ces éléments viennent souligner la difficulté de ce que le jargon humanitaire nomme l’analyse de contexte, dont découle l’analyse des risques, et qui revient à tenter de s’orienter en plein brouillard en recherchant, sélectionnant, analysant des informations parcellaires, contradictoires et parfois confuses – difficulté encore accrue par les pertes d’information liées aux changements répétés de coordinateurs, la plupart du temps sans passation, voire avec des périodes d’intérim ou de vacance du poste.
À cet égard, l’étude du projet de Qabassin semble indiquer que les pratiques visant à recueillir un maximum d’informations dans une logique d’exhaustivité – que ce soit par la multiplication d’outils de suivi, la compilation d’incidents, l’établissement de statistiques, ou la consignation d’informations politico-militaires, dépêches et articles – n’aident pas toujours à l’analyse du contexte. Ces dispositifs, s’ils peuvent être utiles, sont aussi consommateurs de temps et d’énergie, précisément parce que peu sélectifs. Or on peut penser que, parmi les informations qu’ils recueillent si activement, les plus importantes seraient de toute façon parvenues aux oreilles du coordinateur, si tant est que son réseau de relations fonctionne bien. Tout au long de cette histoire ressort de façon saillante l’importance de relations de qualité – que l’expression consensuelle de « boire le thé », on l’a vu, n’explicite en rien, puisqu’elle masque des pratiques opposées. Plusieurs personnes du projet ont entretenu de telles relations avec le personnel syrien et avec des interlocuteurs extérieurs. Ceux-ci leur apportèrent compréhension des dynamiques locales et informations en continu, et partagèrent à certains moments une information décisive permettant d’avoir quelques heures d’avance sur les événements, comme lors de l’évacuation de l’équipe en janvier 2014. Dans ces exemples, contrairement à ce qui est généralement prôné, ce ne furent pas tant l’invocation des « principes MSF », la posture de neutralité ou le discours « standard » qui fondèrent la confiance, que l’engagement dans la relation, dans la discussion, une écoute réelle, une forme de franchise – nécessairement associée au respect des codes et des croyances de l’autre – et de fiabilité : « Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on faitEntretien avec le responsable des urgences depuis juin 2013, 28 janvier 2015.. »
Néanmoins, la fin de l’histoire démontre également la limite des engagements pris dans le cadre de certaines de ces relations. Nous avons accordé une large part aux divergences d’analyse entre le terrain, d’une part, et la coordination et le siège, d’autre part, au lendemain de la prise de pouvoir de l’EIIL, ainsi qu’au décalage entre les degrés d’inquiétude des coordinateurs de projet et des chefs de mission successifs (l’inquiétude se situant le plus souvent du côté du terrain). Par-delà les subtilités et nuances des points de vue, ces décalages se rapportaient à la question de savoir s’il était possible d’avoir confiance dans les garanties données par les représentants de l’EIIL. La réponse affirmative à cette question que le siège opposa avec constance aux inquiétudes du terrain était directement liée aux assurances obtenues par le président de l’association dans le cadre de ses relations privilégiées avec des interlocuteurs importants qui s’étaient montrés dignes de confiance depuis l’ouverture du projet à Atma. À l’inverse, c’est parce qu’il jugeait l’État islamique en Irak et au Levant différent de tous les autres groupes armés présents dans le nord de la Syrie que le coordinateur présent en août et septembre était pessimiste et n’accordait qu’une valeur relative à ces garanties. Ce sentiment émanait de son expérience des groupes djihadistes, de ce qu’il entendait de la part du personnel national et des interlocuteurs de Qabassin et Al-Bab, et aussi de l’intérêt qu’il porta à la nature du groupe, à ce que celui-ci disait, écrivait, publiait, à son projet politique : son idéologie en somme.
Mais cette histoire montre aussi que, malgré tout, on restait. Ni les remises en question régulières de la pertinence du projet, ni la détérioration prédite par certains, les accusations d’espionnage sur Twitter, les rumeurs concernant les menaces d’enlèvement répercutées par le ministère français des Affaires étrangèrs, les incidents d’octobre à décembre ; ni l’assassinat du médecin syrien, ni enfin le kidnapping des cinq expatriés de MSF-Belgique ne conduisirent au retrait de l’équipe. L’évacuation (temporaire, disait-on) fut finalement décidée sur la base d’une information précise d’un interlocuteur de confiance, à propos de combats imminents. Une fois l’équipe sortie, les échelons supérieurs réalisaient qu’ils étaient « soulagésIbid. ». Ce maintien des équipes successives ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur le fonctionnement de l’institution comme sur les raisons qui poussent les individus à rester et à consentir à des risques importants – depuis l’attachement à un lieu, au travail effectué, la répugnance à abandonner une population, jusqu’à des sentiments plus clandestins comme l’exaltation ressentie à certains moments ou le souci de ne pas décevoir l’institution en n’étant pas capable de surmonter sa peur.
***
Le théâtre d’ombres des kidnappings: L’affaire Arjan Erkel
Duncan McLean
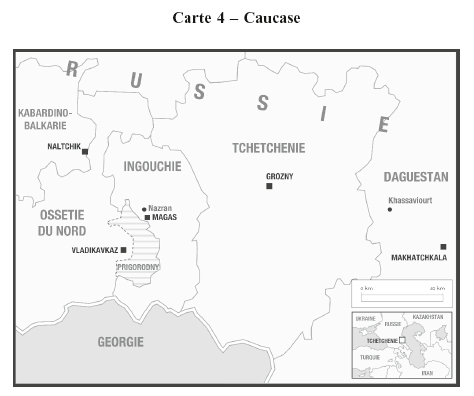
Malgré le vaste élan de solidarité manifesté par nombre d’individus anonymes et d’organisations internationales à l’égard d’Arjan Erkel, la gestion de cette affaire reste un échec : échec des autorités russes, légalement responsables de la résolution de l’affaire. Échec du gouvernement néerlandais, qui s’est entêté dans une approche diplomatique a minima. Échec également des gouvernements partenaires de la Fédération de Russie, qui sont restés largement passifs et indulgents, autorisant ainsi l’escalade de la violence à l’encontre du personnel humanitaire dans la région. Échec enfin de MSF, qui a cru que tous les acteurs ci-dessus faisaient leur maximum pour résoudre l’affaire et le feraient automatiquement sans que MSF ait besoin d’exercer une pression publique supplémentaire. »
Médecins Sans Frontières,
« Arjan Erkel, otage en Fédération de Russie
depuis le 12 août 2002 : un an d’enlèvement »,
dossier de presse préparé pour le premier anniversaire
de la disparition d’Arjan Erkel, août 2003.
Chef de mission pour MSF-Suisse au Daguestan, Arjan Erkel fut enlevé le 12 août 2002 dans les faubourgs de la capitale régionale Makhatchkala et libéré six cent sept jours plus tard dans des circonstances opaques. Sa captivité fut ponctuée d’épisodes d’intense communication publique, initiés pour la plupart par MSF et qui, à l’instar de la déclaration ci-dessus, provoquèrent d’importantes controverses entre la famille Erkel, le gouvernement néerlandais et MSF, trois parties qui affichaient pourtant le même objectif : la libération d’Arjan.
Cette affaire est inhabituelle compte tenu du long procès qui opposa le gouvernement néerlandais à MSF à l’issue de la libération d’Arjan Erkel, et du fait de l’existence d’ouvrages consacrés à l’enlèvementLe journaliste néerlandais Coen van Zwol a fait le récit de l’enlèvement, et Arjan Erkel lui-même a publié ses souvenirs de captivité ; ces deux sources sont citées dans le présent article. Voir Coen van Zwol, Gijzelaar van de Kaukasus: De Ontvoering van Arjan Erkel (« Prisonnier du Caucase. L’enlèvement d’Arjan Erkel »), Prometheus, 2005 ; et Arjan Erkel, Ontvoerd : 607 Dagen tussen Leven en Dood (« Mon enlèvement : 607 jours entre la vie et la mort »), Balans, Amsterdam, 2005.
. Complétés par des entretiens des principaux acteurs de la crise et la consultation de rapports internes à MSF, ces documents offrent la rare possibilité d’analyser l’expérience et les dilemmes d’une organisation humanitaire cherchant à obtenir la libération d’un collaborateur kidnappé.
La disparition
MSF dans le Caucase
Dès ses premières interventions dans les années 1990 en Tchétchénie et dans le Caucase, MSF fut confrontée à la difficulté d’opérer dans un contexte d’intimidations, d’interdiction d’accès et d’extrême violence. La première guerre de Tchétchénie (1994‑1996) décima la population de la République tchétchèneDiverses évaluations font état de 50 000 à 100 000 Tchétchènes tués ou disparus sur une population initiale estimée à 1 million d’habitants. Voir Thorniké Gordadze, « Tchétchénie : l’éradication de l’ennemi intérieur », Fabrice Weissman (dir.), À l’ombre des guerres justes. L’ordre international cannibale et l’action humanitaire, Flammarion, Paris, 2003, p. 191‑216.. Quant à la seconde guerre (1999‑2009), elle prit à partir d’avril 2002 la forme d’une occupation militaire par 100 000 soldats de l’armée fédérale russe. Pendant cette période, les attaques des indépendantistes tchétchènes et les opérations de contre-insurrection furent quotidiennes, engendrant un climat de terreur et la disparition de nombreux civilsVoir par exemple, FIDH, « Tchétchénie – La “normalisation” : un discours de dupes », mission internationale d’enquête, rapport n° 360, mars 2003..
Pendant les deux guerres en Tchétchénie, MSF prit des positions publiques dénonçant leur terrible coût humain, ainsi que les difficultés et les dangers associés à la distribution de l’aide humanitaireDes rapports comme « The Chechen Republic, far from peace », publié par MSF-Belgique en 1996, détaillaient le « bombardement et l’assassinat systématique de civils par l’armée russe en Tchétchénie », tandis que le rapport de novembre 2000 « Chechnya: The politics of terror » dénonçait les « agressions massives et la politique de terreur à l’encontre des civils de Tchétchénie »., tragiquement illustrés par le meurtre de six représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) le 17 décembre 1996 dans leur hôpital de campagne de Novye Atagi. MSF elle-même ne fut pas épargnée par la violence – seize membres de son personnel furent détenus ou enlevés dans le Caucase entre 1993 et 2004Ce total inclut douze « enlèvements express » (résolus en moins de vingt-quatre heures) et quatre enlèvements prolongés, celui d’Arjan Erkel constituant le plus long..
Les prises d’otages étaient un phénomène ancien dans la région, mais elles prirent une ampleur sans précédent pendant la première guerre de Tchétchénie. Les arrestations et les détentions arbitraires de Tchétchènes par les forces russes et prorusses avaient généré une vaste pratique d’échange ou de revente de prisonniers vivants ou morts. Cette utilisation de prisonniers comme monnaie d’échange fut le prélude à la vague d’enlèvements inédite qui toucha le Caucase du Nord à partir du milieu des années 1990Voir FIDH et Mémorial (organisation russe de défense des droits de l’homme), « Tchétchénie : crimes contre l’humanité. Quand leurs auteurs seront-ils jugés ? », rapport d’une mission internationale d’enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés en Tchétchénie, octobre 2000.. Impliquant chaque pan de la société – gangs, clans, rebelles, forces de sécurité, politiciens, entrepreneurs –, ce trafic d’êtres humains ciblait aussi bien les résidents locaux que les voyageurs russes et les étrangers, comme l’illustrent (parmi d’autres) l’enlèvement de Vincent Cochetel, directeur du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Ossétie du Nord, le 19 janvier 1998 (il fut libéré dix mois plus tardVéronique Soulé, « Tchétchénie : Vincent Cochetel le miraculé. Enlevé en janvier, le Français a été libéré par les Russes samedi », Libération, 14 décembre 1998.), ou celui de Geraldo Cruz, infirmier du CICR, le 16 mai 1999 en Kabardino-Balkarie (il fut relâché au bout de deux mois et demi« Red Cross removes workers from North Caucasus after NZ kidnapping », AFP, 24 mai 1999.).
Avant l’enlèvement d’Arjan Erkel, le dernier employé de MSF à avoir fait l’objet d’un kidnapping avait été un chef de mission de la section néerlandaise, Kenny Gluck. Enlevé en Tchétchénie en janvier 2001, il avait été retenu pendant vingt-six jours avant d’être relâché sans conditions. Contrairement à la plupart des cas précédents impliquant la mafia tchétchène et des réseaux liés aux forces de sécurité russes, l’enlèvement avait été perpétré par un groupe de résistants islamistes tchétchènes affiliés à Chamil Bassaïev. Il fut relâché avec une lettre d’excuses publiée par la suite sur le site tchétchène pro-indépendantiste kavkaz.org et signée par Bassaïev lui-même. La lettre expliquait que le chef de mission de MSF avait été enlevé par un groupe de moudjahidin dans l’espoir de négocier sa libération contre celle de combattants et de membres de leurs familles détenus par les forces armées fédérales. Elle stipulait que la Haute Cour de justice islamique avait décidé de le relâcher sans conditions en raison de sa mission humanitaire. La lettre se concluait par ces mots : « Nous vous informons également qu’en examinant votre cas, la Haute Cour de justice islamique a décidé d’interdire les enlèvements de membres d’organisations humanitaires. »Laurence Binet, Crimes de guerre et politiques de terreur en Tchétchénie, coll. « Prises de paroles publiques » de MSF, MSF, septembre 2014, p. 173.
Les égards manifestés par l’opposition tchétchène vis-à-vis de Kenny Gluck et des organisations humanitaires n’améliorèrent pas les relations déjà tendues entre Moscou et MSF, régulièrement accusée par la presse progouvernementale d’avoir pris fait et cause pour les indépendantistesCoen van Zwol, « Erkel ignorait l’identité des attachés américains », NRC, 16 juillet 2003.. Les tensions avec l’État russe s’accrurent encore en 2002 à propos de l’accord tripartite entre la Russie, la Tchétchénie et la République russe voisine d’Ingouchie prévoyant de rapatrier en Tchétchénie quelque 200 000 personnes déplacées. MSF exprima ses préoccupations quant au retour forcé des civils en zone de guerre. La Tchétchénie était en particulier le théâtre d’opérations de nettoyage (les zatchiski) menées par des hommes masqués dans des véhicules blindés aux plaques non identifiables, et dont le travail consistait notamment à torturer et massacrer les civils soupçonnés de soutenir les rebelles« En Tchétchénie, l’intensité des violences n’a pas diminué. Au contraire, bombardements, épurations, rackets, escadrons de la mort et tortures constituent la norme », extrait de « Inquiétudes face aux nouvelles pressions au retour exercées sur les déplacés tchétchènes en Ingouchie », communiqué de presse MSF, 3 juin 2002..
À la mi-2002, les opérations de MSF en Tchétchénie, en Ingouchie et au Daguestan incluaient des cliniques mobiles, le soutien à des hôpitaux et dispensaires (par la fourniture d’équipements médicaux et la réhabilitation des principaux services), ainsi que l’assistance aux populations déplacées. La crainte des enlèvements ou d’attaques ciblées contre les agences humanitaires avait conduit MSF, au printemps 2002, à réduire considérablement le nombre de membres du personnel international présents dans le Caucase.
Contrairement à la Tchétchénie voisine, le Daguestan n’avait pas basculé dans la guerre civile. Au tournant du siècle, la petite République était néanmoins la deuxième plus pauvre de la Fédération de Russie. La proximité de la guerre en Tchétchénie avait multiplié les opportunités de profit pour les réseaux criminels, les hommes politiques et les hommes d’affaires impliqués, entre autres, dans les trafics d’armes et d’êtres humains. Très dépendant des autorités fédérales finançant son budget à hauteur de 90 %, le Daguestan était en proie à une corruption endémique, illustrée par le comportement trouble des « officiers de police [travaillant] simultanément pour l’État, leur clan et les organisations criminellesCoen van Zwol, Gijzelaar van de Kaukasus: De Ontvoering van Arjan Erkel, op. cit., p. 18. Voir également le recueil d’Arkady Babchenko One Soldier’s War in Chechnya, Grove Press/Atlantic Monthly Press, 2009, qui fournit des anecdotes détaillées sur l’impact économique régional du conflit.
».
MSF connaissait peu le Daguestan. En mars 2000, la section suisse y avait mené une mission exploratoire afin d’évaluer la possibilité d’accéder à la Tchétchénie depuis la petite République, où elle comptait également développer des activités. En dépit de différents signaux inquiétants, notamment dans la presse, elle avait conclu que le Daguestan était relativement sûr pour l’heureSelon la Jamestown Foundation ou la BBC, par exemple, « c’[était] dans le Caucase du Nord que la menace d’enlèvement [était] la plus importante – en Tchétchénie et chez ses voisins l’Ingouchie et le Daguestan », voir Nabi Abdullaev, « Foreigner beware: Kidnappers are still operating in North Caucasus », The Jamestown Foundation, 27 février 2001 ; Stephen Mulvey, « Analysis: Caucasus kidnap threat », BBC News Online, 21 juin 2002.. Des opérations modestes, limitées à la réhabilitation de structures de santé, ainsi qu’à la vaccination et à la distribution de biens de première nécessité aux déplacés tchétchènes furent ainsi démarrées.
L’enlèvement
Arjan Erkel était le premier chef de mission permanent de la mission suisse au Daguestan, ses prédécesseurs s’étant relayés à un rythme soutenu. Il arriva à la mi-avril 2002, alors que l’agenda humanitaire régional était dominé par le plan tripartite prévoyant de rapatrier les déplacés en Tchétchénie. Arjan participa aux réunions internes de MSF à Paris au cours desquelles une stratégie de positionnement public contre le retour forcé des déplacés tchétchènes fut élaborée.
À la mi-juillet, le bureau du coordinateur de la sécurité des Nations unies informa MSF que le FSB (Service de sécurité fédéral de la Fédération de Russie, ex-KGB) avait mis en garde contre un accroissement des risques d’enlèvement. Ces informations furent alors interprétées par MSF comme une manoeuvre d’intimidation en lien avec le plan de rapatriement, visant à réduire la présence des ONG et leur activisme. Néanmoins, à la suite de l’enlèvement en Tchétchénie le 23 juillet de Nina Davidovitch, directrice de l’ONG russe Druzhba, un consensus se dessina au sein de MSF pour évacuer le personnel international encore présent et geler les mouvements de personnel national dans le CaucaseLa réduction et l’évacuation du personnel international se firent progressivement au sein des différentes sections : la section française suspendit tous les mouvements d’expatriés dans le Caucase à la suite de l’avertissement initial du FSB ; la section belge suspendit les mouvements après l’enlèvement de Davidovitch ; ce que fit également la section néerlandaise, même si elle maintint une présence à Naltchik, dans la République de Kabardino-Balkarie..
Le Daguestan fit exception. Considérant la zone comme encore sûre, la section suisse y poursuivit ses activités au même rythme. Au cours de la même période, Arjan Erkel fut contacté par un attaché militaire de l’ambassade américaine qui sollicitait des informations sur la sécurité et une aide logistique en vue de sa visite au Daguestan. De sa propre initiative, Erkel envoya une voiture de MSF à l’aéroport de Makhatchkala afin de réceptionner l’officier, qui était accompagné d’un second attaché américain. Il dîna avec eux le 4 août. Aucun autre membre de MSF ne participa à la réunion, toutes les personnes consultées s’opposant d’ailleurs à une rencontre avec les militaires américains, en raison de l’incompatibilité de leur mission avec celle de MSF, ainsi que de l’image qu’un tel rapprochement pouvait véhiculerDocument interne MSF..
Ce n’est qu’après une seconde mise en garde du FSB le 6 août, cette fois relayée directement à la section suisse par le biais de son bureau de Khassaviourt, que la présence du personnel international fut réduite et cantonnée à la ville de Makhatchkala. Arjan Erkel lui-même resta et poursuivit plusieurs discussions d’ordre sécuritaire avec un certain nombre d’interlocuteurs daguestanais. Ceux-ci se montrèrent rassurants, affirmant que MSF n’avait pas à s’inquiéter outre mesure des rumeurs de kidnapping. Néanmoins, l’analyse du chef de mission de la section hollandaise à Moscou – relayée par Erkel au bureau de Genève – faisait écho aux avertissements du FSB : « MSF-Hollande pense que les choses ne se calmeront pas tant qu’un gros poisson n’aura pas été enlevéIbid.. »
Quelques jours plus tard, le 12 août, Arjan Erkel fut enlevé devant la maison de sa petite amie dans les faubourgs de Makhatchkala. Bien que légèrement blessé pendant l’opération, il fut, selon ses dires, relativement bien traité par la suite. Il fut retenu pendant une semaine par les hommes qui l’avaient enlevé, avant d’être remis à des geôliers opérant pour le compte de commanditaires inconnus. Au fil des vingt mois qui suivirent, Erkel fut détenu en plusieurs endroits, jamais autorisé à voir le visage de ceux qui le surveillaient, avec lesquels s’instaurèrent néanmoins des liens et une forme de dialogue. Des bribes d’informations filtraient jusqu’à lui, évoquant parfois des possibilités de libération qui se révélèrent de faux espoirsD’après Mon enlèvement : 607 jours entre la vie et la mort, traduction française du livre d’Arjan Erkel, op. cit..
L’attente (août-décembre 2002)
Les réactions initiales de MSF, de la famille d’Arjan Erkel et du gouvernement néerlandais
Suivant un protocole de gestion de crise calqué sur celui de MSF-Hollande, MSF-Suisse constitua le lendemain de l’enlèvement une cellule de crise à Genève placée sous l’autorité du responsable des programmes au Daguestan. Celle-ci fut renforcée par la suite par des membres du siège travaillant dans les domaines de l’administration, des ressources humaines, de la communication, ainsi que de l’« analyse de contexte ». Dans le mois qui suivit, des cellules de crise terrain furent déployées à Moscou et Makhatchkala avec le soutien en ressources humaines d’autres sections, en premier lieu de MSF-France. La supervision globale incombait à un comité de pilotage composé du président, du directeur général et du directeur des opérations de MSF-SuisseDocument interne MSF..
La section néerlandaise fut impliquée dès le départ malgré la primauté de la cellule de crise suisse pour les opérations et décisions quotidiennes. Son chef de mission à Moscou, seul chef de mission de MSF présent dans la capitale au moment de l’enlèvement, fut mobilisé pour constituer l’embryon d’une cellule de crise terrain, dans l’attente de renforts venus de Genève. Par ailleurs, compte tenu de la nationalité d’Arjan Erkel, une cellule de crise supplémentaire fut créée à Amsterdam. Son rôle consistait principalement à traiter avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères et à gérer les relations avec la famille « en faisant preuve d’un peu plus de sensibilité culturelleEntretien avec Thomas Nierle, ancien directeur des opérations de MSF-Suisse, 5 mai 2015. Implanter une cellule de crise supplémentaire dans le pays d’origine d’un expatrié kidnappé constitue une pratique standard chez MSF.».
La famille fut informée de l’enlèvement le jour même et se montra d’emblée très active. S’efforçant d’attirer l’attention des cercles gouvernementaux sur l’enlèvement d’Arjan, son père, Dick Erkel, se lança dans un lobbying intense auprès de fonctionnaires néerlandais des Affaires étrangères. Membre du Parti démocrate chrétien (CDA), le parti au pouvoir, il mit à profit ses connexions politiques, parvint à rencontrer personnellement le ministre néerlandais des Affaires étrangères dans les premières semaines qui suivirent l’enlèvement et, de manière plus générale, à obtenir un meilleur accès à la bureaucratie gouvernementaleDocument interne MSF..
Le ministère néerlandais des Affaires étrangères traita initialement l’enlèvement comme une simple affaire consulaire. L’affaire gagna en importance lorsque de hauts fonctionnaires au sein de l’administration s’impliquèrent. Une cellule spéciale fut ainsi formée en son sein, dirigée par le directeur aux affaires consulaires, et au sein de laquelle intervinrent fréquemment les supérieurs de celui-ci. Cela n’altéra toutefois pas la ligne de « diplomatie silencieuse » du gouvernement néerlandais, qui déclara très tôt limiter son rôle à celui de facilitateur« Prise de position publique dans l’affaire Arjan Erkel », notes internes de MSF, 2004.. Officiellement, la politique de La Haye était de ne pas négocier avec les preneurs d’otages et de ne pas payer de rançons, sans toutefois empêcher les familles, les employeurs ou d’autres intermédiaires de le faire. Le gouvernement néerlandais semblait d’autant plus réticent à s’impliquer directement dans l’affaire que la Russie était un partenaire stratégique et économique clé pour le pays. En 2002, Moscou était sur le point de devenir le principal fournisseur de pétrole brut des Pays-Bas, qui était de son côté le troisième investisseur étranger dans la Fédération de RussieVoir Statistics Netherlands Webmagazine, « Russia main oil supplier to the Netherlands », 15 mars 2004..
Le silence des ravisseurs
Peu de temps après l’enlèvement, des rumeurs circulèrent dans la presse locale concernant les éventuels responsables, pointant du doigt le FSB, des malfaiteurs ou des rebelles tchétchènes. Les dirigeants du Daguestan prétendaient connaître les coupables. Ils accusaient les « wahhabites, des musulmans radicaux, ennemis de la Russie », tout en insinuant que l’enlèvement était destiné à démontrer que le Daguestan restait un endroit « dangereux et instable23. Les plus conspirationnistes rattachaient l’enlèvement d’Arjan Erkel aux enjeux de la politique des hydrocarbures dans le Caucase. Selon cette lecture, il était dans l’intérêt des entreprises occidentales d’entretenir le chaos au Daguestan et la stabilité en Géorgie afin que cette dernière soit la principale plateforme logistique pour le transport du pétrole et du gaz de la mer Caspienne. Coen van Zwol, Gijzelaar van de Kaukasus: De Ontvoering van Arjan Erkel, op. cit., p. 11‑12, 66.
». D’un autre côté, plusieurs agences humanitaires firent le lien entre les enlèvements d’Arjan Erkel et de Nina Davidovitch et le plan de rapatriement des déplacés tchétchènes depuis l’Ingouchie. Ainsi que le rapporta un journaliste en août 2002 : « Sans révéler leur identité, les dirigeants des organisations humanitaires à Moscou ont déclaré hier que l’objectif de ces enlèvements était de contraindre les ONG humanitaires à quitter la Tchétchénie et les républiques alentour, au moment même où les [déplacés] commencent à rentrer chez eux« Résurgence des activités des rebelles tchétchènes », Le Figaro, 21 août 2002.. »
Fidèle aux recommandations habituellement prônées par les experts en gestion de kidnapping, MSF-Suisse maintint d’abord une approche faite de patience et de discrétionCette approche destinée à faciliter la résolution des enlèvements par le biais d’une transaction commerciale secrète est recommandée dans les formations à la gestion de kidnapping auxquelles les cadres de MSF sont invités à participer (voir par exemple la formation de MSF-France « Enlèvement et kidnapping », animée par une ancienne directrice de la « National Hostage And Crisis Negotiation Unit » de Scotland Yard, les 12‑13 juin 2013 à Paris). Elle correspond à la norme du milieu des consultants en kidnapping. Voir l’entretien d’Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE et senior advisor au sein du cabinet Orrick Rambaud Martelet, dans Défis, 2014, n° 2, Business en milieu hostile. La protection des entreprises à l’international, ministère de l’Intérieur, p. 11 ; Dorothée Moisan, Rançons. Enquête sur le business des otages, Paris, Fayard, 2013, p. 91‑95 ; ou encore Brynna Leslie, « In Harm’s Way », Canadian Insurance Top Broker magazine, été 2011.. Espérant que les autorités russes ou les rebelles résoudraient le cas rapidement, la cellule de crise genevoise décida de « minimiser les interférences et d’attendre un appel téléphonique » des ravisseurs, d’un intermédiaire ou des autorités. Dans les réunions bilatérales, MSF appelait les fonctionnaires russes et daguestanais à fournir « toutes les informations ou contacts qui pourraient permettre de trouver une solution au problème » tout en promettant de « préserver la stricte confidentialité de tout soutien qu’[elle] pourrait obtenirVoir par exemple un courrier de Thomas Linde, directeur général de MSF-Suisse, et de Morten Rostrup, président du Conseil international de MSF, à l’ambassadeur de Russie en Suisse, 23 août 2002.
». D’autres initiatives comme l’activation de réseaux locaux et la recherche de contacts (notamment parmi l’opposition armée tchétchène) furent entreprises en secret. MSF-Suisse sollicita les sections néerlandaise, française et belge à cette fin ; la cellule de crise de Moscou prit conseil auprès de journalistes, d’universitaires et d’experts régionaux. Publiquement, MSF demandait la « libération inconditionnelle » d’Arjan Erkel, les communiqués de presse de MSF se limitant à mettre en avant les « risques pour les civils et les travailleurs humanitaires » dans le Caucase« MSF condamne le kidnapping d’un membre de son personnel et suspend ses activités », communiqué de presse MSF, 14 août 2002.. La famille d’Arjan Erkel approuva cette approche, parfaitement en phase avec la démarche de diplomatie silencieuse prônée par le gouvernement néerlandais.
En octobre 2002, la prise d’otages dans le théâtre de la Doubrovka à Moscou illustra la discrétion opérationnelle et publique adoptée par MSF dans les premiers mois suivant la disparition d’Arjan Erkel. Invitée par les preneurs d’otages tchétchènes (aux côtés du CICR) à faire office de médiateur, MSF préféra s’abstenir. Elle se contenta d’apporter un soutien en matériel médical aux hôpitaux locaux qui accueillirent les rescapés de l’offensive finalement lancée par les forces spéciales russes à l’intérieur du théâtre. Celle-ci avait entraîné la mort de 129 des 850 otages, tous (sauf un) tués par le gaz de combat utilisé par les forces spéciales pendant l’assaut. Le refus du FSB de dévoiler la composition de ce gaz suscita un tollé au sein du personnel de santé moscovite exposé à ses effets alors qu’il essayait de réanimer des patients inconscientsEn raison du grand nombre de patients en difficulté respiratoire et du manque de matériel, le personnel médical pratiqua de la réanimation par bouche-à-bouche, s’exposant ainsi aux émanations de gaz toxique.. MSF resta sciemment en retrait de ces controverses, afin de ne pas contrarier les autorités russes, avec pour conséquence de compromettre la possibilité d’obtenir leur aide en vue d’une libération. À ce stade, la communication de MSF sur l’enlèvement se résumait à « parler pour ne rien direEntretien avec Anne Fouchard (2009), ancienne directrice adjointe de la communication de MSF-France, extraite de Laurence Binet, op. cit., p. 249.
».
Changement de stratégie (novembre 2002-septembre 2003)
Première utilisation de la mobilisation publique (novembre 2002-février 2003)
Les ravisseurs d’Arjan Erkel ne tentèrent aucune prise de contact avec MSF, le gouvernement néerlandais ou sa famille pendant le reste de l’année 2002. En l’absence de demande de rançon et de preuve de vie, les équipes de MSF commencèrent à soupçonner l’existence d’une machination politique de plus grande ampleur derrière la disparition d’Arjan ErkelDocument interne MSF.. Ainsi que se le rappela par la suite le directeur des opérations de MSF-Suisse : « Il y avait toujours l’idée, en arrière-plan, que ce type d’exaction devait être autorisé par quelqu’un quelque part, que dans ce jeu, ce sont des gens de pouvoir qui avaient la mainEntretien avec Thomas Nierle (2009), Laurence Binet, op. cit., p. 233.. »
Vers la fin de l’année 2002, les doutes de MSF quant à la détermination des autorités russes et de la police daguestanaise à résoudre l’affaire allaient croissant. Le gouvernement néerlandais la rejoignait sur ce point. À la suite de la crise de la Doubrovka, une première réunion au sommet eut lieu entre des représentants de MSF et du FSB. Ces derniers firent comprendre à la délégation de MSF que l’enlèvement d’Erkel était le « genre d’ennui [qui] arrivait aux gens qui les emmerdaient, comme nousEntretien avec Jean-Hervé Bradol (2009), ancien président de MSF-France, Laurence Binet, op. cit., p. 246. Le message qu’Arjan Erkel « méritait ce qui lui arrivait » fut répété en mai 2003 par un directeur adjoint du FSB lors d’une réunion avec l’ambassadeur néerlandais et le directeur des opérations de MSF-Suisse (voir l’entretien avec Thomas Nierle (2009), Laurence Binet, op. cit, p. 275).
».
Parmi les dirigeants de MSF, l’approche discrète adoptée par la cellule de crise de Genève commençait à faire débat. Les avis divergeaient quant au meilleur moyen d’inciter les pouvoirs publics russes à résoudre l’affaire : poursuivre la diplomatie silencieuse ou mettre le Kremlin publiquement dans l’embarras ?
Des désaccords s’étaient également manifestés à la suite de l’initiative de MSF-Hollande de recourir aux services d’un cabinet de conseil en sécurité (Control Risks Group, CRG) afin de rassurer la famille sur le fait que « [MSF] ne placer[ait] pas [ses] principes au-dessus de la nécessité de sauver une vie ». Cette initiative avait suscité le mécontentement de la cellule de crise et celui d’autres sections, notamment MSF-FranceLa section néerlandaise avait déjà eu recours aux services de CRG avant l’enlèvement d’Arjan Erkel dans le cadre de formations et de la définition de protocoles de gestion de crise, et pour des conseils lors de l’enlèvement de Kenny Gluck.. Doutant de l’utilité des services proposés par CRG, elles estimaient que l’image de MSF pouvait pâtir de sa proximité avec une compagnie de sécurité connue pour ses liens ambigus avec les services secrets occidentaux. Or la rencontre entre Erkel et les attachés américains en août avait déjà suscité des suspicions sur les liens de l’organisation avec les services secrets« CIA sans frontières » et « Médecins sans médicaments » étaient déjà des surnoms répandus pour MSF au sein de l’armée et des services secrets russes. Voir Coen van Zwol, « L’identité du ravisseur d’Arjan Erkel est connue », NRC Handelsblad, 5 novembre 2003..
À la fin de l’année 2002, en l’absence de progrès de la cellule de crise, le directeur des opérations de MSF-Suisse décida la création d’un groupe de réflexion afin de permettre l’expression d’opinions divergentes et d’examiner les options jusqu’alors ignoréesEntretien avec Thomas Nierle (2009), Laurence Binet, op. cit., p. 250.. Incluant des figures clés du bureau international de MSF ainsi que des sections française, néerlandaise, américaine et suisse, ce « comité de suivi international » n’avait pas vocation à remplacer les instances de Genève (cellule de crise et comité de pilotage) qui restaient décisionnaires.
C’est au cours de sa première réunion, à la mi-novembre 2002, que le comité suggéra d’exercer une pression politique sur les autorités russes puis néerlandaises par le biais de prises de position publiques. Comme le plan de communication de la cellule de crise genevoise l’entérinerait par la suite, l’heure était venue d’accroître la pression sur les autorités russes en les rappelant à leurs responsabilités à l’égard de la libération d’Arjan Erkel36. « Mise en oeuvre de la Phase 2 – Version provisoire », cellule de crise de MSF-Suisse, 13 janvier 2003.. Il s’agissait pour commencer de mener des actions de lobbying ciblées auprès d’acteurs internationaux clés comme les Nations unies, les États-Unis, la Russie et l’opposition tchétchène. Celles-ci pourraient être suivies d’une communication publique comportant un « message agressif ou de dénonciation » en fonction des résultats de la campagne de lobbyingDocument interne MSF.. Il fut par la suite décidé que le kidnapping d’Arjan Erkel serait resitué dans son contexte politique plus large : celui d’une politique destinée à priver la population tchétchène d’aide humanitaire, avec l’assentiment de la communauté internationale.
La première manifestation tangible de ce changement de tactique fut la décision par la cellule de crise genevoise d’organiser en février 2003 une conférence de presse à Moscou avec Dick Erkel et l’ambassadeur des Pays-Bas. Devait s’ensuivre le lancement en mars d’une pétition appelant à la libération d’Arjan Erkel. Lorsqu’ils prirent connaissance de ce nouveau plan de communication, le ministère néerlandais des Affaires étrangères et la famille exprimèrent leur inquiétude. Le ministère considérait que « des accusations directes contre les autorités russes » pouvaient compromettre leur coopération, tandis que la famille était d’avis qu’un ton accusateur pouvait « être contre-productifCourrier de Jaap de Hoop Scheffer, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, à Morten Rostrup, président de MSF International, 29 janvier 2003 ; et compte rendu de la réunion à propos d’Arjan Erkel au ministère des Affaires étrangères, La Haye, 29 janvier 2003.
» – une critique qu’elle renouvela à plusieurs reprises dans les mois qui suivirent. Exposée à la pression de l’opinion publique néerlandaise « dominée par la famille et le GouvernementInterview de Rafa Vila San Juan (2009), secrétaire général de MSF-International, Laurence Binet, op. cit., p. 265.
», MSF-Hollande utilisa ces mêmes arguments pour contester la pertinence de la campagne de mobilisation.
La conférence de presse eut lieu comme prévu le 12 février 2003 et s’accompagna de la publication d’un communiqué de presse. MSF avait quelque peu adouci son discours. Appelant les autorités russes et daguestanaises à oeuvrer à la libération d’Arjan Erkel, l’organisation signalait simplement que « la non-résolution de ce kidnapping pourrait reposer sur des motifs politiques » ; les journalistes étaient libres de déduire les implications d’une telle formule« Toujours aucune nouvelle d’Arjan Erkel, enlevé il y a six mois, jour pour jour, au Daguestan. MSF demande aux gouvernements russe et daguestanais qu’ils accordent la plus haute importance à cette affaire », communiqué de presse MSF, 12 février 2003.. Moins d’un mois plus tard, une pétition internationale fut lancée qui réclamait la libération d’Erkel, les autorités russes faisant « preuve de la plus mauvaise volonté pour résoudre cette affaire« Appel international pour la libération d’Arjan, volontaire de MSF, otage depuis six mois dans le Caucase, à l’occasion de son anniversaire – Les autorités russes n’assument pas leurs responsabilités », communiqué de presse MSF, 7 mars 2003.
». Dans la presse néerlandaise, le chef de mission de MSF-Hollande alla plus loin encore en évoquant ouvertement l’hypothèse d’une implication officielle de la Russie : « Il est possible qu’Arjan ait été kidnappé par les services de sécurité ou par un tiers et que les autorités en soient raviesFenneken Veldkamp, Coen van Zwol, « Au Daguestan, un jeune homme blond vaut des millions », NRC Handelsblad, 5 avril 2003.. » Néanmoins, à l’occasion de réunions bilatérales avec les représentants russes, MSF affirmait qu’elle était prête à abandonner cette campagne, à régler des « frais de service » pour faciliter la libération et à remercier publiquement la Russie pour ses efforts une fois Erkel libéré.
Entre-temps, des éléments pointant la responsabilité du gouvernement russe dans l’enlèvement ou son absence de résolution avaient continué à émerger. En mars 2003 apparut une facture du téléphone mobile d’Erkel sur laquelle figuraient quelque 61 appels effectués après son enlèvement vers différents numéros à Moscou, dans le Caucase et à Rostov, qui incluaient « des policiers, des membres du FSB et des intermédiaires [connus pour leur implication dans d’autres affaires d’enlèvement] ». Ces informations furent jugées non pertinentes pour l’enquête par les autorités russes qui décidèrent peu après de couper la ligne téléphoniqueCoen van Zwol, Gijzelaar van de Kaukasus: De Ontvoering van Arjan Erkel, op. cit., p. 14.. Puis, en avril 2003, la cellule de crise de Moscou fut informée par le procureur adjoint de la Fédération de Russie que des agents du FSB étaient en train de filer Arjan Erkel au moment de son enlèvement, auquel ils avaient assisté sans réagir. Le FSB justifia sa non-intervention en déclarant que ses agents n’étaient pas armésCoen van Zwol, « Erkel ne connaissait pas l’identité des deux attachés américains », NRC, 16 juillet 2003. Dans son livre, Arjan Erkel indique que les ravisseurs déclarèrent également avoir remarqué que le FSB le suivait.. Pour les principaux décideurs de MSF, cela faisait de moins en moins de doute : si l’identité et les motivations des ravisseurs ne pouvaient être établies, le manque de coopération, voire l’obstruction des autorités russes, étaient un fait avéré.
Premières preuves de vie (mars-mai 2003)
Alors que le père et le frère d’Arjan Erkel étaient à Moscou pour remettre la pétition internationale aux autorités russes, ils furent brusquement rappelés à La Haye par le gouvernement néerlandais le 30 mars 2003. Dès leur arrivée, on leur montra, ainsi qu’à des membres de la cellule de crise de MSF, les premières preuves de vie d’Erkel : des courriers datés de fin janvier adressés à chaque partie et supposément transmis par « les services d’un pays tiers ». Les lettres étaient accompagnées de photographies. Sur la première, Arjan Erkel apparaissait en relative bonne santé. Sur la deuxième, datée du 27 février, il portait une barbe et semblait épuisé.
Selon MSF, l’apparition de ces preuves de vie, première avancée positive après sept mois et demi de silence de la part des ravisseurs, tendait à confirmer la pertinence du changement opéré dans la stratégie de communication – et notamment la conférence de presse et les premiers communiqués dénonçant l’absence de volonté des autorités russes et daguestanaises de résoudre l’affaire. Il était plus troublant encore de recevoir ces preuves de vie à quelques jours des conférences de presse supplémentaires prévues par MSF et dont la perspective mécontentait particulièrement les autorités russes et néerlandaisesDocument interne MSF..
À la suite de ces preuves de vie, la campagne médiatique marqua une pauseSeule exception au cours de cette période relativement calme, le sommet de l’Union européenne au cours duquel le sort d’Arjan Erkel fut publiquement évoqué par le président Poutine et le Premier ministre néerlandais Jan Peter Balkenende. « L’Union européenne promet son soutien au plan de paix de la Russie en Tchétchénie », AFP, 31 mai 2003., car des canaux de négociations potentiels s’ouvrirent. Ils se refermèrent peu après. La piste d’un « contact secret » du gouvernement néerlandais à Bakou en Azerbaïdjan ne fut pas approfondie faute de garanties de sécurité suffisantes pour les envoyés de MSF. Par la suite, un intermédiaire du Caucase du Sud en contact avec la cellule de crise eut l’un de ses propres hommes enlevé en essayant d’entrer en relation avec les ravisseurs au Daguestan.
Le premier cycle de négociations et son échec (juin-septembre 2003)
En mai 2003, MSF apprenait que l’enquête sur l’enlèvement d’Arjan Erkel avait été suspendue par la police daguestanaise dès novembre 2002 et venait seulement d’être rouverteDocument interne MSF.Un mois plus tard, le FSB transmettait à l’ambassade des Pays-Bas à Moscou une vidéo d’Erkel, contenant, cette fois, une menace d’exécution en cas de non-paiement de rançon. Pour la cellule de crise genevoise, cela montrait que les autorités russes étaient en mesure de contribuer à la résolution de la crise, si elles le souhaitaient. Ce sentiment fut renforcé lorsque le FSB identifia un intermédiaire avec les ravisseurs prêt à rencontrer MSF. Au cours d’une réunion à Makhatchkala en juillet, celui-ci transmit une demande de rançon de 5 millions de dollars aux représentants de MSF et du gouvernement néerlandais (escortés d’un « coach » nommé par le FSB). Ces derniers exigèrent une preuve de vie avant de poursuivre les discussions.
La preuve de vie attendue fut finalement fournie le 30 juillet (Arjan Erkel confirma par la suite avoir été informé par ses ravisseurs à cette période que sa libération pouvait intervenir sous peu). Mais la frustration restait immense au sein de MSF : « Si le FSB était capable de tirer les ficelles en coulisses », pourquoi ne pouvait-il pas mener lui-même les négociationsIbid.
? Le 12 août, à l’occasion du premier anniversaire de l’enlèvement d’Arjan Erkel, MSF lança sa campagne de communication la plus intense. Elle s’en prenait non seulement au gouvernement russe, qui devait être « rappelé à ses responsabilités légales », mais aussi à « l’attitude timorée » de son homologue néerlandais« Un an après l’enlèvement d’Arjan Erkel, MSF considère que l’enquête est un échec et en appelle à une action renforcée de la part des autorités russes pour résoudre l’affaire », communiqué de presse MSF, 12 août 2003..
Au même moment, le canal de communication ouvert à Makhatchkala avec l’intermédiaire identifié par le FSB se referma. Les services secrets russes refusèrent d’assister à une réunion de suivi. Au sein de MSF-Suisse, des désaccords sur l’interprétation de cet échec se firent jour. Si la cellule de crise de Moscou (comme l’ambassadeur néerlandais, furieux) incriminait la campagne de communication, celle de Genève estimait pour sa part que la piste avait avorté bien avantDocument interne MSF..
Moins d’un mois plus tard, en septembre 2003, une nouvelle possibilité de règlement se présenta par le biais d’un avocat néerlandais en contact avec des intermédiaires ingouches connectés au milieu du crime organisé. La piste semblait suffisamment prometteuse pour que MSF autorise le transfert de 250 000 euros en Russie, via l’ambassade des Pays-Bas à Moscou. Selon les intermédiaires de l’avocat, cette piste s’effondra à la suite d’un attentat contre les bureaux du FSB à Magas, capitale de l’Ingouchie, le 15 septembre, et de la répression policière qui y répondit. Ajoutant à la frustration de MSF, le ministère de l’Intérieur du Daguestan annonça qu’Arjan était vivant, avant de se rétracter.
Le chemin vers la libération (septembre 2003-avril 2004)
La presse et les vétérans du FSB rejoignent l’enquête (septembre-décembre 2003)
Fin 2003, les médias locaux et internationaux accordaient à l’affaire une attention plus grande et commençaient à rendre publics nombre des détails de l’enlèvement, indépendamment des initiatives de communication de MSF. Des journalistes locaux et étrangers menaient également leurs propres investigations. Ainsi, Bob Herbert, du New York Times, relatant la clôture de l’enquête en novembre 2002, soulignait qu’il en serait resté ainsi si « MSF n’avait pas réussi à transformer l’affaire en source d’embarras pour le gouvernement de Poutine« Kindness’s Cruel Reward », éditorial, The New York Times, 26 septembre 2003.
». Plusieurs articles de Coen Van Zwol et de Viatcheslav Ismaïlov (ancien officier de l’armée russe devenu journaliste à Novaïa Gazeta) révélèrent des noms de personnes liées directement à l’enlèvement d’Arjan ou agissant comme intermédiaires. Les investigations menées par Ismaïlov pointaient la responsabilité d’un député daguestanais, Gazimagomed Magomedov, dont un frère était soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat par le FSB, en avril 2002, d’un militant saoudien combattant aux côtés des rebelles tchétchènes. Selon le journaliste, Magomedov était « un patron du crime organisé, se présentant en musulman observant alors qu’il [était] un agent double du FSB ». Figurant sur la liste des personnes à abattre d’une unité spéciale de la police daguestanaise, Magomedov utilisait Arjan Erkel « comme une sorte de police d’assurance ». « Si vous me tuez, alors vous tuez Erkel, et vous faites perdre la face au FSB ». Tel est son jeu », affirmait en novembre le journaliste de Novaïa GazetaVoir Coen van Zwol, « On connaît l’identité du ravisseur d’Arjan Erkel », NRC, 5 novembre 2003 ; et Coen van Zwol, « Mort pour les vivants », NRC, 16 novembre 2003..
À l’automne 2003, un autre intermédiaire proche du FSB, une association de vétérans des services de sécurité baptisée « Honneur & Vérité », sembla offrir de nouvelles pistes prometteuses. C’est le père d’Arjan Erkel qui avait suggéré à MSF de les contacter, avec l’assentiment du FSB et du gouvernement néerlandais. Début décembre 2003, les vétérans étaient confiants dans leur capacité d’obtenir la libération d’Arjan en échange de 180 000 euros (Arjan confirma après coup qu’une fois de plus ses ravisseurs l’avaient préparé à cette époque à sa libération imminente). Mais à l’instar des précédentes tentatives, l’initiative échoua, dans la confusion créée dans les milieux politico-criminels par l’arrestation pour complicité de kidnapping d’un policier daguestanais haut placéDocument interne MSF.. Décrivant rétrospectivement le sentiment de MSF-Suisse et du comité de suivi international à l’époque, le président et le directeur général de la section française écriraient en octobre 2004 :
« Après l’ultime échec en décembre 2003, un an et demi après l’enlèvement de notre collègue, nous étions très profondément inquiets pour sa vie et complètement démoralisés par la disparition de toutes les pistes concrètes qui auraient pu conduire à sa libération. À cette époque, M. Van Wulfften Palthe [un haut fonctionnaire du ministère néerlandais des Affaires étrangères] nous recommanda de rester patients, de préparer la famille Erkel au pire et de garder le silenceJean-Hervé Bradol et Pierre Salignon, « Arjan Erkel : enlèvement politique et mensonge d’État », Revue Humanitaire, n° 11, octobre 2004.. »
MSF pointe la responsabilité directe de parlementaires russes et daguestanais (janvier-mars 2004)
À l’opposé de la recommandation du ministère néerlandais des Affaires étrangères, le comité de suivi suggéra, le 14 janvier 2004, de « lancer une stratégie de communication/stratégie diplomatique forte fin février-début mars », si aucun canal de négociation concret n’avait été identifié au 1er février. La phase numéro un n’était pas nouvelle en ceci qu’elle avait pour objectif de maintenir la visibilité médiatique d’Arjan pour obtenir une « issue favorable de l’affaire ». La deuxième phase prévoyait de souligner le « manque total de volonté politique de résoudre l’affaire » des gouvernements tant néerlandais que russe. La phase finale serait celle du « j’accuse », dénonçant l’absence d’engagement néerlandais et l’incompétence ou la complicité des Russes« Plan de communication de la cellule de crise », février-mai 2004. Pour mémoire, le lobbying antérieur s’était concentré sur le ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov, l’Italie via Berlusconi, le gouvernement du Mexique en tant que présidence du Conseil de sécurité des Nations unies, Kofi Annan, Condoleeza Rice et Colin Powell. Cette deuxième période ciblait en particulier Sergeï Lavrov, supposé proche du président Poutine..
Alors que MSF-Suisse décidait d’appliquer ce plan, la section néerlandaise continuait à douter que pointer du doigt les Russes fût « la seule chose à faire ». Même en cas de complicité de la part des autorités russes, « les énerver à ce point [to piss them off] n’[était] pas nécessairement le bon moyen de les encourager à libérer l’otage. Cela pouvait même les inciter à l’exécuterEntretien avec Kenny Gluck (2009), ancien directeur des opérations de MSF-Hollande, Laurence Binet, op. cit., p. 309. ». La famille Erkel était plus directe encore. Elle tenait MSF pour responsable de la détention prolongée d’Arjan et menaçait l’organisation d’une action en justice si elle persistait dans sa campagne de communication« Embargo sur la campagne de communication », correspondance MSF, 26 février 2004..
MSF fit quelques tentatives pour rassurer la famille Erkel, puis lança le 1er mars sa campagne de mobilisation dénonçant le « scandale de la complaisance internationale » et l’« équilibre local et régional du pouvoir et des profits », qui semblaient peser plus lourd que la vie d’Arjan« Arjan Erkel, otage en Fédération de Russie depuis le 12 août 2002 », dossier de presse de MSF, 1er mars 2004.. Sa détermination était renforcée par le sentiment d’urgence né de la nouvelle, reçue début février, qu’Arjan était « gravement malade, atteint d’une infection pulmonaire, et qu’il pouvait être exécuté avant les prochaines élections présidentielles russes, prévues pour le mois de marsDocument interne MSF, se référant à une « source » de février 2004. L’équipe chargée d’évaluer après coup la gestion du kidnapping d’Arjan Erkel par MSF conclut que cette nouvelle alarmante était « une forme de désinformation délibérée » de la part des ravisseurs, qui provoqua un sentiment de panique au sein de MSF-Suisse et du comité de suivi.
». Le 9 mars, le président de la section française donna une interview pour le compte de la cellule de crise de Genève. Faisant implicitement allusion aux investigations du journaliste Viatcheslav Ismaïlov, il accusa des parlementaires du Daguestan et de la Fédération de Russie d’être impliqués directement dans l’enlèvement d’Arjan« MSF : des fonctionnaires impliqués dans l’enlèvement d’un représentant de MSF au Daguestan », AFP, 9 mars 2004 ; « MSF accuse des fonctionnaires russes de garder en otage l’un de ses volontaires », Le Monde, 10 mars 2004 ; « Médecins Sans Frontières accuse les autorités russes de complicité dans l’enlèvement d’un travailleur humanitaire », Associated Press, 11 mars 2004.. Pour toute réaction, la Russie se borna à signaler que les accusations de MSF étaient « non fondées et tirées par les cheveux« La Russie officiellement accusée d’enlèvements – MSF formule des déclarations désagréables », Nezavisimaya Gazeta, 11 mars 2004.».
Les vétérans, à nouveau (mars-avril 2004)
Arjan Erkel fut finalement libéré le 11 avril 2004, un mois après la campagne de presse et l’accusation publique des autorités daguestanaises et russes par MSF. Les circonstances exactes restent troubles. La libération d’Arjan fut officiellement décrite dans la presse russe comme le fruit d’une opération conjointe du ministère de l’Intérieur daguestanais et du FSB local ; aucun détail complémentaire ne filtra« Arjan Erkel, coordinateur de Médecins Sans Frontières, a été relâché au Daguestan », RIA Novosti, 11 avril 2004.. Selon son propre récit, Arjan Erkel fut transporté dans le coffre d’une voiture depuis son lieu de détention vers le siège du FSB à Makhatchkala, où des fonctionnaires l’informèrent qu’il était libre. Il fut alors brièvement débriefé, puis s’envola vers Moscou et les Pays-Bas. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères s’attribua le crédit pour sa libération, annonçant qu’il avait « donné le feu vert » au groupe de vétérans du FSB, qui avait été mandaté à nouveau pour négocier avec les ravisseursCoen van Zwol, Gijzelaar van de Kaukasus: De Ontvoering van Arjan Erkel, op. cit., p. 114..
Contrairement à sa politique officielle de non-négociation, le gouvernement néerlandais s’était finalement directement impliqué dans la libération de son ressortissant au bout d’un an et demi. C’est ce qu’avait fait comprendre à MSF un membre du ministère néerlandais des Affaires étrangères lors d’une réunion à Genève le 25 mars 2004. Furieux de la récente campagne de communication de MSF, il avait déclaré que « le gouvernement néerlandais n’avait pas d’autre choix que de lancer des négociations avec les autorités russes ». Et d’ajouter que « le gouvernement néerlandais enverrait la facture des négociations pour la résolution de l’affaire, quel qu’en soit le coût ». Quelques mois plus tard, le gouvernement néerlandais poursuivrait MSF en justice, exigeant le remboursement de « frais de service » de 1 million d’euros, supposés avoir été versés en liquide à l’association de vétérans pour faciliter la libération d’ErkelVoir MSF-France, conseil d’administration, 26 mars 2004. MSF ayant rejeté sa demande de remboursement, l’État néerlandais décida de porter plainte contre la section suisse. Après deux jugements favorables à MSF en première et deuxième instances, contestés en appel, le Tribunal fédéral, la plus haute instance judiciaire suisse, exigea finalement de MSF en 2008 qu’elle rembourse la moitié de la rançon. « Il est inacceptable de faire porter à une organisation humanitaire la responsabilité de payer en partie une rançon négociée et versée par un gouvernement. En acceptant, comme le demandait le gouvernement néerlandais, de réduire les conséquences de l’enlèvement d’un travailleur humanitaire à un simple litige commercial, la décision du Tribunal fédéral participe à la banalisation des crimes commis contre les travailleurs humanitaires qui se multiplient en toute impunité depuis plusieurs années », commenta MSF. « Décision choquante et désolante du Tribunal fédéral dans le procès qui opposait MSF et le gouvernement néerlandais », communiqué de presse MSF, 14 juillet 2008..
Faire face à l’incertitude
Douze ans après la libération d’Arjan Erkel, nous ne savons toujours pas qui étaient ses ravisseurs (ceux qui ont procédé à l’enlèvement initial), ses geôliers (ceux qui l’ont gardé en détention pendant six cent sept jours) et les commanditaires (ceux qui ont décidé de l’enlèvement et de la libération). Dans son livre, Arjan Erkel décrit ses geôliers comme des militants islamistes tchétchènes. Il précise qu’ils firent référence à plusieurs reprises au montant de la rançon qu’ils espéraient toucher, tout en indiquant que MSF n’était pas particulièrement visée pour ses activités ni ses positions publiques antérieuresArjan Erkel, op. cit.. Le FSB continua de s’abstenir de tout commentaire sur les détails de la libération d’Erkel ou sur les responsables de l’enlèvement. Quant au président de l’association des vétérans du FSB, il fit vaguement référence à « des criminels, un groupe mélangé de nationalités, y compris, [pensait-il], des Tchétchènes ». Entre-temps, et bien que s’étant octroyé le crédit de la libération d’Arjan Erkel, le gouvernement néerlandais maintint sa discrétion publique, notamment à l’égard des autorités russes, et ne put ou ne voulut fournir de détails sur les responsables de cette affaire« La lumière est faite sur la libération d’Erkel », Simon Ostrovsky, The Moscow Times, 15 avril 2004..
Du point de vue de MSF, la surveillance de longue date d’Erkel, la passivité des agents du FSB pendant son enlèvement, la suspension de l’enquête, la clôture de la ligne téléphonique d’où avaient été passés des appels vers le FSB et des contacts militaires russes après sa disparition, l’absence initiale de demande de rançon malgré les preuves de vie : tous ces indices signalaient que, si l’enlèvement n’avait pas été commandité par les autorités russes, celles-ci l’avaient, au minimum, toléré. « Les empreintes du FSB étaient partout : nous avons fini par les engager », résume un membre du comité de suivi en 2015Entretien avec Jean-Hervé Bradol, 26 juin 2015..
Selon la plupart des diplomates et des spécialistes consultés à l’époque par MSF, des pressions politiques étaient nécessaires pour obtenir l’implication des services secrets russes dans la libération d’Erkel – une analyse que partageaient tous les membres de MSF en dépit de leurs divergences sur l’opportunité de recourir à des campagnes d’opinion.
Malgré sa demande officielle d’une libération inconditionnelle, MSF se révéla disposée à tout moment à user de tous les moyens possibles afin de libérer Arjan Erkel. Dans la pratique, MSF-Suisse associa, tout au long de l’affaire, pressions politiques et propositions informelles de régler l’affaire par le biais d’une transaction commerciale confidentielle.
La décision risquée de dénoncer les gouvernements russe et néerlandais pour leur complicité (au minimum passive) fut d’autant plus difficile à prendre que la famille d’Arjan, et bien entendu La Haye, s’y opposaient. Les relations entre MSF et la famille Erkel avaient été difficiles dès le début, bien avant l’émergence de désaccords sur la manière de gérer le kidnapping. La désapprobation du père d’Arjan à l’égard de l’engagement de son fils pour MSF n’y était peut-être pas étrangère. Mais c’est autour de la stratégie finalement adoptée par MSF-Suisse et plus particulièrement du recours à la mobilisation publique (contraire aux recommandations des experts privés et gouvernementaux) que les désaccords se cristallisèrentVoir le courrier de Thomas Linde, directeur général de MSF-Suisse, et de Morten Rostrup, président du Conseil international de MSF, à l’ambassadeur de Russie en Suisse, 23 août 2002.. Apparemment convaincu que l’enlèvement n’impliquait que des criminels de droit commun et que les autorités russes essayaient sincèrement d’aider à sa résolution, le père d’Arjan interpréta la stratégie de MSF comme le signe d’un manque de professionnalisme. MSF-Suisse échoua à communiquer à la famille sa conviction que sa stratégie était la meilleure du point de vue des intérêts d’ArjanEntretien avec Michiel Hofman, ancien chef de mission de MSF-Hollande en Russie, 25 juin 2015.. Le choix de traiter avec la famille par l’intermédiaire de la section hollandaise plutôt que par des personnes de la section suisse directement impliquées dans les négociations contribua à cet échec.
En définitive, la libération d’Arjan fut-elle facilitée ou entravée par les campagnes médiatiques ? S’il est impossible de répondre à cette question, certaines observations peuvent être formulées sur la base de la chronologie des événements. Les premières preuves de vie et la libération finale suivirent de peu les campagnes médiatiques. Cela tend à soutenir l’hypothèse formulée par la majorité des membres de la cellule de crise, du comité de pilotage et du comité de suivi, à savoir que les autorités russes étaient impliquées au plus haut point et qu’elles n’agiraient que sous la pression politique, de même que le gouvernement néerlandais, lié à Moscou par des intérêts stratégiques et économiques plus importants que le sort d’un de ses ressortissants.
Néanmoins, le responsable de la cellule de crise de MSF à Moscou jugeait la campagne spécifique d’août 2003 contre-productive. Certes, le premier anniversaire de l’enlèvement était un symbole fort pour la presse, ce qui justifiait que MSF cherche à en tirer profit. Mais il était à ses yeux tactiquement inopportun de « titiller la bête [le FSB] pendant qu’elle essa[yait] d’aiderEntretien avec Steve Cornish, ancien responsable de la cellule de crise à Moscou, 29 mai 2015.
». Selon lui, les services secrets russes venaient de s’impliquer directement dans l’identification d’un intermédiaire, avec lequel les négociations semblaient susceptibles d’aboutir ; ce n’était pas le moment de les irriter. Le comité de pilotage et la cellule de crise de Genève considéraient pour leur part que la iste n’était pas assez prometteuse pour justifier de suspendre la campagne de communication.
Certainement, la mobilisation publique était porteuse de risques autant que de bénéfices potentiels. Il allait de soi que l’accusation « d’un manque flagrant d’implication des autorités russes et d’une enquête menée avec fort peu de conviction » ferait réagir celles-ci de manière défensive« Un an après l’enlèvement d’Arjan Erkel, MSF considère que l’enquête est un échec et en appelle à une action renforcée de la part des autorités russes pour résoudre l’affaire », communiqué de presse MSF, 12 août 2003.. Mais, surtout, cette mise en cause aurait également pu mettre Arjan Erkel en danger. La possibilité fut envisagée à l’époque par la cellule de crise. Elle décida toutefois de persévérer, considérant que la vie d’Arjan serait encore davantage exposée si elle se contentait d’attendre, tandis que lui parvenaient des nouvelles alarmantes sur son état de santé, les menaces d’exécution, et que le gouvernement néerlandais invitait à se préparer au pire.
En définitive, ce récit de l’enlèvement d’Arjan Erkel et de sa libération révèle les limites des guides et formations sécuritaires évoqués dans la première partie de cet ouvrage. Le flou qui entoure l’identité et les motivations des ravisseurs, des geôliers et des commanditaires – et de ce fait, la difficulté à évaluer les conséquences des décisions prises – génèrent une incertitude que ni les algorithmes, ni les procédures standardisées ne sont en mesure de réduire. La résolution d’un kidnapping procède moins du suivi rigoureux de protocoles que d’une navigation à vue, de discussions et de révisions permanentes des hypothèses et décisions, et enfin de la capacité à saisir toute opportunité de libérer un collègue (ou de s’échapper lorsqu’on est otageParmi les trois autres employés de MSF victimes d’un enlèvement de longue durée dans le Caucase, l’un s’est échappé. Un autre a été libéré sans condition et le troisième a été échangé contre une faible rançon..)
En 2015, relisant une première version de ce chapitre, le directeur des opérations qui a arbitré et pris les décisions dans cette affaire concluait : « Ce qui est positif à mes yeux, c’est que MSF-Suisse a toujours fait preuve d’une certaine transparence à propos des dilemmes rencontrés et des décisions prises, ce qui nous permet aujourd’hui de discuter ouvertement du sujet. En fin de compte, nous avons jusqu’au bout navigué en eaux troubles dans un brouillard très épais et, encore aujourd’hui, nous ne savons pas ce qui a fonctionné ou pas. Il faudrait que nous posions la question un jour aux Russes ! »
Traduit de l’anglais
par Guillaume Nail et Judith Soussan
Période
Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter afin de rester informé des publications du CRASH.
Un auteur vous intéresse en particulier ? Inscrivez-vous à nos alertes emails.
