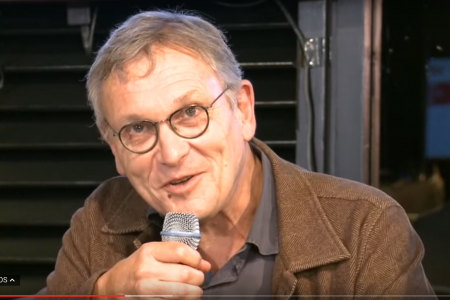Rony Brauman : « Ce n’est pas “America first” mais “America only !” »
Rony Brauman
Dans un article du Monde publié le 28 mars 2025, Rony Brauman revient sur les coupes de budget américaines. Pour l’ex-président de Médecins sans frontières France, l’arrêt des financements de l’aide étrangère par l’administration Trump est « une décision au moins aussi grave et perverse que l’invasion de l’Irak en 2003 ».
Quel est l’impact direct de l’arrêt des financements de l’aide étrangère américaine ?
La conséquence immédiate tangible, c’est le licenciement de milliers de travailleurs de l’aide. C’est aussi la privation de traitements médicaux pour des centaines de milliers de malades, notamment du sida, de la tuberculose ou du paludisme. Soit parce que les stocks de médicaments ne sont plus distribués, soit parce qu’il n’y a plus de personnel sur le terrain pour les administrer. Avec les coupes des financements à destination du fonds global de l’ONU, par exemple, ou encore la suppression du President’s Emergency Program for AIDS Relief Programme lancé en 2003 par la Maison Blanche pour lutter contre le sida., ce sont des pans entiers de la lutte contre les virus, les épidémies et les pandémies qui sont mis en pièces. Nous allons vers des épidémies de paludisme beaucoup plus intenses et la circulation de germes de la tuberculose plus résistants.
Quant aux programmes de nutrition, nous n’avons pas encore de chiffres stabilisés, mais la distribution aux enfants de compléments alimentaires au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso et dans le plus grand camp de réfugiés du monde, qui accueille des réfugiés rohingyas au Bangladesh, est déjà entamée ou suspendue. Quelque 30 % à 40 % des budgets de nombreux pays africains dépendent de l’aide internationale. A terme, beaucoup de gens vont mourir, on parle de millions de vies, je ne sais pas…
Mesure-t-on tous les effets induits par ces décisions à ce jour ?
Absolument pas. Par exemple, l’arrêt des opérations de déminage, au Cambodge, en Ukraine ou au Liban signifie des pertes sèches de terres cultivables et donc plus d’émigration des paysans concernés. En matière de santé, les coupes dans l’USAID affectent directement le financement de la recherche épidémiologique. Aux Etats-Unis, à l’université Johns-Hopkins, leader mondial dans ce domaine, ce sont au bas mot 1 600 à 2000 personnes qui sont licenciées. C’est autant de programmes de recherche en cours qui sont arrêtés. C’est aussi le cas au sein du National Institutes of Health, autre acteur incontournable de la recherche. Ce ne sont pas les labos pharmaceutiques qui vont se substituer à la recherche. La recherche a besoin de liberté et de financements. Désormais, on va avancer avec des semelles de plomb.
Les Etats-Unis avaient décidé en 2003 de s’impliquer dans la recherche et le traitement d’une maladie comme le sida parce qu’elle posait une menace contre la sécurité globale. En décimant les classes moyennes éduquées urbaines, le sida affaiblissait les Etats et leurs structures sécuritaires. Aujourd’hui, tout cela est remis en cause.
En se retirant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui était déjà une organisation pauvre, les Etats-Unis laissent le champ libre aux intérêts privés et aux préférences de quelques milliardaires. Les Etats-Unis sont en train de saboter leur propre système de sécurité. Quand ils vont s‘apercevoir qu’ils ne seront pas épargnés par les menaces virales accrues, qu’il s’agisse du chikungunya, du VIH, d’Ebola, du Covid, ils prendront probablement des mesures correctives. Mais on ne rattrape jamais le temps perdu en matière épidémiologique.
Washington a amputé 92 % du budget de l’USAID, qui représente à elle seule 42 % du total de la solidarité internationale. Quelle leçon en tirez-vous ?
L’énormité de l’implication américaine dans le dispositif de l’aide fait prendre conscience d’un déséquilibre fondamental du système. Ce que révèle cette décision, c’est que tout le système est hyperdépendant des Etats-Unis, trop dépendant. Ce n’est pas tant la décision de réduire les financements en elle-même qui est le plus gros problème finalement, c’est surtout sa soudaineté et sa brutalité. Aujourd’hui, c’est la panique. Car, s’il est en principe convenu qu’une ONG ou une agence onusienne ne devrait pas recevoir plus de 20 % d’un même bailleur, afin de garder une marge de manœuvre en cas de désaccord, dans les faits cela n’a pas été le cas pour tous. C’est comme si une bulle boursière avait explosé. Et même les ONG qui ne dépendent pas de l’aide américaine, comme MSF par exemple, sont affectées. Nous nous retrouvons, par exemple, obligés de prendre en charge l’accès à l’eau en Haïti à cause de l’arrêt des programmes par nos partenaires affectés par la décision américaine. Non seulement ce n’est pas le cœur de métier de MSF, mais cela entame nos ressources.
Cette baisse drastique de l’aide ne concerne pas que les Etats-Unis…
Ces dernières années, les autres pays occidentaux, comme la France ou l’Allemagne, avaient accru leur aide pour prévenir les mouvements migratoires massifs en finançant les pays de départ ou de transit. Mais, oui, ils avaient annoncé avant la décision de Washington une baisse de leurs financements à la solidarité internationale.
Le secteur privé peut-il prendre le relais ?
Tout le secteur va dépendre bien davantage des donateurs privés. Il va y avoir une concurrence accrue pour capter leurs ressources. Sans compter que l’administration Trump dispose d’un pouvoir énorme, celui de classer une ONG comme « charity » ou pas, ce qui détermine les réductions d’impôts potentielles de ses donateurs. Or, il y a le risque que cette administration adopte des critères idéologiques, comme la lutte antiwoke par exemple, pour délivrer le label de « charity ».
La Chine peut-elle se substituer aux Etats-Unis en tant que puissance globale humanitaire ?
La Chine, dans sa quête d’un statut de grande puissance, contribue déjà au financement de grandes institutions internationales et investit de plus en plus les postes disponibles, ce qui lui donne un pouvoir d’influence assez fort. Etant donné les liquidités dont elle dispose, c’est l’occasion rêvée de prendre le pouvoir dans des institutions comme l’OMS ou la Banque mondiale. Mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle finance des ONG en qui elle n’a pas confiance.
Qu’est-ce que cette décision américaine dit de l’état du monde ?
C’est une décision qui flatte le nationalisme sectaire et l’hostilité à l’étranger. Le chacun pour soi devient la règle. Ce n’est pas « America first » mais « America only » ! Cette décision concrétise des tendances présentes dans le monde entier, elle entretient un climat de méfiance et de paranoïa déjà à l’œuvre. On l’a vu avec les attaques sans précédent d’Israël contre l’UNRWA L’agence de l’ONU d’aide aux réfugiés palestiniens créée en 1949. à Gaza.
Heureusement, tout le monde n’a pas perdu la tête, on ne peut pas faire le deuil de l’aide internationale. Les pays européens représentent une part importante, car c’est un sujet de sécurité globale. Mais il est clair que cette décision américaine officialise et cristallise un changement de paradigme qui était déjà à l’œuvre. C’est une décision au moins aussi grave et perverse que l’invasion de l’Irak en 2003. Nous nous dirigeons vers des temps sombres.
Propos recueillis par Christophe Ayad et Louise Couvelaire, pour Le Monde.