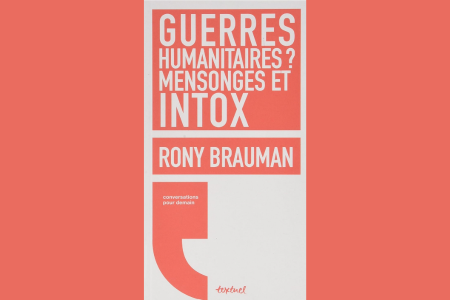A quoi sert le droit humanitaire ?
Rony Brauman
Article publié dans l'Annuaire Français des Relations Internationales, AFRI, Volume XX, 2019
« De toutes nos illusions contemporaines,
la plus dangereuse […] est l’idée que nous
vivons une période sans précédent. »
Tony Judt, Retour sur le XXe siècle.
Histoire de la pensée contemporaine, 2010
A entendre des porte-parole d’organismes humanitaires, les normes et principes qui fondent leur action sont battus en brèche depuis la fin de la Guerre froide, ce recul mettant en danger les équipes humanitaires et les opérations qu’elles conduisent. Dès le milieu des années 1990, au décours de la guerre de Bosnie et du génocide tutsi, la référence à un « avant » s’est fait entendre. Les massacres commis dans ces deux pays et qui faisaient suite aux guerres civiles de Somalie et du Liberia formaient un paysage de violences généralisées, de « conflits déstructurés » n’épargnant dorénavant pas même les personnels humanitaires ni les journalistes. On insistait sur le contraste avec les conflits antérieurs, régulés par les superpuissances, dont les belligérants auraient été de ce fait accessibles aux attentes des humanitaires. « Les civils sont non seulement victimes des conflits, mais ils sont la cible même des conflits : cela constitue une évolution considérable en ce qui concerne, en tous les cas, le 20e siècle », disait, en 1999, le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)Jean-Daniel Tauxe, in Actes du colloque « L’Humanitaire en échec ? » organisé à Paris le 4 février 1999.. Avec la « guerre contre le terrorisme » déclarée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les infractions au droit international humanitaire (DIH) sont décrites comme étant « de plus en plus graves ». Ces alertes culminent, au moment où ces lignes sont écrites, avec les attaques systématiques d’hôpitaux et d’autres lieux civils en Syrie. Des attaques comparables en Afghanistan, au Yémen et au Soudan du Sud complètent ce tableau d’un DIH autrefois respecté et désormais piétiné. La preuve par les chiffres est parfois avancée : la Première Guerre mondiale serait caractérisée par une écrasante proportion de victimes militaires, tandis que les conflits armés contemporains montreraient une proportion inverse, attestant l’excès de cruauté de ces nouvelles guerres.
Il n’est évidemment pas question ici de contester la réalité ni l’horreur des bombardements de quartiers civils en Syrie, qui ne sont que trop réels et révoltants. Il s’agit plutôt de s’interroger sur la pertinence de campagnes et de discours publics visant à réhabiliter le DIH, supposément mieux appliqué dans le passé et dont la promotion deviendrait, au vu des évolutions des conflits armés, un enjeu important de l’action humanitaire contemporaine. C’est donc à une réflexion sur la fonction politique du DIH, éclairée par son histoire, ainsi que par les attentes qu’on peut placer en lui, qu’est consacré cet article.
Les citation et situation évoquées dans cette étude sont principalement, mais pas exclusivement, puisées dans les déclarations et opérations du CICR et de Médecins sans frontières (MSF). Nous sommes bien conscients du fait que des institutions onusiennes, tels le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) sont parties prenantes et auraient figurer dans ce texte. Nous avons toutefois choisi, en tant que membre de MSF, de concentrer notre critique sur cette ONG, considérant que celle-ci est applicable dans les mêmes termes aux autres intervenants humanitaires. Quant au CICR, dont les principes humanitaires formulés en 1965 ne font pas partie du corpus du DIH, mais sont souvent invoqués, il occupe dans notre travail la place qui est naturellement la sienne en tant que gardien statutaire des Conventions de Genève.
Le militaire, le juriste et le secouriste
Commençons par la Première Convention de Genève, point de départ du DIH contemporain, bien qu’elle ne comporte pas le mot « humanitaire ». Signée le 22 août 1864 Douze Etats l’ont signée : le Grand-duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, le Grand-duché de Hesse, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse, le Wurtemberg., elle traite, selon son titre et en dix articles déclinés sur deux pages, de l’« amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne » et peut se résumer en deux points : d’une part, elle prescrit de reconnaître comme neutres, c’est-à-dire soustraits aux hostilités, ce qui est nécessaire aux soins des soldats malades et blessés, à savoir les ambulances et les hôpitaux ; d’autre part, elle introduit un « drapeau distinctif et uniforme », emblème commun à toutes les nations, portant croix rouge sur fond blanc, ainsi qu’un brassard pour le personnel « neutralisé » frappé du même emblème, contretype du drapeau suisse, en hommage au pays hôte de la conférence.
La Convention a évolué, s’est étoffée au fil de conférences ultérieures, elle a étendu son champ aux naufragés (1906), puis aux prisonniers (1929) et, enfin, aux populations civiles (1949). Des « protocoles additionnels » ont été adoptés en 1977 afin de les adapter à des conflits impliquant des forces « irrégulières » dans des conflits internes, à la suite des guerres de décolonisation et de la guerre du Vietnam. Des dix articles composant le premier document, on est passé à 559 articles pour la convention actuellement en vigueur. Autant dire que le DIH est devenu l’affaire d’experts, juristes civils et militaires, disposant d’un matériau se prêtant à des lectures variées et contradictoires.
Revenons aux origines de ce droit, qui nous disent quelque chose de ses difficultés d’application, bien avant les violations contemporaines décrites comme plus graves et plus fréquentes. Le droit humanitaire s’inscrit dans un cadre normatif déjà établi – la distinction entre combattants et noncombattants, théorisée notamment par des philosophes et juristes des Lumières (Grotius, Rousseau, Vattel notamment). Ainsi, les garanties accordées aux prisonniers de guerre par la Convention de 1929 figurent déjà dans le Traité d’amitié et de commerce de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis. Le traitement des prisonniers de guerre constituait, bien avant les conventions humanitaires formalisées comme telles, un enjeu politique central en rapport avec l’essor des mobilisations militaires de masse Sébastien Farré, Colis de guerres. Secours alimentaire et organisations humanitaires (1914-1947), Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 21..
La bataille de Solférino reste dans la mémoire du mouvement humanitaire l’événement fondateur qui allait déboucher sur l’adoption de ce premier traité diplomatique à visée humanitaire. Une coalition franco-sarde dirigée par Napoléon III combattait les armées autrichiennes, dirigées par l’empereur François-Joseph. Là, aux environs de ce village du nord de l’Italie, s’est déroulé en 1859 l’un des affrontements les plus sanglants depuis la fin des guerres napoléoniennes, laissant à terre plus de trente mille morts et blessés en une seule journée de combat. Henri Dunant, un citoyen suisse qui cherchait à entrer en contact avec Napoléon III afin de lui demander une concession en Algérie, a découvert le champ de bataille et ses agonisants, un spectacle qui a bouleversé cet évangélique ardent – il a été l’un des fondateurs de l’Union chrétienne des jeunes gens, connue plus tard sous le nom de YMCA. Dunant participa activement à l’organisation des secours aux blessés, toutes nationalités confondues, et rédigea à la suite de cette expérience un récit saisissant de la bataille, célébrant les exploits guerriers des combattants et détaillant crûment les souffrances des blessés abandonnés à leur sort.
Son livre Un souvenir de Solférino, publié en 1862 et qu’il appelait son « manifeste humanitaire », fut un grand succès en Europe. Il donna lieu à la création en 1863 d’une « Société pour le secours aux blessés militaires » – qui allait devenir le Comité international de la Croix-Rouge dix ans plustard –, dont la première initiative fut la tenue dès 1864 de la conférence diplomatique mentionnée plus haut. Moins de deux ans s’étaient écoulés entre la publication du récit de la bataille et la tenue de la conférence : c’est dire que le projet résonnait favorablement, tant dans les sphères de pouvoir que dans l’opinion, la France impériale s’étant montrée particulièrement bienveillante envers lui. C’est d’ailleurs un ex-officier de l’armée de Napoléon III, le général suisse Guillaume-Henri Dufour, qui fut le premier président de cette nouvelle société humanitaire.
Voilà qui rappelle que le droit dans la guerre (jus in bello) est d’abord l’affaire des belligérants, donc des pouvoirs politiques, et que les termes des conventions humanitaires ont été dès l’origine et tout au long de leur histoire négociés par des plénipotentiaires et des généraux des différents Etats signataires. Un tel droit n’est pas simplement l’oeuvre de philanthropes visionnaires, comme on le suggère généralement en le plaçant sous la figure d’Henri Dunant, mais le témoin de la militarisation des sociétés charitables. Les Croix-Rouge « sont pensées à partir de la fin du XIXe siècle comme un service auxiliaire volontaire des armées en campagne » Ibid..
Nous reviendrons sur ce point, après avoir souligné que le brouillage de la distinction entre civils et combattants ne date pas des conflits de ces trente dernières années : il est déjà à l’oeuvre au moment même où est signée la première convention. Pour cruelle qu’elle fût, la bataille de Solférino s’est en effet déroulée à la manière d’un duel collectif. Livrée à l’écart du bourg, mettant aux prises des combattants en uniforme, elle a commencé à l’aube et a pris fin le soir, avec la déroute de l’un des deux camps, en l’occurrence les Autrichiens. Loin d’être le modèle des guerres suivantes, elle est au contraire la dernière de ce genre, du fait des évolutions techniques et des changements politiques de l’époque.
Ainsi, la guerre civile américaine (1861-1865) mettait en jeu des armes d’une puissance inédite, comme la mitrailleuse et les premiers blindés, des moyens logistiques nouveaux comme le train, ainsi que des fusils tirant plus vite et plus loin. Cette même année, face à des combattants sudistes soutenus par une grande partie de leur population, le général nordiste Sherman lançait ses troupes dans une « marche vers la mer » ne faisant aucun quartier, détruisant bâtiments et récoltes afin de briser le moral de l’ennemi en faisant peser la guerre sur les civils. Si les Etats- Unis n’étaient pas partie prenante à la première Convention de Genève, ils avaient néanmoins élaboré dès 1863, leur propre jus in bello, le code Lieber, compilation de textes existants qui visait à limiter la violence infligée aux populations du Sud confédéré. Lieber reconnaissait ainsi leur existence dans la guerre en leur déniant explicitement toute reconnaissance politique. A l’inverse et jusqu’en 1949, les civils sont ignorés dans les conflits internationaux visés par les Conventions successives de Genève.
La codification des conflits armés, qu’ils soient internationaux ou internes, était certes inspirée par la volonté de limiter la violence, mais elle laissait aux généraux – comment aurait-il pu en aller autrement ? – le dernier mot quant à l’appréciation des « nécessités militaires », notion-clef qu’intègre naturellement le droit humanitaire.
Quelques années plus tard, pour justifier la violence de la répression contre les francs-tireurs, lors de la guerre de 1870-1871, le commandement allemand invoquait la Convention de Genève, violée par les Français du fait de la présence de ces combattants « irréguliers ». Le droit humanitaire naissant était à nouveau pris de court peu après, lors du siège de Paris, dans le contexte d’une guerre d’où avaient disparu la notion de champ de bataille et, donc, la distinction entre combattants et non-combattants, entre front et arrière. Dunant, admirateur de Napoléon III, se trouvait d’ailleurs à Paris lors de la « semaine sanglante » (21-28 mai 1871), lorsque les troupes versaillaises écrasaient l’insurrection parisienne, mais n’en a guère parlé dans ses écrits, lui qui avait été choqué par le carnage de Solférino. Les indignations sélectives ont une longue histoire !
Le dernier tiers du XIXe siècle, marqué par le progrès des transports et des communications, a également été celui de l’intensification des conquêtes coloniales, « ipso facto transformées en guerres justes au nom du droit naturel, de commerce, de circulation et de propriété », comme l’a écrit l’historien Enzo Traverso « Interpréter la guerre », in Le XXe siècle des guerres, Editions de l’Atelier, 2004, p. 488.. Être humanitaire, c’est par définition se référer à une espèce humaine unique, mais la notion d’égalité existentielle de tous les humains n’y est pas nécessairement comprise. Tous humains, mais certains plus que d’autres, pour le dire à la façon d’Orwell. Exemple : les munitions explosives furent proscrites pour « excès de cruauté » par la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), mais elles restaient autorisées pour la chasse aux grands fauves et les guerres coloniales. Cette distinction entre humains a été théorisée, selon les termes de l’époque, par Gustave Moynier, cofondateur et deuxième président de la Croix-Rouge – poste qu’il occupa pendant 36 ans –, écrivant que ses principes fondateurs étaient le produit de la morale évangélique et de la civilisation. L’idéal humanitaire était par conséquent « inaccessible aux tribus sauvages [...] qui cèdent sans arrière-pensées à leurs instincts brutaux tandis que les nations civilisées cherchent à l’humaniser » Gustave Moynier, Les Causes du succès de la Croix-Rouge, Académie des sciences morales et politiques, Paris, 1888.. On voit que les normes humanitaires, loin d’être un bien intemporel, n’échappent ni aux représentations dominantes de leur époque, ni aux rapports de forces politiques.
Les conflits et massacres des guerres civiles et des conquêtes impériales apparaissent rétrospectivement comme l’annonce des guerres totales du XXe siècle, mécanisées et industrialisées, tandis qu’était adopté un traité qui regardait vers une bataille emblématique du XIXe. Dunant a d’ailleurs pressenti la totalisation des conflits armés dans un recueil de textes intitulé de façon prémonitoire L’Avenir sanglant, publié à la fin de sa vie. On sait ce qu’il en a été des normes humanitaires au long de l’« âge des extrêmes », comme l’a nommé l’historien Eric Hobsbawm, caractérisé par les massacres coloniaux, les guerres mondiales, les génocides, les guerres civiles et les camps de concentration. S’il est un moment de l’histoire où fut ignoré non seulement tout principe de miséricorde mais aussi toute préoccupation d’économie de la vie humaine, ce fut ce « court XXe siècle » (1914-1991), bien plus que ces trente dernières années.
Le supposé recul des normes humanitaires serait un effet du changement de nature des conflits contemporains, désormais intra- et non plus inter-nationaux. Il est vrai que les conflits d’après-Guerre froide sont principalement des conflits internes et non plus interétatiques. Des Etats étrangers y restent néanmoins impliqués et la fin de la Guerre froide, comme nous le rappellent les conflits en cours au Proche-Orient et en Afrique, ne signifie pas la fin des confrontations par proxies. Ces derniers ne sont cependant plus les clients dociles de puissants patrons, échappant volontiers au contrôle de ceux-ci en nouant leurs propres alliances, de même qu’ils manifestent une tendance à la fragmentation qu’atteste la multiplication de groupes armés. La fin de la confrontation Est-Ouest a, de facto, modifié les formes de conflictualité.
Est-ce à dire pour autant qu’ils font désormais plus de victimes chez les civils que chez les combattants ? C’est ce qu’affirmait, par exemple et entre autres, le rapport de l’Unicef présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1996 et repris dans un autre document de cette institution en 2009 : « Déjà en 1996, l’étude Machel notait avec une profonde préoccupation que les tactiques de guerre avaient changé et que les civils, surtout les enfants, étaient de plus en plus souvent les cibles de la violence et les victimes d’atrocités. Malheureusement, cette tendance se poursuit. L’impact des conflits armés sur les enfants et sur les populations civiles en général est encore plus terrible de nos jours qu’à l’époque. Aujourd’hui, les groupes armés adoptent des tactiques de guerre qui cherchent à amener le combat plus immédiatement, plus systématiquement et plus massivement au coeur de la population civile » Examen stratégique décennal de l’« Etude Machel », Les Enfants et les conflits dans un monde en mutation, Unicef, 2009.. La dénonciation de cette prétendue dégradation est devenue un lieu commun dans le milieu humanitaire, où est fréquemment mis en avant le déprimant constat évoqué plus haut, souvent résumé en deux chiffres : au cours de la Première Guerre mondiale, 80 à 90% des victimes étaient des soldats, tandis que désormais, on observerait la proportion inverse Cf. notamment Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford
University Press, 1999. Cf. également Adam Roberts, « Lives and statistics: are 90% of war victims civilians? »,disponible sur le site weblearn.ox.ac.uk/access/content/user/1044/Survival_Jun-Jul_2010_-_AR_on_lives___statistics_-_non-printable.pdf..
En réalité, les premières victimes des conflits actuels, en nombre tout au moins, sont des hommes jeunes, en âge de combattre. Sans doute est-on plus sensible aux pertes concernant les femmes et les enfants, mais elles sont numériquement moins importantes que les pertes concernant les hommes. Ce rapport de 90/10 relève plus d’une recherche de dramatisation que d’une estimation chiffrée. Soulignons également la difficulté de distinguer civils et combattants dans des conflits internes, où on peut souvent être l’un et l’autre selon le moment. On a vu précédemment que ce brouillage est général dès la fin de XIXe siècle et ne doit rien aux « nouveaux conflits », contrairement à ce qui est souvent dit. Ce qui choque particulièrement dans cette affirmation est la présentation avantageuse de la guerre 14-18, l’acquiescement à la mort de près de vingt millions d’hommes, d’ailleurs pour moitié des civils, et la mutilation de plusieurs autres millions. Que cette boucherie puisse être publiquement invoquée comme modèle de respect du droit humanitaire sans susciter de réaction immédiate de rejet, voilà qui montre avec quelle facilité ce droit s’inscrit dans une logique de tueries de masse, pourvu que ces dernières puissent être rangées dans la catégorie des « nécessités militaires ».
Faut-il alors se débarrasser du droit humanitaire ? Non, car il permet aux organisations humanitaires d’ouvrir un espace de négociations avec les gouvernements. Ceux qui en acceptent le principe, naturellement, et ce n’est pas le cas de tous, mais beaucoup y consentent. Les organisations humanitaires peuvent s’y adosser, afin de renforcer leurs demandes d’autorisation d’agir, et conforter leur statut d’acteurs légitimes dans des conflits au nom même des engagements pris par ces Etats. Ni morale à brandir, ni artefact à dédaigner, le droit humanitaire aide les organisations humanitaires à trouver leur place dans la guerre. Ce n’est pas rien et, pour cela, il doit être défendu. En attendre plus, c’est oublier ce qu’il est profondément et s’illusionner sur ses vertus. Laisser entendre que la guerre peut être « civilisée » par le droit, c’est ignorer les réalités politiques du droit et de la guerre.
Henri Dunant parlait de créer des « oasis d’humanité » dans le déferlement de violences qu’est la guerre. Prenons cette formule au mot : les humanitaires tentent, avec des succès divers mais réels, de créer de telles oasis d’humanité minimale, qu’il s’agisse de lieux de soins ou de distributions de vivres et de matériel de survie. Pour ceux qui peuvent en bénéficier, c’est précieux, parfois salvateur, mais cela ne devrait pas masquer une réalité crue : les humanitaires et les principes qu’ils invoquent ne modifient en rien la réalité de la guerre, qui est celle d’une fabrique de décombres.
« Même la guerre a des règles », peut-on lire sur des affichettes éditées par Médecins sans frontières (MSF) pour protester contre des bombardements d’hôpitaux. En théorie, sans doute, les hôpitaux et autres biens civils devraient être épargnés. En pratique, la guerre n’a qu’une règle, la recherche de la victoire ou de gains divers, les moyens employés dans ce but pouvant néanmoins différer d’une situation et d’une époque à l’autre. Demeure ce point fondamental que, pour des forces politiques engagées dans des conflits armés – Etats ou acteurs non étatiques –, les frontières de l’intolérable se confondent avec celles de leurs intérêts. D’une manière générale, selon que le pouvoir sera ou non soucieux de s’attirer les bonnes grâces de la population, il se conduira avec plus ou moins d’aménité à son égard. Et selon le degré d’importance qu’il attache à son image internationale, il modulera son niveau de brutalité. L’armée américaine, par exemple, a mis au point un logiciel qu’emploient ses officiers de ciblage (targetting officers) pour anticiper, en fonction de divers paramètres (densité de population, heure de la journée, types de constructions, etc.), les dommages collatéraux de bombardements de quartiers urbains. Objectif : éviter des pertes civiles supérieures à vingt-neuf morts, car le chiffre trente est le seuil à partir duquel des signaux négatifs apparaissent dans la presse, selon ses conseillers Cf. les propos d’Eyal Weizmann disponibles sur le site www.radicalphilosophy.com/article/forensicarchitecture#fnref56..
Un autre exemple : l’usage du lance-flammes, introduit par l’Allemagne en 1915 et largement utilisé par la suite, a été considéré comme le symbole de la cruauté de la guerre du Vietnam dans les années 1970. La célèbre photographie de la petite fille brûlée fuyant une attaque au napalm a soulevé l’indignation générale, notamment aux Etats-Unis, et poussé le Pentagone à supprimer cette arme du champ de bataille en 1978. Dans un article consacré à ce sujet, un officier vétéran du Vietnam précise que ce type d’arme, outre la mauvaise image qu’il véhiculait, fut en fait considéré comme inutile dans le contexte de l’hypothèse d’une guerre contre les Soviétiques, ce qui n’est plus le cas dans les conflits contemporains, où est réapparu le combat rapproché. Et cet officier de se féliciter qu’il ait été réintroduit en 2003 dans l’arsenal américain, conformément au droit : « The use of weapons that employ fire, such as tracer ammunition, flamethrowers, napalm, and other incendiary agents, against targets requiring their use is not a violation of international law […]. They should not, however, be employed to cause unnecessary suffering to individuals » Cf. le site taskandpurpose.com/bring-backflamethrower/utm_content=buffer89e3e&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=tp-buffer.. C’est bien ce qu’arguait également l’armée israélienne en 2014, lors de l’opération « Cast Lead » pour défendre l’emploi de bombes au phosphore lancées à Gaza, un emploi dicté par les « nécessités militaires ». Pourquoi l’utiliser dans le cas contraire ?
En octobre 2016, une table ronde organisée à Genève par le CICR avait pour sujet : « Translating humanitarian law into military tactics ». Il s’agissait de réfléchir aux moyens de conduire les opérations militaires dans les limites du droit humanitaire, en particulier de s’interroger sur des règles d’engagement armé adaptées et efficaces, tout en étant juridiquement acceptables. Parmi les quatre panélistes, on comptait deux conseillers juridiques auprès de forces armées (Alliance atlantique et Etats-Unis) et un colonel. Cette incitation à mieux intégrer droit humanitaire et tactique militaire est un rappel supplémentaire de l’origine et de la logique de ce droit, qui sont trop souvent escamotées derrière l’image d’Epinal du secouriste penché sur la victime. Rappel également de l’identité de son gardien, le CICR, qui n’est pas une organisation humanitaire comme les autres : mandataire des Etats, il est le promoteur d’un traité international dont les interlocuteurs primordiaux et les exécutants finaux sont les diplomates et les militaires. Il lui revient à ce titre de discuter avec les Etats du caractère licite, discutable ou illicite de la mise à mort d’êtres humains. C’est son rôle primordial et c’est ce qu’il fait. On ne voit pas, cependant, pourquoi des ONG devraient le rejoindre pour se faire les promoteurs auxiliaires de cette forme de peine de mort.
Les principes, boussole ou symbole
Les « principes humanitaires » sont eux aussi invoqués par les organisations se réclamant du DIH, qui mettent en avant la neutralité, l’indépendance et l’impartialité ainsi que l’humanité, à la fois comme cadre éthique, gage de sécurité et guide de l’action de terrain. C’est cet usage que nous voudrions examiner maintenant, en commençant par constater que seuls deux d’entre eux, l’humanité et l’impartialité, figurent dans les Conventions de Genève. Les deux autres, neutralité et indépendance, sont extraits des « principes fondamentaux sur lesquels repose l’action de la Croix-Rouge » énoncés lors de la XXe conférence de cette organisation en 1965. Cette dernière avait sans doute besoin de réaffirmer sa vocation sous de tels auspices, au terme d’un siècle d’existence au cours duquel les sociétés nationales de Croix-Rouge avaient été les relais politiques des Etats dont elles étaient – et demeurent – statutairement les auxiliaires. Il ne suffit cependant pas de marteler une affirmation pour qu’elle devienne réalité, ni de nier une contradiction pour qu’elle disparaisse : l’auxiliaire d’un Etat est au service du pouvoir en place. La Croix-Rouge française, par exemple, a été une virulente chambre d’écho du nationalisme et de sa propagande pendant la Première Guerre mondiale John F. Hutchinson, Champions of Charity, War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Oxford,
1996., un exécutant obéissant des ordres de la « Révolution nationale » sous le régime de Pétain et un partenaire actif des autorités coloniales durant les guerres d’Indochine et d’Algérie, pour ne citer que ces moments marquants. Le même constat peut être fait pour toutes les autres sociétés nationales, mais il faut noter que ce ne fut pas le cas du CICR, qui conserva sa neutralité, au point que cela lui fut parfois reprochéJean-Claude Favez, Une mission impossible ? Le CICR, les déportations et les camps de concentration nazis, Payot, Lausanne, 1988..
On comprend, dans un tel contexte historique, la nécessité pour la Croix-Rouge de proclamer ces principes, opportunément qualifiés de fondamentaux. Le mouvement de la Croix-Rouge est de plus une entité singulière, ni publique ni privée, une catégorie juridique à elle seule, ni ONG ni OIG. Il a ses propres contraintes et sa propre logique d’action, qui ne s’appliquent pas aux autres organismes humanitaires. C’est une première raison de s’interroger sur la validité universelle des principes qu’il proclame, mais ce n’est pas la seule. L’autre raison, plus importante, tient au caractère vague des principes invoqués, qui se prêtent à des interprétations contradictoires et dont l’emploi inconsidéré empêche de comprendre la situation réelle dans laquelle on se trouve. On examinera ici les trois principes constamment invoqués, à savoir neutralité, indépendance, impartialité – qui donne les « NIIHA » pour « neutral, impartial, independant humanitarian agencies », dans le jargon des organisations non gouvernementales internationales.
Commençons par le principe d’impartialité, considéré avec de bonnes raisons comme central, car il s’agit d’un engagement distributif primordial : ce principe enjoint de ne faire aucune distinction autre que celle fondée sur le besoin. Remarquons qu’il n’est pas employé dans son sens usuel, qui se différencie peu de la neutralité. On dit d’un tribunal ou d’un arbitre qu’il doit être impartial dans la mesure où il ne doit pas prendre parti, autrement dit qu’on attend qu’il juge de manière neutre. Ce mot a donc une signification spécifique dans le domaine de l’aide humanitaire. Il aurait été plus clair de parler de principe de proportionnalité ou d’équité, ce qui aurait levé la confusion avec le sens ordinaire, car il s’agit bien d’un engagement de discrimination positive. Au-delà de cette distinction sémantique se pose la question de la détermination et de la hiérarchie des « besoins », notion qui n’est objective qu’en apparence. L’examen des formes d’action des organisations humanitaires montre qu’on peut les décliner en différentes catégories, non exclusives : démographique (les femmes et les enfants, les moins de cinq ans, plus rarement les vieux), sociale (une minorité discriminée, une couche sociale défavorisée, un groupe décrit comme « vulnérable »), médicale (les blessés opérables avec chances de succès, les malades atteints d’une affection spécifique, tel le trachome, le sida, la malnutrition etc.), organisationnelle (eau potable, alimentation, hébergement, éducation, etc.), situationnelle (réfugiés, personnes déplacées, conflits armés, catastrophes naturelles) et d’autres encore. Est-il plus impartial, dans un conflit armé, d’opérer des blessés de guerre que d’offrir des dialyses à des insuffisants rénaux qui s’en voient privés du fait des circonstances ? De fournir des soins dans un hôpital psychiatrique délaissé plutôt que de l’eau potable à la population d’un quartier ? De s’intéresser à des blessés lorsqu’ils sont victimes de guerre et de s’en détourner s’ils sont victimes d’autre chose ? De prendre soin d’enfants plutôt que de vieillards ?
Agir, c’est choisir, et choisir, c’est éliminer. Il suffit d’observer les choix très différents faits par des acteurs se réclamant du même principe d’impartialité pour se rendre à cette évidence, pourtant bien peu partagée : tout programme d’assistance humanitaire comporte des critères d’inclusion fixant les limites de la population dite bénéficiaire et donc l’exclusion de ceux qui se trouvent hors critères mais pas hors besoins. Les acteurs de l’aide tendent à qualifier de « besoins » ce qui figure dans leur répertoire de services à offrir, comme le relève l’enquête de Marion Péchayre menée sur ce sujet au Pakistan Guillaume Lachenal / Céline Lefèvre / Vinh-Kim Nguyen (dir.), La Médecine du tri. Histoire, éthique, anthropologie, PUF, 2014.. L’auteure souligne que la notion de besoin est d’ordre relationnel, en ce sens qu’elle dépend de qui la formule et qui l’évalue. L’impartialité consiste en l’affirmation, tout à fait judicieuse et respectable, d’une volonté d’équité, traduite en des actes variables selon les préférences revendiquées et les possibilités limitées des acteurs.
Deuxième principe considéré comme fondamental et néanmoins ouvert lui aussi à diverses interprétations : la neutralité. Il s’agit là de « s’abstenir de prendre part aux hostilités » en temps de guerre et « en tout temps aux controverses d’ordre politique, religieux, racial ou philosophique », selon les termes de la Croix-Rouge. Cette définition laisse à l’arrière-plan ce que fut le premier sens de cette notion, à savoir l’engagement de respect des lieux de soins que prenaient les signataires de la première Convention de Genève, dont l’article 1er stipulait : « Les ambulances C’est-à-dire les lieux de soins mobiles, selon la signification de l’époque.et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés ».
Sous cet angle, la neutralité est un principe de retenue que devraient s’appliquer les belligérants et non les organisations humanitaires. Ajoutons, ne serait-ce que pour mieux mesurer la distance qui nous sépare de cette première Convention, que celle-ci prévoyait le retrait définitif des blessés, lesquels ne devaient pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre (article 6). Une telle disposition, pensable dans le contexte des conflits du XIXe siècle, était devenue anachronique à l’heure de la totalisation des guerres. Elle fut supprimée dès la première révision de la Convention, en 1906, qui attribua aux blessés un statut de prisonnier de guerreCf. Xavier Crombé, The Future of an Ambiguity: A History of Medical Neutrality, à paraître. L’auteur retrace la généalogie de la neutralité en tant que concept diplomatique et enjeu de définitions et critiques changeantes..
Cette précision d’ordre généalogique faite, il faut revenir à l’usage commun de la notion et se demander alors s’il est éthiquement acceptable de s’engager à ne prendre aucune part à des controverses, notamment lorsqu’elles sont de nature politique ou raciale. Les critiques répétées adressées par MSF aux responsables européens concernant le sort réservé aux migrants MSF a vivement critiqué le harcèlement et les violences contre les migrants à Calais. Plusieurs sections nationales de l’ONG ont également décidé de refuser les fonds humanitaires de l’Union européenne (UE) afin de protester contre l’accord UE-Turquie de mars 2016. Cette décision a fait l’objet de vifs débats internes., sujet hautement politique, sensible et controversé, sont objectivement en contradiction avec son affirmation de neutralité. On peut considérer qu’il est moralement plus juste de dénoncer des exactions dont sont témoins les humanitaires que de « s’abstenir de prendre part à une controverse politique », mais on ne peut ignorer qu’une telle dénonciation fait partie de la controverse. Une organisation bouddhiste birmane protestant – simple hypothèse – contre les exactions infligées aux Rohyingas et proposant son aide à ces derniers devrait-elle être considérée comme en infraction à un principe humanitaire ? On arguera qu’elle devrait au contraire être soutenue pour son engagement humanitaire violant le principe de neutralité. Dans ces deux cas comme dans de nombreux autres, il y a contradiction entre principe de neutralité et souci d’humanité. Autrement dit, les critiques publiques adressées à un pouvoir politique peuvent donc être pleinement justifiables d’un point de vue humanitaire tout en contredisant l’affirmation de neutralité. Ignorer cette contradiction, c’est s’enfermer dans une bulle rhétorique au risque de se couper du monde réel.
En Afghanistan par exemple, les Provincial Reconstruction Teams (PRT’s) étaient des unités militaires en civil offrant des services et des biens à la population. Mises en place par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), leur mission était de de gagner « les coeurs et les esprits » ainsi que de collecter du renseignement sur l’ennemi taliban. Cette classique stratégie contre-insurrectionnelle a été violemment critiquée par les organisations non gouvernementales (ONG) qui accusaient les PRT’s de mettre à mal leur neutralité en « brouillant la ligne de partage entre humanitaire et militaire » et de les mettre en danger du fait de cette confusion. Sans aucun doute, cette ligne de partage, pour peu qu’elle existe, était-elle brouillée en Afghanistan, mais bien plus profondément qu’à ce niveau superficiel. C’est en effet tout le dispositif international d’assistance qui l’est, ONG comprises, engagé au service d’un gouvernement en guerre, dans un pays occupé et décrit dès le moment initial par le général Colin Powell dans ces termes : « NGOs are [...] a force multiplier for us, [...] an important part of our combat team ». Cette déclaration, qui a choqué les ONG, recouvre, de fait, une réalité empiriquement observable, à côté de laquelle la question des PRT’s est anecdotique. Tout le dispositif de l’aide en Afghanistan est placé sous le contrôle du gouvernement et des forces d’occupation. Pour qui voyait cette réalité dans sa vérité nue, la campagne de protestation s’apparentait à la recherche d’un bouc émissaire, un exutoire à l’embarras causé par le divorce entre l’affichage d’un principe et la réalité de l’action unilatérale des ONG dans ce pays. Elle était en tout cas dérisoire, voire dangereuse, car induisant un sentiment trompeur de neutralité et de sécurité, celle-ci étant considérée comme tributaire de celle-là. En fait, des travailleurs de l’aide en Afghanistan ont effectivement été tués, mais ces meurtres n’avaient rien à voir avec la confusion humanitaire militaire. L’analyse de ces événements montre qu’il s’est agi, à chaque fois, de raisons locales différentes sans rapport avec le brouillage incriminé par les ONG Michaël Neuman / Fabrice Weissman, Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l’ère de la gestion des risques, CNRS éditions, Paris, 2016.. Le plus meurtrier de ces incidents (bombardement de l’hôpital de Kunduz, en octobre 2016) est dû aux forces gouvernementales afghanes et à l’US Air Force et non aux Talibans.
Evitons tout malentendu : il n’est pas dans notre intention de discréditer l’action des ONG oeuvrant en Afghanistan. Elles se rendent utiles dans de multiples domaines, elles tentent de n’exclure personne sur les terrains et dans les domaines où elles agissent et c’est ce qui compte. Elles font ce qu’elles peuvent, là comme ailleurs, comme elles l’ont fait dans de multiples situations où elles ne peuvent être présentes que d’un côté. Néanmoins, leur prétention de neutralité ne résiste pas à l’examen dès lors qu’on quitte le domaine des intentions pour s’intéresser à celui de l’action.
Si la critique de cette affirmation a son importance, c’est parce que son incohérence obscurcit la vision des enjeux de l’action humanitaire. Ainsi, lors du siège et de la bataille de Mossoul (2016-2017), MSF et le CICR ont refusé de rejoindre le dispositif d’assistance mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant que la proximité avec la coalition nuirait à leur neutralité Cf. l’enquête de mortalité rétrospective conduite par l’université Johns Hopkins, disponible sur le site journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002567.. Compromettant par ce refus leurs opérations de secours, ces deux organisations donnaient alors le sentiment d’être plus préoccupées de la menace hypothétique de dommages à leurs principes que soucieux de se déployer au plus près des victimes de cette guerre. On voit ici comment les principes, destinés à favoriser l’action du fait de la confiance qu’ils sont supposés induire, deviennent un frein dès lors qu’on en fait une morale.
L’indépendance est le troisième principe invoqué dont la Croix-Rouge nous dit qu’il est la condition pour le respect des deux précédents. Laissons de côté l’impossibilité, déjà évoquée, pour une société nationale de Croix-Rouge d’être à la fois auxiliaire des pouvoirs publics et indépendante de ces derniers, pour nous intéresser au sens et aux limites de cette notion pour les ONG. La plupart d’entre elles sont financées par des bailleurs de fonds (ECHO, USAID, DFID, etc.) et ne sont donc pas en mesure de décider par elles-mêmes de l’allocation de leurs ressources ni de la durée de leurs programmes de terrain, cela devant être discuté avec leurs financeurs. Tributaires des priorités et des contraintes des organismes leur permettant d’agir, elles ne peuvent se déclarer indépendantes, guère plus que les sociétés nationales de Croix-Rouge. Cette limitation de leur liberté d’action et d’expression publique ne les empêche pas pour autant de réaliser un travail utile dans un esprit qui n’est pas moins humanitaire que celui de leurs consoeurs autofinancées. Elle les amène cependant, par exemple, à soumettre leurs décisions d’engagement à l’appréciation des financeurs, de même qu’à mettre parfois un terme à un programme non parce qu’il est devenu superflu, mais parce que le budget est consommé et non renouvelé.
Les organismes financés par des donateurs individuels et ayant donc la pleine disposition de leurs fonds ne peuvent pour autant prétendre être indépendants au sens commun de ce mot, à savoir décider souverainement de l’emploi de leurs ressources. Ils peuvent, et c’est ce qui les caractérise, débloquer ces dernières rapidement en cas d’urgence, décider de proposer leurs services à des interlocuteurs (étatiques et non étatiques) selon leur propre volonté et négocier avec eux les termes de leur assistance sans l’interférence de donateurs institutionnels ayant leur propre politique. Si cette réactivité et cette souplesse sont des atouts précieux, la liberté qui les rend possibles n’est cependant pas celle d’un acteur souverain, car les modalités et lieux d’implantation, tout comme les orientations des programmes font nécessairement l’objet de négociations avec les autorités du lieu Claire Magone / Michaël Neuman / Fabrice Weissman, Agir à tout prix ? Négociations humanitaires : l’expérience de Médecins Sans Frontières, La Découverte, Paris, 2011.. Le financement n’est donc que l’un des aspects de la question de l’indépendance. Restent deux capacités essentielles que seule permet la non-dépendance à des bailleurs de fonds : d’une part, prendre des initiatives que n’autoriseraient pas des donateurs institutionnels, telles que s’installer dans certains territoires rebelles, s’engager avec des interlocuteurs non reconnus ou encore agir selon un protocole non admis ; d’autre part, décider de mettre un terme à un programme si on estime que ce dernier est devenu plus nocif qu’utile à la population destinataire ou que les critères d’inclusion sont éthiquement inacceptables. En somme, c’est aux deux extrémités – au début et à la fin d’un programme d’aide humanitaire – que se situent les capacités de décision autonome de l’acteur humanitaire financièrement indépendant. Ce qui se passe entre-temps relève des relations avec le pouvoir, le potentiel de négociation de l’ONG étant tributaire de l’utilité, autrement dit de l’intérêt politique qu’elle représente pour ce dernier.
En finir avec le droit et les principes ?
L’ultime argument de défense des principes est la sécurité des équipes humanitaires, en accord avec le statut d’immunité prévu pour elles par les Conventions de Genève. Le respect de ces principes, répète-t-on en écho au CICR, est la seule protection qui vaille, un abri sécurisant en tant que source de confiance pour les « parties au conflit ». En pratique cependant, affirmer la clarté de ses intentions – fourniture d’une assistance sans arrière-pensées politiques ni agenda caché – n’est en rien une protection, comme le montre l’analyse des incidents violents subis par les humanitaires au cours des trois dernières décennies Cf. Michaël Neuman / Fabrice Weissman, op. cit., et le site www.msf-crash.org/en/publications/warand-humanitarianism/review-aid-danger-perils-and-promise-humanitarianism.. Les « organisations à principes » (principled organizations) n’ont pas moins de victimes à déplorer que les autres et ce sont toujours des gains (politiques, financiers, personnels) que recherchaient les auteurs d’agressions, pas une punition pour de supposés manquements aux principes. Certes, il n’était pas illogique d’imaginer, aux premiers âges de l’humanitaire organisé, la neutralité et l’indépendance comme des conditions à remplir pour permettre l’action. Il est cependant inconséquent et parfois très risqué d’ignorer que cette hypothèse n’est pas vérifiée. La condition pour agir dans une relative sécurité est d’être plus utile à nos potentiels agresseurs en étant présents et vivants qu’absents ou morts (ou détenus), comme l’a résumé de manière frappante Fabrice Weissman.
A quoi servent alors les principes s’ils ne fournissent ni orientation pour l’action ni sécurité pour les acteurs ? Ne serait-il pas suffisant de se déclarer « humanitaire », c’est-à-dire animé par l’ambition d’être utile sans attendre de retour ? C’est en tout cas de cette façon que s’est présentée MSF au cours de la première moitié de son existence, plus soucieuse de démontrer son utilité pratique que sa conformité à des principes. Cependant, avec la multiplication et la diversification des acteurs se plaçant sous la bannière de l’humanitaire depuis la décennie 1990, le sens du mot s’est brouillé et il n’est pas superflu, depuis lors, d’en clarifier le contenu. Se déclarer « neutre-impartial-indépendant » revient, dans ce nouveau contexte, à brandir un drapeau blanc signalant qu’on n’a pas d’ennemis. Un symbole, en d’autres termes, visant à se différencier d’autres acteurs de secours porteurs d’autres intentions (religieuse, communautaire, politique, commerciale), mais rien de plus. C’est la raison pour laquelle l’auteur de ces lignes, qui a longtemps situé la neutralité à mi-chemin entre paresse intellectuelle et lâcheté politique, s’y est rallié sous cette acception restrictive. N’y voir qu’un symbole et non une boussole permet d’éviter des spéculations oiseuses – tenter de déterminer si tel positionnement, tel choix opérationnel est neutre ou non, impartial ou non –, entreprise vaine, voire contre-productive comme j’ai cherché à le montrer.
Il ne s’agit pas pour autant de plaider en faveur d’un pur pragmatisme selon lequel nos devoirs se borneraient à la mise en oeuvre des méthodes et des compétences les plus appropriées, autrement dit à une obligation de moyens et une mise en oeuvre de process. Ces réquisits techniques ne sont rien s’ils ne prennent place dans un cadre éthique : savoir qui on inclut et qui on exclut des programmes d’assistance et pouvoir s’en expliquer, s’inquiéter du risque d’être plus utile au pouvoir qu’à la population, être attentif à ce qui peut éventuellement démentir des hypothèses de départ. Ces questions et enjeux relatifs à la responsabilité spécifique des humanitaires n’admettent pas de réponse simple, ils ne peuvent être figés à la manière d’une doctrine, ne se laissent pas enfermer dans une présentation PowerPoint. A l’illusoire clarté des « principes », ils substituent l’inconfort d’interrogations jamais closes. Pour cette raison même, ils nous paraissent plus concrets pour apprécier le service rendu aux populations destinataires de l’aide et aussi plus consistants pour la motivation des équipes d’aide que la vaine recherche d’une orthodoxie principielle.
Pour citer ce contenu :
Rony Brauman, « A quoi sert le droit humanitaire ? », 28 juin 2019, URL : https://msf-crash.org/fr/guerre-et-humanitaire/quoi-sert-le-droit-humanitaire
Si vous souhaitez réagir à cet article, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous contacter ici :
Contribuer