
Claire Magone, Michaël Neuman & Fabrice Weissman
Directrice de la communication de Médecins Sans Frontières, basée à Paris
Après des études de communication (CELSA) et de sciences politiques (La Sorbonne), Claire Magone a travaillé plusieurs années avec des associations humanitaires, notamment en Afrique au Libéria, en Sierra Leone, au Soudan ainsi qu'au Nigéria. En 2010, elle devient directrice d’études au Crash, puis directrice de la communication de MSF en 2014.

Directeur d'études au Crash depuis 2010, Michaël Neuman est diplômé d'Histoire contemporaine et de Relations Internationales (Université Paris-I). Il s'est engagé auprès de Médecins sans Frontières en 1999 et a alterné missions sur le terrain (Balkans, Soudan, Caucase, Afrique de l'Ouest notamment) et postes au siège (à New York ainsi qu'à Paris en tant qu'adjoint responsable de programmes). Il a également participé à des projets d'analyses politiques sur les questions d'immigration. Il a été membre des conseils d'administration des sections française et étatsunienne de 2008 à 2010. Il a codirigé "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de MSF" (La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (CNRS Editions, 2016).

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.
I. Histoires courtes
Sri Lanka. Dans la guerre totale
FABRICE WEISSMAN
Le 18 mai 2009, la victoire totale du gouvernement sri lankais sur les rebelles séparatistes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, Tigres de libération de l’Eelam tamoul) mettait un terme à vingt-six années de guerre civile. Décrite par le gouvernement comme la « plus vaste opération de sauvetage humanitaire au monde », l’offensive victorieuse de Colombo a été célébrée comme un modèle par de nombreux commentateurs militaires étrangersCf. par exemple V. K. SHASHIKUMAR, « Lessons from the war in Sri Lanka », Indian Defence Review, 24, nº 3, juillet-septembre 2009 ; Lawrence HART, « The option no one wants to think about », The Jerusalem Post, 9 décembre 2009.. Elle démontrerait la capacité d’une armée démocratique déterminée à vaincre militairement un mouvement « terroriste ». En pratique, la victoire a été remportée au prix de milliers de morts civiles et de l’enrôlement des organisations humanitaires dans une politique de déplacements forcés et d’internement des rescapés. L’expérience de MSF est révélatrice des choix difficiles que la guerre totale impose aux organismes d’aide.
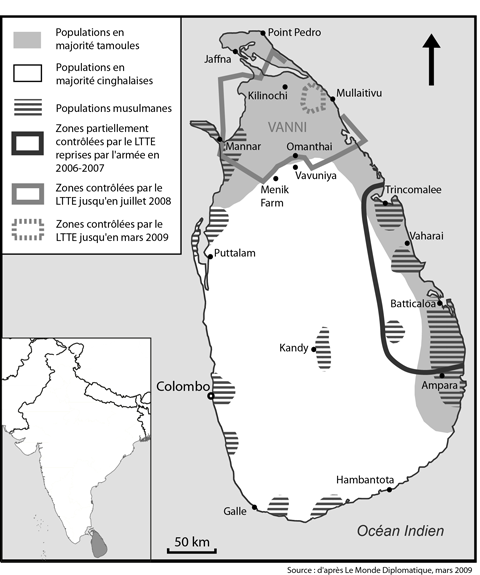
Logiques de guerre
En 2003, après dix-sept années de présence dans la guerre civile qui oppose depuis le milieu des années 1980 le gouvernement aux LTTE, MSF se retire du Sri Lanka. Un accord de cessez-le-feu (CFA, cease fire agreement) a été conclu un an auparavant, entraînant un retour relatif à la normale et suscitant un espoir de paix. Des négociations ont débuté sous la coprésidence de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres pays occidentaux dont la Norvège, également à la tête d’une mission d’observation du cessez-le-feu (la SLMM, Sri Lanka Monitoring Mission, Mission de contrôle du cessez-le-feu au Sri Lanka).
Dès 2003, les pourparlers achoppent sur la question clé du conflit : comment assurer une coexistence pacifique entre les communautés cinghalaise, tamoule et musulmane, qui représentent respectivement 75 %, 17 % et 8 % de la population de l’île ? Si les parties s’engagent à explorer une solution fédérale au conflit, les discussions s’enveniment dès qu’il s’agit d’en préciser le contenu ou même de s’accorder sur l’administration transitoire des zones rebelles (un tiers du territoire)Éric MEYER et Eleanor PAVEY, « Bon offices, surveillance, médiation. Les ratés du processus de paix à Sri Lanka », Critique Internationale, nº 22, janvier 2004, 35-46, p. 37.. Le retour à la guerre semble imminent lorsque les côtes sri lankaises sont frappées par le tsunami du 26 décembre 2004. Passé la réponse à l’urgence, la gestion de l’aide à la reconstruction ravive les conflits de souveraineté entre le gouvernement central et la guérilla séparatiste. Dès la fin 2005, attentats, assassinats et disparitions dans le nord-est du pays entretiennent un climat de terreur. Alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient, les provinces de l’est basculent dans la guerre ouverte en avril 2006.
En 2006-2007, l’armée reprend le contrôle total des districts de Batticaloa et Trincomalee, situés dans l’est du pays, repoussant les LTTE au nord dans leur sanctuaire du Vanni.
L’année suivante, le gouvernement dénonce officiellement l’accord de cessez-le-feu et resserre son étreinte sur le Vanni, s’emparant du district de Mannar en avril 2008, avant d’entrer, en juillet, dans le district de Killinochi. En janvier 2009, l’armée entame son offensive finale. Les Tigres sont encerclés sur un territoire adossé à la mer, dont la superficie passe de 300 km2en janvier à 26 km2en mars, 12 km2le 23 avril puis 4 km2le 8 mai. Ils sont anéantis dix jours plus tard. Leur chef est tué, ainsi que la plupart des dirigeants politiques et militaires.
À l’origine de la majorité des violations du cessez-le-feu en 2005-2006, les LTTE ont largement précipité le retour à la guerre. Lors des élections présidentielles de novembre 2005, ils ont enjoint la population tamoule de s’abstenir, favorisant ainsi la victoire de Mahinda Rajapakse, candidat hostile au processus de paix, élu de justesse face au négociateur du CFA, l’ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Selon le politologue sri lankais Jayadeva UyangodaJayadeva UYANGODA, The Way We Are. Politics of Sri Lanka 2007-2008, Social Scientists’ Association, Colombo, 2008, p. 7., les dirigeants des LTTE comptent alors sur une nouvelle épreuve de force pour rehausser leur position dans de futures négociations : une guerre d’usure permettrait d’affaiblir l’économie, de diviser la base sociale du régime et de l’isoler sur la scène internationale en raison des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme qu’il ne manquerait pas de commettre. La médiatisation des violences commises par l’armée est en effet la principale ressource politique des LTTE sur la scène internationale.
Or, dès avant son retrait officiel du cessez-le-feu en janvier 2008, l’administration Rajapakse fait entendre qu’elle est déterminée à ne plus négocier. Elle profite des effets d’aubaine du 11 septembre 2001 pour imposer une lecture strictement sécuritaire et antiterroriste de l’affrontement. Récusant l’existence du « problème ethnique » placé au centre des négociations et du débat politique depuis 1987, l’administration Rajapakse considère que les LTTE, dont elle vise l’élimination militaire et politique, sont le seul obstacle à la paix.
Confrontés à l’avancée rapide des troupes gouvernementales, les LTTE entraînent dans leur débâcle des dizaines de milliers de civils. À mesure que le territoire rebelle se rétrécit, les Tigres dissuadent les populations de rejoindre les zones gouvernementales par des moyens de plus en plus violents : exécution des fuyards et/ou représailles contre leurs familles, puis, à partir de janvier 2009, mitraillage, pilonnage et attaques-suicides des colonnes de civils cherchant à gagner les lignes gouvernementales« Report of the secretary-general’s panel of experts on accountability in Sri Lanka », Nations unies, 31 mars 2011.. Le contrôle d’une population est stratégique pour les LTTE pour au moins deux raisons. D’une part parce qu’ils enrôlent des enfants de plus en plus jeunes pour compenser leurs lourdes pertes. De l’autre, parce qu’en mêlant leurs forces combattantes aux civils, ils obligent l’armée gouvernementale à choisir entre deux maux : ralentir, voire stopper, son offensive, ou commettre des crimes de guerre.
Dénonçant cette stratégie de « bouclier humain », le gouvernement demande, en novembre 2006, la médiation du CICR et de la SLMM afin d’organiser l’évacuation des civils vivant dans les zones de combat vers des camps installés à l’arrière de ses lignes. Les Tigres s’opposent à l’opération. Colombo décrit alors son offensive comme une « mission humanitaire » destinée à « libérer les civils innocents pris en otages par les LTTE».Cf. par exemple, « Offensive to provide water, not to gain territory », The Sunday Leader, volume 13, issue 4, Colombo, 6 août 2006.
Si l’armée affirme « adhérer à une politique du zéro mort civil [ZCC]»Ministère de la Défense du Sri Lanka, « Ultimatum to LTTE expires. Terrorists ignore safe passage for stranded civilians », 1erfévrier 2009, http://www.defence.lk., dans les faits elle s’encombre peu de la présence des secouristes et des populations lors de sa progression. Les camps de déplacés, les hôpitaux, les convois humanitaires, les sites de distribution alimentaire sont frappés à de nombreuses reprises par l’artillerie et l’aviation gouvernementales« Report of the secretary-general’s panel of experts… », op. cit. Plusieurs centaines de civils sont hachés par les obus et la mitraille en 2006-2008, plusieurs milliers entre janvier et mars 2009, plusieurs dizaines de milliers entre avril et mai 2009. Selon un décompte officieux des Nations unies, quelque 7 000 civils ont été tués entre janvier et début mai 2009 et 13 000 autres dans les deux dernières semaines de l’affrontement – l’organisation ICG (International Crisis Group) chiffrant à au moins 30 000 le nombre de morts civiles lors de la campagne du Nord. Pour sa part, le gouvernement ne reconnaît que 5 000 morts civiles, dont il attribue la responsabilité aux LTTE.ICG, « War crimes in Sri Lanka », International Crisis Group, Bruxelles, 17 mai 2010, http://www.crisisgroup.org.
Pendant toute la durée de l’affrontement, le gouvernement mène une intense guerre de propagande destinée à masquer le coût humain effroyable de son offensive. Il déclare mener une « guerre humanitaire », justifiant à ce titre l’enrôlement des ONG et des agences des Nations unies dans ses politiques de pacification. De 2006 à 2008, MSF cherche vainement à résister, avant de tenter en 2009 de devenir un rouage important du dispositif militaro-humanitaire dans l’espoir d’en atténuer la brutalité.
2006-2008 : le gouvernement fixe les règles
En 2006-2007, la reconquête de l’Est fait au moins 250 morts civils et plusieurs centaines de blessés, selon les organisations locales de défense des droits de l’hommeUTHR(J), « Can the East be won through human culling ? », special report nº 26, University Teachers for Human Rights (Jaffna), août 2007, http://www.uthr.org.. Environ 160 000 personnes sont déplacées par les combats. Elles reçoivent une assistance hétérogène de la part du gouvernement, des ONG et des agences des Nations unies invitées par Colombo à s’installer dans le sillage de l’armée. Les programmes d’assistance ne durent que quelques mois. Dès mars 2007, le gouvernement, stoppant l’assistance humanitaire et usant de menaces, organise avec le concours du HCR le retour forcé des déplacés vers leurs villes et villages d’origine dévastés, placés sous administration militaire.
Les premières victoires gouvernementales s’accompagnent d’une intensification des violences politiques (disparitions, assassinats, menaces, etc.) à l’encontre des personnalités sri lankaises critiquant ouvertement le militarisme et le nationalisme étroit de la nouvelle administration. Journalistes étrangers et ONG internationales sont également la cible de campagnes d’intimidation. Exploitant la défiance de la société sri lankaise à l’encontre des ONG, dont le débarquement massif en décembre 2004 a été vécu comme un « second tsunami », les médias nationalistes accusent régulièrement les organisations humanitaires d’être des « profiteurs de guerre » « à la solde des terroristes». Cf. à ce sujet, Simon HARRIS, « Humanitarianism in Sri Lanka. Lessons learned ? », Feinstein International Center, Tufts University, Briefing Paper, juin 2010, https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=36675391.
Une première attaque à la grenade frappe trois ONG internationales dans les provinces de l’Est en mai 2006, faisant trois blessés. Le 4 août 2006, dix-sept employés sri lankais de l’association Action contre la faim (ACF) sont exécutés dans leur bureau de Muttur, sur la côte est, quelques heures après la reprise de la ville par les forces progouvernementales. Fait sans précédent dans l’histoire de l’action humanitaire au Sri Lanka, l’assassinat (dont la SLMM impute la responsabilité au gouvernement) déclenche des condamnations officielles des chancelleries occidentales et des Nations unies, auxquelles le gouvernement répond par la création d’une Commission d’enquête, dont les investigations n’aboutiront jamais. Entre 2007 et 2009, plus d’une dizaine de travailleurs humanitaires sont assassinés, dont plusieurs employés du CICR.
Les ambitions de MSF
Anticipant une reprise des hostilités, la section française envoie plusieurs missions exploratoires au Sri Lanka au cours du premier semestre 2006, bientôt rejointes par des équipes des sections hollandaise et espagnole. Les trois sections proposent, en juillet-août 2006, l’ouverture de projets chirurgicaux dans trois hôpitaux situés en zone gouvernementale à proximité des lignes de front, à Point Pedro (front nord), Vavuniya (front sud) et Mannar (front ouest). Toutes ont pour objectif de s’implanter à terme dans les zones contrôlées par les LTTE, la section française proposant d’ores et déjà d’ouvrir une mission entre Batticaloa et Trincomalee sur le front est, où les premiers déplacements de population ont été signalés.
Aucune des équipes d’évaluation n’a toutefois constaté de besoins criants. Le Sri Lanka dispose d’un personnel qualifié et d’un système de santé performant hérité des politiques sociales ambitieuses menées depuis l’indépendance. Qui plus est, afin d’affirmer sa souveraineté symbolique sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement n’a jamais cessé d’assurer la continuité des services publics en zones rebelles, payant le salaire des fonctionnaires du ministère de la Santé et assurant l’approvisionnement des structures médicales. Enfin, de nombreuses organisations humanitaires arrivées après le tsunami sont encore présentes en 2006.
Dans ces conditions, les interventions proposées à Point Pedro, Mannar, Vavuniya et en zones LTTE relèvent avant tout d’une logique de prépositionnement. Elles visent à renforcer l’offre de soins et la capacité de réponse aux urgences dans les régions où MSF s’attend à une reprise du conflit, avec ses conséquences prévisibles : rupture d’approvisionnement médical, départ du personnel soignant local, afflux de blessés et déplacements de population. Même si elle n’est pas toujours clairement exprimée (sauf par la section hollandaise), l’ambition de MSF est aussi d’assurer une présence internationale dans les zones d’affrontement afin de « témoigner du sort des populations », dans l’espoir d’inciter les belligérants à faire preuve de retenue dans l’usage de la violence. MSF-Hollande, plans annuels Sri Lanka 2008 et 2009.
Le différend
Alors qu’en juillet 2006 les premiers obus de la « mission humanitaire » gouvernementale s’abattent sur le front est, les équipes de MSF-France croient pouvoir obtenir les autorisations nécessaires au démarrage de leurs activités dans un délai raisonnable. Elles pensent que l’organisation a acquis une forte légitimité au Sri Lanka du fait de sa présence des deux côtés de la ligne de front entre 1986 et 2003 et de sa réaction lors du tsunami. En appelant à l’arrêt des dons trois jours après la catastrophe, expliquant que la reconstruction était du ressort de l’État et que la grande majorité des besoins d’urgence étaient déjà couverts par les autorités et la société, MSF n’a pu que flatter la fierté nationale sri lankaise.
Les équipes déchantent rapidement. En dépit du soutien des autorités locales et du ministère de la Santé, les démarches pour obtenir des permis d’importation, des visas et des autorisations de circulation à l’intérieur du pays se perdent dans un dédale bureaucratique. Au fil des échecs, il devient évident qu’aucune décision ne peut être prise sans l’aval du ministère de la Défense et de l’entourage présidentiel, dont l’emprise sur l’appareil d’État ne cesse alors de se renforcer.
Or, à partir de juillet 2006, le ministère de la Défense limite l’accès aux zones rebelles affectées par les combats (désignées « uncleared areas ») au CICR et à des équipes restreintes des agences des Nations unies qui ne peuvent y réaliser que de courtes visites. Les autres organisations de secours sont invitées à travailler à l’arrière des lignes, dans les zones sous contrôle gouvernemental. Déterminée à intervenir dans les zones rebelles de l’Est où la guerre fait rage, MSF cherche à négocier un statut d’exception comparable à celui du CICR et des agences des Nations unies, mais sans résultat.
La section française tente alors d’exercer des pressions médiatiques et diplomatiques. Le 9 août 2006, elle publie un communiqué de presse dénonçant le meurtre des travailleurs humanitaires d’ACF et le « manque d’assistance médicale [pour] les dizaines de milliers de gens vivant au cœur de l’offensive militaire ». Une semaine plus tard, elle réalise une tournée auprès des ambassadeurs occidentaux et des coprésidents du processus de paix, estimant que ces derniers ont l’oreille du gouvernement. Fin août, MSF-France parvient à rencontrer le conseiller spécial à la présidence (Basil Rajapakse) et le secrétaire à la Défense (Gotabhaya Rajapakse). Si les deux frères du président assurent que MSF est la bienvenue au Sri Lanka pour travailler dans les hôpitaux désignés par le ministère de la Santé, ils s’emportent lorsque la chef de mission requiert d’accéder aux zones rebelles. MSF est accusée de partialité envers les LTTE et de « vouloir dicter au gouvernement ce qu’il doit faire». Entretien avec l’ancienne chef de mission de MSF-France, réalisé le 24 février 2011.
MSF se trouve dans une position de négociation délicate. En août 2006, aucun élément d’information solide ne permet d’affirmer que l’aide fournie par le gouvernement, le CICR et les agences des Nations unies dans les « uncleared areas » est inadéquate. MSF estime que le dispositif existant ne pourra faire face à un afflux de blessés et à des déplacements de population – anticipations que le gouvernement récuse, affirmant que les conséquences du conflit seront limitées et bien prises en charge par les agences autorisées. Ces divergences masquent en réalité un différend implicite : MSF revendique une certaine liberté de parole incluant la possibilité de dénoncer les violences extrêmes dont ses équipes pourraient être témoin. Or le gouvernement entend limiter le nombre d’observateurs susceptibles de dévoiler les crimes de guerre qu’il s’apprête à commettre.
La crise
Alors que le siège encourage les équipes à rester fermes, la section française apprend par voie de presse, le 30 septembre 2006, qu’elle est sous le coup d’un arrêté d’expulsion, de même que MSF-Espagne et cinq autres ONG internationales. Selon les quotidiens nationaux, l’expulsion est liée à l’engagement pro-Tigres de MSF, en faveur desquels elle mènerait des « activités clandestines » sous le couvert de l’aide à la reconstruction post-tsunami. Cf. par exemple « Four INGOs to be booted out over link with Tigers », The Island, 30 septembre 2006 ; « Ignominious departure for INGOs, under fire for alleged assistance to LTTE and non-implementation of post-tsunami rebuilding pledges », The Sunday Times, 8 octobre 2006.
L’information est confirmée dans la journée par un courrier du Département de l’Immigration donnant une semaine aux équipes pour quitter le territoire en raison d’« infraction à la législation sur les visas » (plusieurs expatriés, dont les chefs de mission, sont en effet entrés au Sri Lanka avec un visa touriste).
MSF demande immédiatement le soutien des ambassades des expatriés visés par la mesure d’expulsion. Le 5 octobre 2006, elle apprend du ministre des Droits de l’homme que l’arrêté d’expulsion est « suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête [sur les agissements illégaux de l’organisation] ». Le chef de l’État vient en effet de rencontrer les coprésidents du CFA et a déclaré officiellement qu’il « continuera de faciliter l’accès humanitaire aux zones affectées par le conflit tout en gardant à l’esprit des considérations de sécurité ».
MSF reste néanmoins publiquement accusée d’activités clandestines en faveur des LTTE et toujours privée d’autorisations de travail. Que faire pour restaurer sa réputation alors qu’il y a peu de chances que le gouvernement se dédise, s’interrogent les chefs de mission à la mi-octobre ? Venu les épauler, le président international de MSF a bien essayé de publier un démenti dans les médias et convoqué une conférence de presse dans l’espoir de « laver l’image de MSF ». Seuls deux journaux (anglophones) en ont rendu compte.
Par ailleurs, quelles garanties de sécurité doit-elle exiger des autorités – alors que le CICR vient de subir une attaque à la grenade à Jaffna, quelques jours après avoir été accusé de partialité pro-LTTE par la presse, et que le ministère de la Défense refuse de rencontrer MSF, réduisant la crise à un problème de visas en passe d’être réglé ? Faut-il se contenter de la suspension de la mesure d’expulsion et de la retenue de la presse depuis quelque temps ou exiger une déclaration publique de soutien annonçant l’abandon des poursuites et garantissant la sécurité des équipes, selon la ligne défendue publiquement par le président international ? Combien de temps MSF peut-elle attendre des autorisations de travail ?
Si toutes les sections se posent la question du retrait, seule MSF-France semble déterminée à passer à l’acte : « Bientôt, s’il n’y a pas de résultats concrets, nous devrons prendre la décision de quitter le pays par manque d’espace humanitaire », prévient, le 13 octobre 2006, le directeur des opérations. Cette option ne fait pas l’unanimité : peut-on claquer la porte alors que de toute évidence le conflit est en train d’exploser ? À quoi servirait le départ d’une ou de plusieurs sections ? S’agit-il simplement de redéployer les moyens d’intervention là où la présence de l’association est acceptée ? Ou de faire un « coup médiatique » afin de mettre en difficulté le gouvernement et de renforcer la position de négociation des organisations qui restent ?
Le compromis
Finalement, les trois sections font le choix de continuer à négocier. Renonçant à obtenir des autorités un démenti officiel, l’abandon de l’enquête et une déclaration publique de soutien, elles finissent par signer un accord-cadre leur permettant de démarrer des activités dans les trois hôpitaux sélectionnés par le ministère de la Santé. La question de l’accès aux « uncleared areas » n’y est pas mentionnée. Les projets ouvrent en décembre 2006 et janvier 2007.
Dans les deux années qui suivent, les missions médico-chirurgicales de Point Pedro (MSF-France), Mannar (MSF-Espagne) et Vavuniya (MSF-Hollande) ont une faible activité. En 2007, la plupart des blessés et des déplacés de guerre se concentrent en effet sur le front est alors qu’en 2008 l’encerclement du Vanni fait encore peu de victimes civiles. L’aide de MSF permet néanmoins d’assurer la continuité des soins courants (urgence et chirurgie) dans les hôpitaux manquant de spécialistes, confrontés à des ruptures d’approvisionnement et aux rigueurs de l’occupation militaire. Reste qu’à Vavuniya, MSF doit suspendre ses activités chirurgicales en mars 2008 en raison du renforcement des équipes du ministère de la Santé, qui rend sa présence superflue. MSF-Espagne décide de fermer le programme de Mannar fin 2008 après la reprise du districtparl’arméegouvernementale et quitte le pays l’année suivante.
La section française cherche néanmoins à intervenir dans les provinces de l’Est, où l’armée progresse rapidement. Afin d’accéder aux « uncleared areas », elle s’en est remise à l’ONU. Dès la fin octobre 2006, le coordinateur résident des Nations unies a entrepris de négocier avec le gouvernement une procédure permettant de désigner les organisations habilitées à travailler en zones rebelles. Il obtient au mois de novembre 2006 une autorisation d’accès globale du ministère de la Défense pour vingt et une ONG, dont MSF.
Forte de ce laissez-passer, l’équipe de coordination effectue, en février 2007, une mission d’évaluation en zone LTTE, près de Vaharai. Elle ne peut cependant obtenir les autorisations nécessaires au démarrage du projet avant la reprise de la zone par les forces gouvernementales, un mois plus tard, ce qui rend caduque sa raison d’agir. Elle propose alors de soutenir l’hôpital de Batticaloa, dont le service de chirurgie est débordé en avril 2007 après la reconquête par l’armée de la bande côtière située au sud de la ville. Là encore, les blocages administratifs à Colombo et le manque de ressources humaines à Paris retardent l’intervention. Les équipes chirurgicales arrivent en août 2007, alors que l’hôpital a retrouvé une activité normale et que les provinces de l’Est sont presque entièrement pacifiées.
La section française se rabat sur l’aide aux populations déplacées, apportant un soutien modeste (cliniques mobiles, assainissement, distribution de biens de première nécessité) à environ 30 000 des 160 000 personnes prises dans le mouvement de va-et-vient lié aux déplacements et réinstallations forcés organisés par le gouvernement. Elle ferme son programme en janvier 2008, sans s’être réellement interrogée sur les enjeux de sa participation aux transferts forcés de population organisés avec le soutien du HCR.
Au final, seule la section hollandaise parvient à s’implanter en zone rebelle – mais loin des combats. En mai 2007, elle ouvre un programme à Killinochi, « capitale » des LTTE, encore à l’abri des affrontements. Elle choisit de soutenir les départements de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, dans une logique de prépositionnement. Mais, tandis que le front se rapproche à l’été 2008, entraînant des déplacements de population en direction de Killinochi, des difficultés relationnelles avec le personnel médical de l’hôpital obligent MSF à limiter son intervention à une aide logistique concernant l’aire des déchets et la construction de latrines pour les déplacés. C’est alors que, le 8 septembre 2008, le gouvernement ordonne l’évacuation du Vanni à l’ensemble des organisations humanitaires à l’exception du CICR et d’équipes restreintes des agences des Nations unies.
MSF fait partie des premières organisations à quitter les zones LTTE. Ses efforts immédiats pour y retourner se heurtent à un refus catégorique du secrétaire à la Défense rencontré le 28 novembre 2008. Contactées pour faire pression sur les autorités, les représentations diplomatiques indienne et occidentales se disent impuissantes. Depuis 2007, le Sri Lanka s’est en effet rapproché de la Chine, du Pakistan et de l’Iran, avec lesquels il a signé une série d’accords de coopération économique et militaire.
Après trois années de négociation, alors que le conflit semble sur le point de basculer dans une confrontation décisive et sans merci pour les populations, MSF n’a plus qu’un seul projet chirurgical à Point Pedro, un modeste programme d’appui à l’hôpital et au district sanitaire de Vavuniya, et très peu d’espoir d’accéder aux zones de conflit. L’association est alors mal à l’aise pour s’exprimer : depuis la crise de 2006, elle estime qu’une critique publique du gouvernement peut conduire à son expulsion, voire à des représailles physiques contre son personnel. Les équipes semblent désemparées.
2009 : l’offensive finale et le règlement humanitaire de la question tamoule
Entre janvier et mai 2009, la concentration des combats sur un territoire de plus en plus exigu et densément peuplé entraîne une forte augmentation du nombre de victime sciviles.Les blessés ne peuvent bénéficier que de soins rudimentaires en zones LTTE, soins prodigués par huit médecins sri lankais du ministère de la Santé ayant refusé d’abandonner leur poste. Le CICR, qui continue d’assurer leur approvisionnement médical par voie terrestre puis maritime jusqu’au 9 mai 2009, parvient à transférer 6 600 blessés et malades graves ainsi que leurs accompagnants (13 000 personnes au total) vers les zones gouvernementales.
Près de 300 000 personnes sont évacuées par l’armée des territoires progressivement repris aux Tigres. Les militaires escortent les rescapés vers des zones de transit où ils sont triés : les personnes suspectées d’appartenir aux LTTE sont transférées dans des camps de prisonniers baptisés « centres de réhabilitation », les autres vers des camps d’internement fermés gérés par l’armée et désignés « centres de bien-être ». Ceinturés de plusieurs rangées de barbelés, ils sont surveillés par l’armée et la police.
Le plus gros camp d’internement se situe au sud de Vavuniya, à Menik Farm, dans une région marécageuse et isolée. Sa construction a démarré en septembre 2008 sous la coordination de l’armée, qui réalise les deux premières tranches du complexe. Début février 2009, Colombo sollicite l’aide des agences humanitaires et de leurs pays donateurs pour édifier cinq zones supplémentaires. Le volet sanitaire comprend la création de 1 400 lits dans les hôpitaux périphériques, l’installation de cinq petits hôpitaux et de vingt postes de santé à l’intérieur des centres. Quelque 200 000 personnes sont censées pouvoir vivre dans ces « villages de bien-être » pendant une période de trois à cinq ans. Très réticents à financer la construction de camps d’internement permanents, les bailleurs finissent par accepter de soutenir des programmes d’urgence de quelques mois en échange de la promesse gouvernementale de réinstaller 80 % des déplacés avant la fin de l’année 2009.
Dès février 2009, l’annonce de la création de Menik Farm soulève en effet une polémique de dimensions nationale et internationale qui va s’amplifiant à partir de juillet. Des parlementaires sri lankais, indiens et britanniques comparent les « centres de bien-être » à des « camps de concentration » évoquant ceux de l’Allemagne nazieJeremy PAGE, « Barbed wire villages raise fears of refugee concentration camps », The Times, 13 février 2009.. Les journalistes internationaux, qui ne sont pas autorisés à se rendre à Menik Farm en dehors de quelques visites guidées organisées par l’armée, donnent un large écho aux informations les plus alarmistes sur l’état sanitaire des camps – le Times affirmant en juillet tenir d’une source humanitaire internationale que 1 400 personnes y meurent chaque semaine, « un taux de mortalité qui donne du crédit aux accusations de nettoyage ethnique portées à l’encontre du gouvernement », soutient le quotidien britanniqueRhys BLAKELY, « Thousands die in Tamil “welfare village” », The Times, 10 juillet 2009.. Le rôle des Nations unies et des organisations humanitaires commence à être mis en question par la presse. L’ONU est accusée « d’avoir caché l’ampleur des massacres»Philippe BOLOPION, « L’ONU a caché l’ampleur des massacres au Sri Lanka », Le Monde, 29 mai 2009., l’aide du gouvernement britannique aux victimes de guerre est suspectée de « financer des camps de concentration»Jeremy PAGE, « British aid for war refugees may be used to fund “concentration camps” », The Times, 28 avril 2009., l’ONU et les ONG d’être « complices d’une opération d’incarcération à grande échelle».Sri Lanka, stop ! », Le Monde, éditorial, 10 septembre 2009.
L'attente
Entre le mois de janvier et le 20 avril 2009, MSF assiste de loin à l’écrasement du Vanni. Les premières arrivées de civils en zone gouvernementale, fin janvier 2009, permettent néanmoins à la section hollandaise de retrouver un certain niveau d’activité. Malades et blessés évacués des régions en guerre commencent à affluer à l’hôpital général de Vavuniya, dont le nombre de patients hospitalisés passe de 365 à 1 004 entre le 1er février et le 1er avril. Un, puis deux chirurgiens de MSF-Hollande viennent étoffer l’équipe sri lankaise. MSF embauche des aides-soignants pour améliorer la prise en charge des patients. Mais elle ne peut aller au-delà : les autorités refusent l’arrivée d’un anesthésiste et de deux infirmières expatriés supplémentaires. Elles s’opposent également au renforcement des équipes chirurgicales dans les autres hôpitaux accueillant les blessés évacués par le CICR.
Dans le district de Vavuniya, la dizaine de camps d’internement installés dans des bâtiments publics est rapidement saturée, amenant les militaires à transférer les premiers internés dans les zones 0 et 1 de Menik Farm en février. Les responsables militaires et sanitaires de Vavuniya sollicitent l’aide de l’ONU et des ONG pour assister les populations récemment évacuées. La section hollandaise répond favorablement à la requête des autorités locales à la recherche de partenaires pour distribuer des compléments alimentaires spécialisés aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes et allaitantes dans les centres d’internement. Les distributions démarrent mi-février 2009 malgré l’absence d’accord formel du ministère de la Santé, qui affiche sa volonté d’assurer seul l’assistance médicale et nutritionnelle à l’intérieur des camps. « [Les responsables locaux] veulent réellement que nous amenions du personnel, quoi qu’en dise Colombo. Nous avons un accès complet aux camps et le général [chargé de la supervision des camps] nous a donné son numéro de portable personnel au cas où quiconque ferait obstruction », rapporte la chef de mission de MSF-Hollande.
Forte de sa présence dans les camps et auprès des blessés, la section hollandaise participe au dévoilement des violences de guerre et des politiques d’enfermement du régime. Entre janvier et mars 2009, elle publie un communiqué de presse et plusieurs mises à jour sur les sites Internet de l’association, décrivant l’importance du nombre de victimes civiles dans le Vanni et la privation de liberté des déplacés internés à Vavuniya. Plusieurs représentants de MSF s’expriment à ce sujet dans les médias internationaux. À la différence du CICR, qui déclare que « le simple bon sens voudrait que la population civile soit évacuée sans plus tarder [des zones de combats]»« Sri Lanka. Le CICR fait part une nouvelle fois de sa préoccupation quant au sort des civils pris au piège des combats », 4 mars 2009, http://www.icrc.org., MSF demande aux deux parties de permettre l’accès des organisations humanitaires aux zones de guerre.
Privée d’opérations (à l’exception de Point Pedro), la section française se montre plus discrète. Elle se contente de relayer une partie des informations de MSF-Hollande et de répondre à quelques interviews dans lesquelles elle se dit alarmée par le bombardement des zones civiles et des structures de santé – alors dénoncé avec vigueur par le CICR, les organisations de défense des droits de l’homme, l’ONU et les gouvernements occidentaux, qui exigent à partir de février un « cessez-le-feu humanitaire » pour épargner les civils.
L'urgence
Le 20 avril 2009, l’armée brise les lignes de défense des LTTE et coupe en deux leur territoire, entraînant l’évacuation de plus de 100 000 civils en quelques jours. La dernière bataille s’accompagne du déplacement de 77 000 personnes supplémentaires entre le 14 et le 20 mai 2009. De nombreux blessés figurent parmi les évacués. Environ 400 personnes sont admises les 21 et 22 avril à l’hôpital de Vavuniya, où les équipes de MSF et du ministère de la Santé opèrent jour et nuit. L’hôpital compte plus de 1 900 patients à la mi-mai, pour 480 lits. Alors que les bulldozers de l’armée en sont encore à défricher les zones 3 à 5, la population de Menik Farm passe de moins de 30 000 détenus à plus de 220 000 en cinq semaines. Quelque 45 000 personnes sont également internées dans de petits camps provisoires dans le district de Vavuniya, 21 000 dans ceux de Jaffna, Mannar, Batticaloa, Trincomalee et Ampara.
À partir du 20 avril, les deux sections de MSF se donnent trois priorités : fournir des soins d’urgence aux déplacés en zone de transit, renforcer les capacités opératoires et postopératoires (via notamment l’ouverture d’un hôpital de campagne) et développer des activités médico-sanitaires à l’intérieur des centres d’internement. Semblant prises au dépourvu par l’ampleur et la rapidité des transferts de population, les autorités locales se montrent réceptives à la plupart des propositions de MSF, demandant même à la section hollandaise de démarrer des cliniques mobiles à l’intérieur des camps « le plus tôt possible». Office of the Regional Director of Health Services, Vavuniya, « To MSF-Holland Project Coordinator. Request for medical team to work at IDP camps », 21 avril 2009.
À Colombo, le ministère de la Santé s’oppose à cette dernière intervention. Le Plan d’urgence (Master Plan), qu’il vient d’actualiser avec le soutien de l’OMS et de l’Unicef, réserve le monopole des activités de soins et de santé publique à l’intérieur des camps au gouvernement et à des partenaires triés sur le volet. En revanche, Colombo est très intéressé par les propositions d’intervention à l’extérieur des centres d’internement, qui cadrent avec sa programmation. Les 1eret 6 mai, les sections française et hollandaise signent chacune un nouveau protocole d’accord avec le ministère de la Santé les autorisant à démarrer trois projets : l’installation d’un hôpital chirurgical sous tentes de cent lits en face du complexe de détention de Menik Farm (MSF-France), le renforcement des soins aux blessés à l’hôpital de Vavuniya (MSF-Hollande) et l’ouverture d’une unité de soins postopératoires à Pompaimadhu (MSF-Hollande). Face à l’urgence, MSF choisit de s’inscrire dans les plans d’action du gouvernement au prix de deux concessions. Elle renonce à négocier dans l’immédiat un accès aux zones de transit et aux camps d’internement. De plus, elle doit signer un accord-cadre comportant une clause de confidentialité l’engageant à « maintenir la stricte confidentialité des informations relatives à la fourniture de services [de santé] » et à « ne faire aucun commentaire public sans l’aval du secrétaire du ministère de la Santé ».
Les programmes entérinés par Colombo ouvrent en moins de deux semaines. Les équipes tentent d’emblée d’aller au-delà des activités autorisées. À l’occasion de l’arrivée de la deuxième vague de déplacés, la section hollandaise parvient à négocier localement l’envoi d’une équipe de quatre personnes dans la zone de transit d’Omanthai (où elle avait vainement tenté d’intervenir en avril). Du 16 au 20 mai, les médecins de MSF assistent au triage et à l’embarquement des 77 000 rescapés de la dernière offensive dans des bus militaires à destination des camps d’internement. L’équipe traite 750 patients présentant pour la plupart des blessures anciennes, pas ou mal soignées. Elle ne peut que prodiguer des soins d’urgence (nettoyage des plaies, administration d’antibiotiques et d’antidouleurs), diriger les 200 cas les plus graves vers l’hôpital de Vavuniya, qu’elle sait débordé, et espérer que les blessés directement transférés dans les camps recevront les soins adéquats qui préviendront le développement d’infections handicapantes et/ou mortelles.
Une partie des blessés est transférée vers l’hôpital de Mannar. Le CICR, qui y a déployé une équipe chirurgicale, recense 800 patients et contacte directement MSF pour renforcer ses équipes. Les 23 et 24 mai, deséquipes mixtes du CICR, de MSF et du ministère de la Santé opèrent soixante patients présentant des blessures anciennes et infectées. Mais le 25 mai, la direction de l’hôpital reçoit l’ordre de Colombo d’interrompre sa collaboration avec le CICR et MSF, qui n’a pas été avalisée par le ministère de la Santé au niveau central. Les 800 blessés sont renvoyés sans soins vers les camps d’internement.
Le doute
L’accès aux camps devient alors un enjeu central pour MSF. Si la campagne de « sauvetage humanitaire des populations otages des LTTE » a signifié leur écrasement sous les bombes, comment ne pas craindre que les « villages de bienêtre » ne soient en réalité des lieux destinés à faire mourir la population tamoule à petit feu ?
L’accès aux camps d’internement est strictement réglementé mais possible pour le personnel national et international de MSF comme pour celui des cinquante-deux ONG et agences des Nations unies – à l’exception de plusieurs périodes de quarante-huit heures pendant lesquelles les forces de sécurité réalisent des opérations de « filtration » (screening) destinées à identifier d’éventuels militants des LTTE. MSF ne peut néanmoins se faire une idée précise de la situation sanitaire. Affirmant son monopole sur la production de chiffres, le gouvernement interdit toute enquête épidémiologique indépendante. Les responsables de MSF doivent se faire une représentation approximative de l’état sanitaire des populations à partir de leurs impressions visuelles, de brefs entretiens avec les personnes internées et de discussions plus longues avec les patients hospitalisés à Vavuniya et Menik Farm. Ils complètent le tableau en échangeant des informations avec le personnel de santé sri lankais, les employés nationaux et internationaux des autres agences de secours et les forces de sécurité, dont certains fonctionnaires critiquent ouvertement le refus de Colombo d’autoriser une plus large implication des acteurs internationaux à l’intérieur des camps – quelques-uns contestant même la politique d’enfermement.
L’impression générale qui en ressort est que les deux arrivées massives d’internés en avril et mai ont créé un énorme chaos, mais que celui-ci a progressivement été maîtrisé par le gouvernement et les acteurs de secours agissant sous la coordination du major général Chandrasiri, responsable en chef des complexes d’internement. Présidant les réunions de coordination interagences, celui-ci gère d’une main de fer l’assistance. Fin mai, OCHA constate qu’il manque 15 000 abris (sur 40 000), que la moitié des latrines ont été construites et que les besoins en eau sont couverts à 75 %. En privé, ses représentants reconnaissent que la vitesse à laquelle sont mis en place les services d’assistance est sans commune mesure avec, par exemple, le rythme lent et chaotique de la réponse des Nations unies et des ONG au Darfour en 2004.
Les plans du ministère semblent directement inspirés des manuels de santé publique produits par l’OMS ou MSF, mais le gouvernement paraît éprouver des difficultés à les mettre en œuvre malgré la mobilisation annoncée de 300 médecins et 1 000 infirmier(ère)s. Les équipes apprennent de sources concordantes (police, morgue, CICR chargé de la distribution de sacs mortuaires) que le nombre de décès à Menik Farm se situe fin mai entre dix et quinze par jour. Rapporté à la population totale des camps, il correspond à un taux de mortalité de 0,45 pour dix mille personnes et par jour. Si ce taux est bien en deçà des seuils d’urgence utilisés en Afrique, il est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Les camps ne sont pas des mouroirs, mais la désorganisation initiale du système de soins (dénoncée par une partie des médecins sri lankais, qui se mettent en grève durant l’été) est selon toute vraisemblance à l’origine d’une surmortalité parmi les personnes physiologiquement affaiblies (blessés, personnes âgées, enfants, malades chroniques, etc.)
En juin, les deux sections de MSF multiplient les propositions d’intervention à l’intérieur des camps (soins de santé primaires, nutrition, consultations de chirurgie, soins de santé mentale, surveillance épidémiologique, etc.). Toutes rencontrent une fin de non-recevoir plus ou moins explicite. Ce refus intensifie les interrogations et le malaise des équipes. Pourquoi le gouvernement s’obstine-t-il à interdire à MSF toute activité de santé à l’intérieur des camps ? Cherche-t-il à masquer une grave détérioration de la situation sanitaire ou une féroce répression politique ?
Les équipes de MSF-France travaillant à l’hôpital de Menik Farm sont particulièrement perplexes. Le taux d’occupation des lits ne dépasse pas 70 % alors que les autres hôpitaux périphériques sont toujours surchargés. MSF, qui n’a aucun contrôle sur la sélection des patients qui lui sont adressés depuis les camps, s’interroge sur les raisons de la sous-utilisation de sa structure. Comment s’assurer qu’elle reçoit les cas les plus graves en priorité ? Existe-t-il un tri politique des patients ? L’hôpital de MSF ne sert-il pas uniquement la propagande du gouvernement, cherchant à donner une apparence de normalité ? Aux sièges des deux sections comme sur le terrain, nombreux sont ceux qui se demandent si MSF ne devrait pas quitter les camps et dénoncer les politiques de détention du régime dont les organisations humanitaires sont de facto les auxiliaires sanitaires.
Le choix
À l’issue d’une visite du siège en juin 2009, la section française fait le choix de persévérer, tout en étant consciente du rôle que le gouvernement lui assigne : participer au maintien de l’ordre sanitaire dans des camps modèles dont la principale fonction est de surveiller et de contrôler des populations jugées « dangereuses », d’étouffer toute résurgence du nationalisme tamoulFabrice WEISSMAN, « Bienvenue à la “ferme”. MSF et la politique d’internement des déplacés du Vanni », rapport de visite dans les camps de Menik Farm et à Colombo (Sri Lanka), 4-14 juin 2009, Paris, Fondation MSF/CRASH, juillet 2009. Ayant décrété l’abolition des minorités et renoncé par là même à prendre en compte leurs aspirations politiquesEn juillet 2009, le président déclare : « Ma théorie est qu’il n’y a pas de minorités au Sri Lanka. Il y a seulement ceux qui aiment leur pays et ceux qui ne l’aiment pas », cité dans The Hindu, 6 juillet 2009., l’administration Rajapakse entend réduire les populations du Vanni à des bénéficiaires de la sollicitude humanitaire de l’État, bien soignés, bien nourris, bien logés, et surtout bien gardés. La « ferme » – Menik Farm – est emblématique de cette politique appelée à s’étendre au-delà des barbelés, comme l’indique la décision du ministère de la Défense de recruter 50 000 soldats supplémentaires à l’issue de la guerre. Cette dernière initiative donne du crédit aux critiques du régime qui dénoncent une pacification du Vanni sous forme d’occupation militaire de longue durée.
Les seules concessions que peuvent escompter les acteurs internationaux (États, ONU, ONG, etc.) concernent l’assouplissement de la politique d’enfermement : transparence du processus de « filtration », libération de certaines catégories d’internés et amélioration des conditions de détention. MSF doit contribuer à cette amélioration, estiment ses responsables opérationnels. À cette fin, MSF-France entend devenir un rouage essentiel du système de santé des camps d’internement : en juillet, elle augmente sa capacité d’hospitalisation, étoffe le plateau technique (radiologie, échographie, laboratoire, etc.) et remplace les tentes d’hospitalisation par des bâtiments semipermanents. Elle entreprend par ailleurs d’obtenir la libération pour raisons médicales de certains internés.
Cette position est aux antipodes de celle défendue par les autres organisations humanitaires et les bailleurs de fonds (États-Unis et Union européenne en tête). Finançant les camps à hauteur de 700 000 dollars par jour, l’ONU et ses bailleurs s’opposent en juin 2009 à l’amélioration substantielle des standards d’assistance réclamée par le gouvernement (construction d’abris en dur et de latrines à fosses septiques, extension des infrastructures de soins et du réseau d’eau courante, etc.) afin d’affirmer la nature temporaire des centres d’internement. La majorité des ONG refuse à la même époque de distribuer du ciment pour solidifier le sol des abris en toile et en plastique. Les conditions d’hébergement sont pourtant précaires. Les tentes et les bâches utilisées dans l’ensemble des zones (à l’exception des zones 0 et 1, dotées d’abris en dur construits par l’armée) se dégradent rapidement alors que les latrines débordent et qu’une boue nauséabonde envahit les tapis de sol. Dans un étrange renversement de situation, le gouvernement accuse les organisations humanitaires d’être à l’origine d’une « crise humanitaire » et de prendre les déplacés en otage pour faire plier les autorités. Les accusations se renforcent en août 2009 quand les premières pluies de mousson transforment les camps en cloaques. Mais les images des camps inondés sont également un outil de mobilisation dont s’emparent les organisations de défense des droits de l’homme et une partie du personnel politique sri lankais pour exiger une « prompte et rapide réinstallation des déplacés dans leurs lieux d’origine ».
En effet, le passage à l’opposition du général Sarath Fonseka, commandant en chef de l’armée sri lankaise ayant conduit l’offensive victorieuse, et sa décision de concourir contre le chef de l’État sortant aux élections présidentielles anticipées de janvier 2010 mettent la question de l’internement des déplacés sur le devant de la scène politique. Partageant la même base sociale, Rajapakse et Fonseka sont à la chasse aux voix des minorités. Dès le mois d’août 2009, l’ancien chef d’état-major dénonce le sort réservé aux internés par l’administration Rajapakse. Conjugués aux pressions internationales, ces enjeux électoraux conduisent le régime à ouvrir les camps et à entamer une politique de réinstallation au pas de charge à partir du mois de septembre 2009. Le 31 décembre, plus de la moitié des déplacés ont déjà été renvoyés dans leurs villes et villages détruits, minés, quadrillés par l’armée et les forces de sécurité en civil. Les sections française et hollandaise ferment leurs programmes d’urgence. L’hôpital de Menik Farm n’aura pas eu le temps de devenir le principal hôpital des camps d’internement. Plus de 4 000 admissions ont été enregistrées entre le 22 mai et le 6 décembre, dont 585 patients souffrant de blessures de guerre. Selon les informations recueillies auprès des autorités de santé locales, cette activité représente entre 5 % et 10 % du total des hospitalisations en provenance des camps.
Revenue au Sri Lanka en pensant bénéficier d’un statut à part dans le monde de la solidarité internationale, MSF s’est retrouvée dans une position de négociation extrêmement fragile, finalement comparable à celle des autres ONG. La faiblesse de sa position tient en premier lieu à la stratégie victimaire des Tigres, qui a consisté à retourner le discours humanitaire en outil de propagande au service de la perpétuation d’un mouvement aux pratiques totalitaires. Arguant de la perfidie des LTTE, le gouvernement a démontré une remarquable habileté à organiser et à justifier l’assujettissement des organisations humanitaires à ses intérêts politico-militaires. MSF s’est retrouvée assignée à un rôle d’auxiliaire d’une politique de pacification ayant réglé la question du vivre ensemble au Sri Lanka par le bombardement, la surveillance militaro-policière et l’assistance sanitaire des populations décrétées dangereuses.
Sous la menace permanente de sanctions administratives et de représailles violentes, l’association n’a pas su trouver les soutiens politiques lui permettant de résister. Dépourvue d’alliés dans la société sri lankaise, elle s’est appuyée sur les États occidentaux et les Nations unies, à l’influence déclinante. MSF a fini par accepter les diktats du gouvernement – qui lui a imposé ses lieux, cibles et modalités d’intervention – tout en comptant sur les failles bureaucratiques du système et sur ses pôles de contestation internes pour retrouver une marge d’autonomie. L’association a enfin renoncé à faire un usage offensif de sa liberté de parole face à un régime pourtant soucieux d’apparaître aux yeux du monde et de sa propre société comme le garant d’un État de droit respectueux des valeurs démocratiques. En définitive, MSF a opté pour une politique du moindre pire, cherchant à améliorer le sort des rescapés d’une guerre totale dont aucun pouvoir ne semblait en mesure d’enrayer le cours.
***
Éthiopie. Jeu de dupes en Ogaden
LAURENCE BINET
En avril 2007, le conflit qui oppose depuis 1994 l’État fédéral éthiopien au groupe indépendantiste de l’Ogaden ONLF (Ogaden National Liberation Front, Front de libération nationale de l’Ogaden) s’intensifie sur le territoire de l’Ogaden, dans la région Somali. Après une série d’offensives de la rébellion, une vague de répression s’abat sur la région : attaques et incendies de villages, violences et déplacements forcés, refus d’accès aux puits et blocus économique, le commerce étant pourtant une activité vitale pour les nomades qui peuplent ce territoireJeffrey GETTLEMAN, « In Ethiopian desert, fear and cries of army brutality », The New York Times, 18 juin 2007
En 2007, MSF se donne pour ambition de prendre en charge les victimes du conflit. Dans une région très faiblement pourvue en structures médicales, où la population est dispersée, il s’agit de soutenir des centres de santé et d’organiser des dispensaires mobiles pour aller au-devant des patients.
L’équipe de la section hollandaise s’efforce d’ouvrir un programme dans l’hôpital de Wardher, situé en périphérie de la zone de conflit, mais l’accès aux populations vivant dans cette région lui est régulièrement refusé par l’armée. Elle parvient néanmoins à réaliser quelques tournées de consultations médicales, au cours desquelles elle recueille des récits des exactions commises par les belligérants. Mais, après avoir dû évacuer temporairement la mission à la suite d’une attaque des rebelles non loin de sa base en juillet 2007, elle se voit interdite de retour par les autorités éthiopiennes.
Au même moment, ces dernières donnent l’ordre à la section belge de MSF d’interrompre sa mission exploratoire dans la zone de Fiq, située au cœur du conflit, où elle s’apprêtait à ouvrir un programme. Le CICR est quant à lui accusé de soutenir l’ONLF, puis expulsé de la région Somali.
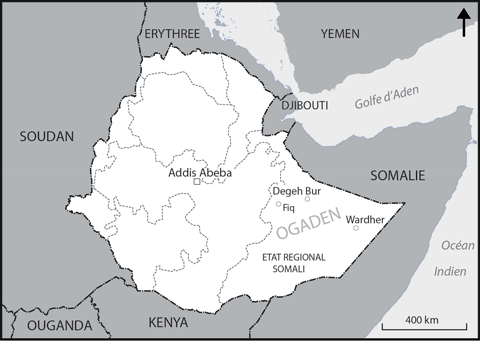
Aucune autre organisation humanitaire n’est active dans les zones de conflit de l’Ogaden. L’aide du PAM est distribuée par l’armée, suspectée de réserver l’assistance aux populations se tenant à distance de l’ONLF.
Début septembre 2007, après une série de rendez-vous diplomatiques peu concluants, notamment auprès des principaux États bailleurs de l’Éthiopie, MSF dénonce, lors d’une conférence de presse, le refus d’accès aux populations de l’Ogaden« MSF denied access to Somali Region of Ethiopia despite worsening humanitarian crisis », communiqué de presse MSF, 4 septembre 2007.. Les récits de violations des droits de l’homme collectés par la section hollandaise y sont également mentionnés et sont repris par des médias internationaux« Ethiopia blocking civilian access to medicine in conflict zone, agency says », Associated Press, 4 septembre 2007..
Le gouvernement accuse alors MSF de violer la souveraineté de l’État et de soutenir l’ONLF « Ethiopia. government denies “blocking” NGO », IRIN, Nairobi, 4 septembre 2007.. La section belge est sommée d’arrêter le programme de prise en charge des malades atteints de tuberculose qu’elle mène de longue date hors de la zone de conflit, tandis que l’équipe hollandaise reste interdite de retour à Wardher.
Entre-temps, soucieux de réagir aux alertes relatives à la situation en Ogaden émises en particulier par MSF, OCHA a envoyé une mission enquêter sur le terrain. Celle-ci a constaté une détérioration de la situation sanitaire et économique dans certaines zones « Report on the findings from the UN humanitarian assessment mission to the Somali Region », 30 août-5 septembre 2007.: accès difficile à l’eau et à la nourriture, pénurie de médicaments et d’aliments thérapeutiques, nombreux cas de diarrhée aiguë et de rougeole. En novembre, OCHA obtient des autorités éthiopiennes qu’elles autorisent plusieurs organisations internationales à travailler en Ogaden. Prenant acte de l’opposition des autorités au retour des sections belge et hollandaise, MSF encourage les candidatures des sections suisse et espagnole, qui se retrouvent sur la liste des élues. OCHA obtient également la promesse que des agents du PAM pourront être présents pendant les distributions alimentaires organisées par l’armée, mais cette promesse ne sera pas tenue.
En janvier 2008, les sections suisse et espagnole ouvrent des programmes médico-nutritionnels dans les zones directement touchées par le conflit – Fiq et Degeh Bur –, et la section hollandaise se réinstalle à Wardher, sans autorisation ni interdiction formelle. Mais, dès la mi-janvier, deux sections sont de facto bloquées. En effet, l’équipe de MSF-Hollande à Wardher est assignée à résidence après qu’un de ses camions a refusé de s’arrêter à un barrage de l’armée. Des membres du personnel national sont accusés d’espionnage pour le compte de l’ONLF. Une équipe mobile de la section suisse de MSF est également arrêtée en pleine mission exploratoire et interdite de sortir de son hôtel, sans explication. Avant cet incident, la section suisse avait constaté que les populations étaient victimes de violences directes et faisaient face à des pénuries d’eau, de nourriture et de soins médicaux dues aux difficultés de déplacement engendrées par le conflit. Les responsables de l’organisation hésitent toutefois à considérer ces observations comme représentatives de la situation à l’échelle de la région.
En mars 2008, à peine les assignations à résidence sont-elles levées que les activités des trois sections de MSF sont bloquées, au motif que la plupart des membres du personnel expatrié sont dépourvus de permis de travailLettre du secrétaire général du bureau international de MSF au Premier ministre éthiopien et au ministre éthiopien des Affaires étrangères, 31 mars 2008.. En mai, une grave crise nutritionnelle requiert l’intervention en urgence de main-d’œuvre internationale dans plusieurs États de l’Éthiopie, et les autorités deviennent plus souples en matière de permis de travail.
Toutefois, dans la région de Fiq, les équipes mobiles de MSFSuisse sont toujours paralysées et, en juin 2008, des membres du personnel national sont incarcérés, accusés d’espionnage. Un mois plus tard, la section ferme son programme et dénonce publiquement l’étouffement administratif qui l’empêche de porter secours aux populations de la zone« Ethiopia. Repeated obstructions lead MSF-Switzerland to pull out from Fiq, Somali Region of Ethiopia », communiqué de presse de MSF-Suisse, 10 juillet 2008.. Dans un document qu’elle fait circuler auprès des bailleurs de fonds, des institutions internationales et des ambassades, elle dénonce également l’instrumentalisation des distributions de l’aide alimentaire d’urgence par les autorités éthiopiennes et l’absence de réaction des Nations unies« Access and response in the Somali Region, mission impossible ? The case of MSF-Switzerland in Fiq », rapport MSF, décembre 2007-juin 2008..
Les autres sections, espérant pouvoir travailler dans l’espace d’intervention qui leur est accordé et estimant manquer de preuves solides concernant les détournements de l’aide, ne s’associent pas à cette démarche. Dans les années qui suivent, s’accommodant des contraintes administratives récurrentes, elles développent des programmes de soutien aux structures de santé dans les zones où le conflit perdure en basse intensité. Elles y prodiguent des soins médicaux et nutritionnels à des populations qui en sont de toute façon dépourvues et elles assurent la prise en charge médicale des réfugiés somaliens dans les camps de transit le long de la frontière.
Antagonisme des ambitions
La question de l’accès à l’Ogaden en 2007-2008 reflète l’antagonisme entre les ambitions de MSF et celles du gouvernement éthiopien. En effet, celui-ci considère que l’aide d’organisations internationales humanitaires aux populations des zones ONLF est un soutien potentiel à cette rébellion. Il stigmatise la prise de contact avec les insurgés, pourtant capitale pour assurer la distribution impartiale de l’aide et la sécurité des équipes humanitaires, l’assimilant à un engagement politique. Cette position est clairement exprimée et assumée au cours de réunions avec les représentants de MSF et dans des courriers officiels qui leur sont adressésLettre de Tekeda Alemu, ministre éthiopien des Affaires étrangères aux chefs de mission des sections belge, hollandaise, suisse et espagnole de MSF, 18 février 2008.. En 2009, le président de la région Somali confiera même à un journaliste qu’il « croit que MSF a un agenda caché. MSF consulte les chefs de clan qui ont des relations étroites avec l’ONLF et embauche du personnel qui soutient l’ONLF».Peter GILL, Ethiopia since Live Aid, Oxford University Press, Oxford, 2010.
Convaincue de sa légitimité à aider les populations de l’Ogaden, MSF met du temps à prendre la mesure de cette intransigeance. Elle s’efforce d’y résister en jouant sur la pluralité des sections et en activant les leviers de la négociation diplomatique et de l’expression publique. Mais cette expression publique joue en sa défaveur. Pendant la conférence de presse de septembre 2007, bien qu’initialement écartés, car jugés insuffisamment documentés, les récits de violences recueillis par l’équipe de la section hollandaise sont mentionnés. L’épisode renforce la défiance des autorités éthiopiennes à l’encontre de MSF, accusée de faire la propagande de l’ONLF sous le couvert de l’assistance humanitaire. Quelques semaines plus tard, les représentants de l’association ont l’occasion de vérifier l’intolérance du gouvernement à la critique lors d’un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères : celui-ci leur présente un dossier de coupures de presse rassemblant toutes les critiques publiques émises par l’organisation à l’encontre des autorités éthiopiennes depuis l’épisode de la dénonciation des transferts forcés de population pendant la famine de 1985.
En juillet 2008, c’est la dénonciation solitaire du refus d’accès par la section suisse qui voit sa portée limitée par le choix des autres sections de se maintenir en Ogaden. Ce paradoxe n’échappe pas aux autorités, qui accusent publiquement MSF de « disséminer des rumeurs dont le contenu est clairement démenti par les réalités sur le terrain».« Ethiopia slams Swiss charity over Ogaden pull-out », Reuters, 12 juillet 2008.
De l’aveu même des chefs de mission, le réseau de contacts officiels de MSF en Éthiopie est peu développé et mal organisé. Lorsqu’il s’agit de négocier avec les autorités, les équipes, ayant souvent peu d’expérience dans le pays, peinent à identifier les bons interlocuteurs au sein d’un système administratif dont la complexité brouille les niveaux de responsabilité : autorisations et restrictions sont décidées tantôt au niveau régional, tantôt au niveau fédéral, tantôt par les autorités de santé, tantôt par l’armée, sans qu’aucune règle paraisse définie.
Sur le plan diplomatique, l’équipe chargée de coordonner les démarches de l’ensemble des sections MSF auprès des États, des sociétés civiles et des institutions internationales constate la vanité de toute démarche auprès de l’Union africaine, au sein de laquelle l’Éthiopie a un rôle prépondérant. Elle concentre donc ses efforts sur les agences onusiennes et les États occidentaux pourvoyeurs de l’aide internationale à l’Éthiopie, donc susceptibles de se montrer sensibles aux difficultés d’accès des populations de l’Ogaden à cette aide. Mais l’Éthiopie est le principal allié africain des États-Unis et de leurs partenaires dans la « guerre contre le terrorisme », notamment en Somalie, où Addis-Abeba joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les insurgés islamistes.Voir chapitre « Tout est négociable : MSF en Somalie », p. 101.
En tête à tête, la plupart des diplomates et des représentants des agences des Nations unies présents en Éthiopie se montrent préoccupés par le refus d’accès et la manipulation de l’assistance. Si nombre d’entre eux encouragent MSF à dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas, aucun ne paraît avoir les moyens ou l’ambition de modifier le rapport de forces avec le gouvernement éthiopien, passé maître dans l’art du contrôle de l’aide.
Au cours de cet épisode, les autorités éthiopiennes ont entraîné MSF dans deux tours de valse à trois temps. Le premier tour s’amorce d’avril à novembre 2007, lorsqu’elles imposent répression et refus d’accès. Le deuxième temps est marqué par les protestations diplomatiques et publiques de MSF. Il mène au troisième temps, en novembre : une ouverture de façade, momentanément concédée par les autorités sous la pression des Nations unies.
En 2008, au deuxième tour de valse, le rythme s’accélère. Le temps du refus d’accès est plus marqué et celui de l’ouverture à peine esquissé, les autorités enchaînant quasiment sans interruption les épisodes de harcèlement administratif qui paralysent les activités des équipes.
Au final, si MSF résiste au premier tour de valse, elle s’essouffle ensuite pour finir par se plier au tempo qui lui permet de rester dans la danse. En effet, depuis ce qui constitue à ce jour son dernier positionnement public sur la situation en Ogaden, l’organisation joue profil bas, espérant ainsi développer de meilleures relations avec les autorités et améliorer son accès à la région. Ce positionnement est censé lui permettre de porter secours aux populations au cas où le conflit y reprendrait de l’ampleur. Mais rien ne laisse penser que le gouvernement éthiopien ouvrirait alors plus volontiers l’accès qu’en 2007 et 2008.
***
Yémen. Profil bas
MICHEL-OLIVIER LACHARITÉ
En 2004, une insurrection guidée par l’ancien député Hussein Al Houthi éclate dans le nord du Yémen, dans le gouvernorat de Saada. Ses partisans contestent le rapprochement politique du gouvernement yéménite avec les États-Unis et revendiquent le renouveau du zaydisme, une école du chiisme à laquelle appartenait l’imamat qui régna au Yémen jusqu’en 1962. La guerre de Saada se déroule de juin 2004 à février 2010 et se caractérise par des périodes d’affrontements intenses entrecoupées de moments de répit.
La section française de MSF réalise une première mission exploratoire dans le nord du Yémen en juillet 2007, alors qu’un cessez le-feu vient d’être signé sous les auspices du Qatar un mois auparavant. Au terme de quatre épisodes d’affrontement, le gouvernement n’est pas venu à bout du mouvement houthiste, et celui-ci n’est pas parvenu à contrôler des territoires. Pour MSF, l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins secondaires dans la région de Saada, peu dotée en hôpitaux et exposée au risque de reprise des hostilités, avec ses conséquences prévisibles (blessés de guerre, déplacements de population, etc.). L’association met en place des activités médicales dans l’hôpital de Haydan en septembre 2007, de Razeh en décembre 2007 et d’Al Talh en avril 2008. Tous situés en zone gouvernementale au démarrage des activités de MSF, ces hôpitaux passent progressivement sous le contrôle des partisans d’Al Houthi pendant la guerre – Haydan en 2008, Razeh et Al Talh en 2009.
Entre 2004 et 2007, le conflit yéménite est très peu couvert par les médias. L’absence d’images et de récits de guerre s’explique par l’extrême contrôle de l’information exercé par le gouvernement yéménite, qui se manifeste par des actes de répression physique envers les journalistes et des poursuites judiciaires contre les opposants du régimePatrice CHEVALIER, « The Yemeni law and how to use it against journalists », http://www.hal.archives-ouvertes.fr – version 1, 16 février 2009.. Ces dernières se multiplient à partir de 2001, favorisées par la « guerre contre le terrorisme » dans laquelle le Yémen s’engage, signifiant son alignement aux côtés des États-UnisIbid. Le gouvernement contrôle également la communication sur le mouvement des partisans d’Al Houthi : ainsi, des journalistes proches du pouvoir yéménite ont fondé un think tank et un site Internethttp://www.nashwannews.com. Voir Samy DORLIAN, « Yémen. Observation sur le traitement médiatique de la guerre de Saada », Olfa LAMLOUM (dir.), Médias et Islamisme, coll. « Études contemporaines », Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2010. dont les analyses visent à limiter la capacité de mobilisation politique des rebelles. Ceux-ci n’ont guère les moyens de faire parler d’eux au-delà des tracts distribués à la population et des rares contacts qu’ils nouent avec les quelques journalistes s’aventurant à couvrir le conflit.
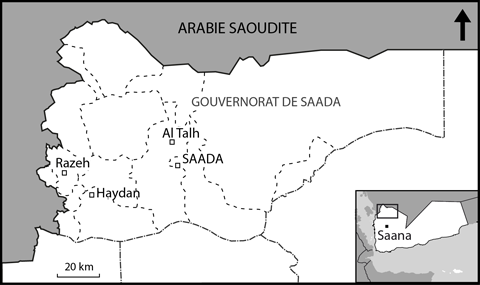
Lors de l’ouverture du projet de MSF en septembre 2007, la donne a changé depuis quelques mois: la médiation diplomatique du Qatar s’accompagne en effet de la médiatisation du conflit, notamment par la chaîne satellitaire qatarie Al Jazeera. Les insurgés commencent à distribuer des DVD contenant des scènes de guerre, leurs victoires militaires et les discours de leurs leaders, et transmettent des informations via des listes de diffusion électronique sur Internet, permettant de contourner la fermeture des sites pro-Al Houthi.
MSF est, avec le CICR, qui agit par l’intermédiaire du CroissantRouge yéménite, la seule organisation d’aide internationale à accéder aux zones de combats. Rare témoin étranger du conflit et de ses conséquences désastreuses pour la population, l’association hésite : doit-elle contribuer au dévoilement des violences d’une guerre méconnue, quitte à mettre en péril ses opérations ? Entre 2007 et 2009, l’évolution du contexte d’intervention incite MSF à choisir la prudence. Sa marge de manœuvre dépend en effet en grande partie du bon vouloir du gouvernement. Celui-ci soumet les déplacements du personnel international, les mouvements de véhicules, de médicaments et de matériel de MSF à une autorisation au cas par cas du ministère du Plan, de la police et du gouverneur de Saada. En 2009, les ambitions de MSF en matière de communication se limitent explicitement à faire connaître localement ses activités au Yémen, en d’autres termes, à se faire accepter par les parties en conflit.
Un silence opportun ?
Entre août 2009 et février 2010, la ville d’Al Talh passe sous le contrôle des houthistes. L’hôpital dans lequel MSF travaille se retrouve ainsi sur une ligne de front qui avance et recule entre Al Talh et la ville de Saada. En août et septembre, il est atteint plusieurs fois par des balles et des fragments d’obus.
Le 8 septembre 2009, les équipes de MSF reçoivent sept enfants et une femme, touchés par des bombardements en pleine ville, à l’hôpital. Deux seulement survivent à leurs blessures. Le 14 septembre, le marché d’Al Talh est bombardé par l’aviation gouvernementale. Trente et un blessés et neuf morts sont amenés à l’hôpital. Très vite, les partisans d’Al Houthi y font massivement irruption afin d’y prendre des images des blessés, avant d’être convaincus de quitter les lieux par les équipes de MSF, qui font valoir que la présence des insurgés transforme l’hôpital en une cible militaire potentielle. Ce jour-là, l’autorité gouvernementale de la région contacte à plusieurs reprises la coordinatrice du projet, lui affirmant qu’il n’a pas donné l’ordre de bombarder et s’inquiétant de savoir si MSF va communiquer sur l’événement. Le lendemain, les autorités centrales émettent un communiqué de presse dans lequel elles s’exonèrent de toute responsabilité vis-à-vis des bombardements4. Deux jours plus tard, un avion gouvernemental lance des tracts qui proposent deux options à la population : se battre contre les rebelles ou quitter la ville.
Dans les jours qui suivent, les combats s’intensifient autour de Saada. Les équipes de MSF s’inquiètent de l’impact d’une insécurité croissante sur leur capacité à maintenir leurs activités à l’hôpital : les routes d’évacuation vers la capitale et vers l’Arabie saoudite sont de plus en plus dangereuses, semblant réduire de jour en jour les possibilités d’évacuation de son personnel international. Ses employés nationaux, qui empruntent plusieurs fois par semaine la route entre Saada et Al Talh, y sont bloqués, harcelés ou empêchés de circuler par l’armée. Une haute figure militaire du Yémen contactée par MSF, qui cherche à obtenir des garanties de sécurité, lui conseille de partir. Le 22 septembre, MSF arrête ses activités chirurgicales et organise le transfert des patients vers l’hôpital de Saada, situé à une quinzaine de kilomètres. Quelques jours plus tard le personnel expatrié est évacué d’Al Talh, et le personnel national quitte l’hôpital.
L’association ne communique pas sur les bombardements dont elle a été témoin, manquant à l’engagement qu’avait pris MSF en 2006 : « Nous avons appris à être prudents dans nos actions sans pour autant nous interdire de dénoncer des crimes graves et ignorés, tels que le bombardement de civils, des attaques sur des hôpitaux ou le détournement de l’aide humanitaire. Prendre publiquement position en réaction à de telles situations et placer d’autres acteurs face à leurs responsabilités reste un rôle essentiel de MSFMSF, accord de la Mancha, Athènes, 2006.. »
Comment MSF a-t-elle justifié son mutisme face à un crime grave et peu relayé au monde extérieur par des témoins directs ?
Pour les responsables opérationnels de l’association, dénoncer les bombardements revenait à pointer la responsabilité directe du gouvernement, donc à mettre en péril la poursuite des activités de MSF au Yémen pour un gain aléatoire : déplorer la mort de civils dans les combats aurait-il incité les belligérants à faire preuve de retenue dans l’usage de la violence ?
Plus généralement, en 2009, MSF a été expulsée du Darfour, un an auparavant ses activités au Niger ont été suspendues par le gouvernement et, au moment des bombardements d’Al Talh, une communication publique de l’organisation sur les conditions d’internement des déplacés du conflit sri lankais a provoqué la colère des autorités : les débats autour de ce qui est perçu comme un dilemme entre la parole et l’action sont donc vifs au sein de MSF et une partie de ses cadres revendiquent de soigner en silence. Ainsi, quelques mois plus tôt, dans un entretien accordé à Al Jazeera à la suite de l’expulsion de MSF du Darfour, le directeur des opérations de l’association avait déclaré : « Il faut faire la différence entre les militants des droits de l’homme ou de la justice internationale, et les organisations de secours. »
Peu déterminée à dénoncer un crime qui ne la touchait pas directement et à hypothéquer l’ensemble de ses opérations au Yémen, MSF n’a pas souhaité non plus enjoindre publiquement les parties en conflit d’épargner l’hôpital et de garantir la sécurité de ses équipes et de leurs déplacements. Face à l’intensification des combats, ses équipes ont choisi de mettre en sécurité le personnel et les patients et d’évacuer la structure, en silence, ne voyant aucune utilité immédiate et concrète à communiquer. Toutefois, le 5 octobre, alors que les quelques soignants qui avaient continué d’y accueillir des patients après le départ de l’association avaient tous quitté l’hôpital, MSF diffusa un communiqué à l’agence nationale de presse et plusieurs journaux yéménites. Espérant pouvoir redémarrer un jour ses activités à Al Talh et craignant que l’hôpital ne soit pillé et bombardé, elle « appela au respect des structures de santé [du gouvernorat de Saada] et de leur fonctionnalité », en l’occurrence au respect de l’équipement et des murs du bâtiment déserté.
Une parole en l’air
En décembre 2009, comme chaque année, MSF mène une action de communication institutionnelle destinée à développer sa visibilité consistant à établir et à diffuser dans les médias le « Top Ten des crises humanitaires ». Le Yémen en fait partie. MSF y mentionne notamment que « la violence a connu une escalade en août quand les forces armées yéménite sont assailli et bombardé les partisans d’Al Houti » et déplore que « des dizaines de milliers de personnes ont fui dans les gouvernorats voisins de Saada : Hajja, Amran et Al Jawf, où elles n’ont pas ou peu d’accès aux soins ».
Al Jazeera et de nombreux autres médias arabes reprennent l’information. La chaîne qatarie organise même une édition spéciale autour de la communication de MSF sur le Yémen en décembre 2009, et ses analystes s’interrogent publiquement sur les conséquences négatives de cette prise de parole sur la crédibilité du président Saleh.
La réponse du gouvernement est instantanée. Toutes les autorisations pour l’organisation au Yémen, en plein cœur de la guerre, sont immédiatement suspendues : mouvements de personnes et véhicules, importations, ouvertures de projet, renouvellement de l’accord-cadre avec MSF. Lors d’une réunion, des représentants du gouvernement exposent leurs griefs principaux au chef de mission : MSF n’a pas fait preuve de neutralité dans le conflit, en dénonçant uniquement les violences de guerre de l’armée et pas celles des partisans d’Al Houthi, et elle fait une analyse infondée de l’offre de soins dans des zones gouvernementales où elle n’est pas ou très peu présente. L’un des interlocuteurs de MSF au sein du gouvernement conclut : « C’est à cause de ce genre de rapport purement politique que vous vous êtes fait expulser du DarfourCompte rendu interne MSF, décembre 2009.. »
Pourtant, l’inscription du Yémen au Top Ten des crises humanitaires ne visait aucun objectif politique ou opérationnel précis – si ce n’est « attirer l’attention des médias sur une crise oubliéeEntretien avec la directrice adjointe de la communication, MSF-France, janvier 2011.». C’est précisément l’absence d’intention et de cible qui s’est traduite par une description approximative du conflit et de ses conséquences, dans laquelle le gouvernement a pu percevoir une forme d’empathie pour la cause des insurgés. Le court récit le présente en effet comme principal responsable de l’intensification des hostilités et des entraves à l’assistance, réprimant une rébellion animée de revendications économiques, politiques, sociales et religieuses.
Les autorités posent explicitement les termes de la négociation : si l’association accepte de démentir les problèmes d’accès posés par le gouvernement yéménite, l’insuffisance de l’offre de soins en zone gouvernementale, et souligne que l’utilisation unique du Yémen pour parler du rapport Top Ten n’engage que le point de vue des médias, alors le gouvernement lèvera les sanctions contre elle. MSF accepte le troc. En décembre 2009, les responsables du siège parisien adressent donc un courrier aux autorités yéménites dans lequel ils reconnaissent que le rapport a pu paraître partial et que les problèmes d’accès des civils aux soins étaient insuffisamment documentés. L’agence nationale de presse diffuse deux communiqués aux intitulés éloquents : « MSF présente ses excuses au Yémen pour son rapport inexact sur Saada » et « MSF demande pardon au Yémen pour son rapport faussé sur les conditions de santé des déplacés ». Ils sont transmis par SMS à une partie des abonnés de téléphonie mobile yéménites et relayés par une vingtaine de médias nationaux et quelques agences internationales. Le gouvernement lève immédiatement toutes les sanctions contre MSF.
Lors des bombardements d’Al Talh, MSF a traité la communication publique comme une menace pour ses opérations, et non comme un moyen de pression pour inciter le gouvernement à garantir la sécurité des civils et des équipes de secours. Celui-ci aurait difficilement pu contester un témoignage direct et instantané d’un acteur médical prenant en charge les victimes civiles de bombardements et lui-même touché par l’insécurité. En revanche, l’épisode du Top Ten, qui confirme l’extrême sensibilité du gouvernement yéménite à son image médiatique dans la guerre, révèle la fragilité de la position de MSF quand sa prise de parole ne vise pas d’objectif politique ou opérationnel précis. L’association n’a eu dès lors aucune raison de résister au bras de fer imposé par les autorités. Elle a de fait nourri la propagande du gouvernement en niant les difficultés d’accès aux soins auxquelles faisait face la population, et dont il partage la responsabilité avec la rébellion.
***
Afghanistan. Retour négocié
XAVIER CROMBÉ en collaboration avec MICHIEL HOFMAN
Traduit de l’anglais par Xavier Crombé, Luce Deron et Isabelle Sassier
Le 28 juillet 2004, deux représentants de MSF organisaient une conférence de presse à Kaboul pour annoncer la décision de l’association de se retirer d’Afghanistan. Le 2 juin, précisèrent-ils, cinq de ses membres avaient été assassinés dans la province de Badghis et, près de deux mois plus tard, les autorités de Kaboul n’avaient toujours rien fait pour arrêter et traduire en justice les suspects. En outre, un porte-parole supposé des talibans avait revendiqué les assassinats et accusé MSF d’« espionner pour le compte des Américains », justifiant ainsi de nouvelles attaques à venir. Ces éléments avaient conduit l’association à conclure que « toute action humanitaire indépendante, qui suppose que des volontaires se rendent sans armes dans des zones de conflit pour apporter leur aide, est devenue impossible [en Afghanistan] ».
Au-delà de ces raisons immédiates, les deux porte-parole mirent en cause la responsabilité des forces internationales dans la création d’un contexte délétère. Les tentatives systématiques de récupération de l’action humanitaire par la coalition internationale pour «gagner les cœurs et les esprits» avaient profondément nui à l’image de neutralité et d’impartialité des travailleurs humanitaires« After 24 years of independent aid to the Afghan people, Doctors Without Borders withdraws from Afghanistan following killings, threats, and insecurity », communiqué de presse de MSF, 28 juillet 2004..

La décision de MSF suscita la surprise parmi les participants de la conférence de presse, nombre d’entre eux évoquant les vingt-quatre années d’engagement de l’organisation en Afghanistan, y compris aux pires heures du conflit. « N’y a-t-il aucun moyen pour vous de rester […] et de faire face à ces problèmes de sécurité ? » demanda quelqu’un dans l’assistanceTranscription de la conférence de presse, juillet 2004, archives de MSF..
Dans un commentaire publié par le Wall Street Journal quelques semaines plus tard, Cheryl Benard, une chercheuse américaine proche de l’administration Bush, proposa une solution « clés en main » : « Nous avons changé d’époque […]. Le principe prôné par Médecins Sans Frontières – selon lequel le personnel civil fournissant une aide médicale aux personnes en détresse doit se voir accorder le droit de passage – appartient désormais au passé […]. Une appréciation objective des faits devrait conduire les organisations telles que Médecins Sans Frontières à réclamer, non pas moins, mais plus de présence militaire ; non pas une séparation des domaines, mais au contraire une coopération plus étroite avec l’armée. Faute de quoi, elles ne devront pas seulement se retirer d’Afghanistan, mais de la plupart des conflits du XXIesiècle. »Cheryl BENARD, « Afghanistan without doctors », The Wall Street Journal, 12 août 2004. L’époux de Cheryl Benard a été ambassadeur américain en Afghanistan.
« Dans la “guerre contre la terreur”, toutes les factions veulent que nous choisissions notre camp », répliqua le président du conseil international de MSF. « L’“appréciation objective” de Mme Benard […] n’est qu’un nouvel exemple de cette logique. Nous refusons de choisir un camp. »Dr Rowan GILLIES, « The real reasons MSF left Afghanistan », lettre au rédacteur en chef, The Wall Street Journal, 19 août 2004.
La controverse n’était pas nouvelle : elle battait son plein depuis que l’administration Bush, en représailles aux attentats du 11 Septembre, avait lancé l’opération « Liberté immuable » (« Operation Enduring Freedom ») en Afghanistan et appelé les ONG humanitaires à se joindre à l’effort de guerre. Cependant, au cours des mois précédant les assassinats de Badghis, le positionnement de MSF n’avait pas été dénué de contradictions, les forces occidentales et les autorités afghanes dont elle cherchait à se distancier ayant constitué de fait ses principaux interlocuteurs. L’association avait certes décidé de se tenir à l’écart du plan de reconstruction conçu par une « communauté internationale » soutenant ouvertement le gouvernement Karzaï, mais n’avait pas eu pour autant de contact avec l’opposition armée depuis la chute du régime taliban et elle avait considérablement réduit ses programmes, y compris dans les régions où l’insurrection gagnait du terrain. La légitimité dont MSF pensait bénéficier en raison de sa longue présence dans le pays ne suffisait pas à garantir le respect d’une « exception humanitaire » de plus en plus incompatible avec l’agenda des principaux acteurs politiques, militaires et humanitaires sur la scène afghane.
Dès lors, comment MSF a-t-elle pu revenir en Afghanistan en 2009 et relancer des activités non seulement à Kaboul, mais aussi dans la province de Helmand, l’une des zones les plus disputées par les troupes occidentales, l’appareil de sécurité afghan et les groupes d’opposition armée ? L’année 2008 avait été présentée comme la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires. En 2009, les pertes civiles et militaires atteignirent des niveaux sans précédent. En bref, aucune réouverture miraculeuse de l’« espace humanitaire » ne s’était produite. Pourtant, comme le défend ce chapitre, l’évolution des dynamiques du conflit et des intérêts de ses différents acteurs a contribué à restaurer, à leurs propres yeux, la valeur de l’« offre » de MSF et a ainsi redonné à l’organisation des atouts pour négocier l’accès aux populations affectées par la guerre. Si « nous avons changé d’époque », il n’aura fallu que quelques années pour que la situation afghane démente les pronostics de Cheryl Benard.
À l’opposé d’une représentation commune de l’action humanitaire, associée aux interventions d’urgence et au déploiement rapide de ressources, le récit qui suit montre à quel point la réinsertion de MSF sur le terrain afghan exige des efforts longs et soutenus, tant pour identifier des interlocuteurs que pour conduire des négociations avec toutes les parties, à différents niveaux de leur hiérarchie respective.
Changement d’époque ?
Un changement évident a eu lieu au lendemain du 11 septembre 2001 : après des années d’oubli, l’Afghanistan allait désormais être le théâtre d’une intervention massive et directe des forces armées occidentales. MSF n’avait initialement pas grand-chose à dire sur l’opération « Liberté immuable », menée par les États-Unis et avalisée par l’ONU au nom du principe de légitime défense. Comme plusieurs voix au sein de MSF le soulignèrent, le rôle d’une organisation humanitaire n’est pas de juger du bien-fondé d’une guerre ou de ses objectifs, mais plutôt des moyens employés pour la conduire. À cet égard, la rhétorique de l’administration Bush, de la « justice infinie » à la « guerre contre le terrorisme », en passant par sa référence aux ONG comme « multiplicateurs de force » de l’armée américaineCommentaire de Colin Powell lors d’une conférence de presse du Département d’État, Washington DC, 26 octobre 2001 et son refus d’appliquer le droit international humanitaire (DIH) aux « combattants ennemis », avait de quoi susciter l’inquiétude. Toutefois, dans la première phase de la guerre, les appels à la mesure et au respect de la distinction entre responsabilités militaires et humanitairesPar exemple : communiqué de presse de MSF, « Médecins Sans Frontières casts doubt on military’s “humanitarian airdrops” in Afghanistan », 8 octobre 2001 ; Rony BRAUMAN, « Des mots magiques aux cruelles désillusions », Le Monde, 22 novembre 2001. eurent d’autant moins de poids que MSF, comme la plupart des organisations d’aide, avait quitté l’Afghanistan avant le début des bombardements américains, le régime taliban ayant déclaré qu’il ne pouvait plus garantir la sécurité du personnel expatrié. Le déploiement massif d’aide aux frontières du pays en prévision d’un afflux de réfugiés se révéla rapidement inapproprié car la crise anticipée n’eut pas lieu, ce qui affaiblit encore davantage la position des humanitaires.
Quand les premières équipes expatriées de MSF revinrent en Afghanistan en novembre 2001, quelques jours seulement après la chute du gouvernement taliban et la prise de Kaboul par la coalition d’opposition afghane dénommée l’Alliance du Nord, elles n’identifièrent aucune situation d’urgence. Lorsque des informations commencèrent à circuler faisant état de crimes de guerre perpétrés par l’armée américaine et ses alliés afghans, notamment le bombardement de prisonniers talibans dans la prison de Qala-e-Jangi, MSF resta silencieuse, tout comme la communauté internationale. L’association renonça à prendre une position publique sur le sujet, faute d’accord entre ceux qui considéraient que la dénonciation de ces crimes relevait de son rôle légitime et ceux qui craignaient qu’elle ne soit perçue comme une prise de position avant tout politique, étant donné qu’aucun travailleur humanitaire n’avait été directement témoin des événements. Cf. Jean-Hervé BRADOL, « Questions gênantes à une coalition au-dessus de tout soupçon », La Croix, 17 décembre 2001 ; et le rapport moral du président de MSF-F, mai 2002, archives de MSF.
Au cours de l’année suivante, les différentes sections de MSF présentes en Afghanistan avant l’intervention de la Coalition reprirent la plupart de leurs programmes, là où les conditions de sécurité le permettaient. À la fin 2002, MSF menait des opérations dans quinze provinces et pouvait de nouveau se présenter comme l’un des premiers acteurs de santé du pays, ainsi qu’elle l’avait été au cours de la plus grande partie de la décennie précédente. Un tel rôle n’allait toutefois pas tarder à poser problème. Attirées par la disponibilité soudaine des financements d’États soucieux de montrer leur contribution à l’effort de guerre américain, les organisations d’aide commencèrent à affluer. Les agences des Nations unies étaient désormais sous la tutelle de la Manua (Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan), dirigée par Lakhdar Brahimi. L’Afghanistan devait être le terrain d’expérimentation de la nouvelle approche intégrée des opérations de paix des Nations unies, dont M. Brahimi était l’un des principaux architectes. Composée d’un volet politique et d’un volet d’assistance, la Manua fit primer le premier sur le second. Elle afficha un soutien sans faille aux objectifs militaires de la Coalition et exigea que les programmes d’aide servent à renforcer la légitimité du gouvernement afghan issu des accords de Bonn de décembre 2001.
Pour les principaux bailleurs de fonds (États-Unis, Commission européenne, Banque mondiale) le développement des services de santé constituait une source importante de légitimité politique. Un programme de plusieurs millions de dollars fut développé à compter de 2003, confiant à des ONG sélectionnées par le ministère de la Santé et les donateurs internationaux la charge de délivrer des soins de santé primaires dans les régions rurales de provinces entières. Reflet de la nouvelle stratégie des bailleurs, centrée sur le financement d’une aide à la reconstruction ce programme indiquait une détermination politique claire à donner de l’Afghanistan l’image d’un pays en situation de « postconflit ». Ce message avait déjà été véhiculé par l’armée américaine en novembre 2002, avec l’annonce de la création d’équipes provinciales de reconstruction (Provincial Reconstruction Teams, PRT), unités civilo-militaires « conçues pour améliorer la sécurité, étendre l’autorité du gouvernement afghan et faciliter la reconstruction dans les provinces prioritaires»USAID, Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan. An Interagency Assessment, juin 2006, p. 10 (disponible sur http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADG252.pdf).. La communauté de l’aide, qui en 2003 comptait 200 ONG internationales et entreprises privées et 800 organisations afghanes, rejeta dans l’ensemble l’offre des PRT de coordonner leurs actions. Mais la plupart de ses membres souscrivirent sans réserve aux conditions fixées par les bailleurs pour l’attribution de leurs financements, qui faisaient d’eux les exécutants des politiques du gouvernement afghan.
L’introuvable compromis et le retrait
L’incrédulité était probablement le sentiment le plus partagé parmi les équipes de MSF à l’époque, tant vis-à-vis du discours de « postconflit » de la communauté internationale qu’à l’égard des ambitions affichées par la politique de développement sanitaire, laquelle consistait en une privatisation de fait sous le contrôle bureaucratique d’institutions gouvernementales fragiles. Refusant publiquement de s’inscrire dans le cadre de la reconstruction, MSF revendiquait au contraire la nécessité de maintenir une aide humanitaire indépendante et impartiale dans un contexte de conflit persistant impliquant des forces internationales appartenant à la coalition dirigée par les États-Unis ou à la Fias (Force internationale d’assistance à la sécurité) mandatée par les Nations unies.
Soudées autour de cette position de principe, les cinq sections de MSF firent preuve de moins de cohérence pour la traduire en termes opérationnels. La majeure partie de leurs programmes étant située dans des régions relativement stables au centre et dans le nord du pays, elles s’y trouvaient confrontées aux incertitudes caractéristiques des situations de « ni guerre ni paix », dans lesquelles la frontière entre action médicale humanitaire et projets de développement de santé est difficile à fixer. Tout au long de l’année 2003 et au début de l’année 2004, bon nombre de structures de santé qu’elles soutenaient furent confiées à d’autres ONG ou, de manière formelle, remises au ministère de la Santé afghan. En parallèle, les équipes cherchèrent à identifier des « besoins médicaux non couverts », liés à la tuberculose ou au paludisme, tentant ainsi de jouer un rôle utile en marge des politiques de santé nationales. Limités dans leur taille, de tels programmes avaient sans nul doute un impact sur leurs bénéficiaires directs, mais présentaient peu d’intérêt pour l’administration Karzaï et ses soutiens internationaux, soucieux d’afficher des résultats rapides à grande échelle.
Les choix opérationnels de MSF ne lui permettaient pas davantage de convaincre l’opposition armée de sa neutralité. Malgré ses activités dans les villes de Kandahar et de Ghazni, dans le Sud, l’association n’avait guère de visibilité, ou d’impact, sur les effets de la guerre, relativement silencieuse, qui gagnait les régions environnantes. De fait, l’association n’avait pas réellement tenté de renouer contact avec les talibans depuis leur renversement. L’assassinat en mars 2003, dans la province d’Uruzgan, d’un représentant du CICR, sur ordre d’un commandant taliban, rendit cette option encore plus difficile à concevoir et contribua à la décision de MSF de retirer son personnel expatrié de Ghazni quelques mois plus tard. Les talibans ne constituaient d’ailleurs pas la seule source d’insécurité pour les organisations humanitaires. Au yeux des chefs de guerre en quête de coups d’éclat permettant d’affirmer leur influence, elles constituaient également des cibles faciles. Selon toute vraisemblance, c’est sur ordre de l’un d’eux que furent assassinés les membres de MSF dans la province de Badghis. En dépit des raisons invoquées par l’organisation pour justifier son départ du pays, ce meurtre fut donc ressenti par beaucoup à MSF comme la conclusion tragique d’un processus de retrait opérationnel déjà en cours.
Ce n’était pas la première fois que la pertinence et la viabilité des opérations de l’organisation se voyaient remises en cause en Afghanistan. Dans les années 1980, l’importance des missions clandestines de MSF reposait sur un puissant symbole : les « French doctors » prenaient parti en dénonçant publiquement les crimes de guerre de l’occupant soviétique. L’aide médicale apportée à la population des zones contrôlées par les moudjahidines témoignait d’un soutien à leur cause. Les dirigeants de ces derniers accordaient leur protection aux équipes de MSF en échange de l’assistance que celles-ci prodiguaient à leur base sociale. Avec le départ des Soviétiques et dans un contexte de corruption et de rivalités que des financements américains massifs avaient attisées chez les dirigeants des partis et les centaines d’organisations humanitaires présentes dans les camps de réfugiés du PakistanFiona TERRY, Condemned to Repeat ? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press, Ithaca, 2002, p. 71-80 ; Olivier ROY, « L’humanitaire en Afghanistan. Entre illusions, grands desseins politiques et bricolage », Cemoti, nº 29, janvier-juin 2000, p. 21-30., la valeur ajoutée des petites équipes médicales de MSF commença à être questionnée, y compris au sein de l’association. Les tensions avec les escortes moudjahidineRapport moral du président de MSF-F, 1989, archives de MSF.et les incidents de sécurité se multiplièrent jusqu’au meurtre d’un expatrié de l’association dans une clinique de la province de Badakhshan, qui entraîna la fermeture de tous les programmes de MSF en Afghanistan en 1990.
Lorsque l’organisation revint en 1992, après la chute du régime communiste, le contexte était très différent, les moyens dont elle disposait également. Lançant d’abord ses activités à Kaboul, devenue le théâtre d’une guerre civile entre factions, MSF était désormais en mesure de mettre en œuvre les capacités logistiques développées au cours de la décennie précédente sur d’autres terrains – voitures équipées de radios, kits médicaux acheminés par avion. La taille des opérations l’emportait désormais sur la valeur du symbole, et c’est par la présence de trois à quatre sections réparties à travers le pays et sur ses multiples lignes de front que MSF bâtissait sa réputation et son acceptation par les belligérants. Cependant, au début de l’année 2001, face à la paix relative imposée par les talibans et l’état de pauvreté du pays, soumis à un régime de fer et aux sanctions internationales, la présence de MSF n’allait pas sans susciter de nouveau malaise et interrogations. La nouvelle donne occasionnée par l’intervention internationale et le choc de Badghis, trois ans plus tard, contribueraient à faire oublier ces questionnements.
L’invitation au retour
Entre 2004 et 2008, deux évolutions majeures conduisirent certains à MSF à considérer la possibilité d’un retour en Afghanistan. En premier lieu, le mythe du « postconflit » ne tarda pas à se désagréger. Trop confiante et pressée de réaffecter ses forces en Irak, l’administration américaine avait pris en 2003 la décision unilatérale de réduire ses troupes dans le Sud, obligeant ainsi ses alliés de l’OTAN à prendre le relais sans qu’ils y aient été préparés. L’opposition armée, basée au Pakistan, saisit l’opportunité de cette passation chaotique pour lancer une offensive majeure au printemps 2006Ahmed RASHID, Descent Into Chaos. How the war against Islamic extremism is being lost in Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Penguin Books, Londres, 2008.. Dans leur zone d’influence traditionnelle, les différentes composantes des talibans purent exploiter à leur profit le mécontentement grandissant de la population envers la corruption du gouvernement et de ses fonctionnaires locaux et l’absence de services publics dans les provinces, ainsi que le ressentiment suscité par la présence étrangère. Leur influence s’étendit progressivement à d’autres régions du pays, y compris dans le NordGilles DORRONSORO, The Taliban’s Winning Strategy in Afghanistan, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2009. La riposte des forces internationales, fondée sur le recours massif aux bombardements aériens multipliant les victimes civiles, contribua encore davantage à leur aliéner le soutien de la population. Comme le révéla un rapport de la Manua, les pertes civiles imputables aux groupes d’opposition armés en 2008 n’avaient dépassé que légèrement celles causées par les « forces pro-gouvernementales », lesquelles étaient dues, pour les deux tiers, à des frappes aériennes. La même année, trente-huit travailleurs humanitaires avaient été assassinés et cent quarante-sept enlevés, conduisant la Manua à conclure que « l’espace humanitaire [s’était] considérablement réduit»Manua, « Afghanistan. Annual report on protection of civilians in armed conflict », 2008, Nations unies, Kaboul, 2009.. Ce rapport signalait une prise de conscience tardive au sein des Nations unies et des acteurs de l’aide quant au prix à payer pour leurs années d’association à l’agenda « postconflit » de ces mêmes « forces pro-gouvernementales ».
La seconde évolution, à contre-courant de la première, tenait aux démarches entreprises, au cours de la même période, par le CICR pour restaurer un dialogue avec l’opposition armée et obtenir la reconnaissance de sa neutralité. L’assassinat de son délégué en 2003, suivi quelques mois plus tard de l’attentat meurtrier contre sa délégation en Irak, avait provoqué une profonde remise en question en son sein. En 2004, alors que MSF décidait de quitter l’Afghanistan, le CICR, pour sa part, entreprenait de tirer parti du large éventail des activités autorisées par son mandat, telles que l’accès aux détenus et les programmes orthopédiques, pour démontrer sa pertinence opérationnelle et développer des canaux de communication avec le commandement de l’opposition. La validité de cette approche fut d’abord visible en août 2007, lorsque les talibans accordèrent au CICR le rôle d’intermédiaire dans les négociations qui menèrent à la libération d’otages sud-coréens. « Afghanistan : ICRC facilitates release of twelve South Korean hostages », communiqué de presse du CICR, 29 août 2007.
Ce fut précisément pendant cet épisode qu’une équipe de MSF conduisit une mission exploratoire en Afghanistan, dans le but d’évaluer la situation et de suggérer des pistes pour un possible retour de l’association. Ses conclusions imposèrent l’idée qu’un tel retour nécessitait des approches innovantes et comportait de nombreux risques. Le fonctionnement habituel de l’organisation lui-même posait cependant question, suscitant réticence et incertitudes. Le déploiement de plusieurs sections autonomes sur le terrain et la coordination des programmes par des expatriés se succédant sur de courtes périodes semblaient en effet comporter trop de risques dans un tel contexte. Mais la réalité de la guerre devenant de plus en plus patente, la dynamique des discussions sur l’Afghanistan s’accéléra en 2008, en grande partie grâce à la volonté du CICR de partager son expérience et certains de ses contacts avec MSF afin de faciliter son retour. L’opposition armée semblait en effet en demande d’une aide médicale accrue pour ses combattants et les populations vivant dans des zones sous sa sphère d’influence. Le CICR souhaitait la présence d’autres acteurs humanitaires sur le terrain afin de répondre aux besoins croissants générés par le conflit. Les représentants de la Croix-Rouge mirent cependant MSF en garde : pour être crédibles aux yeux de l’opposition, ses opérations devraient atteindre une certaine « masse critique » ; de plus, la multiplication des sections et des représentations de MSF comme par le passé risquerait d’être un frein au développement d’un réseau de contacts fiables.
Malgré les craintes liées à la sécurité des équipes, l’offre de bons offices du CICR plaida au sein de MSF en faveur de son retour en Afghanistan. Il y avait maintenant consensus sur la nécessité d’une représentation unique et, à cette fin, la section belge de MSF fut sélectionnée pour conduire les négociations et assumer la responsabilité des opérations en Afghanistan pendant deux années. Parallèlement, les premiers contacts furent établis avec des représentants de l’opposition armée au cours de l’année 2008. Bien que le degré d’autorité et d’influence de ces interlocuteurs fût encore incertain, ces prises de contact, au cours desquelles la responsabilité des talibans dans les assassinats de Badghis avait fait l’objet d’un démenti, semblèrent conforter l’analyse du CICR : l’opposition armée voyait désormais plus d’avantages à favoriser qu’à entraver les opérations médicales humanitaires destinées à sa base sociale. C’était maintenant à l’équipe chargée des opérations de développer un rôle humanitaire pertinent pour MSF en Afghanistan.
Concilier les intérêts de MSF et du gouvernement afghan
Les grandes lignes d’une stratégie opérationnelle furent définies en février 2009, au terme d’une visite de dix jours à Kaboul menée par le nouveau chef de mission. Ce dernier recommanda de fournir des soins médicaux dans les régions où le système de santé était le plus déstructuré par le conflit. Malgré le peu de fiabilité des données médicales et démographiques disponibles, les districts du sud et de l’est du pays, épicentre des combats, paraissaient concentrer les besoins les plus pressants. Toutefois, l’accès à ces districts ne pouvait être envisagé que comme un objectif à moyen terme. Les conditions de sécurité étaient telles qu’il était pratiquement impossible pour des expatriés, mais aussi pour des Afghans d’autres régions du pays, de s’y rendre par la route, a fortiori d’y évaluer la situation médicale et sanitaire. De telles évaluations risquaient également d’être perçues comme une atteinte à l’autorité du gouvernement de Kaboul. Selon le discours officiel, soutenu par les bailleurs internationaux, et de leurs « partenaires d’exécution », le plan de relance des soins de santé primaires permettait de couvrir 85 % des zones rurales, un chiffre fondé sur les fonds déboursés et non sur le fonctionnement effectif des structures de soins.
Il était donc préférable pour MSF d’opter, dans un premier temps, pour des opérations moins sensibles, l’aidant à acquérir une crédibilité et à développer un réseau local fiable. Le chef de mission recommandait de se concentrer sur l’amélioration des soins de santé secondaires dans les villes proches des zones de conflit et accessibles par avion. Ce choix, compatible avec l’envoi d’équipes internationales sur le terrain, répondrait à des besoins médicaux évidents, les hôpitaux de nombreuses capitales provinciales, y compris Kaboul, ayant été largement exclus des financements internationaux. La présence d’expatriés, bien que limitée et confinée aux lieux de travail et de vie, était considérée comme nécessaire pour garantir le suivi des activités et, plus encore, pour conduire des négociations directes avec les parties en conflit, comme le CICR l’avait recommandé. Le chef de mission concluait son rapport ainsi : « Étant donné que les attentes sont très fortes de tous les côtés, il est important d’avoir “quelque chose à montrer” assez rapidement et qui puisse bénéficier clairement à différentes régions du pays et à différentes populations. »« Strategic choices for MSF in Afghanistan », rapport interne MSF, février 2009.
Il fut donc décidé de soutenir deux hôpitaux publics : l’hôpital provincial de Boost à Lashkargah, capitale de la province de Helmand, lieu de combats intenses entre les forces internationales, l’armée afghane et l’opposition armée depuis plusieurs années ; et un hôpital de district dans la banlieue est de Kaboul, une zone qui attirait une population croissante de migrants et de déplacés. En optant pour des structures de santé publique existantes plutôt que pour des structures mises en place et gérées par MSF, l’équipe de coordination espérait faciliter le processus de négociation avec le gouvernement de Kaboul, dont dépendait l’octroi de visas, de permis de travail et d’autorisations d’importation de matériel médical, et démarrer ainsi plus vite ses opérations. La province de Helmand étant au cœur de la zone d’influence des talibans et les premiers contacts de MSF au sein de l’opposition ayant exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre de programmes médicaux à Kaboul, il paraissait raisonnable de penser que les deux sites retenus rencontrent les faveurs des deux camps.
Du côté du gouvernement afghan, le calendrier politique joua en faveur de MSF. Depuis le départ de l’association, les autorités avaient adopté, avec le soutien tacite de la Manua et des bailleurs internationaux, de nouvelles réglementations accroissant leur contrôle sur les ONG. Les organisations médicales n’avaient d’autre choix que de devenir les sous-traitants du ministère de la Santé, par lequel transitait l’argent des bailleurs. Néanmoins, à l’approche de l’élection présidentielle prévue pour l’été 2009, les projets opérationnels de MSF présentaient aux yeux du ministre de la Santé une occasion de redorer son blason politique. Il se montra disposé à dispenser l’association du cadre imposé aux autres ONG et à intercéder auprès des ministères compétents afin de faciliter son enregistrement légal.
Les protocoles d’accord pour chaque projet soulevèrent peu de discussion et tous deux furent signés le 30 juin 2009. L’agence de presse afghane rendit compte de l’événement dans deux communiqués séparés, qui laissaient peu de doute sur les différences de points de vue des signataires. Dans l’un d’eux, le ministre de la Santé déclarait : « Nous avons invité MSF à reprendre ses activités en Afghanistan et l’avons assurée que le gouvernement lui fournira tous les locaux et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des stratégies [nationales]. »« Health Ministry, MSF ink MoUs », Pahjwok Afghan News, 30 juin 2009.
L’autre communiqué, sollicité par MSF pour contrebalancer l’exercice de relations publiques du ministre, citait le chef de mission : « MSF dépendra uniquement de dons privés, garantissant ainsi son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et militaires. »« MSF to support 2 hospitals », Pahjwok Afghan News, 30 juin 2009.
Les deux protocoles d’accord Protocole d’entente entre le ministère de la Santé publique, la République islamique d’Afghanistan et Médecins Sans Frontières, 2009.assuraient à l’association le contrôle de ses activités médicales et engageaient leurs signataires à appliquer les principes du droit humanitaire à l’intérieur des structures de santé. S’il était entendu que MSF fournirait une assistance médicale en « soutien » au ministère de la Santé, les médicaments et le matériel devaient demeurer sous sa supervision, et ce, jusqu’au patient. Tous les services devaient être fournis gratuitement. Les armes étaient interdites dans l’enceinte de chaque hôpital, placé dorénavant sous le contrôle de gardiens employés par MSF. Le soutien de tierces parties à l’hôpital, notamment des forces internationales, devait être soumis à l’accord préalable de l’organisation. Enfin, conformément aux Conventions de Genève, il était stipulé que les patients ne pouvaient en aucun cas être harcelés ou arrêtés par des forces de sécurité pendant leur traitement et aussi longtemps que les médecins les jugeraient incapables de supporter un interrogatoire. Quant au personnel médical, il ne pourrait être poursuivi pour avoir traité des patients, quels qu’ils soient.
Démilitariser les hôpitaux
L’application de ces clauses nécessita néanmoins de nouvelles négociations, en particulier dans le cas de l’hôpital de Boost à Lashkargah. Des soldats britanniques de la Fias, des entreprises de sécurité privées protégeant les agents de développement du gouvernement britannique ainsi que la police, l’armée et les services secrets afghans – la DNS (Direction nationale de la sécurité) – avaient en effet pour habitude de circuler lourdement armés dans l’enceinte de l’hôpital. Si le protocole d’accord avait suffi à convaincre la police et l’armée afghanes de mettre un terme à cette pratique, les autres étaient déterminés à n’obéir qu’aux ordres de leur hiérarchie.
Les premières négociations avec les forces internationales furent ainsi conduites avec les autorités britanniques. Le chef de mission entama ce processus à Kaboul avec l’ambassadeur britannique, avant de se rendre à Londres auprès des départements interministériels et militaires concernés. Ces démarches permirent à MSF d’obtenir l’arrêt des activités des PRT dans l’hôpital et le retrait définitif des soldats de son enceinte. La section états-unienne de MSF organisa en août 2009 une série de réunions avec des représentants du Département d’État à Washington et des officiers du Centcom (US Central Command, Commandement central des États-Unis) en Floride. L’objectif était d’informer les responsables politiques et militaires américains des activités médicales que l’association prévoyait de développer et de demander que toutes les forces militaires sous commandement américain, y compris les forces spéciales de l’opération « Liberté immuable », respectent le statut protégé de sa mission médicale. Au moment de la visite de MSF, la nouvelle administration Obama préparait une deuxième révision de sa stratégie de guerre en Afghanistan. Le général McChrystal, nommé en juin commandant des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, finalisait son rapport d’évaluation de la situation, dont les premiers échos laissaient entendre qu’il serait sombre. Pour autant, la stratégie de relations publiques des autorités américaines envers les ONG ne semblait guère avoir changé depuis 2001. En avril 2009, Richard Holbrooke, le représentant spécial du président pour l’Afghanistan et le Pakistan, avait déclaré que « 90 % de la connaissance qu’ont les États-Unis de l’Afghanistan provient des organisations d’aide»Envoy laments weak US knowledge about Taliban », Associated Press, 7 avril 2009.. Début août à Genève, le général Petraeus avait fait la promotion, devant un panel de diplomates de l’ONU et de représentants d’ONG, d’un nouveau « Centre de fusion civilo-militaire»« Rising threatto aidagencies in Afghanistan »,GlobalPost, 18 septembre 2009.. Néanmoins, au Département d’État comme au Centcom, les interlocuteurs de MSF reconnurent qu’il lui était nécessaire de rechercher des garanties de sécurité auprès de toutes les parties en conflit. Contrairement aux réactions habituelles des officiers des PRT sur le terrain, ils ne firent aucune objection lorsque des représentants de l’association expliquèrent que, d’un point de vue humanitaire, MSF ne faisait pas de différence entre les militaires américains et les talibans.
Ces réunions ne débouchèrent sur aucun engagement formel, mais, sur le terrain, les objectifs de MSF parurent avoir été atteints : alors qu’à l’automne 2009 plusieurs structures médicales soutenues par des ONG internationales firent l’objet de raids impliquant des soldats de la Fias« US troops stormed Afghan hospital, aid group says », cnn.com, 7 septembre 2009, voir http://articles.cnn.com., aucun incident de ce type ne se produisit dans les hôpitaux soutenus par MSF. Ces négociations internationales eurent peut-être d’autres effets induits : en octobre, le général de la DNS dans la province de Helmand informa le chef de mission qu’il avait reçu de nouvelles instructions de Kaboul et ordonné à ses hommes d’« appliquer à partir de maintenant le droit humanitaire international à l’hôpital de Boost », avant d’ajouter que « l’hôpital devrait être un lieu sûr pour chaque patient, qu’il soit ou non lié à l’opposition». « MSF Afghanistan situational report », octobre 2009, archives MSF.
Identifier et convaincre les bons interlocuteurs au sein de l’opposition
Le retrait effectif de tout homme en armes des deux hôpitaux devait marquer le démarrage des activités médicales. Ces dernières débutèrent officiellement à Kaboul en octobre 2009, mais à Lashkargah, elles restèrent dans les faits suspendues jusqu’en janvier 2010. Les équipes étaient présentes dans les services de l’hôpital, mais attendaient l’arrivée de médicaments, dont l’acheminement par camions de Kaboul à Helmand nécessitait d’obtenir l’autorisation de l’Émirat islamique d’Afghanistan (EIA), le groupe d’opposition armé le plus puissant, également connu sous le nom de Quetta Shura. La plupart des districts des provinces du Sud et, par conséquent, le trafic routier étaient sous son contrôle.
Depuis son retour en Afghanistan, MSF avait subi plusieurs revers dans ses tentatives de dialogue avec le commandement taliban. L’approbation de l’opposition pour le projet de Kaboul avait été relativement simple à obtenir. Les interlocuteurs initiaux de MSF considéraient que l’hôpital choisi, situé dans une zone pachtoune, était facilement accessible à leur réseau. De plus, les activités chirurgicales prévues offraient la perspective de soins pour leurs combattants blessés. Mais le peu d’intérêt et d’engagement dont ils avaient fait preuve concernant l’ouverture potentielle de projets dans les provinces du Sud, dont celle de Helmand, connue comme étant le fief de l’EIA, avaient jeté des doutes sur l’étendue de leurs connexions.
Au printemps 2009, MSF entreprit de lier d’autres contacts avec l’opposition, en s’appuyant cette fois sur son propre réseau d’anciens employés afghans, et, durant l’été, elle parvenait à établir une communication avec des membres reconnus de l’EIA. Dès les premiers échanges, ces nouveaux interlocuteurs lui signifièrent que ses contacts initiaux n’étaient pas des représentants légitimes de leur groupe, mais étaient liés au réseau Haqqani, dont l’influence s’étendait sur Kaboul et le sud-est de l’Afghanistan ainsi que dans la région pakistanaise du Waziristan. L’EIA était quant à lui implanté dans le Sud, mais également influent auprès des nouveaux insurgés dans l’Ouest et le Nord. Les deux groupes étaient des organisations partenaires, mais n’avaient ni la même base sociale ni les mêmes intérêts. Il faudrait donc désormais négocier avec chacun d’eux séparément, en fonction de la région concernée.
SiMSF avait réussi à élargir son réseau,elle avait néanmoins perdu du temps à identifier les bons contacts pour obtenir des garanties à Helmand. De plus, peu après une première rencontre positive, elle fut informée que le conseil de l’EIA rejetait ses deux projets, au motif que leur localisation dans des structures du ministère de la Santé représentait un soutien inacceptable au gouvernement Karzaï, surnommé avec mépris le « ministère du Travail des Américains ». Cette décision interdisait de fait l’acheminement des médicaments par la route de Kaboul à Helmand.
Six mois de plus furent nécessaires pour résoudre le contentieux. MSF justifia son choix opérationnel comme étant une étape indispensable à l’importation de médicaments. Elle fit valoir que, ses équipes étant déjà sur le terrain et les médicaments en attente à Kaboul, il était trop tard pour mettre fin au projet. L’association s’engagea à tenir compte des zones suggérées par l’EIA dans l’identification de futurs programmes et souligna qu’elle avait obtenu de la part des forces afghanes et étrangères l’assurance qu’elles ne pénétreraient pas dans l’hôpital de Lashkargah. Du côté de l’opposition, les enjeux de sécurité étaient indissociables des questions de légitimité et l’autorisation demandée par MSF pour le transport de ses médicaments constituait un moyen de pression pour obtenir des garanties et des concessions supplémentaires de la part de l’association. Exprimant leur méfiance vis-à-vis des médecins du ministère de la Santé de Lashkargah et mettant en doute le respect des Conventions de Genève par les États-Unis, l’opposition exigea que MSF s’engage par écrit à contrôler le personnel de l’hôpital et fournisse un protocole d’accord officiel signé de l’armée américaine engageant cette dernière au respect du droit humanitaire. MSF prit soin de ne rien promettre à la place des forces internationales, soulignant en revanche sa capacité à les tenir comptables de leurs actes par le biais des médias.
L’EIA accorda finalement sa permission pour le transport des médicaments à Helmand en janvier 2010. Soucieux d’être reconnus comme un gouvernement compétent et légitime dans les zones progressivement passées sous leur contrôle, les dirigeants de l’opposition semblaient plus intéressés par l’aide médicale comme un atout pour conquérir les « cœurs et les esprits » que pour le bénéfice direct de leurs combattants. Lorsque MSF demanda si l’EIA avait des suggestions pour de nouveaux programmes, un de ses représentants répondit : « Les besoins les plus importants sont ceux des populations civiles, particulièrement les soins maternels ; nous pouvons prendre soin de nos combattants. »
Faire ses preuves
Le lancement des activités médicales ne signifiait pas la fin des négociations. Au sein même de l’hôpital de Lashkargah, elles avaient lieu de manière quotidienne entre l’équipe expatriée et le personnel médical local. Avant l’arrivée de l’organisation, médecins et infirmiers avaient fait de l’hôpital provincial la salle d’attente de leurs propres cliniques privées. Même s’ils espéraient tirer profit du soutien apporté par MSF, bon nombre de dispositions du protocole d’accord auxquelles ils avaient eux-mêmes souscrit allaient à l’encontre de leurs intérêts commerciaux, menacés notamment par la gratuité des soins et des médicaments, désormais de règle à l’hôpital. Leurs activités privées étaient aussi difficilement conciliables avec le respect d’horaires fixes de travail mis en place par l’équipe expatriée afin d’assurer la continuité des soins. Les sources de tension étaient donc nombreuses et les pratiques difficiles à modifier, au détriment de l’amélioration de la qualité des soins. Ces négociations étaient d’autant plus difficiles à conduire que, dans un environnement dangereux où MSF manquait d’expérience, l’équipe expatriée était limitée et ne pouvait prendre le risque de s’aliéner les médecins locaux dès l’ouverture du projet.
À la fin de l’année 2010, la coordination de la mission afghane estima avoir suffisamment de garanties pour renforcer le personnel médical international à Lashkargah. La crédibilité de MSF auprès de la population et des acteurs du conflit imposait d’améliorer rapidement les services offerts par l’hôpital, d’autant qu’au problème de la qualité des soins s’ajoutait celui de l’accès des patients. En novembre 2010, une enquête conduite auprès d’eux révéla qu’une grande partie de la population de la province de Helmand était dans l’impossibilité de se rendre à l’hôpital de Lashkargah pour y être soignée, en raison du coût du transport et des conditions de sécurité. Le prix d’une course en taxi depuis les districts jusqu’à la ville s’élevait en moyenne à cent dollars. Face à la menace constante des mines, des combats et des mesures d’intimidation, peu de gens osaient se déplacer pour obtenir des soins, même dans les situations d’urgence vitale. L’opération militaire très médiatisée conduite par les forces internationales dans la province au printemps 2010, dans le cadre du « surge»Renforcement des troupes américaines. décrété par l’administration Obama, n’avait manifestement pas amélioré la situation. « Nous sommes pris entre deux feux », se plaignit une des personnes interrogées par l’équipe de MSF, « les talibans nous interdisent de sortir la nuit, les patrouilles de l’armée britannique nous contrôlent le jour ». « Ils n’arrêteront pas leurs combats pour nos patients. Ils s’entre-tuent par centaines, pourquoi s’arrêteraient-ils pour un seul patient ? »,déclara un vieil homme d’un district sous le contrôle des talibans. Et d’ajouter, à propos de l’hôpital de Lashkargah : « Je ne vois aucune arme ici. Cela veut dire que vous n’avez pas de problème avec les talibans. » L’équipe de MSF se fixa comme objectif de prendre langue avec les chefs locaux de l’opposition armée afin de tenter d’accéder à des districts particulièrement touchés par le conflit. « Les talibans ne sont pas sous un seul commandement. Vous avez peut-être le droit d’être ici, mais est-ce que vous pouvez vous rendre dans mon district ? », avait conclu le vieil hommeCitations extraites du rapport interne de MSF « The challenges in accessing Boost hospital in Lashkargah city, Helmand province », novembre 2010.. À ce jour, les divisions entre chefs de l’opposition dans les districts de Helmand n’ont pas permis à MSF d’obtenir un accord et les garanties nécessaires pour répondre à cette demande.
Les responsables de la mission avaient anticipé les difficultés opérationnelles rencontrées dans l’hôpital de Lashkargah, propres à toute intervention dans une structure publique. Ils les avaient acceptées afin d’obtenir rapidement du gouvernement afghan les autorisations qui permettraient à MSF d’acquérir une plus grande marge de manœuvre pour d’autres programmes. Après une première série de négociations, les attentes des dirigeants de l’opposition armée étaient fortes pour l’ouverture de nouveaux projets dans les régions sous leur contrôle. Tout en cherchant à consolider ses premiers programmes, MSF entreprit donc dès le printemps 2010 d’évaluer la possibilité de nouvelles interventions, si possible dans des structures indépendantes. Les deux provinces choisies pour cette deuxième phase opérationnelle étaient celles de Khost et de Kunduz.
Khost était le fief du réseau Haqqani dans le sud-est de l’Afghanistan, mais aussi la principale base de l’opération « Liberté immuable » dans le pays, d’où étaient menées les opérations contre-terroristes dans les zones tribales pakistanaises. Aussi l’équipe de MSF fit-elle l’objet d’une grande méfiance lorsqu’elle rencontra les représentants des tribus locales. Mais ses contacts avec le réseau Haqqani et la singularité de son offre médicale contribuèrent à dissiper les soupçons. Pour les représentants locaux, le besoin médical le plus pressant concernait les soins maternels et infantiles, comme le soulignaient les indicateurs de santé disponibles. MSF pouvait mettre en place un projet faisant intervenir des femmes expatriées, ce qui était la seule façon, comme ses interlocuteurs durent le reconnaître, de garantir que les femmes de Khost puissent être soignées. Enhardi par cette perspective, l’un des interlocuteurs locaux de MSF suggéra d’adjoindre à ce programme un volet psychologique pour répondre à ce qu’il jugeait être une vague alarmante de suicides parmi les femmes de la région. Pour qu’un tel programme puisse voir le jour et qu’une équipe d’expatriés puisse s’installer à Khost, l’association devait à présent entamer un nouveau cycle de négociations afin d’obtenir les garanties de sécurité nécessaires auprès des différentes parties au conflit.
L’accès à la ville de Kunduz posait moins de problèmes de sécurité, mais il n’enallait pas de même dans les districts. Kunduz était la première province du Nord où l’EIA était parvenu à étendre son influence et les affrontements s’y étaient multipliés au cours de l’année précédente. Cette confrontation armée demeurait un phénomène récent, épargnant encore le système de santé local, contrairement à la situation prévalant dans les provinces du Sud. Mais Kunduz constituait désormais une zone stratégique, puisqu’une nouvelle voie d’approvisionnement des forces internationales traversait la province depuis le Tadjikistan. L’arrivée récente de troupes américaines faisait craindre une intensification du conflit dans un avenir proche.
L’évaluation conduite par MSF recommandait de négocier au plus tôt une présence médicale dans la province afin de disposer à temps d’une offre de soins adaptée aux conséquences d’une montée de la violence. Une équipe expatriée fut installée à Kunduz pour entreprendre sur place les négociations avec les nombreux acteurs locaux du conflit afin d’ouvrir l’accès aux districts de la province, dont certains étaient sous contrôle taliban. Par la suite, l’idée s’imposa d’ouvrir un centre de traumatologie dans la capitale provinciale, destiné à prendre en charge les victimes directes du conflit. Au mois de décembre 2010, les autorités provinciales validèrent le projet de l’association. La violence s’était toutefois déchaînée plus vite que prévue combats et attentats faisant de nombreuses victimes parmi les interlocuteurs de MSF, au sein des autorités comme de l’opposition, compliquant encore les négociations alors même que les conditions pour l’ouverture du projet n’étaient pas encore réunies. Sans garantie, notamment, que les patients ne seraient pas arrêtés ou attaqués durant leur transport vers le centre de soins de MSF, le projet ne pourrait bénéficier à toutes les parties.
Au printemps 2011, les négociations pour travailler dans les provinces de Khost et de Kunduz étaient toujours en cours, à un moment où les pressions intérieures et internationales sur le gouvernement Karzaï, les négociations politiques entre les belligérants et l’engagement pris par l’administration Obama de réduire les troupes américaines à compter de l’été suscitaient des transformations rapides de l’environnement politique et militaire. Dans ce contexte mouvant, les attentes pesant sur MSF restaient fortes. Comme l’avait déclaré un représentant de l’EIA : « Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité si vous ne faites pas rapidement du bon travail. »
Lorsque l’équipe chargée de la mission exploratoire conduite en juillet 2007 rencontra les représentants de divers départements du gouvernement Karzaï, elle put constater que, malgré le bon accueil qui lui était réservé, l’idée d’un possible retour de MSF en Afghanistan suscitait également des réactions ambivalentes. « MSF représente le passé, la guerre, et dans différents ministères, il y a aussi des craintes et de l’incompréhension […].[Certains responsables] font clairement le lien entre notre retour et la détérioration de la situation dans le Sud. »« Afghanistan. What humanitarian space and role for Médecins Sans Frontières ? », rapport de visite d’évaluation, août 2007, archives MSF. De nouveau, en décembre 2010, alors que les autorités provinciales de Kunduz se préparaient à signer l’accord autorisant MSF à démarrer son programme pour les blessés de guerre, un responsable fit remarquer, en substance, que le retour de MSF dans la province était pour lui à la fois une bonne chose et un mauvais signe.
Ces remarques soulignent la même évidence, à savoir que l’action humanitaire est un symptôme de la guerre, pas un remède – en tout cas, pas contre la guerre. Elles mettent également en lumière ce que ce chapitre s’est efforcé de montrer : pour que l’action de MSF soit acceptée, les principaux acteurs politiques et militaires de la guerre doivent admettre l’existence du conflit et voir leur intérêt dans les services médicaux que l’ONG peut offrir. La situation en Afghanistan n’est pas moins polarisée aujourd’hui qu’elle ne l’était lorsque MSF s’est retirée du pays en 2004 et elle est sans nul doute beaucoup plus violente. Le changement déterminant du point de vue de l’acteur humanitaire réside dans le fait que les différentes parties en conflit considèrent désormais les opérations médicales dans les régions où elles s’affrontent comme contribuant à asseoir, à des degrés divers, leur légitimité respective.
MSF a été capable jusqu’à présent de jouer avec l’évolution de ces perceptions en faisant valoir que son assistance médicale pouvait être utile à chaque camp. Cette équation demeure néanmoins fragile et n’a permis pour l’instant que peu d’amélioration dans l’accès aux populations vivant dans les zones rurales au cœur des combats. Certes, l’étape actuelle d’expansion contribue à renforcer le crédit de MSF vis-à-vis de ses interlocuteurs haut placés, mais pour que cette situation perdure, il est indispensable qu’il y ait continuité dans les interactions comme dans la conception que les belligérants se font de leurs intérêts. Orcelane dépend pas seulement de l’habileté de MSF dans la conduite des négociations, mais bien davantage de la dynamique de la guerre – ou d’une paix violente. Plutôt que de chercher à mesurer l’étendue de l’« espace humanitaire » en Afghanistan, il est plus éclairant de considérer les opportunités et les risques de ce moment humanitaire.
***
Pakistan. Le piège de la contre-insurrection
JONATHAN WHITTALL
Traduit de l’anglais par Michaël Neuman
Entre 2008 et 2010, les conflits internes ou liés à la « guerre contre le terrorisme » qui agitent le nord-ouest du Pakistan ont provoqué le déplacement de 4,2 millions de personnesInternational Crisis Group, « Pakistan. The worsening IDP crisis », Asia Briefing, 16 septembre 2010.. Depuis 2007 au moins, la population des provinces des FATA (Federally Administered Tribal Areas, Régions tribales « fédéralement » administrées) et de KPK (Khyber PakhtunkhwaAnciennement dénommée North-West Frontier Province (NWFP).) vit sous la menace d’affrontements entre l’armée pakistanaise et des groupes armés d’opposition (tels que le Tehrik-el-Taliban Pakistan, TTP), d’attaques de drones américains et de violences sectaires. Les talibans afghans utilisent désormais la région frontalière des FATA pour lancer leurs opérations contre les forces de la coalition en Afghanistan. Cette province est aussi celle à partir de laquelle le TTP conduit ses offensives contre l’État pakistanais. Du fait d’un accès très limité aux zones tribales, MSF n’a qu’une faible compréhension des besoins médicaux de leur population. La majeure partie des activités de l’association reste en effet confinée à la province de KPK, qui jouxte celle des FATA, où l’armée l’autorise à répondre aux carences des structures hospitalières. C’est pourtant dans les FATA que les besoins médicaux sont vraisemblablement les plus importants, compte tenu du manque de professionnels de santé en raison de l’insécurité. Au Pakistan, le discours de MSF s’est largement appuyé sur les principes de neutralité et d’impartialité, et sur une volonté d’afficher son indépendance financière. L’organisation a tenté de se distinguer d’une conception de l’action humanitaire au service de la stratégie contre-insurrectionnelle des autorités. Mais dans quelle mesure ses efforts ont-ils permis d’accéder aux populations les plus affectées par le conflit ?
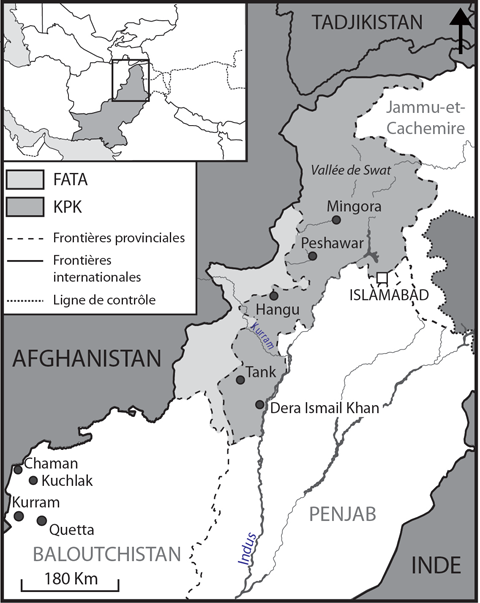
Dans le nord-ouest du Pakistan, l’armée et les bailleurs de fonds internationaux assignent à l’assistance humanitaire un rôle déterminant dans leur stratégie de « stabilisation » visant à asseoir la légitimité du gouvernement. Les zones et les populations bénéficiaires de l’aide nationale et internationale sont en effet définies en fonction des priorités de la contre-insurrection. L’armée pakistanaise refuse aux organisations l’accès aux régions où elle mène ses offensives tant que les territoires ne sont pas décrétés « sécurisés et autorisés » et prêts pour la « reconstruction ». C’est le cas aujourd’hui pour les FATA. Ce le fut également en 2010 pour les districts de Dera Ismail Khan et de Tank (dans la province de KPK), où des déplacés s’étaient regroupés. En 2009 et 2010, MSF tenta en vain d’apporter son soutien à des structures hospitalières de Dera Ismail Khan, y compris au moment des inondations.
Officiellement, l’armée justifie ces restrictions par son incapacité à garantir la sécurité du personnel international. Or, à partir de 2009, elle a banni toute possibilité de dialogue entre MSF et le TTP, ne serait-ce que pour négocier les garanties de sécurité qu’elle ne peut fournir. Les populations considérées comme liées aux terroristes sont largement exclues de l’assistance – soins médicaux, abris et nourriture – fournie par l’armée aux personnes déplacées. Cette punition collective est inscrite dans la Loi sur le crime dans la zone frontière (Frontier Crimes Regulation). Elle consiste à ne fournir une assistance qu’aux seuls déplacés dont la région d’origine a été qualifiée d’« affectée » par le conflit. C’est ainsi que la population du district de Khyber Agency, dans les FATA, qui n’a jamais été reconnue officiellement comme affectée, n’a pratiquement pas reçu d’aide.
Cette utilisation de l’aide au service de la stratégie contre-insurrectionnelle du Pakistan a été largement appuyée par les États-Unis et par l’Organisation des Nations unies, tous deux apportant un soutien officiel au gouvernement pakistanais. Les agences spécialisées des Nations unies – dont le HCR et le PAM – soutiennent explicitement l’une des parties en conflit, comme l’illustre le Plan de réponse humanitaire de l’ONU pour le Pakistan, introduit par une lettre du gouvernement pakistanais exposant sa politique contre-insurrectionnelle en KPK/FATA. De plus, les financements des États-Unis sont alloués en fonction des objectifs de « stabilisation par le développement » – auxquels concourent les activités de « renforcement des capacités » de nombreuses ONG – au détriment de la réponse aux urgences.
Selon une personne déplacée interrogée en mars 2010, « l’Amérique paie [l’armée pakistanaise] qui nous combat et détruit nos maisons. Puis elle fournit les secours. On n’est pas dupes» « We don’t trust that », entretien dans le camp de déplacés de Summer Bagh (KPK), 10 mars 2010.. L’expérience de MSF au Pakistan confirme qu’il s’agit d’une suspicion généralisée qui a des conséquences sur la capacité de réponse des ONG. Conscientes de la défiance des groupes d’opposition et d’une partie de la population à leur égard du fait de leurs liens avec les bailleurs de fonds américains et les Nations unies, les ONG limitent l’essentiel de leurs interventions aux zones où elles ne craignent pas d’être prises pour cible.
Dans un tel contexte, MSF s’est efforcée d’échapper à un strict rôle d’auxiliaire de la stratégie de contre-insurrection et de stabilisation gouvernementale. Elle a tenté d’étendre son intervention aux régions « non autorisées » et en direction des populations désignées comme « terroristes ». Son principal défi a été de faire accepter sa présence par l’ensemble des acteurs politiques et militaires, soutenant le gouvernement ou s’y opposant. Ses activités médicales dans la vallée de Swat illustrent cette difficulté.
Naviguer en eaux minées
Dans le contexte pakistanais, on pourrait estimer que la capacité de MSF à se faire accepter par les parties en présence tient davantage à la manière dont sa politique opérationnelle est perçue qu’à la compréhension de ses « principes » – au moins par l’opposition armée. Néanmoins, l’affirmation de « neutralité et d’indépendance » que l’organisation défend avec vigueur est si opposée aux pratiques d’un humanitaire d’État au service de la contre insurrection et de la stabilisation qu’elle devient une position politique en elle-même et contribue à un certain degré d’acceptation. Le fait qu’au Pakistan les organisations humanitaires épousent les priorités politiques occidentales conduit l’opposition à accorder de la valeur à la position singulière de MSF.
Pourtant, l’association reste incapable d’intervenir dans les zones « non sécurisées et non autorisées » par le gouvernement. En fin de compte, c’est au regard de son aptitude à déployer des secours auprès des personnes qui en sont privées que devrait être jugée la façon dont MSF est parvenue à s’extirper des contraintes imposées par la contre-insurrection. Sur la base de ce critère, son accès, et en particulier celui de son personnel international, à des régions du KPK comme Hangu et Timergara est une réussite. Son volume opérationnel dans ces zones est de loin bien plus important que celui d’autres organisations humanitaires. Pourtant, ces succès n’ont pas permis de lui assurer l’accès aux FATA, là où les besoins sont probablement plus nombreux, dans des conditions qu’elle juge acceptables.
MSF face à la stabilisation de la vallée de Swat
MSF intervient pour la première fois dans la vallée de Swat (province de KPK) en 2008 alors que des groupes armés d’opposition contrôlent la région. Ses activités sont mises en œuvre par des employés pakistanais avec l’appui d’expatriés qui font des visites ponctuelles. Son partenariat stratégique avec le Conseil des médecins de Swat (Swat Doctors Society), l’approvisionnement en médicaments et matériels des salles d’urgence ainsi que la mise en place d’un service d’ambulance confortent la crédibilité de l’organisation en tant qu’acteur médical à l’utilité reconnue. Pour l’autoriser à travailler dans la vallée de Swat, les autorités pakistanaises exigent alors de MSF qu’elle obtienne l’accord de l’opposition. L’organisation bénéficie d’un accès direct aux hautes autorités rebelles, qui entretiennent elles-mêmes un dialogue direct et ouvert avec l’État. Mais les parties en conflit ne souhaitent pas prendre la responsabilité de la sécurité d’employés internationaux. Les garanties obtenues auprès de l’opposition ainsi que la pertinence de son action médicale au cœur du conflit rendent acceptable aux yeux de l’organisation le compromis consistant à travailler sans présence permanente d’expatriés. En mai 2009, à la suite de plusieurs incidents de sécurité, MSF ferme néanmoins ses projets dans le district.
Entre mai et juillet 2009, l’armée pakistanaise lance une offensive importante dans la vallée de Swat, qui provoque le déplacement de plus de trois millions de personnes et une perte du contrôle de la région par l’opposition armée. À l’issue de l’offensive, qualifiée de succès par l’armée pakistanaise, la zone est alors décrétée « sécurisée et autorisée » et inscrite comme prioritaire pour le « développement à des fins de stabilisation ». En mai 2010, alors que le conflit se poursuit dans les FATA, interdites à MSF, hormis un projet modeste dans le district de Kurram, l’organisation retourne dans la vallée de Swat, afin d’assurer le fonctionnement d’une salle d’urgence dans l’hôpital de district, à Mingora.
Les projets du gouvernement pakistanais pour Swat sont détaillés dans le Plan intégré de stabilisation et de développement socio-économiqueGouvernement de NWFP, 2009, « Malakand comprehensive stabilisation and socioeconomic strategy ». La vallée de Swat est un des districts de la division de Malakand.. Dans la partie consacrée à la « fourniture des services sociaux de base » se trouve une référence spécifique au besoin de restaurer, de développer et d’améliorer les infrastructures de santé. Parallèlement au financement de ces dernières, le gouvernement des États-Unis fournit environ 36 millions de dollars d’aide directe au gouvernement du KPK, dont 12 millions sont destinés « à la réhabilitation, au personnel et à l’approvisionnement »du département de la SantéUSAID, Implementation letter nº MLK 01 : « Malakand reconstruction and recovery program », www.usaid.gov.. Les ONG se trouvent là où l’argent est disponible : quatre vingts d’entre elles, nationales et internationales, arrivent dans la vallée de Swat à la suite de l’offensive militaire.
La décision de MSF de retourner dans ce district après l’offensive n’est pas fondée sur un désir de reconstruire la zone dans le cadre d’un programme de stabilisation, mais renvoie à l’évaluation des besoins médicaux par l’organisation. La salle d’urgence de Mingora fonctionne très mal et malgré l’annonce de la fin du conflit, l’insécurité persiste, comme le révèlent d’importants afflux épisodiques de blessés. Le principal défide l’organisation est alors d’intervenir dans ce contexte sans compromettre sa capacité à se faire accepter par les groupes locaux opposés au gouvernement et à sa stratégie contre-insurrectionnelle, dans le district et aux alentours. Cela est d’autant plus important que les autorités lui ont clairement fait savoir qu’elles ne toléreraient pas qu’elle soigne des « militants » dans sa structure de santé.
De manière préventive, l’association, qui bénéficie de la confiance de la population, acquise lors de sa précédente intervention dans la région, décide de s’exprimer publiquement. Elle fait paraître un communiqué dans la presse locale explicitant ses intentions : « MSF revient à Swat afin de répondre aux besoins médicaux très spécifiques que nous avons identifiés à l’hôpital de Mingora. En tant qu’organisation médicale d’urgence ayant uniquement pour objectif la fourniture de soins vitaux, MSF n’est pas impliquée dans la reconstruction de Swat après l’offensive, pas plus qu’elle ne participe à la stratégie politique et militaire de quiconque. Pour nos activités au Pakistan, nous n’acceptons de financements d’aucun gouvernement, et avons décidé de ne nous appuyer que sur des financements privés. »Communiqué de presse MSF, 25 juillet 2010.En outre, puisque le terme d’ONG est devenu synonyme d’organisation financée par les États-Unis, liée aux Nations unies, ou d’organisation confessionnelle, MSF se présente d’abord comme une « organisation médicale privée », puis comme une « organisation médicale humanitaire » auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs.
Il devient également indispensable d’identifier les intervenants pertinents pour la mise en œuvre de ses activités, ce qui nécessite d’effectuer un travail de réseau avec différents groupes au sein de la population, à Swat et ailleurs dans la région. Plus précisément, MSF cherche à entrer en contact avec des écoles religieuses (madrasas) et des ONG nationales qui ont eu un rôle important dans la réponse aux déplacements de population provoqués par le conflit et les inondations de 2010. Le fait que MSF s’engage avec lesgroupes décrits parl’Occidentcomme « lescœursetlesesprits » à conquérir est une étape à la fois indispensable à la modification de sa perception et nécessaire pour que ses activités bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin.
Dans d’autres régions du nord-ouest du Pakistan où MSF n’a pas été capable de négocier sa présence après 2009, il lui aurait été possible d’intervenir à condition d’accepter de travailler uniquement par l’intermédiaire d’ONG nationales ou seulement avec du personnel pakistanais. C’est ce modus operandi qui lui a permis de mettre en place son projet dans le district de Kurram Agency, dans les FATA, comme cela avait été le cas dans la vallée de Swat en 2008. L’organisation aurait pu accéder alors à des endroits tels que Dera Ismail Khan et une partie de la province des FATA. Mais la décision a été prise en 2010 de ne pas répéter l’approche de Swat dans d’autres districts des FATA et du KPK : privée à partir de fin 2009 de la possibilité d’établir un dialogue direct avec l’opposition, MSF a considéré que, dans un territoire à ce point disputé, il lui était indispensable d’avoir des équipes associant employés nationaux et internationaux. L’organisation a en effet tiré les leçons de son expérience à Swat, où deux de ses ambulanciers ont été tués en février 2009. MSF a estimé alors que la présence de personnel international aurait diminué l’exposition des employés nationaux, qui, sous la pression de la communauté et des groupes armés, prenaient en effet des risques très importants.
Une autre solution pour permettre l’accès d’employés internationaux de l’organisation aurait pu être de recourir à des escortes de l’armée pakistanaise. Mais MSF s’yrefuse : fournies par l’une des parties au conflit, ces escortes transformeraient ses équipes en cible potentielle.
***
Somalie. Tout est négociable
Entretien avec BENOÎT LEDUC (ancien chef de mission et responsable de programmes de la section française de MSF en Somalie) réalisé par MICHAËL NEUMAN Ce texte est le produit d’entretiens menés entre juin et décembre 2010 qui ont porté sur les choix opérés par la section française et, de fait, les choix des sections belge, espagnole, hollandaise et suisse, également présentes en Somalie, n’ont pas été abordés.
Présente en Somalie depuis 1979 pour porter assistance aux réfugiés somali-éthiopiens, MSF a tôt fait l’apprentissage des risques et des difficultés à y travailler. En janvier 1987, dix membres d’une équipe présente à Tuj Walaje, dans le nord du pays, sont enlevés par les séparatistes du Somaliland ; en avril 1988, la section hollandaise de MSF est présente à Hargeisa lors du bombardement massif de la ville. La décennie qui suit s’ouvre sur une intensification de la guerre civile, résultat d’un processus engagé des années auparavant, où se conjuguent effondrement de l’État et explosion des armées privées constituées sur des bases personnelles, claniques et affairistesVoir notamment Roland MARCHAL, « Mogadiscio dans la guerre civile », Les Études du CERI, nº 69, octobre 2000.. À la suite de la chute du dirigeant Siad Barre, en 1991, MSF multiplie ses interventions : dans Mogadiscio déchirée par les affrontements, en zone rurale auprès des déplacés, ainsi qu’auprès des réfugiés somaliens qui fuient la guerre en direction du Kénya. L’organisation œuvre notamment à limiter les conséquences de la famine qui, à partir du printemps 1992, justifie l’une des premières interventions « militaro-humanitaires » internationales de l’après-guerre froide. Les opérations de secours sont menées dans un contexte de sécurité parmi les plus précaires qu’ait connus l’organisation. L’intensité des combats et les menaces directes à l’encontre des employés de l’organisation contraignent l’association à de nombreuses évacuations.

D’avril 1992 à mars 1995, les Nations unies mettent en place plusieurs missions consécutives censées faire respecter le cessez-le-feu entre les principales factions combattantes et sécuriser l’aide humanitaire. Les renforcements successifs de la force internationale contribuent pourtant à en faire un acteur direct du conflit. Les pertes civiles et militaires se multiplient, les forces internationales se rendant elles-mêmes coupables de nombreux crimes de guerre. La confusion entre les secours et l’intervention militaire internationale atteint un paroxysme.
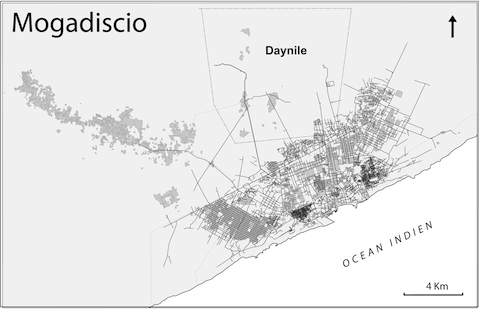
Dans le souci de ne plus être associée à la violence exercée au nom de l’humanitaire, et confrontée tant à l’insécurité grandissante qu’au rejet des étrangers par la population somalienne, la section française de MSF décide en mai 1993 de se retirer du pays. Cette décision s’appuie également sur la baisse de la mortalité liée à la famine.
Durant les années suivantes, le pays reste le théâtre d’affrontements entre entrepreneurs politico-militaires3. Nous avons ici préféré ce terme à celui de « seigneur de guerre », parfois utilisé dans l’entretien. Roland Marchal revient en détail sur ce dernier, largement utilisé par les institutions et médias internationaux pour décrire les responsables somaliens chargés des milices combattantes. Pour une analyse critique de ce terme et les conséquences de son usage sur les défauts d’analyse de la situation somalienne, voir Roland MARCHAL, « Warlordism and terrorism. How to obscure an already confusing crisis ? The case of Somalia », International Affairs, nº 83, 2007.. Malgré des interruptions régulières, les sections de MSF continuent de développer des projets d’assistance à Mogadiscio et dans l’intérieur du pays. En 1997, Ricardo Marques, un médecin expatrié, est assassiné dans l’hôpital de Baidoa, soutenu par la section française, revenue dans le pays deux ans plus tôt. Cet événement entraîne de nouveau le départ de l’association de Somalie.
MSF-France s’y réinvestit neuf ans plus tard, à la faveur d’une accalmie des combats à Mogadiscio. À l’été 2006, l’ICU (Islamic Courts Union, Union des tribunaux islamiques), un regroupement de tribunaux islamiques apparus au milieu des années 1990 pour restaurer l’ordre dans la capitale, s’est rendue maîtresse de celle-ci, dont elle entend faire le laboratoire d’une Somalie islamique. La population de Mogadiscio retrouve un calme perdu depuis quinze ans ; l’aéroport international, fermé depuis 1995, rouvre. Une fenêtre se dessine pour les organisations de secours, qui espèrent que les conditions de sécurité dans la capitale vont s’améliorer. Mais le moment ne dure pas. En décembre 2006, le régime éthiopien, craignant l’établissement d’un régime islamiste radical à ses portes, lance une offensive de grande ampleur contre l’ICU, qui est mise en déroute.
La guerre civile somalienne s’intensifie et s’internationalise, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » opposant les réseaux djihadistes transnationaux aux puissances occidentales, à l’ONU et à leurs alliés régionaux. L’insurrection se radicalise et voit notamment l’autonomisation du groupe Al-Shabaab, à l’origine « organisation de la jeunesse » regroupant un petit nombre d’éléments les plus durs. Ces groupes s’opposent au TFG (Transitional Federal Government, Gouvernement fédéral de transition), soutenu par les Nations unies et par l’Amisom, une force d’interposition de l’Union africaine établie en 2007. Divisé, ce gouvernement n’a jamais été en mesure d’exercer son pouvoir au-delà de quelques quartiers de la capitale.
C’est dans ce contexte que la section française de MSF va tenter de se créer un espace d’intervention. L’association, à travers des négociations incessantes, est mise au défi de trouver des compromis dans plusieurs domaines : la sécurité de son personnel, qui pose notamment la question du recours aux gardes armés, ses priorités d’intervention, la qualité de ses secours, le contrôle de ses ressources alimentant l’effort de guerre des combattants, l’usage de sa liberté de parole.
Entretien
Pour beaucoup de membres de MSF à Paris, la Somalie se résumait aux clans, au souvenir de la mort de Ricardo Marques, à trop de complexité. Elle incarnait la mise en œuvre d’une intervention dans des conditions de sécurité inacceptables et de dépendance à l’égard des groupes armés. Absente du pays depuis 1997, la section française s’est posé la question d’un retour en 2006. Quel était le contexte de la discussion ?
Dans la foulée de sa victoire contre l’ARPCTL’alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme était une coalition d’entrepreneurs politico-militaires soutenus par les États-Unis. S’il n’est pas établi qu’elle ait été formée à l’initiative des États-Unis, elle fut soutenue par ces derniers afin de lutter contre l’influence d’Al-Qaeda en Somalie. Elle se transforma rapidement en groupe de lutte contre les Tribunaux islamiques. D’après International Crisis Group, la CIA aurait fourni entre 100 000 et 150 000 dollars par mois à l’ARPCT désireux de combattre les éléments les plus radicaux au sein des tribunaux. Voir http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/10/rorycarroll.oliverburkeman en juin 2006, l’ICU a exercé son contrôle sur Mogadiscio. Les habitants de la ville, entièrement désarmée, en apparence tout du moins, redécouvraient une sécurité à laquelle ils n’avaient plus eu accès depuis quinze ans. Cette situation nouvelle a permis aux partisans d’un retour de la section française de MSF en Somalie d’en relancer l’idée. Une mission exploratoire a été conduite à l’été 2006, à Mogadiscio et Merka, une ville portuaire du Sud, pour prendre des contacts et se rendre compte de la réalité de la situation sur le terrain. Le retour à la guerre, consécutif à l’intervention de l’armée éthiopienne en Somalie fin 2006, a encouragé la poursuite de ces démarches. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à suivre le dossier.
La réouverture d’un projet a toutefois été l’objet de multiples discussions. La direction des opérations s’opposait à l’utilisation de gardes armés, et posait la question du risque d’une réouverture pour la sécurité des équipes. Par ailleurs, quatre sections de MSF travaillaient déjà dans le pays, et cela constituait un argument pour certains, qui estimaient que la présence de la section française n’était pas nécessaire.
Revenons sur cette question des gardes armés. En Afghanistan, en Érythrée, à de multiples occasions dans d’autres situations, l’organisation a eu recours à des combattants pour sécuriser ses équipes, ses convois. Si l’aide humanitaire ne doit pas être imposée par la force, l’utilisation d’escortes armées est parfois apparue comme une condition de l’assistance. Quels ont été les éléments du débat qui ont amené MSF à recourir à des gardes armés pour mener ses opérations en Somalie ?
Lors des discussions ayant précédé la réouverture des projets, les arguments opposés à un recours à des gardes armés se fondaient sur l’expérience de MSF en Somalie et dans d’autres pays. Ils comprenaient le risque de participer au financement du conflit, de mettre les équipes davantage en danger, de se rendre dépendant des milices, tout en y associant parfois la question de la neutralité des opérations. Au début des années 1990 en Somalie, le recours aux milices était une condition de l’action. Et puis, il n’a plus été possible de s’en défaire. Censées défendre l’association, elles organisaient elles-mêmes les incidents de manière à encourager un renforcement du dispositif. Dès le milieu des années 1990, il s’est agi pour les équipes de diminuer le nombre de gardes, de limiter nos relations contractuelles avec les milices. En recourant aux escortes, MSF, même marginalement, pouvait participer à créer les conditions de la violence. Nous prenions le risque qu’un membre de notre personnel tue quelqu’un. Les très nombreux incidents de sécurité que nous avions connus dans le passé rendaient ce débat légitime.
Mais les gardes armés en Somalie sont surtout une contrainte, ce n’est pas un choix. Lors de nos premières visites, nous nous disions également que nous ne voulions pas de gardes armés. Et puis nous nous sommes rendu compte que la moindre échoppe avait un garde, armé de sa kalachnikov… Depuis les années 1990, la sécurité en Somalie était entièrement privatisée. C’était un fait admis pour les équipes de MSF qui y travaillaient alors ; nous nous sommes également rendus à cette évidence. Dans tous les hôpitaux en Somalie, il existe à l’entrée une casemate pour déposer les armes, le propriétaire reçoit un numéro en échange, c’est comme un vestiaire. C’est la routine. Finalement, c’est cette réalité que nous avons décidé d’accepter à l’issue des débats.
Quelles ont été les étapes de la réouverture ?
Un des membres de la mission exploratoire de l’été 2006 avait été le chef de la mission en 1997. Il avait rencontré à l’hôtel à Mogadiscio son ancien adjoint, venu comme beaucoup d’autres Somaliens prendre le pouls de la ville en vue de relancer ses affaires. Il était basé à Kismayo, dans le sud de la Somalie, et a facilité notre arrivée dans une ville de la région, Jamaame. Il s’agissait d’une zone rurale, plutôt épargnée par les conflits. En outre, il y avait une piste d’atterrissage. C’est une condition sine qua non car, en voiture, l’accès est vite rendu trop dangereux.
Ensuite, il y avait bien sûr des besoins médicaux identifiés, comme c’est le cas dans l’ensemble des zones rurales somaliennes, et, surtout, pas d’acteurs de soins. Nous avons effectué quelques missions exploratoires dans des villages aux alentours. Il y avait eu de grosses inondations de novembre 2006 à janvier 2007. D’après les récits, des enfants étaient morts de diarrhées, du fait du manque d’eau potable – les habitants boivent l’eau de la rivière. Anticipant l’impact des inondations sur les récoltes, nous craignions également que la situation nutritionnelle ne se détériore.
Il y a eu de nombreuses discussions sur la pertinence d’intervenir à Jamaame. Pour beaucoup, le processus allait ralentir l’ouverture à Mogadiscio, considérée comme un objectif prioritaire dans la mesure où la capitale, fortement peuplée, était l’épicentre du conflit. Or le projet à Jamaame a ouvert très vite. MSF était un peu connue dans la région, pour avoir travaillé à Kismayo dans les années 1990. Les représentants du village ont rapidement désigné un interlocuteur unique pour s’occuper des véhicules, organiser le recrutement du personnel non qualifié, la location des structures. Nous avons expliqué et fait valoir les principes d’intervention de MSF, à savoir la neutralité dans le conflit, notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, notre impératif d’être en mesure de soigner tout le monde. Dès le mois de mars 2007, nous avions une équipe sur place. En avril, on s’est remis à travailler sur l’ouverture du projet à Mogadiscio.
Je pense que le travail que nous avons effectué à Jamaame était indispensable. Il faut se souvenir que nous avions commencé à travailler sur la Somalie à partir de quelques rapports anciens. Nous étions tétanisés, nous ne comprenions rien, ou alors seulement les risques. Jamaame était l’endroit où nous avons réappris ce qu’était la Somalie dans des conditions correctes : se déplacer, effectuer des évaluations nutritionnelles rapides, prendre le temps de discuter tranquillement avec nos interlocuteurs afin de connaître le contexte sanitaire.
Il y avait un seul clan à Jamaane, qui avait la réputation de se tenir éloigné des conflits, et la population était demandeuse. Cela nous a permis de comprendre le rôle des vieux du village, des chefs qui représentent chacun des sept sous-clans du clan, d’aborder la question de la négociation concernant les voitures, les maisons, les gardes armés, autant d’enjeux existant également à Mogadiscio. La location d’une voiture en Somalie entraîne une série de compromis. On n’applique pas ce que l’on apprend quand on est logisticien, à savoir qu’une voiture doit rouler droit, freiner, avoir des ceintures de sécurité. Là, il s’agit d’abord de comprendre qui en est le propriétaire, quels sont les rapports de forces entre les clans, les individus, les risques de représailles contre les équipes. Nous n’aurions jamais saisi ça à Mogadiscio, avec la guerre, les déplacements de population, la multitude clanique…
En outre, il y avait un intérêt à avoir un ancrage rural, un projet qui paraissait plus pérenne sur le plan de la sécurité. Ainsi, jusqu’à 2008, nous n’avons pratiquement pas évacué la mission. Parmi les raisons en faveur de l’ouverture du projet de Jamaame, il y avait aussi des raisons institutionnelles. Nous ne savions pas combien de temps allait prendre l’ouverture du projet à Mogadiscio. C’était donc aussi une façon de se mettre au travail, de justifier la mise en place d’une équipe à Nairobi, également chargée d’appuyer l’implantation du projet de Mogadiscio.
S’agissant des gardes armés, nous avons discuté des montages possibles, afin de nous libérer de certaines contraintes qu’ils représentaient. Nos gardes ne sont pas sous contrat, nous ne les gérons pas directement : nous versons une enveloppe financière aux représentants de la population, qui décident du dispositif de sécurité et qui le maintiennent en place. Mais les questions posées par les escortes restent entières. Quelles consignes donner aux gardes ? Comment gérer leur association avec nous ?
L’équipe qui avait mené la première mission exploratoire à l’été 2006 à Mogadiscio avait proposé l’idée de travailler sur la maternité et l’obstétrique. Cette idée n’a pas été retenue, car les indicateurs manquaient et les risques qu’auraient pris les équipes paraissaient très élevés. La chute des Tribunaux islamiques et la reprise des combats au début de l’année 2007 ont conduit à une remise à plat de la réflexion. Finalement, c’est vers la chirurgie que s’est orienté le projet. Pourquoi ne pas avoir concilié les deux priorités ?
Dès les premières visites en Somalie, nous avons été confrontés à la difficulté d’obtenir des indicateurs fiables. Il n’y avait pas de données officielles, tous les chiffres sont facilement manipulables, car invérifiables. MSF, soumise à la culture du chiffre, habituée à manier les outils épidémiologiques, a toujours eu des difficultés à valider des projets sur les perceptions ou les intuitions des équipes. Comment appréhender la notion de besoins quand on a le sentiment que l’urgence est partout : déplacements de population, crises nutritionnelles récurrentes, couverture vaccinale médiocre, insécurité générale, etc. ? Les évaluations elles-mêmes sont difficiles à mener : l’absence de structures de soins publiques est en partie amortie par le recours à des pharmacies ou à des consultations privées. On ne comprenait rien aux habitudes en matière de santé des Somaliens.
D’une certaine manière, à Mogadiscio, après l’intervention éthiopienne, c’était un peu plus simple : c’était la guerre, il y avait des blessés. Dans les conditions d’insécurité d’alors, il semblait que nous devions intervenir sur les risques vitaux. La chirurgie s’imposait. Nous avons effectué une évaluation en janvier 2007, puis une autre en avril. La capitale somalienne était alors en pleine ébullition. Les troupes éthiopiennes et gouvernementales menaient des offensives importantes contre les combattants islamistes des quartiers nord de la ville. Selon le HCR, ces combats avaient fait plus de 1 000 victimes civiles et 350 000 déplacés, notamment dans le corridor d’Afgooye, situé sur une trentaine de kilomètres à l’ouest de la capitale. Les Éthiopiens se livraient au pillage et à la destruction systématique des structures médicales qui auraient pu fournir des secours aux insurgés islamistes.
Des missions d’évaluation ont été lancées au sein de diverses structures dans la ville et sa périphérie. Nous voulions nous installer dans une structure existante afin d’alléger les procédures d’ouverture et les négociations liées à la sécurité du projet. Nous avons examiné les disponibilités. Des 800 lits d’hospitalisation disponibles en janvier 2007, il n’en restait plus, en juin, que 250. Les seuls services de chirurgie disponibles étaient ceux soutenus par le CICR. Mais ils n’offraient pas toutes les conditions d’accès aux combattants de l’opposition, entre autres pour des raisons géographiques.
L’hôpital de Daynile, un quartier périphérique au nordouest de la ville, fut considéré comme un endroit intéressant. Il avait reçu un afflux de patients. Il vivotait mais était en bon état. Il était situé en plein milieu d’un camp de déplacés. En outre, il était excentré. Or il était crucial d’être en périphérie, car une structure en pleine ville nous aurait directement exposés aux combats et aurait été difficilement accessible pour la population.
Mais l’hôpital était aussi placé sous le contrôle d’un personnage fort de Mogadiscio, Mohamed Qanyare, un entrepreneur politico-militaire local. Nos relations avec Qanyare ont été à l’origine de profonds désaccords avec les autres sections de MSF, qui y voyaient un risque pour la sécurité des projets. Il avait été proche du TFG avant de s’en éloigner puis de le réintégrer. Il avait été financé par les États-Unis, notamment dans le cadre de l’ARPCT en 2006.
Nous avons expliqué à Mohamed Qanyare l’importance de l’accès pour tous. Il a semblé accepter tout cela et s’est désengagé de la gestion de l’hôpital. Il disait : « Je m’occupe de la sécurité sur la zone. Pour le reste, vous voyez telle personne, telle personne, telle personne. »
Qanyare est un chef murosade, un sous-clan du clan hawiye. Or on trouvait des Murosade un peu partout, tant dans les milices shabaabs qu’au sein du TFG ou de l’Agence de sécurité nationale, chargée du renseignement et de l’anti-terrorisme. Ces allégeances multiples créent bien entendu beaucoup de complexité, mais nous avons également pu en jouer pour ouvrir des espaces de discussion avec les différents acteurs.
Il est apparu assez rapidement que nous obtiendrions les garanties que les combattants de toutes les factions pourraient se faire soigner à l'hôpital de Daynile. Toutes les parties ont accepté de jouer le jeu, même à contrecœur. Pour Qanyare, il en allait de son prestige. Il s’était présenté aux élections présidentielles de 2004, misait toujours sur sa carrière politique et voulait se montrer ouvert à tous les clans. C’est probablement pour cela qu’il a joué cette partition, ainsi que celle du gatekeeper, celui qui ouvre la porte à l’étranger et par lequel l’accord avec le clan est rendu possible.
Du côté des insurgés, il y avait un intérêt à favoriser l’assistance à leurs blessés, aux populations déplacées, et à encourager les organismes d’aide à témoigner des crimes de l’armée éthiopienne, appuyée par les milices gouvernementales. Ils savaient que nous allions travailler avec quelqu’un qui les avait combattus ; et Mohamed Qanyare savait que l’hôpital dont il nous ouvrait les portes allait fournir des soins à des combattants ennemis.
Cette prise en compte des intérêts des différentes parties au conflit pose la question de la manière dont s’effectuent les arbitrages opérationnels, en montrant qu’ils ne résultent pas uniquement de l’analyse des besoins de la population.
Les arbitrages ont procédé d’un mélange de différents impératifs. Des discussions ont eu lieu pour savoir si nous devions orienter nos opérations vers la pédiatrie ou la chirurgie. La pédiatrie répondait à de réels besoins et aurait été plus facile à mettre en place, car elle nécessite un dispositif technique moins lourd. Mais nous avons ouvert un programme de chirurgie – dont le besoin était également criant – parce que c’était ce que nous demandaient les acteurs, les notables que nous avons pu rencontrer. Si nous avions ouvert un centre nutritionnel ou pédiatrique, la tolérance de l’insurrection, des milices islamistes radicales, du clan murosade, de tous les autres groupes vis-à-vis du projet aurait été moindre. Je pense que l’hôpital aurait été pillé à un moment ou à un autre.
Simultanément aux discussions relatives à l’ouverture de notre projet à Mogadiscio lors de notre visite en avril 2007, nous avons été mis en contact avec un groupe de médecins proches de l’insurrection. Ils opéraient clandestinement et nous ont décrit les violences de l’armée éthiopienne contre les structures médicales. Ils ont insisté sur l’importance de l’existence d’une structure neutre qui puisse accueillir les blessés quels qu’ils soient. Nous avons discuté avec eux de notre projet à Daynile en lien avec Qanyare. Malgré leurs réticences, ils ont compris que les combattants insurgés auraient accès à l’hôpital. Pour soutenir leurs activités médicales, nous leur avons fait une donation de matériel médical, un appareil de radiologie, des tables chirurgicales, pour un total de plus de 120 000 euros. Les médecins de l’opposition n’avaient plus les moyens de soigner la population et souhaitaient faire redémarrer des structures de soins. Avec les donations, nous avons pu répondre à ce besoin, tisser des liens avec les médecins et, par ailleurs, « payer le prix » de notre proximité avec Qanyare pendant que l’on négociait l’ouverture du projet à Daynile. Nous n’avions aucun contrôle direct sur l’usage qu’ils feraient du matériel. Mais nous avons décidé d’assumer, malgré les craintes d’autres sections de MSF qui prétendaient que ce soutien à l’opposition islamiste pouvait mettre en danger l’ensemble des projets dans le pays.
Nous avons également mis en place des activités d’approvisionnement en eau dans les camps situés aux alentours de l’hôpital, à la suite des vagues successives de déplacés au printemps 2007. Nous avons distribué des réservoirs d’eau, des couvertures. C’était aussi une façon de protéger l’hôpital en offrant des soins aux populations vivant dans les environs.
Lors du montage du projet, MSF a veillé à définir un mode de répartition des ressources avec les différents interlocuteurs. Quelles approches ont été développées ?
Notre capacité à monter et à maintenir le projet a principalement tenu à la mise en place d’une structure de contrôle de l’hôpital, un « board » communautaire, une sorte de conseil d’administration extérieur à MSF. Nous sommes restés dans la gestion « indirecte » en évitant autant que possible de nous retrouver mêlés aux luttes personnelles, politiques ou claniques locales. Nous n’avons pas choisi les membres du board, qui étaient une douzaine et étaient désignés par cooptation. C’étaient des notables du quartier. Il s’agissait le plus souvent de proches de Qanyare, des Murosade.
En cas de problème, nous nous tournions vers eux : « C’est vous le board, c’est votre hôpital, c’est vous qui gérez, et nous vous soutenons. » Lorsque nous avons souhaité nous désengager de l’activité d’approvisionnement en eau par camions pour faire des forages, nous en avons discuté avec le board. C’est lui qui a négocié l’accès aux terrains, ainsi que l’interruption de la location des camions. Nous ne nous mêlions pas de ces négociations, elles restaient opaques pour nous. Nous nous contentions de faire passer des messages : « Si MSF est menacé, on risque d’arrêter nos projets. »
En ce qui concerne les recrutements, nous avons fait le pari qu’en misant sur les compétences nous retrouverions la diversité clanique indispensable pour atteindre les patients. Nous recrutions en faisant passer des tests écrits, des questionnaires supervisés par du personnel international. Cette transparence a été valorisée en collaboration avec le board. Si tout le monde pouvait participer, si le personnel était recruté pour ses qualités et non en raison de son clan, les gens acceptaient. En avril 2008, nous avons ainsi organisé un test, destiné à recruter vingt infirmiers, auprès de 535 personnes.
Et comme à Jamaame, la sécurité faisait l’objet d’un montage indirect : le budget affecté aux gardes armés était inclus dans une enveloppe que nous donnions à l’hôpital et qui était destinée à financer les activités dans lesquelles nous n’étions pas directement impliqués, dont les activités médicales non chirurgicales.
Depuis l’ouverture du projet, plus de 12 000 patients Chiffres à la fin de l’année 2010.ont été soignés à l’hôpital, dont plus de 50% de blessés liés à la guerre. Néanmoins, la situationa grandement évolué. Les Shabaabs contrôlent aujourd’hui la zone ; l’influence de Qanyarea diminué. Dans ce contexte, les populations civiles et les combattants des différentes factions peuvent-ils toujours accéder à l’hôpital ?
Les premiers mois du projet, les patients venaient surtout des districts voisins de l’hôpital. Parmi les blessés, il y avait une proportion importante de femmes et d’enfants, victimes des bombardements : plus de 56 % entre octobre et décembre 2007, plus de 53 % pour l’année 2008. Peu à peu, l’origine des patients s’est diversifiée et cela nous a rassurés sur le fait que la population, quelle que soit son affiliation clanique, avait accès à l’hôpital. Actuellement, nous sommes effectivement dans un quartier contrôlé par l’opposition islamiste. Les blessés de guerre proviennent de ses bastions. Cela est moins vrai pour les patients qui ne sont pas blessés de guerre : leur origine géographique est beaucoup plus variée.
Il est très probable que certaines factions armées refusentde se rendre à l’hôpital, mais ce n’est sans doute pas le cas pour les femmes et les enfants. Nous n’avons pas de certitude à ce sujet. Leur proportion dans l’ensemble de la population prise en charge pour des violences de guerre a baissé depuis 2008, mais elle suit l’évolution du conflit ainsi que la nature et la géographie des combats. Dès que des bombardements en zone résidentielle ont lieu, cette proportion remonte. En revanche, lors des périodes de forte intensité d’affrontements directs, comme c’est le cas depuis le début de l’année 2011, les admissions concernent davantage les combattants. Mais nous devons continuer à prêter une grande attention à cette question de l’accès indiscriminé à l’hôpital.
Dans ces conditions, nous sommes parfois considérés par certains acteurs politiques, des officiers de la force de l’Union africaine par exemple, comme le service de chirurgie de guerre de l’opposition. Il est alors opportun de rappeler le b.a.-ba de l’accès à une structure médicale en temps de guerre, à savoir que des combattants blessés et désarmés sont des non-combattants. En outre, ils ne représentent qu’une partie de nos patients. Par ailleurs, nous pouvons rappeler notre soutien au département médical de l’hôpital, où 70 % des patients qui sont hospitalisés sont des femmes et des enfants.
À Jamaame aussi, nous avons dû faire face à un changement de l’autorité en place et à la prise du pouvoir par les Shabaabs. Lorsque nous avons commencé, les « anciens » (elders) occupaient le pouvoir et assumaient toutes les fonctions (la justice, la police, la prison, la gestion du marché), en dépit de la présence d’un représentant du TFG. Lorsqu’en mai 2008 les Shabaabs ont repris le contrôle de la ville, les elders ont été écartés, et ont parfois été accusés de corruption. Actuellement, ils sont partiellement réintégrés dans la vie de la communauté, les Shabaabs ayant probablement compris l’intérêt d’avoir leur soutien pour administrer la zone.
En janvier 2008, une attaque contre une équipe de la section hollandaise de MSF à Kismayo a causé la mort de trois employés, un Somalien, un Kényan et un Français. Cet événement et une détérioration régulière de la sécurité dans le pays ont accéléré la révision des modes opératoires de l’association. L’ensemble des projets basculent vers ce qu’on appelle de la« gestion à distance ». Cela consiste en une gestion quotidienne du projet par du personnel national, collaborant à distance avec du personnel international. Or cette gestion à distance, comme le recours aux gardes armés en quelque sorte, brise la vision idéalisée des conditions de mise à disposition de l’aide. En effet, l’humanitaire ne repose-t-il pas sur un certain rapport à l’autre, le médecin d’ici qui va soigner là-bas ? Les arguments opposés à ce mode de gestion soulèvent la question de la neutralité, de l’indépendance des personnels nationaux, tout autant que la question du contrôle des ressources. Comment résout-on ces dilemmes ?
L’attentat de Kismayo en janvier 2008 a entraîné l’évacuation du personnel international de tous les projets de MSF, mais nous avons renvoyé les équipes à Jamaame et à Daynile après quelques semaines de réflexion en interne. En mai 2008, l’assassinat du dirigeant shabaab Aden Hashi AyroAyro était un des dirigeants d’Al-Shabaab. Il était présenté comme l’un des représentants d’Al-Qaeda en Somalie. par les États-Unis a créé un vide de pouvoir dont ont pu profiter un certain nombre de factions djihadistes et qui a accéléré la radicalisation de certaines d’entre elles. Cette fragmentation de l’insurrection islamiste a eu un coût très élevé concernant la sécurité du personnel humanitaire. Parallèlement, on a observé une intensification du rejet de l’aide humanitaire – perçue comme un soutien pur et simple aux islamistes – par de nombreux partisans du TFG. Jusqu’à l’élection du sheikh Sharif Sheikh Ahmed à la tête du gouvernement, en janvier 2009, les attaques de travailleurs humanitaires par les combattants du TFG n’ont pas été moins dangereuses que celles menées par les Shabaabs.En 2008, quarante-cinq travailleurs humanitaires furent tués en Somalie, contre trente-trois en Afghanistan et dix-neuf au Soudan, et treize furent kidnappés (Abby STODDARD, Adele HARMER et Victoria DIDOMENICO « Providing aid in insecure environments. Trends in violence against aid workers and the operational response (2009 update) », avril 2009, Overseas Development Institute, Londres ; « 2008 was deadliest year for aid workers – study », Reuters, 6 avril 2009.
Au cours de la période qui a précédé la mort d’Ayro, il nous avait été possible de maintenir les contacts avec l’opposition via les réseaux murosade et médicaux. Nous avions établi des relations fonctionnelles et constructives avec Al-Shabaab. En janvier 2008, l’organisation nous avait même adressé un courrier nous prodiguant ses encouragements. Mais dès lors que des insurgés islamistes non murosade sont arrivés à Daynile, il nous est devenu plus difficile de négocier les visites. D’autant plus que le trajet entre l’aéroport et l’hôpital n’a jamais été aussi dangereux, du fait des combats et des risques d’enlèvement.
À Jamaame, où nous avions une équipe expatriée, nous avons été contraints de nous limiter à organiser des visites ponctuelles. À Daynile, nous avions mis en œuvre le projet sans présence permanente de personnel international, du fait des risques de violence contre les étrangers, mais aussi des dommages collatéraux : tirs croisés, attentats… Le choix que nous avions fait de ne pas nous impliquer dans des activités médicales non chirurgicales était également dû au fait que le nombre d’expatriés était limité. De ce mode intermittent, nous sommes passés aux visites « éclair », rares et planifiées à la dernière minute. L’équipe expatriée reste aujourd’hui basée à Nairobi. La gestion du projet dépend bien davantage du personnel somalien qu’auparavant. Bien sûr, certains employés ont pu s’accommoder d’un environnement où ils reçoivent les salaires, les ressources, les médicaments et sont soumis à un contrôle moindre. Néanmoins, organiser les visites d’expatriés à Daynile qui permettraient d’améliorer le suivi du projet, c’est aussi du stress supplémentaire pour le personnel national, parce qu’il faut veiller sur nous, organiser notre sécurité.
L’avenir du programme se joue sur cette tension entre la sécurité et l’impératif de suivi : d’un côté, un membre du board de Daynile explique que « s’il arrive quelque chose, c’est la fin de l’hôpital » ; de notre côté, ainsi que l’expliquait notre chef de mission, nous savons que « s’il ne se passe rien, à savoir si on n’y va pas, c’est aussi la fin de l’hôpital ». Nous en sommes là aujourd’hui.
Notre limite la plus forte réside dans notre faible capacité à développer nos activités ou à répondre aux urgences. En août 2010, la population de déplacés présente dans les camps de la région de Daynile se chiffrait sans doute à environ 110 000 personnes. Les besoins y sont très importants et la fourniture d’aide insuffisante. Quelques organisations effectuent un travail limité dans les camps, comme le Croissant-Rouge. En temps normal, nous déciderions probablement d’y intervenir largement, avec des activités d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de distribution, de soins médicaux, etc. Mais les camps constituent la base sociale des Shabaabs. Ils sont très contrôlés. Notre personnel n’est pas toujours rassuré à l’idée d’y intervenir. De manière générale, les menaces qui sont exercées sur les employés locaux sont très importantes. Leur sécurité est en jeu, au quotidien, de façon très aiguë.
S’agissant du contrôle du bon usage des moyens fournis par MSF, on prend en compte le maximum d’éléments, médicaux, logistiques, financiers : dans une certaine mesure, tous les ingrédients d’un projet classique sont là. Il faut se poser la question de la supervision, de la qualité médicale, du suivi. Nous analysons les flux de médicaments, les rapports d’activité et le nombre de patients déclarés. Et après, nous examinons la consommation de certains médicaments sensibles ou onéreux, les chiffres et les raisons des admissions et des sorties dans les activités nutritionnelles. Des éléments peuvent certes nous échapper, le nombre d’enfants dans le programme nutrition par exemple, et nous ne sommes pas à l’abri d’héberger des patients fictifs. Mais ces risques se posent aussi dans des projets avec expatriés. Par ailleurs, nos visites à Daynile – et nous n’y sommes pas retournés depuis avril 2009 – sont relativement inefficaces. Nous passons notre temps à gérer les imprévus du quotidien alors que la partie médicale, qu’il s’agisse de faire un inventaire physique de la pharmacie ou de suivre un patient, vérifier la qualité des soins et les prescriptions, est réduite à la portion congrue.
Cette situation qui se prolonge est inquiétante pour la qualité des soins que nous fournissons. Nos standards de soins à Daynile ne sont pas les mêmes que ceux de nos programmes à Haïti, par exemple. Il est parfois même difficile de certifier les diplômes de nos médecins. De ce fait, la réduction des fractures, le contrôle des infections ne peuvent se faire dans des conditions aussi satisfaisantes que nous le souhaiterions, malgré nos échanges avec le personnel, les formations que nous mettons en place.
Tant que la situation sécuritaire restera aussi difficile, un retour rapide à une présence expatriée régulière est improbable. En outre, de nouvelles contraintes peuvent apparaître, et notamment des exigences des Shabaabs concernant la nationalité des expatriés autorisés à visiter les projets.
En janvier 2008, c’est sans ambiguïté qu’Al-Shabaab affirmait son allégeance aux responsables d’Al-Qaeda. Dans le même temps, l’intervention internationale s’est inscrite dans un contexte de plus en plus influencé par la guerre contre le terrorisme. Quel est l’impact de cette polarisation sur notre action ?
Nous vivons un nouvel épisode dans les tentatives de cooptation de l’aide par les parties en conflit, dans un pays qui en a connu de très nombreux. En janvier 2010, le PAM, sur fond d’accusations de détournement et de corruption, a annoncé la suspension de son aide dans le centre et le sud du pays, du fait du nombre croissant d’attaques contre son personnel. Puis, en février, ce sont les Shabaabs eux-mêmes qui ont interdit l’aide alimentaire du PAM sous le prétexte que ses opérations étaient « motivées politiquement » et qu’elles déstabilisaient le marché local. En novembre 2009, ils avaient émis une liste de onze conditions à la poursuite de l’aide internationale, dont le paiement d’une taxe de 20 000 dollars tous les six mois et le licenciement de tout le personnel féminin – à l’exception de celui travaillant dans les structures de soins. En août 2010, Al-Shabaab annonçait l’interdiction imposée aux ONG World Vision, Adra et Diakonia, les accusant de prosélytisme. Le groupe demande aujourd’hui aux employés somaliens des projets de MSF dans les zones qu’il contrôle le versement d’une taxe équivalant à 5 % de leur salaire, ainsi que le paiement de « frais d’enregistrement » de 10 000 dollars par projet. Il cherche également à capter des taxes pour l’utilisation des aéroports. Daynile n’est pas concerné, ou tout au moins le board a su faire barrage aux demandes. Cela révèle l’intérêt que les Shabaabs trouvent au projet.
Chaque exigence des Shabaabs provoque une nouvelle réflexion sur les limites de ce qu’il est raisonnable d’accepter dans une situation aussi complexe, en tenant compte des besoins médicaux considérables, de nos interrogations concernant notre capacité à gérer ces programmes et de l’impasse dans laquelle se trouvent l’intervention internationale et le pays, engagé dans un énième plan de paix.
De l’autre côté, le régime de sanctions internationales et les législations antiterroristes tendent à limiter la capacité des organisations d’aide à travailler dans les zones contrôlées par les insurgés. C’est l’accès des populations civiles à l’aide qui est remis en cause. Alors que les Nations unies lancent tous les jours des messages sans cesse plus alarmants sur la « situation humanitaire », les bailleurs de fonds américains ont suspendu courant 2009 une partie de leur financement par crainte de poursuites qui pourraient être engagées pour avoir fourni de l’assistance à Al-Shabaab, qualifié d’organisation terroriste par le Département d’État depuis mars 2008. La législation américaine devient menaçante vis-à-vis des organismes qui fournissent de l’aide pouvant bénéficier à des personnes liées d’une manière ou d’une autre aux islamistes. Les Nations unies elles-mêmes ont adopté en mars 2010 une résolutionRésolution 1916 (2010), adoptée le 19 mars 2010. qui crée potentiellement les conditions de sanctions contre les organismes d’aide travaillant dans des territoires contrôlés par les groupes d’opposition. Dans un article paru en juin 2009, Ahmedou Ould-Abdallah, le représentant spécial des Nations unies pour la Somalie, avait écrit que « ceux qui se réclament de la neutralité peuvent également être complices » de l’opposition. Même s’il n’a pas de conséquences immédiates, ce processus rend d’autant plus impérative la nécessité de se distinguer des initiatives internationales aux yeux de la population et des parties au conflit.
Pourtant, dans la mesure où les Shabaabs contrôlent la majorité du pays, et Mogadiscio en particulier, nous ne faisons que prendre acte de cette réalité. Notre priorité est de nous assurer que nos patients ne sont pas triés en fonction de leur allégeance ou appartenance à des groupes, pas de choisir nos interlocuteurs – y compris si ceux-ci se réclament d’Al-Qaeda.
Les violences contre les civils sont nombreuses, les attaques contre les hôpitaux sont légion, et nos interventions sont limitées du fait des contraintes sécuritaires. Pourtant, dans l’espace public, on entend beaucoup plus les Nations unies que MSF, qui apparaît assez silencieuse. De quoi souhaitons-nous parler ? De quoi nous interdisons-nous de parler ?
À l’origine, la ligne directrice de notre communication épousait celle de nos opérations : il s’agissait d’être peu visible. Nous ne voulions pas dire quoi que ce soit. Nous avions peur de tout le monde. Les responsabilités de l’attaque de Kismayo contre MSF-Hollande n’ont jamais été clairement établies. Nous avions peur des Shabaabs, des Éthiopiens, des clans, des seigneurs de guerre, du gouvernement ou de l’absence de gouvernement.
Au début, à Daynile, que ce soit la population, le personnel, les forces insurrectionnelles puis les Shabaabs, tout le monde nous disait : « Ne parlez pas, ne faites pas de politique. » On a reçu ce message très clairement à plusieurs reprises. Cette stratégie est peut-être payante : à Jamaame, les Shabaabs expulsent toutes les ONG sauf MSF.
Dans un contexte aussi complexe, le risque de la prise de parole est très grand. En conséquence, notre communication publique actuelle est uniquement factuelle, très liée à nos activités, à nos prises en charge d’enfants malnutris, de blessés à Daynile. Ce sont les Shabaabs qui sont les plus méfiants à l’heure actuelle, et la communication de MSF revêt une dimension pragmatique : il est plus important aujourd’hui de se distinguer des efforts internationaux visant à la défaite des Shabaabs et soutenant à tous crins un gouvernement transitoire en perte de vitesse. Nous avons pu publier un communiqué de presse demandant à l’Union africaine de ne pas bombarder les quartiers résidentiels. Nous n’avons en revanche jamais demandé aux Shabaabs de ne pas se servir de la population civile comme d’un bouclier humain lorsqu’ils se cachent dans le marché de Bakara.
Au vu de l’immensité des besoins médicaux, de la difficulté à y répondre, nous avons peur de perdre ce que nous avons mis en place. Il nous apparaît indispensable de nous distinguer des acteurs internationaux, de ne pas appeler au renforcement de l’Amisom par exemple. Mais les prises de parole directement liées aux responsabilités dans le conflit sont certainement plus difficiles à définir et à assumer.
***
Gaza. Conflits de souveraineté
CAROLINE ABU-SADA
MSF est intervenue pour la première fois dans les Territoires palestiniens en 1988, quelques mois après le déclenchement de la première Intifada. Depuis, plusieurs sections s’efforcent de répondre aux conséquences de l’occupation israélienne sur l’accès de la population palestinienne à certains soins. L’existence d’un système de santé performant rend plus difficile pour MSF d’y trouver sa place. En 2007, Gaza compte près de 3 800 médecins, plus de 4 200 infirmiers, une vingtaine d’hôpitaux, pour un peu plus de 1,5 million d’habitants. Gaza dispose de 13,6 lits d’hospitalisation pour 10 000 habitants, contre 17 en Jordanie. Les principales causes de mortalité y sont les maladies cardiaques et cérébrovasculaires, à l’instar de régions à haut revenu ou à revenu intermédiaireDonnées de 2007, bureau de l’OMS, Gaza.. Les projets de MSF sont mis en œuvre dans un contexte de conflit internationalisé dès son origine, faisant l’objet d’une très forte médiatisation et d’intenses mobilisations politiques transnationales. Au sein de l’organisation, l’impératif « d’en être », dicté par l’importance symbolique de ce conflit, se heurte donc à la difficulté de trouver des activités médicales pertinentes.
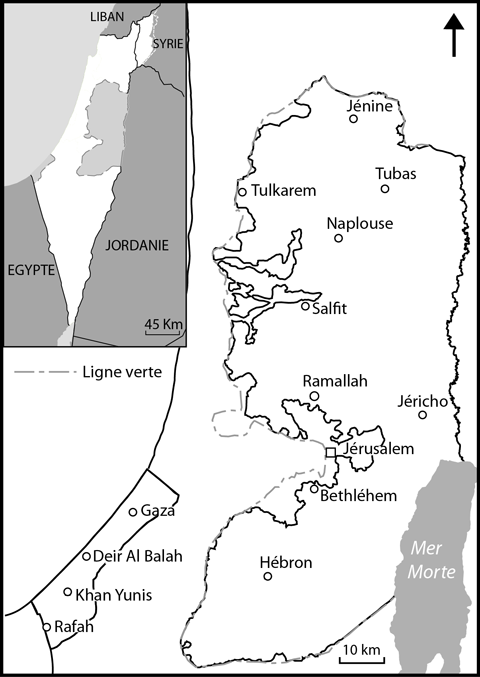
Ce chapitre porte sur les interventions de MSF dans la bande de Gaza entre 2007 et 2010, période durant laquelle le positionnement politique et opérationnel de l’organisation a été profondément revu, au prix de concessions de sa part comme de celle du gouvernement gazaoui.
Présente à Gaza depuis 2000, la section française mène jusqu’en 2005 des projets de soins psychologiques accompagnés d’une aide médico-sociale aux personnes vivant dans des zones particulièrement affectées par le conflit (familles dont les maisons sont réquisitionnées par l’armée, vivant à proximité de colonies ou dans les zones de la bande de Gaza pour lesquelles une permission de l’armée est nécessaire pour entrer ou sortir, etc.). Après le désengagement israélien de la bande de Gaza, en août 2005, le projet s’oriente en priorité vers les habitants des zones frontalières, considérées comme les plus affectées par les violences. Il comporte un volet d’approvisionnement en médicaments et en matériel médical des structures de santé susceptibles de recevoir des afflux de blessés. Depuis ses débuts, MSF est en contact avec ses deux interlocuteurs politiques habituels : d’une part, Israël, avec lequel sont discutés visas, accès à Gaza et questions administratives ; d’autre part, l’Autorité palestinienne, ébauche de structure étatique issue des accords d’Oslo de 1993 et installée à Ramallah, en Cisjordanie, avec laquelle sont coordonnées les activités de soin.
En janvier 2006, le Hamas (Mouvement de résistance islamique) remporte les élections législatives dans l’ensemble des Territoires palestiniens. S’ensuit une année de tension politique entre le Fatah, principal parti de l’Autorité palestinienne, et le Hamas, à l’issue de laquelle des affrontements armés éclatent dans la bande de Gaza, au printemps 2007. En juin, après une bataille faisant plus d’une centaine de morts, le Hamas accède au pouvoir. L’Autorité palestinienne garde quant à elle le contrôle de la Cisjordanie. Il y a désormais un gouvernement dirigé par un parti ayant remporté des élections régulières, le Hamas, installé dans la bande de Gaza, et un gouvernement non élu dirigé par le Fatah, en Cisjordanie. Le gouvernement qui s’installe à Gaza est aussitôt boycotté par une partie des acteurs internationaux, parmi lesquels les États-Unis et l’Union européenne, alors qu’Israël place la région sous embargo terrestre, aérien et maritime, dont l’aide humanitaire doit théoriquement être exemptée. Les principaux bailleurs de fonds conditionnent le financement des organisations non gouvernementales internationales à leur engagement à ne pas entrer en contact avec le Hamas. Par conséquent, un certain nombre d’entre elles sont contraintes de limiter, voire de suspendre, leurs activités. Financée par des fonds privés, MSF n’est pas affectée par ces consignes qui, au nom de la lutte antiterroriste, discriminent les Palestiniens en fonction de l’endroit où ils vivent. En septembre 2007, Israël qualifie Gaza d’« entité hostile ». Pour sa part, le Hamas entend désormais affirmer sa capacité à prendre en charge la gestion de Gaza, c’est-à-dire à se transformer en parti de gouvernement. L’ensemble des stratégies du Hamas avec les acteurs présents, et notamment avec MSF, se définit à l’aune de cette évolution.
En 2007, plusieurs changements majeurs interviennent dans le domaine de la santé à Gaza. Tout d’abord, le nombre important de blessés dûs aux affrontements entre les factions palestiniennes met le système de soins face à ses limites. La seule « bataille de Gaza » de juin 2007 fait plus de 500 blessés. Si les hôpitaux palestiniens montrent une remarquable capacité à prendre en charge les interventions chirurgicales, les soins postopératoires sont peu ou mal assurés. Le climat d’insécurité et les tensions entre les factions limitent également l’accès aux soins dans les structures publiques pour les patients considérés comme des opposants au Hamas. De plus, le fonctionnement du système de santé est directement affecté par la compétition entre les deux ministères de la Santé, concurrents, de Gaza et de Ramallah. Le Fatah, qui dirige l’Autorité palestinienne, exige ainsi de ses fonctionnaires de santé à Gaza qu’ils fassent grève s’ils veulent continuer à percevoir leur salaire, tandis que le Hamas duplique les structures administratives et y affecte ses propres fonctionnaires. L’embargo, malgré l’affirmation israélienne que les soins médicaux en sont exclus, et la mauvaise volonté du ministère de la Santé de Ramallah à collaborer avec Gaza, rendent l’approvisionnement des hôpitaux en médicaments et en équipements plus difficile.
Ce changement de contexte apporte à MSF la possibilité de médicaliser son action, au-delà des soins psychologiques. Un centre de soins postopératoires et de physiothérapie pour les blessés admis dans les hôpitaux palestiniens ouvre à Gaza-ville. Puis des équipes mobiles de kinésithérapeutes sont mises en place dans toute la bande de Gaza. Elles permettent de répondre aux difficultés de circulation de certains patients se trouvant dans l’incapacité physique de se déplacer, ou dont la proximité avec le Fatah entrave l’accès aux structures de soins contrôlé par le Hamas. Enfin, une clinique pédiatrique ouvre à Beit Lahiya pour pallier les insuffisances créées par l’embargo et les grèves du personnel de santé. Toutes ces nouvelles activités s’effectuent dans le cadre de structures privées de MSF, afin d’assurer l’accès à tous les patients et parce que la place manque dans les hôpitaux publics.
Le Hamas : de l’indifférence au rapport de forces et aux négociations imposée
Dans un contexte marqué par le blocus israélien, les sanctions internationales contre le Hamas et l’animosité entre factions palestiniennes, la nouvelle situation politique à Gaza pose des difficultés à MSF, habituée à ne dialoguer qu’avec l’Autorité palestinienne et les Israéliens. Depuis son arrivée dans la bande de Gaza, en 2000, MSF a certes rencontré de manière périodique les dirigeants du Hamas, mais à une époque où le parti politique n’était pas entré dans le jeu électoral et n’était qu’un groupe d’opposition parmi d’autres. Au cours des mois qui suivent l’arrivée au pouvoir du Hamas à Gaza, l’organisation continue de négocier le cadre légal de sa présence avec l’Autorité palestinienne. Les accords formels concernant la fourniture de soins postopératoires ambulatoires et l’ouverture d’une unité de soins pédiatriques sont ainsi signés à Ramallah en août 2007 et mai 2008. Pour sa part, dans les premiers temps, le gouvernement du Hamas consacre peu d’énergie à contraindre les ONG internationales à établir des rapports formels avec lui. Ses représentants, aux responsabilités parfois floues dans le cadre d’une structuration en cours, semblent se satisfaire de discussions informelles avec MSF, qui les informe de ses orientations et de ses activités.
Mais en continuant de négocier le cadre légal de ses interventions avec l’Autorité palestinienne établie à Ramallah, MSF prend le risque d’être perçue comme soutenant le Fatah dans le conflit de souveraineté qui l’oppose au Hamas. Certes, en septembre 2008, l’association souligne publiquement la responsabilité des autorités politiques, dont le Fatah, dans la dégradation de la situation sanitaire. Dans un communiqué de presse intitulé : « Gaza : le politique prime sur la santé », elle déclare : « Le syndicat palestinien des travailleurs de la santé [pro-Fatah] encourage ses employés grévistes à se porter volontaires auprès de structures gérées par des ONG et à soigner les patients gratuitement. Or MSF n’a ni la capacité ni la légitimité de gérer les répercussions de cette crise. De même qu’il ne relève pas de son mandat d’assurer un “service minimum” comme demandé par certaines parties en conflit. MSF refuse de jouer ce rôle. Nous ne pouvons et ne devons pas remplacer l’intégralité d’un système de santé public. […] Au lieu d’être considérée comme un service essentiel, humanitaire et vital, la santé est utilisée comme un moyen de pression politique par deux parties tout aussi irrespectueuses des conséquences que cela peut avoir pour la population. » MSF, « Gaza : la politique prime sur la santé ? », septembre 2008, http://www.msf.fr.
Mais c’est l’unique fois dans la communication publique de l’association depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas à Gaza que l’Autorité palestinienne est ainsi pointée du doigt. En tant que telle, la substitution à des systèmes de santé défaillants n’a rien d’une nouveauté pour MSF, mais il importe dans ce cas précis de ne pas apparaître comme prenant parti dans la lutte intrapalestinienne et de signifier la position inconfortable dans laquelle les belligérants la placent.
Début octobre 2008, Bernard Kouchner, alors ministre français des Affaires étrangères, déclare à la suite d’une visite à Gaza que le gouvernement français obtient des informations des ONG françaises travaillant sur place. MSF, comme MDM de son côté, publie un communiqué de presse dénonçant des affirmations sans fondement et dangereuses, qui sèment le doute sur ses intentions et menacent ses activités. En effet, les déclarations du ministre, par ailleurs cofondateur de MSF en 1971 et de MDM en 1980, contribuent à augmenter la défiance du Hamas vis-à-vis des organisations étrangères telles que MSF.
Le 27 décembre 2008, l’armée israélienne lance l’opération « Plomb durci » dans la bande de Gaza. Les trois premiers jours de l’offensive sont très violents. Shifa, l’hôpital principal de Gaza-ville, semble débordé par l’arrivée massive de blessés et MSF décide de mettre en place un hôpital sous tentes gonflables pour accroître les capacités chirurgicales. Alors qu’il était initialement prévu que les tentes soient installées dans l’enceinte de l’hôpital, l’équipe établit finalement sa structure à l’extérieur, après la fin de l’offensive, pour faciliter l’accès aux soins de l’ensemble des victimes. Le projet est discuté à un échelon technique du ministère de la Santé gazaoui, le ministre n’en étant lui-même pas informé. Au même moment, en janvier 2009, MSF signe un accord avec le ministère de la Santé de Ramallah pour l’expansion de ses activités postopératoires dans la bande de Gaza.
L’offensive militaire de décembre 2008 et janvier 2009, qui fait 1 300 morts palestiniens, plus de 5 000 blessés3. « The Gaza Strip. Operation Cast Lead, 27 Dec. ’08 to 18 Jan. ’09 », Btselem, http://www.btselem.org. et entraîne des destructions matérielles considérables, marque un tournant politique à Gaza. D’une part, le Hamas en sort victorieux aux yeux de la population, face à une Autorité palestinienne très affaiblie, notamment du fait des déclarations, le premier jour du conflit, de son président, Mahmoud Abbas, selon lesquelles l’attaque de Gaza par l’armée israélienne relève de la responsabilité du Hamas. D’autre part, la fin de l’offensive signifie la réorganisation de l’administration du Hamas, qui a perdu un certain nombre de ses dirigeants, victimes des tirs israéliens. Ces changements conduisent les relations entre MSF et le gouvernement gazaoui à une deuxième phase, celle du rapport de forces.
À la suite d’une visite d’inspecteurs du ministère gazaoui de la Santé à l’hôpital sous tentes de MSF à la mi-juillet 2009, le ministre décide de la fermeture immédiate de la structure, estimant que l’organisation n’a pas les autorisations nécessaires et qu’un plateau chirurgical sous tentes n’a pas sa place à Gaza. Plusieurs réunions se succèdent entre octobre 2009 et avril 2010, au cours desquelles se précisent les critiques et les exigences du Hamas : les premières portent sur le manque d’intégration de MSF dans les structures publiques et sur sa politique de recrutement, les secondes sur l’accès aux dossiers individuels des patients et sur les visites à domicile des équipes médicales. Pour le Hamas, le travail de MSF doit s’inscrire dans la carte sanitaire qu’il souhaite mettre en place, afin d’« éviter la duplication et le gaspillage financier»4. Expression utilisée dans un courrier transmis du ministère de la Santé à MSF, mars 2010.. Selon lui, une intégration de l’organisation dans les structures publiques doit aussi permettre un transfert de compétences au personnel du ministère. En outre, il estime que, du fait de l’absence d’un accord du ministère relatif aux activités chirurgicales (unité de soins intensifs et bloc opératoire), il ne peut garantir la qualité des soins, dont il estime avoir la responsabilité. S’agissant du recrutement, MSF se voit reprocher d’avoir employé des chirurgiens du ministère sans en avoir averti ce dernier, en leur offrant qui plus est des rémunérations bien supérieures à celles qu’ils reçoivent en tant que fonctionnaires – deux chirurgiens avaient en effet été embauchés en 2008 par MSF ; payés à l’acte, ils ont touché jusqu’à 8 000 dollars par mois en raison de l’augmentation du nombre d’interventions pratiquées après l’opération « Plomb durci ». Enfin, le ministre exige de MSF, comme des autres organisations médicales travaillant à Gaza, qu’elle arrête ses visites à domicile, et surtout qu’elle lui transmette les dossiers médicaux complets des patients afin de pouvoir les suivre en cas de plaintes consécutives à des prises en charge médicales.
À ces reproches juridico-administratifs s’ajoutent d’autres considérations. Durant les discussions entre MSF et le Hamas, il est en effet beaucoup question du comportement des équipes, expatriées et nationales, des « fêtes » organisées au sein du bureau de l’organisation, où se mêlent Palestiniens et expatriés et au cours desquelles de l’alcool est consommé, autant d’éléments entrant en contradiction avec « la façon dont [le Hamas] envisage l’organisation de la société»Compte rendu d’une réunion entre le Hamas et MSF en novembre 2009.. Marqué par les déclarations de Bernard Kouchner et le rejet dont il fait l’objet de la part des Occidentaux, le Hamas continue également d’exprimer ses doutes quant au caractère non partisan de MSF. Il remet par exemple en question les réunions quotidiennes de sécurité – dont le but est de vérifier les conditions de circulation pour les équipes –, qu’il assimile à de la collecte d’informations. En septembre 2009, deux employés palestiniens de l’organisation sont convoqués par les services de la Sécurité intérieure, qui les interrogent avec agressivité à propos du travail de l’association, mais semblent avant tout leur reprocher des comportements dans le privé non compatibles avec le nouvel ordre social que le Hamas souhaite mettre en place.
Ces points de dissension reflètent la volonté du Hamas d’être reconnu comme l’autorité de santé légitime dans la bande de Gaza, alors que le ministère de la Santé de Ramallah continue d’exiger de MSF la signature d’accords-cadres et des « informations sur ses activités».Entretien avec le directeur de la coopération internationale du ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne, 12 janvier 2011.
À la fin de l’année 2009, les rédacteurs du plan stratégique de l’organisation reconnaissent la nécessité de prendre acte de la nouvelle réalité politique et administrative à Gaza : « Les discussions en cours avec les autorités dans la bande de Gaza vont continuer afin de rétablir l’espace de travail de l’association (le Hamas montre une volonté forte de maintenir un strict contrôle à l’intérieur de la bande). Par conséquent, les conditions de la présence de MSF seront à mettre en balance avec les compromis qui sont demandés par le Hamas. »Plan stratégique, MSF-France, 2010.
Néanmoins, nombre de demandes du Hamas sont rapidement considérées par MSF comme légitimes de la part d’une autorité gouvernementale. L’association s’engage à ne plus recruter de fonctionnaires et à fournir plus d’informations concernant les activités du projet. Elle s’engage également et enfin à élaborer une proposition d’accord global destiné à définir le cadre de son intervention et à développer à l’hôpital Nasser le projet de chirurgie plastique qu’elle souhaite y mettre en place en collaboration avec le ministère gazaoui. En revanche, invoquant le respect du secret médical, MSF refuse de transmettre les dossiers complets des patients. Le ministre convient finalement que cette information ne pourra être partagée qu’entre médecins (de MSF et du ministère de la Santé). Il cède également sur la question de l’intégration des structures de soins psychologiques et postopératoires de MSF dans le système public. Celle-ci fait en effet valoir que la confidentialité des données relatives aux patients bénéficiant de soins psychologiques pourrait être mise à mal et que le choix des patients nécessitant une physiothérapie doit rester la responsabilité de MSF. En revanche, l’association assure que des formations en kinésithérapie seront offertes au personnel du ministère, et concède l’arrêt des visites à domicile pour la rééducation ou la santé mentale, qui prend effet fin février 2010.
Ces événements soulignent la difficulté de MSF à s’adapter aux conséquences du changement politique intervenu à Gaza et aux revendications des nouvelles autorités en matière de politique de santé. La relative lenteur avec laquelle ses équipes ont réorienté leurs relations avec les autorités politiques, conservant plus que de raison l’illusion d’un pouvoir exercé à Gaza depuis Ramallah, est en effet l’une des faiblesses qui apparaissent à l’examen de l’action conduite depuis 2006. En l’absence de trace écrite indiquant un choix explicite de MSF, mais en s’appuyant sur un certain nombre de témoignages recueillis auprès d’expatriés, de responsables du siège et d’employés palestiniensEntretiens effectués en décembre 2010, janvier et février 2011., on peut émettre une double hypothèse. D’une part, l’équipe gazaouie, recrutée à l’époque où le Fatah exerçait le pouvoir à Gaza et majoritairement composée de personnes proches du Fatah et de partis de la gauche nationaliste palestinienne, a probablement exercé une influence sur la façon dont les équipes internationales ont appréhendé les événements de la bande de Gaza. D’autre part, on peut supposer qu’une telle influence s’exerce d’autant mieux qu’elle porte sur des expatriés et des responsables du projet, y compris au siège, ayant pour la plupart intégré les représentations dominantes véhiculées sur les acteurs politiques palestiniens, et qui accordent au Fatah une légitimité supérieure à celle du Hamas. Cette proximité idéologique, sans doute implicite, ainsi que le biais de la grille utilisée par MSF pour comprendre le contexte peuvent expliquer à nos yeux la difficulté de l’association à modifier sa lecture de la situation à Gaza.
Pour MSF, il s’agit de ne pas se laisser dicter quoi que ce soit en matière de comportement ou en ce qui concerne ses activités par un gouvernement perçu comme cherchant à imposer sa politique de santé et sa vision de la société. Cette posture relève tantôt d’une volonté politique de limiter la collaboration avec le Hamas, tantôt de la difficulté de l’association à saisir les profondes mutations qui secouent le territoire. MSF donne l’impression aux autorités en place d’être hors de leur portée, quand celles-ci ont grandement besoin d’organiser les services à la population et d’asseoir leur légitimité.
Le Hamas a donc finalement imposé à MSF de négocier avec lui son espace de travail dans la bande de Gaza. Les négociations ont porté sur un ensemble de points tant médicaux qu’administratifs. Ce sont des questions d’une tout autre nature qui ont défini les relations de MSF avec Israël après la défaite politique et militaire du Fatah.
Israël et la gestion humanitaire de la bande de Gaza
Israël a évacué colons et militaires de la bande de Gaza en août 2005, lors d’un retrait unilatéral non négocié. Mais il ne continue pas moins d’en contrôler toutes les entrées et sorties. Le maintien des activités de MSF dépend donc très largement de la qualité de sa relation avec les autorités israéliennes. Cela est d’autant plus vrai depuis l’instauration du blocus de Gaza, dans le cadre duquel seuls certains produits de première nécessité et l’aide humanitaire sont autorisés à entrer sur le territoire. Dans les faits cependant, il arrive que des commandes de matériel ou de médicaments restent bloquées, quelques jours ou plusieurs semaines, dès lors que l’ensemble des autorisations n’a pas été réuni, que le contenu des caisses contrevient au règlement, par ailleurs très flou, de l’embargo, ou même sans raison apparente.
L’offensive israélienne « Plomb durci » révèle de façon exemplaire le rôle qu’Israël entend faire jouer à l’aide humanitaire à Gaza et apporte ainsi un éclairage sur les relations entre MSF et l’État hébreu, soucieux d’afficher des préoccupations humanitaires. Ainsi, en réponse à la proposition française d’une « trêve de quarante-huit heures pour motifs humanitaires » le 1erjanvier 2009, Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères, explique, alors que le bilan fait déjà état de plus de 400 morts du côté palestinien, que « les camions d’aide passent les points de contrôle » et par conséquent qu’« il n’y a pas de crise humanitaire à Gaza et […] pas besoin de trêve ». Lorsque le 31 mai 2010 l’armée israélienne donne l’assaut à une flottille composée de six navires transportant de l’aide humanitaire à destination de Gaza, l’ambassadeur adjoint d’Israël aux Nations unies, à qui revient la tâche de défendre le blocus, adopte également cette position – permettant ainsi de minimiser les conséquences de la « stratégie de garrottage » adoptée par les gouvernements israéliens successifs.Rony BRAUMAN, « La “flottille de la liberté” : humanitaire ou politique ? », 4 juin 2010, http://www.msf-crash.org.
Interrogé au début de l’année 2011 sur l’espace de travail laissé à MSF pendant l’opération « Plomb durci », le responsable des relations avec les ONG au sein de l’unité du ministère israélien de la Défense chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les Territoires (Cogat) justifie rétrospectivement les autorisations fournies à l’organisation en expliquant : « Durant l’opération “Plomb durci”, nous avons autorisé tous les acteurs humanitaires qui fournissaient une réelle assistance humanitaire à entrer. On a autorisé MSF parce que l’on savait que cela serait utile. MSF nous a demandé s’ils pouvaient faire entrer l’hôpital sous tentes, les médicaments et les travailleurs humanitaires. Et rien n’est plus humanitaire que l’aide médicale. Si les mouvements sont coordonnés avec le Bureau de liaison israélien (DCL) et que vous donnez de l’aide médicale, pourquoi l’interdire ? Certaines ONG ont voulu entrer pour voir, pas pour aider, et c’est pour ça qu’on leur a refusé l’accès. »10. Entretien réalisé à Tel-Aviv le 16 janvier 2011.
MSF constate, comme d’autres organisations humanitaires, que les difficultés de passage de l’aide vers Gaza se sont accentuées après la mise en place de l’embargo. Pour l’organisation, l’année 2007 avait commencé avant même la « bataille de Gaza » par un incident ayant eu des conséquences sur son espace de travail. Le 17 avril, un employé palestinien de Gaza se fait arrêter pour avoir participé à un « complot » contre Israël lors d’un passage à Jérusalem, où il s’était rendu pour une réunion avec l’équipe de coordination. Cette arrestation, puis la condamnation de l’employé, au-delà des conséquences humaines dramatiques, ont de nombreuses répercussions pour l’organisation. Des rumeurs selon lesquelles MSF aurait trahi son employé et l’aurait livré aux Israéliens se propagent à Gaza. En Israël, l’association est victime d’une courte mais intense campagne de presse, dans laquelle elle est accusée de favoriser le terrorisme11. Voir notamment « Doctors without borders gave terrorist entry pass to Israel », 17 mai 2007, http://www.israelnationalnews.com.. Pour les autorités de Tel-Aviv, cet épisode représente une aubaine : la crédibilité de MSF est affaiblie ; les restrictions de mouvements entre la Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza peuvent être justifiées par le risque d’attentat. Pourtant, l’association reste en mesure de développer ses activités, à tel point que certaines organisations, dont les autorisations de passage au poste-frontière d’ErezSeul point de passage pour les personnes séparant Israël de la bande de Gaza. sont délivrées de manière plus aléatoire, pensent qu’elle bénéficie d’un traitement de faveur. Une coalition d’organisations d’aide œuvrant dans les Territoires palestiniens (AIDA) publie ainsi un communiqué en décembre 2008 dans lequel elle fait état des différences de traitement entre organisations : « En conséquence, le recours à des arguments “sécuritaires” pour restreindre l’accès au personnel des ONG à Erez pendant plus de vingt jours consécutifs depuis la première semaine de novembre n’est pas cohérent avec des réponses sécuritaires précédentes. Plus encore, l’octroi de permissions d’entrée aux employés de MSF, des Nations unies et du CICR n’est pas non plus cohérent avec l’argument “sécuritaire”. »Traduit de l’anglais. AIDA, « Unprecedented denial of humanitarian access to Gaza must not continue say International Agencies », http://www.kvinnatillkvinna.se.
En revanche, alors que MSF n’a que très peu de capacité de négociation avec Israël, elle semble se contenter de cet état de fait. Par exemple, elle ne revendique pas un accès plus important à Jérusalem pour le personnel de Gaza, et vice versa, dans un conflit où l’accès et la libre circulation des personnes et des biens sont pourtant de véritables enjeux.
Dans ces conditions, comment échapper au rôle d’auxiliaire de santé de la puissance occupante ? La transformation des ONG en supplétifs de l’occupation est explicitement prise en compte dès 2002 par le président de la section française de MSF : « L’aide humanitaire internationale, qui ne jouait jusqu’à présent qu’un rôle périphérique dans ce conflit, risque de se voir attribuer un rôle d’auxiliaire de gardien de prison au cœur d’un impitoyable système de domination et de ségrégation. Après la capacité de résistance de la population palestinienne, c’est maintenant l’indépendance des secouristes étrangers qui va être mise à l’épreuve. »« Chroniques palestiniennes. Dans les nerfs de la guerre », rapport, supplément à Messages, le journal des MSF, juillet 2002, 63 pages.
Des intellectuels de gauche israéliens questionnent également le rôle de l’aide humanitaire alors même que près de quatre cinquièmes de la population gazaouie en dépendOCHA, « Special focus – occupied Palestinian Territories », décembre 2007, dans la mesure où, selon eux, cette aide « suspend la catastrophe » et dégage Israël de son devoir de trouver une issue au conflit. Pour Adi Ophir et Arielle Azoulay, « l’intervention [des organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme] est une extension du dispositif du pouvoir, une de ses branches, celle qui est responsable de la “suspension de la catastrophe” et de la création des conditions d’un “désastre chronique”»Arielle AZOULAY et Adi OPHIR, « The ruling apparatus of control in the Occupied Territories », actes de colloque, avril 2004, Van Leer Institute, Jérusalem.. « C’est comme un rendez-vous chez la diététicienne. Les Palestiniens vont maigrir comme il faut mais ils ne mourront pas », illustrait Dov Weissglas, un conseiller du Premier ministre Ehud Olmert au début de l’année 2006, à la suite de la victoire du Hamas aux élections législatives en janvier, pour justifier les mesures d’embargo« As the Hamas team laughs », Haaretz, 19 février 2006.. Certains Palestiniens critiquent également la présence des ONG dans les territoires occupés, qui entraîne selon eux une « normalisation » de la situation et qui libère Israël de ses responsabilités de puissance occupante. Notons toutefois que cette réflexion sur l’éventuelle complicité des humanitaires avec un système oppressif n’a rien de spécifique aux Territoires palestiniens.
Il est des contextes qui échappent difficilement à la polarisation et les Territoires palestiniens en sont un. Ne travaillant qu’auprès des populations palestiniennes et pas en Israël, ce qui lui est parfois reproché dans les médias israéliens, MSF s’est retrouvée de façon récurrente confrontée à la question de sa « neutralité » dans le conflit israélo-palestinien. Celle-ci s’est également posée dans le cadre de ses rapports avec les deux factions politiques palestiniennes, la violente passation de pouvoir entre le Fatah et le Hamas à Gaza ayant bouleversé ses repères.
Le déséquilibre des forces en présence, la forte couverture médiatique du conflit, qui encourage la prise de parole publique, la proximité des expatriés avec les employés palestiniens tout comme leur exposition quotidienne dans le conflit rendent difficile la neutralité politique et favorisent l’empathie des équipes expatriées avec les Palestiniens, renvoyés à leur statut de victimes. Dès 2001, la question était évoquée en conseil d’administration : « Ils sont plusieurs [de l’équipe terrain] à demander pourquoi leur activité de témoignage n’est pas relayée par un discours public de MSF dénonçant la politique et les pratiques israéliennes dans les Territoires palestiniens. » C’est à la suite de ces demandes émanant du terrain qu’ont été publiées en 2002 les « Chroniques palestiniennes»« Chroniques palestiniennes. Dans les nerfs de la guerre », loc. cit.. Présentées comme « le témoignage de la réalité quotidienne d’une population prise dans la guerre et soumise à des souffrances le plus souvent ignorées », ces chroniques représentent le temps fort de l’activité de témoignage de MSF dans les Territoires occupés et un moyen d’apaiser les tensions entre les équipes de terrain et le siège.
Les débats indiquent qu’il y a un « surinvestissement de l’activité de “témoignage” par plusieurs membres des équipes de terrain»Compte rendu du conseil d’administration du 27 avril 2001.. Témoigner des conditions de vie des Palestiniens et des violences dont ils sont victimes devient parfois la finalité des équipes, qui attendent de MSF une prise de position publique. L’association peut comprendre que l’exigence de « neutralité » atteint ses limites quand, comme le rapporte son président, « l’occupation militaire s’accompagne d’une telle violence contre les habitants des Territoires, le rapport de forces est tellement déséquilibré qu’il y a une certaine complaisance à l’égard du plus faible même quand il commet des crimes».Compte rendu du conseil d’administration du 26 avril 2002.
Quelques années plus tard, la question est de nouveau posée par les responsables du programme dans des termes très similaires : « Est-ce que nous sommes neutres ? Nous n’attendons de personne qu’il soit complètement neutre de manière individuelle, à cause de la proximité avec les Palestiniens et du déséquilibre fréquent du conflit, cependant l’organisation elle-même doit utiliser un langage neutre. Ce que nous attendons des expatriés (et du personnel national, dans la mesure du possible) c’est de faire un effort afin de maintenir un certain degré d’objectivité, d’éviter un langage biaisé et critique et de rester factuels. »Document interne, 2007.
Car la mission de MSF à Gaza s’est construite dans un quasi-monopole relationnel avec le Fatah. L’adhésion d’une partie des équipes au programme laïc et national du parti de Yasser Arafat, le recrutement d’employés idéologiquement proches du Fatah ou des partis de gauche, l’intervention initialement pensée dans le cadre d’une opposition entre Palestiniens et Israéliens – et non entre deux factions palestiniennes – ont concouru à faire de la transition politique à Gaza un passage périlleux pour MSF.
***
Birmanie. Contre la dictature, tout contre
FIONA TERRYL’auteur souhaite remercier Richard Horsey pour ses commentaires sur la première version de ce chapitre.
Traduit de l’anglais par Ève Dayre
La question de savoir si les organisations internationales humanitaires doivent travailler en Birmanie, État répressif et autoritaire, divise et suscite des débats passionnés. De nombreux groupes d’exilés et leurs sympathisants – principalement basés en Thaïlande, aux États-Unis et au Royaume-Uni – affirment qu’il est impossible d’apporter de l’aide dans le pays sans renforcer le régime militaire. Pourtant, les organisations humanitaires qui ont choisi de travailler dans le pays soutiennent que l’aide peut être apportée de manière responsable et parvenir à ceux qui en ont besoin sans que la junte en tire un bénéfice indu. Le débat est acerbe, mettant en évidence les arguments contestables utilisés par les uns et les autres : les groupes d’exilés amplifient les excès du régime et les bénéfices qu’il tire de l’aide internationale, tandis que les organisations « de l’intérieur » minimisent en réaction les contraintes que leur impose le régime militaire.

L’expérience de MSF en Birmanie épouse parfaitement les contours de la polémique. La section française de MSF s’est retirée du pays en 2006 au terme de cinq années d’efforts pour monter un programme de traitement efficace du paludisme dans les régions frontalières de la Thaïlande en proie à des conflits. À cette occasion, elle dénonça publiquement les « conditions inacceptables imposées par les autorités », qui, si elle s’y soumettait, ne feraient de MSF « qu’un sous-traitant technique assujetti aux priorités politiques de la junte »« Empêchée de travailler, la section française de MSF se retire du Myanmar (Birmanie) », communiqué de presse de MSF, Paris, 30 mars 2006. À l’autre bout du spectre, la section hollandaise de MSF a mis en œuvre le programme médical le plus important de tous les organismes de secours présents en Birmanie. S’appuyant sur des dispensaires présents dans quatre États et divisions du pays, il bénéficie à deux fois plus de patients vivant avec le VIH/sida que le programme du gouvernement et de toutes les autres organisations d’aide réunisEn 2008, MSF-Hollande et MSF-Suisse traitaient respectivement 10 000 et 1 000 patients séropositifs avec des antirétroviraux, contre 4 000 pour le gouvernement et les autres agences réunis. Cf. « A preven- table fate : the failure of ART scale-up in Myanmar », Amsterdam : MSF, novembre 2008, p. 1.. Entre ces deux extrêmes, la section suisse de MSF est tenaillée par le doute. Ses projets n’ont cessé d’être entravés depuis son arrivée en 1999, mais elle a choisi de défier discrètement les restrictions gouvernementales et de persévérer.
Ce qui se murmure dans le milieu de l’aide à Rangoon ainsi qu’au sein de MSF pour expliquer comment la section hollandaise parvient à intervenir dans cet État autoritaire est que « le chef de mission de MSF-Hollande joue au golf avec les généraux ». Comme toute bonne rumeur, celle-ci est en partie fondée. N’arrivant pas à obtenir un rendez-vous avec le commandant régional pour discuter de l’ouverture d’un dispensaire dans une région minière de l’État de Kachin, le chef de mission s’est rendu au club de golf de Myitkyina où jouait le commandant. Ce dernier répondit favorablement à la requête et MSF reçut l’autorisation d’ouvrir le dispensaire. Sur le ton moralisateur souvent de mise dans le monde de l’aide, y compris chez MSF, l’anecdote a fini par se transformer en un mythe selon lequel le chef de mission – resté en poste quinze ans, un fait sans précédent dans l’histoire de MSF – entretenait des relations privilégiées avec certains généraux au point d’être considéré comme un « collaborateur ». L’intéressé montra peu d’enthousiasme à démentir les rumeurs, se tenant à l’écart des débats sur les activités, rejetant les propositions de communication publique qu’il jugeait critiques à l’égard du régime, et niant publiquement les difficultés liées à l’intervention en Birmanie.
Cependant, le fait qu’une partie de golf supposée puisse devenir synonyme de « collaboration » est révélateur du malaise éprouvé par toutes les sections de MSF dans le contexte birman. Après tout, si jouer au golf peut permettre de garantir de bonnes relations avec un commandant qui a le pouvoir de décider ce que MSF peut ou ne peut pas faire pour la population, le prix à payer apparaît modique. Il en irait différemment si le commandant demandait à MSF de lui acheter ses clubs de golf ou de lui renouveler sa carte de membre. Mais plutôt que d’analyser la manière avec laquelle MSF-Hollande a monté cet ambitieux programme dans un contexte aussi difficile et de discuter des méthodes employées, toutes les sections de MSF, y compris le siège de la section hollandaise à Amsterdam, ont préféré s’en tenir à la fiction d’une relation privilégiée malsaine, avant de fermer les yeux.
Ce chapitre revient sur les choix politiques des trois sections de MSF en réaction aux contraintes et aux dilemmes rencontrés en Birmanie. Comment deux sections appartenant à la même organisation ont-elles pu parvenir à des conclusions si radicalement opposées quant à la possibilité de travailler dans un pays ? Quelles ont été les concessions consenties et les stratégies ayant conduit à de telles différences d’engagement auprès des populations birmanes ?
Le choix d’intervenir
Ne disposant pas de mandat officiel définissant les types de situations d’urgence auxquels elle doit répondre, MSF choisit librement où proposer – ou non – son assistance médicale humanitaire.
La section française de MSF commença à travailler au début de l’année 1984 auprès des réfugiés du groupe ethnique des Karens en Thaïlande. Jusqu’aux années 2000, elle apporte une assistance médicale dans les villages et les camps situés près de la frontière, menant des opérations clandestines dans le territoire tenu par les rebelles du KNU (Karen National Union, Union nationale karen). Bien que le contrôle des camps de réfugiés par des mouvements politiques ait parfois été source de malaise, il semblait moins problématique d’aider les victimes de la junte à l’extérieur du pays plutôt qu’à l’intérieur. Aussi, lorsque la section hollandaise demanda en 1989 l’autorisation d’entrer en Birmanie, elle se heurta à un grand scepticisme au sein de l’organisation.
Les principaux objectifs affichés par la section hollandaise étaient d’évaluer les besoins médicaux dans les régions frontalières en proie à des conflits armés, et de témoigner de ce qui s’y passait« MSF policy for the near future », Amsterdam : document interne, non daté (mais d’après le contenu, vers 1993).. L’armée birmane menait alors de brutales campagnes contre-insurrectionnelles contre des minorités ethniques dans plusieurs États frontaliers bordant la Thaïlande, le Laos et la Chine. Celles-ci consistaient à priver les rebelles de tout soutien en forçant les villageois à s’installer dans des zones contrôlées par le gouvernement et en rasant leurs maisons et leurs champs. Des récits de viols, d’enrôlements et de travaux forcés, ainsi que d’exécutions sommaires circulaient parmi les 140 000 réfugiés qui s’étaient enfuis en Thaïlande. Les épreuves endurées par la population de l’État de Kachin, limitrophe de la Chine, où la section hollandaise souhaitait se rendre à l’origine étaient pour leur part moins connues. Prendre publiquement la parole pour dénoncer les causes des souffrances constituait une motivation importante de l’association.
L’État de Rakhine, dans l’Ouest, abritant les Rohingyas musulmans et de plus petites minorités hindoues, suscite également l’intérêt de l’association. Privées de citoyenneté, ces minorités sont soumises à des lois draconiennes régissant le moindre aspect de leur vie, de l’âge auquel ils peuvent se marier jusqu’à l’autorisation de se déplacer en dehors de leur village, entravant leur accès à des services médicaux. Contrairement aux Karens et aux Môns réfugiés en Thaïlande, la plupart des Rohingyas ayant fui la répression n’ont pas trouvé asile dans un pays voisin. Ils furent refoulés du Bangladesh une première fois en 1978, puis une seconde fois en 1994-1995. À leur retour en Birmanie, ils se sont de nouveau trouvés confrontés à la répression et à la brutalité des militaires qu’ils avaient fuis, dans une situation aggravée pour beaucoup par la confiscation de leurs terres et de leurs biens par le gouvernement en leur absence. Les sections hollandaise et française de MSF travaillèrent toutes deux auprès des réfugiés au Bangladesh et dénoncèrent publiquement leur refoulement vers la Birmanie, ainsi que la complicité du HCR dans ce processus.Cf. par exemple, « Les Rohingyas : rapatriés de force en Birmanie », MSF, Paris, 22 septembre 1994.
Outre les conflits frontaliers et la répression généralisée, le peuple birman vit dans un état de pauvreté absolue provoqué par l’incompétence de la junte et ses choix budgétaires. Ceux-ci privilégient le maintien du pouvoir en place et de sa capacité militaire à combattre ses ennemis, aussi bien réels qu’imaginaires, de l’intérieur comme de l’extérieur. Le budget dédié au secteur de la santé ne représente que 0,3 % du PIB. Des millions de personnes n’ont pas accès à des soins abordables et efficaces et sont, du coup, exposées aux conséquences mortelles de maladies évitables et curables telles que le paludisme. En outre, la Birmanie connaît l’une des pires épidémies de VIH d’Asie et l’une des prévalences de la tuberculose parmi les plus alarmantes du monde. Le recours à des traitements antituberculeux inadéquats entraîne de multiples pharmacorésistances, dont les conséquences peuvent à terme se faire sentir bien au-delà de ses frontières.
Les raisons ne manquent donc pas, sur le plan médical, pour justifier la volonté de MSF de travailler en Birmanie. Bien que le pays ait rarement connu de situation d’urgence aiguë avec un risque de mort imminente pour un grand nombre de personnes (à l’exception du passage du cyclone Nargis en 2008), l’« urgence chronique » dont souffre sa population est généralisée. Dès lors, le problème que pose l’intervention n’est pas tant que faire ?, mais plutôt comment faire ? Comment MSF peut-elle s’assurer qu’en aidant les victimes elle ne renforce pas sans le vouloir la main de leur oppresseur ?
Entrer dans le pays
Dès le départ, la section hollandaise de MSF se heurta à des obstacles de taille dans ses efforts pour, littéralement, mettre le pied en Birmanie. Elle déposa une première demande en 1989 à l’occasion d’une légère ouverture du régime. Largement isolationniste, celui-ci avait jusqu’alors limité la présence des organismes de secours à une poignée d’agences de l’ONU et au CICR. En réaction aux sanctions décidées par de nombreux gouvernements occidentaux et à la condamnation internationale qui suivit la répression des manifestations prodémocratiques en 1988, le régime avait pris des mesures d’apaisement, dont celle d’entrouvrir la porte à des ONG internationales afin d’améliorer son image. Toutefois, si le régime militaire était disposé à accepter une aide étrangère, aucun volontaire international de MSF n’était admis sur le sol birman – une position que la junte tint à nouveau lors de la réponse aux conséquences du cyclone Nargis en 2008. Mais c’était une condition que MSF ne pouvait pas accepter, estimant qu’il lui serait impossible d’évaluer les besoins ou de surveiller la distribution des secours sans la présence d’employés étrangers. Il a fallu deux ans de négociations avant qu’un employé international soit autorisé à séjourner dans la capitale d’alors, Rangoon. Il y arriva en janvier 1992.
Pour prendre ses distances par rapport aux activités de MSF en Thaïlande et au Bangladesh, MSF-Hollande adopta la version néerlandaise de son nom, Artzen Zonder Grenzen (AZG) – nom sous lequel elle est encore connue aujourd’hui (et que nous garderons dans ce chapitre). Par ailleurs, elle entra en Birmanie sous les auspices de l’Unicef, en ouvrant une antenne dans le même bâtiment et en se servant de la réputation de l’agence des Nations unies comme référenceRapport d’activité février-mars 1992, Rangoon.. Même si le nom « AZG » continue actuellement de faire sourciller au sein du mouvement MSF, c’était un petit prix à payer si l’on estime que c’est effectivement la différence de nom qui protégea AZG de la méfiance tatillonne à laquelle fut soumise MSF-France quand elle sollicita à son tour l’autorisation de travailler dans le pays en 1995 : le ministre de la Santé souhaitait accéder à la demande, mais la hiérarchie militaire la rejeta, en raison des activités clandestines de MSF et de ses liens avec le KNU.
Il fallut attendre une bien plus grande ouverture du régime vis-à-vis de l’extérieur pour que MSF-France puisse entrer en Birmanie, en 2000. Pour sa part, MSF-Suisse chercha également à évaluer ses chances de travailler en Birmanie et entreprit une mission exploratoire en 1998 à l’invitation du ministère de la Santé. Elle bénéficia d’une politique d’ouverture sans précédent – quoique relative – du régime à l’égard des organisations de secours internationales initiée par le numéro trois du régime – et futur Premier ministre –, Khin Nyunt. La junte autorisa le CICR à inspecter ses prisons, ses camps de travail et certaines zones frontalières, tandis que AZG et d’autres ONG élargirent leurs opérations. La lune de miel ne durera pas.
Négocier les activités humanitaires
Une fois dans le pays, toutes les sections de MSF sont contraintes à faire des concessions dans trois domaines essentiels : choisir où et avec qui travailler ; contrôler l’aide apportée; et s’exprimer publiquement sur les causes sous-jacentes des problèmes médicaux du pays.
Indépendance de choix. Le climat de méfiance auquel AZG fut confrontée à son arrivée en 1992 ne présageait rien de bon quant à sa liberté de mouvement ou son libre choix de population cible. Pendant la longue période de négociations qui précéda son entrée dans le pays, l’attention d’AZG était concentrée sur le sort des Rohingyas dans l’État de Rakhine, qui avaient été 250 000 à fuir vers le Bangladesh, à la suite de la répression gouvernementale de 1991 et 1992. Mais cette priorité n’était pas partagée par le gouvernement, qui orienta AZG vers le township de Shwepyithar, en périphérie de Rangoon, afin qu’elle y dispense des soins de santé. L’association accepta cette proposition pour des raisons « stratégiques », la considérant comme un « premier pas » qui permettrait de nouer des relations de confiance avec les dirigeants et de favoriser des ouvertures dans des régions où les besoins étaient plus pressants.
AZG eut rapidement connaissance d’un township encore plus déshérité, Hlaing Thayar, bâti sur des rizières de l’autre côté du fleuve qui traverse Rangoon. Décidée à tester, au moins au niveau local, sa capacité effective à aider en priorité ceux qui en avaient le plus besoin, elle demanda la permission d’inclure Hlaing Thayar dans une enquête nutritionnelle prévue pour Shwepyithar en juillet 1992. Dans un geste de bon augure quant au pouvoir de négociation d’AZG, le gouvernement accepta. Par la suite, les taux élevés de malnutrition constatés chez les enfants convainquirent les autorités de laisser AZG assister les deux townships.
Reste que ces townships n’étaient pas des banlieues ordinaires de Rangoon, mais des zones où les résidents de douzaines de bidonvilles avaient été réinstallés de force après que le régime eut incendié leurs maisons suite au soulèvement étudiant de 1988. Les bidonvilles avaient non seulement fourni un vivier de manifestants, mais également offert à ces derniers une sorte de refuge lorsqu’ils tentaient d’échapper à la police. Peu soucieux du bien-être de leurs occupants, le gouvernement souhaita les détruire. Quelque 50 000 personnes furent déplacées vers Hlaing Thayar en 1989, chiffre qui grimpa à 164 000 en 1995« Urban displaced program Shwepyithar and Hlaingthayar townships, Yangon division, Burma (Myanmar). Janvier 1992-juillet 1995 », MSF- Hollande, 1996, p. 6.. AZG ne prit pas pleinement conscience du piège inhérent aux situations de réinstallation forcée dans lequel elle s’enfermait. En apportant une aide médicale aux déplacés, AZG soulageait certainement leurs souffrances. Mais, par sa présence et sa participation au dispositif gouvernemental, elle cautionnait tacitement la politique de réinstallation forcée, d’autant que celle-ci s’est poursuivie malgré la présence de l’organisation.
La section hollandaise ne manqua pas d’exprimer ses inquiétudes face aux réinstallations forcées. L’organisation aborda la question des implications sanitaires de ces dernières avec ses interlocuteurs du gouvernement et fit visiter les townships aux bailleurs de fonds pour dévoiler les pratiques du régime« Burma (Myanmar). Evaluation of the MSF-Holland programs », Ams- terdam, 1998, p. 24.. Mais comme il est expliqué plus loin, les pressions destinées à modifier les agissements de la junte, surtout en provenance de l’extérieur, n’avaient qu’un effet extrêmement limité. Si AZG avait su s’extraire du contrôle gouvernemental et construire de bonnes relations avec la population, peut-être sa présence aurait-elle été plus facilement justifiable. Signe des restrictions imposées, une évaluation du programme datant de 1996 recommanda la tenue de discussions avec la hiérarchie du ministère de la Santé afin de déterminer si un employé de MSF, confronté à une urgence médicale alors qu’aucun fonctionnaire médecin ou infirmière n’était présent à l’hôpital, était autorisé à sauver une vie. « Ou [devait-il] se contenter de noter ce qu’il [observait] et laisser le patient mourir ? »« Urban displaced program », op. cit., p. 19.
AZG ne perdit pas de vue sa population cible, et sa persévérance fut récompensée quand on l’autorisa à visiter l’État de Rakhine en avril 1993. Elle ne put cependant y accéder de façon indépendante et dut se résoudre à être accompagnée par des officiels du ministère de la Santé ainsi que par une escorte policière lorsqu’elle se rendit dans les zones les plus reculées. AZG voulut travailler dans les townships à dominante musulmane d’où avait fui la majorité des personnes qui s’étaient réfugiées au Bangladesh, et où beaucoup retournaient. Mais là encore elle dut céder concernant le choix de son implantation. Elle ne put faire autrement que de s’installer dans la capitale de l’État, Sittwe. Le paludisme étant la principale cause de morbidité dans l’État, AZG lança un programme de lutte contre cette maladie qui incluait la formation de microscopistes pour le diagnostic, des activités prophylactiques et des traitements. AZG fournissait aussi des consultations mobiles dans neuf townships, ce qui permit à ses équipes de mettre en lumière quelques-uns des problèmes de discrimination et de travail forcé que subissaient les habitants de la région. Pourtant, selon un des coordinateurs du projet, l’objectif premier d’AZG, qui était de témoigner du sort des Rohingyas, fut bientôt abandonné au profit d’une vision médicale. « Même si durant tout ce temps nous avons sillonné l’État de Rakhine, l’accent était mis sur des activités médicales et de laboratoire de haute qualité, et très peu semble avoir été rapporté ou écrit sur l’aspect témoignage ou politique de la mission. »« Background of MSF-H Rakhine State project, Myanmar, 1994-1999 », MSF-Hollande, Maungdaw, mai 1999, p. 12.
Il fallut encore attendre quatre ans pour qu’AZG soit finalement autorisée à établir une base dans l’enclave musulmane de Maungdaw, en janvier 1998.
Une tentative visant à étendre les activités aux populations touchées par les conflits dans l’État de Kachin échoua à la dernière minute en 1995, quand AZG omit d’offrir un cadeau personnel au commandant local comme l’aurait fait n’importe quelle ONG. Mais, à cette époque, les entraves sur le front politique commençaient à être contrebalancées par des succès inattendus sur le front médical. AZG réorienta sa stratégie et renonça à la tactique du « premier pas » destinée à gagner la confiance des autorités. À la place, elle s’orienta vers une « diplomatie médicale », consistant à utiliser son expertise et son volume opérationnel afin de renforcer sa position de négociation. La percée se produisit fin 1995 lorsque AZG reçut la permission semi-officielle d’effectuer, avec des employés du ministère de la Santé, une étude sur la résistance aux antipaludéens dans l’État de Rakhine. La publication, qui faisait état de l’inefficacité du protocole de traitement nationalCette étude a été publiée dans une revue internationale sous le titre : F. M. SMITHUIS, F. MONTI, M. GRUNDI, A. ZAW OO, T. T. KYAW, O. PHE et N.J. WHITE, « In vivo sensitivity of Plasmodium falciparum to chloroquine, sulphadoxine-pyrimethamine, and mefloquine in Rakhine State, Wes- tern Myanmar », Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, n° 91, 1997, p. 468-472., rendit furieux le ministre de la Santé. Mais l’association avait entretemps reçu un feu vert officieux au niveau local pour modifier le traitement dans l’État de Rakhine, en remplaçant la chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine par l’association méfloquine-artésunate. Quand un médecin issu du civil fut nommé ministre adjoint de la Santé en 2001, le protocole thérapeutique changea officiellement. Au moyen de sa « diplomatie médicale », la section hollandaise participa également grandement à briser le tabou entourant l’épidémie croissante de VIH/ sida en Birmanie. Elle fut autorisée à démarrer des activités d’éducation à la santé et de distribution de préservatifs dans le township de Hlaing Thayar. Poussant son avantage, AZG prit ouvertement en charge les personnes vivant avec le sida, traitant les infections opportunistes tout en luttant contre la stigmatisation des séropositifs. Puis, en août 2003, AZG fut pionnière dans le traitement par antirétroviraux en Birmanie. Elle remit ainsi en question le dogme qui prévalait parmi les organisations médicales selon lequel les capacités dans le pays étaient insuffisantes pour se permettre autre chose que de l’éducation à la santé et du « marketing social » de préservatifs« Burma trip report, 26 novembre-5 décembre 2002 », document de travail.. En l’espace de cinq ans, AZG a fourni ces médicaments salvateurs à plus de 10 000 patients.
Ce changement d’orientation médicale entraîna une modification de la population ciblée par AZG, qui passa des victimes de la répression ou des conflits armés aux victimes de maladies mortelles. Les centres de soins antipaludéens, initialement considérés comme des « projets alibis » pour accéder à certaines régions, se virent adjoindre des programmes de traitement des infections sexuellement transmissibles (IST), du VIH et de la tuberculose, qui devinrent les objectifs mêmes de l’intervention. À partir de la fin des années 1990, les zones d’implantation des projets furent sélectionnées en fonction de la vulnérabilité des habitants aux maladies infectieuses : des cliniques spécialisées ouvrirent près des mines de jade de l’État de Kachin afin de réduire la transmission des IST, dont le VIH, parmi la population itinérante, les travailleurs sexuels et les usagers de drogue par voie intraveineuse. AZG entama des activités de réduction des risques et d’échange de seringues, et renforça l’éducation à la santé sur les causes et les conséquences de l’infection par le VIH. Des projets similaires furent lancés dans l’État de Shan. Dès lors que les brutalités militaires n’étaient plus identifiées comme responsables de tous les maux, le régime, inquiet de la propagation du virus, fit moins de difficultés quand AZG demanda l’autorisation d’ouvrir des dispensaires dans de nouvelles régions. Cette réorientation se révéla être un choix politique habile qui permit une augmentation spectaculaire du nombre de personnes aidées par AZG.
Lors de son arrivée dans le pays en 1999, la section suisse de MSF dut elle aussi faire des concessions quant à son choix d’implantation. Bien qu’invoquant une raison médicale – des taux de résistance aux antipaludéens parmi les plus élevés au monde – pour justifier son souhait d’intervenir dans les trois États de Kayin, Môn et Kayah qui bordent la Thaïlande, MSF-Suisse dut commencer à travailler dans la région côtière du district de Tanintharyi. « Dès le début, nous avons dû faire des concessions et accepter de sacrifier notre indépendance, notre liberté de choisir où nous voulions travailler, se rappelle le premier chef de mission, Patrick Wieland. Nous pensions que peu à peu nous gagnerions la confiance des autorités locales pour atteindre progressivement les régions frontalières. » Mais cette stratégie ne fonctionna qu’en partie. « Nous avons gagné un peu de terrain en direction de la frontière avec les cliniques mobiles “malaria”, mais nous n’avons jamais pu implanter un dispensaire fixe là où on le voulait. Nous nous sommes rapprochés au maximum et des gens venaient à nous, ils parcouraient parfois quarante kilomètres pour consulter dans nos cliniques. »Correspondance e-mail entre Patrick Wieland et Jean-Clément Cabrol, 31 août 2007.
Pendant que le pays continuait de s’ouvrir sous l’influence de Khin Nyunt, MSF-Suisse obtint le droit d’accéder à l’État de Kayah, ce qu’aucune organisation d’aide n’avait obtenu auparavant, y compris le CICR, à l’exception d’une simple visite de la prison de l’État. L’association ouvrit une clinique au nord de la capitale, Loikaw, en mars 2004. Au regard des frustrations et des contraintes quotidiennes intrinsèques au travail en Birmanie, le simple fait d’établir une base faisait figure d’avancée significative dans l’ouverture d’un « espace humanitaire ». Et cela même si MSF-Suisse se vit empêchée d’atteindre les zones de conflit où elle estimait – d’après les rapports envoyés par les agences basées à la frontière – que des milliers de civils avaient besoin d’aide. Elle dut se satisfaire de faire fonctionner un centre de santé primaire où les personnes déplacées par l’armée pouvaient venir et recevoir un traitement. Et, depuis cette base, MSF-Suisse ne cessa de réclamer une autorisation pour que ses équipes mobiles puissent accéder aux zones de conflit de basse intensité, par l’intermédiaire de Karuna, une ONG locale.
La section française, quand elle démarra ses programmes, en 2001, ne fut pas confrontée au même dilemme que MSF-Suisse et MSF-Hollande, qui avaient été contraintes de commencer à travailler dans une autre région que celle qu’elles avaient proposée. Elle ouvrit un projet visant à améliorer le diagnostic et le traitement du paludisme, d’abord dans l’État de Môn puis dans celui de Kayin, avec des cliniques fixes et des consultations mobiles, et repoussa elle aussi les limites des zones autorisées, souvent par bateau. Dès la première année, MSF améliora considérablement la prise en charge des personnes atteintes de paludisme : le taux de mortalité chez les patients hospitalisés à Mudon fut divisé par deux entre juillet 2001 et juin 2002, et l’hôpital n’enregistra aucun décès pour cause de paludisme au cours du second semestre 2002Rapport d’activité 2002, objectifs 2003, MSF-France, Paris, 2002, p. 2.. De surcroît, l’approche du « premier pas » porta ses fruits dans une certaine mesure, puisque l’intervention de MSF-France s’étendait à de nouveaux territoires comme le township de Ye et l’État de Kayin. Dans les régions nouvellement accessibles, les 7 500 consultations données entre avril et août 2004 dépassèrent les prévisions pour l’année entière« Aperçu du projet Birmanie 2005 », MSF-France, 2004, p. 5.. Cela persuada MSF de la nécessité de continuer d’étendre ses activités vers la frontière, espérant faire la jonction avec les activités transfrontalières menées depuis la Thaïlande. Mais le limogeage du Premier ministre Khin Nyunt et de tout son appareil de renseignement militaire en octobre 2004 sonna le glas de futures expansions pour de longues années.
Maîtrise et supervision de l’aide. Le second compromis de taille consenti par les sections de MSF en Birmanie fut de renoncer au contrôle permanent de la destination de l’aide. En effet, le gouvernement imposait périodiquement de sévères restrictions en matière de visite des projets, tantôt uniquement applicables au personnel étranger, tantôt à l’ensemble des employés. Ces restrictions, qui entravaient la supervision des projets par MSF, étaient depuis longtemps inhérentes au travail en Birmanie, mais elles s’intensifièrent après le départ de Khin Nyunt afin de rappeler à l’ordre les agences qui avaient étendu leurs opérations sous son autorité. Les partisans de la ligne dure remplacèrent les ministres plus modérés au gouvernement, et les tracasseries à l’encontre des organisations humanitaires se multiplièrent : resserrement des créneaux pendant lesquels les visites en dehors de Rangoon étaient autorisées ; approbation préalable de tous les nouveaux employés expatriés ; soumission régulière au gouvernement des listes des employés nationaux ; allongement de la durée des procédures d’enregistrement auprès des ministères ; et renégociations plus fréquentes des protocoles d’accord avec le gouvernement. En outre, les organisations d’aide devaient être escortées par un « officier de liaison » du gouvernement à chaque visite de terrain – planifiée des semaines à l’avance.
Toutes les sections de MSF durent mesurer les effets de ces règles sur leur capacité à maîtriser et à superviser l’utilisation de l’aide, au regard de ce qu’elles estimaient pouvoir encore faire et de ce qu’elles espèrent réaliser en persévérant. Contrairement à ce qu’affirmaient certains groupes d’exilés, le détournement de l’aide par le gouvernement – la principale crainte quand on ne peut pas superviser son usage – ne fut jamais le problème. À la différence des détournements massifs organisés par les gouvernements de Corée du Nord ou d’Éthiopie, les vols étaient commis au niveau local et/ou individuel : un commandant de zone réquisitionnant un bateau ou une voiture pour son usage personnel ; le responsable de la santé du township volant des médicaments pour sa clinique privée ; ou l’employé du ministère de la Santé vendant des vaccins contre la poliomyélite au lieu de les distribuer gratuitementRapport de fin de mission du chef de mission MSF-Suisse (novembre 2005-février 2008), Rangoon, 12 février 2008, p. 22.. Bien que frustrants, ces incidents isolés étaient loin de la taxation systématique ou de la réaffectation des secours à des groupes « méritants » cautionnées par d’autres gouvernements. La fongibilité de l’aide crée plus de malaise que son détournement : tous les programmes de MSF assument dans le domaine sanitaire des responsabilités qui devraient incomber au gouvernement, ce qui permet à l’État d’affecter ses ressources ailleurs. De nombreux employés de MSF ont l’habitude d’exprimer leur inconfort face à cette situation, mais sans le dire publiquement. Rares sont ceux qui croient que le gouvernement accorderait davantage de moyens au secteur de la santé si MSF se retirait. Le mépris cynique manifesté envers les survivants du cyclone Nargis par le régime, qui décida de maintenir le référendum sur la nouvelle Constitution pendant qu’ils enterraient leurs morts, mit fin aux doutes qui pouvaient subsister quant aux priorités du gouvernement. Ce dilemme était ressenti de manière plus aiguë au niveau local, où les efforts de MSF pour éviter de collaborer avec le régime conduisirent à la création de structures de santé indépendantes – parfois à quelques mètres à peine d’un dispensaire d’État – sapant encore davantage les capacités localesRapport de visite en Birmanie, juin 2006, Genève, 2006, p. 11.
Le renforcement des contrôles sur les activités d’assistance qui suivit le limogeage de Khin Nyunt fin 2004 affecta chacune des sections de MSF de façon différente. Les projets de MSF-Suisse dans l’État de Kayah et le district de Tanintharyi furent inaccessibles pendant plusieurs mois. L’organisation s’obstina à naviguer dans des procédures bureaucratiques sans fin, désormais obligatoires, pour faire entrer des expatriés dans le pays, qui se trouvaient par la suite bloqués à Rangoon. Certains d’entre eux achevèrent même leur mission sans avoir réussi à atteindre le site de leur projetEntretien avec Asis Das, ancien coordinateur médical pour MSF-France (2005-2006) et AZG (2007-2009).. Le gaspillage d’argent et de ressources humaines entraîné ralluma des débats anciens au sein de MSF-Suisse : fallait-il rester en Birmanie ou en partir ? Finalement, les partisans de la persévérance eurent gain de cause, arguant que MSF ne pouvait pas abandonner les 500 patients qu’elle avait récemment placés sous traitement antirétroviral. Se retirer équivalait à les condamner. C’est ainsi qu’à maints égards MSF-Suisse devint l’otage de son propre programme, modifiant les paramètres de sa réflexion quant aux concessions qu’elle pouvait ou non accepter en Birmanie.
MSF-France, qui n’avait pas de patients sous ARV, prit une décision opposée. La dernière vague de restrictions arriva au moment où MSF venait de négocier une base permanente à Ye, à partir de laquelle elle ambitionnait d’étendre sa couverture médicale. Mais le régime, décidé à limiter le nombre de témoins potentiels de sa répression contre les insurgés et leurs partisans supposés mit un terme à l’intervention. Lorsque la section française se retira en mars 2006, le responsable du programme expliqua : « Pour les organisations humanitaires, il s’agit de reconnaître le moment où nous sommes réduits à un rôle de sous-traitant technique des autorités birmanes, soumis à leurs priorités politiques et empêchés de poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu’organisation humanitaire. En ce qui concerne les programmes de la section française, nous estimons avoir franchi cette ligne. C’est avec une grande amertume que nous avons dû décider de quitter le pays« Pourquoi la section française de MSF a mis un terme à ses activités en Birmanie », entretien avec le responsable du programme, 30 mars 2006, http://www.msf.org/msf/articles/2006/03/why-the-french-section-of-msf-ha... .. »
Mais, même en partant, MSF-France consentit à un dernier renoncement, en bridant sa tendance habituelle à mobiliser l’opinion publique et à alimenter le débat sur les limites de l’action humanitaire dans un tel contexte.
Un silence assourdissant. Le départ relativement discret de la section française s’inscrit dans la logique d’autocensure qui met en évidence le troisième compromis d’importance accepté par les sections de MSF en Birmanie. Depuis les années 1980, le témoignage et la prise de parole publique sont progressivement devenus des aspects important de l’action de MSFVoir infra Fabrice WEISSMAN, « Silence, on soigne... », p. 233-256.. En mobilisant l’opinion publique et les acteurs politiques, MSF cherche à faire pression pour des changements. Mais, en Birmanie, toutes les sections étaient persuadées que la moindre prise de parole interprétée comme critique à l’égard du régime mettrait en péril leurs opérations, au détriment de centaines de milliers de patients que traitait MSF chaque année. Les équipes s’inquiétaient aussi pour la sécurité des employés nationaux si MSF devait encourir les foudres du régime. Pour ces motifs (et d’autres raisons liées à des réorganisations internes chez MSF à Paris), la section française quitta le pays sans conviction ni enthousiasme. Et, pendant toutes leurs années de présence, AZG et MSF-Suisse s’exprimèrent rarement publiquement sur les responsabilités de la junte dans les souffrances du peuple birman. Il n’y eut qu’une exception, en 2008, lorsque MSF dénonça l’insuffisance des traitements contre le sida« A preventable fate. The failure of ART scale-up in Myanmar », loc. cit..
Traiter les symptômes de la répression sans être en mesure d’en traiter les causes engendra un malaise parmi les équipes d’AZG. La section hollandaise de MSF était intervenue en Birmanie dans l’intention de témoigner et avait mis en place, sans guère de discussions ni de débat, un programme médical qui risquait d’être remis en question à la moindre critique des pratiques du régime et de sa politique. La tension évidente entre le département des affaires humanitaires d’Amsterdam, plus soucieux de témoigner, et l’équipe de coordination à Rangoon, se traduisit par une incohérence dans les programmes et les objectifs. Le département des affaires humanitaires produisit des rapports internes détaillés sur le sort des Rohingyas et demanda aux équipes de terrain de recueillir et de compiler des données sur des incidents les affectant ; ces données étaient ensuite partagées à huis clos avec les donateurs et des organisations de défense des droits de l’homme qui n’avaient pas d’activité dans le pays. Pourtant, au fil du temps, faute d’un objectif bien identifié au recueil de données, l’enthousiasme faiblit. Il est difficile de savoir si, finalement, le but était d’améliorer la condition des Rohingyas ou d’accomplir le « devoir de témoignage » que s’imposaient les membres de MSF. Le fossé entre les points de vue de Rangoon et d’Amsterdam transparaît dans les documents d’orientation politique générale rédigés au siège de 2001 à 2009 concernant les projets en Birmanie. La ligne de Rangoon était clairement déterminée par son programme médical : elle n’allait pas compromettre la possibilité de traiter chaque année 200 000 malades du paludisme dans l’État de Rakhine. Et pourtant Amsterdam persistait à croire qu’AZG devait rester en Birmanie essentiellement pour témoigner.
AZG aurait peut-être pu faire davantage pour alléger les souffrances des Rohingyas si ses « activités médicales » et ses « activités de témoignage » du programme avaient été mieux synchronisées. Documenter, compiler et signaler en privé aux autorités concernées les obstacles aux soins de santé – comme les restrictions aux déplacements empêchant les transferts à l’hôpital, et le coût prohibitif des passages aux checkpoints – pouvait être un moyen de faire changer les choses, moins menaçant que les déclarations publiques, et plus efficace que les discussions de couloir avec les bailleurs.
Il est notoirement difficile d’influencer le comportement de la junte birmane. Richard Horsey, ancien responsable du Bureau international du Travail à Rangoon, décrit l’étrange contradiction du régime qui le rend imperméable aux pressions tant discrètes que publiques : « [Le régime] est à la fois dédaigneux des critiques extérieures, mais en même temps curieusement sensible à la manière dont il est perçu. Il semble sincèrement croire qu’il agit dans l’intérêt national, et s’estime profondément incompris, et injustement traité, par le monde entier. »Richard HORSEY, Ending Forced Labour in Myanmar. Engaging a Pariah Régime, Londres, Routledge, 2011.
D’un côté, ce dédain limite la marge de manœuvre et l’influence des puissances extérieures, y compris des États asiatiques proches, sur le comportement du régime, rendant futiles les efforts déployés par les organisations d’aide pour inciter les alliés de la Birmanie à faire pression en faveur de changements. De l’autre, la susceptibilité du régime quant à son image le pousse à une réaction brutale lorsqu’il est publiquement critiqué. En octobre 2007 les généraux expulsèrent le représentant de l’ONU Charles Petrie après qu’il avait osé suggérer à l’occasion de la Journée des Nations unies que le gouvernement n’en faisait pas assez pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Petrie avait également évoqué la « révolte Safran » conduite un mois plus tôt par des moines, en soulignant que « les inquiétudes du peuple [s’étaient] clairement exprimées lors des récentes manifestations pacifiques – il [incombait] à tous de les entendre»Déclaration de la représentation des Nations unies en Birmanie à l’occa- sion de la Journée de l’ONU, bureau du coordinateur résident et humanitaire, Rangoon, 24 octobre 2007.. Cette déclaration suivait plusieurs autres critiques formulées publiquement par des organisations travaillant dans le pays, à commencer par une dénonciation exceptionnelle du gouvernement par le CICR en juin 2007, qui accusa la Birmanie de violations graves et répétées du droit international humanitaire. Le CICR condamnait notamment le recours aux détenus comme porteurs pour l’armée, et déplorait le refus du régime d’entamer des discussions ou d’ouvrir ses prisons à l’institution« Myanmar. Le CICR dénonce des violations graves et répétées du droit humanitaire international », communiqué de presse du CICR no 07/82, Rangoon/Genève, 29 juin 2007.. Quelques mois plus tard, treize ONG publièrent une déclaration commune appelant le gouvernement à cesser d’entraver leurs efforts en faveur des plus pauvresViolet CHO, « International aid groups ask junta to eliminate barriers », Burma News Network, 20 octobre 2007. Aucune section MSF n’a signé cette déclaration commune.. Alors que l’expulsion de Petrie étouffa toute velléité de protestation ultérieure, le fait que le CICR ne puisse toujours pas accéder aux prisons ou aux zones frontalières confirma l’imperméabilité du régime à toute influence ou pression extérieures.
Aucune des sections de MSF ne soutint les initiatives critiquant publiquement les pratiques du régime. Elles adoptèrent une approche plus discrète, défiant le cadre imposé par l’État en agissant plutôt qu’en prenant la parole. Les sections suisse et hollandaise interviennent fréquemment sans autorisation en bonne et due forme, en envoyant des personnels nationaux évaluer les besoins des nouveaux déplacés et en travaillant durant de longues périodes sans protocole d’accord valide. Elles s’engagent aussi auprès de groupes placés « hors la loi », comme les travailleurs sexuels et les usagers de drogue, ce qui implique un risque d’emprisonnement pour le personnel national de MSF. Elles partent du principe qu’il vaut mieux s’excuser après les faits que de se voir refuser d’emblée une autorisation. Après le passage du cyclone Nargis, par exemple, AZG n’attendit pas la permission d’envoyer une équipe dans la région du delta. Ses médecins bangladais et chinois réussirent à passer inaperçus et restèrent longtemps après que tous les autres étrangers eurent reçu l’ordre de partir. MSF-Suisse développa une stratégie d’accès « à l’usure », consistant à déposer des demandes répétées d’autorisation de déplacement, à exiger des justifications quand des refus leur sont opposés, ainsi qu’à réitérer inlassablement son souhait d’atteindre les populations en détresse. En outre, en 2007, la section envoya des équipes et des fournitures médicales sur les lieux des manifestations pendant la révolte Safran et essaya d’aider les blessés. Ses employés restèrent même bloqués à l’intérieur de la Pagode Sule, au centre de Rangoon, lorsque la police boucla le quartierRapport de fin de mission du chef de mission MSF-Suisse, op. cit., note 2, p. 4.. Même si l’impact était surtout symbolique – les manifestants blessés ne venaient pas se faire soigner, probablement de crainte de se faire repérer s’ils étaient traités par des étrangers – MSF-Suisse, en l’absence d’autres organisations d’aide à l’exception du CICR, estimait qu’il était important de marquer sa solidaritéRapport de visite de terrain, Genève : MSF-Suisse, octobre 2007..
Pourtant, malgré tous ces actes de « résistance » et le nombre de patients traités, on ne peut s’empêcher de se demander si MSF n’est pas devenue trop mécanique dans son approche, trop détachée du contexte : ne réduit-elle pas les gens à leurs maladies plutôt que de voir qui ils sont et ce dont ils souffrent plus largement ? Une récente évaluation du programme décrit le projet mené à Rakhine comme sclérosé« MSF en Birmanie. Doutes et certitudes », Bureau international de MSF, Genève, septembre 2008, p. 18. : malgré les premiers succès remportés avec le changement des protocoles et des comportements face au VIH dans le pays, AZG ne s’est pas suffisamment servie de son poids, pourtant non négligeable, pour exiger des changements, comme par exemple la levée des restrictions au déplacement des patients vers un hôpital.
S’il est compréhensible que MSF ait privilégié la présence opérationnelle plutôt que la dénonciation ouverte en Birmanie dans un contexte où il y avait si peu à gagner et tant à perdre, ses déclarations publiques sont moins explicables. Elles minimisent les contraintes imposées aux organismes de secours et ne montrent guère de solidarité avec ceux qui préféreraient changer le système et se passer de l’aide internationale, plutôt que d’accepter son obole. La polarisation du contexte est en partie responsable de cette attitude, puisque tout aveu de difficulté fait le jeu des activistes, qui l’utilisent comme argument contre toute assistance. Mais cela ne justifie ni le ton ni l’étendue du déni. Interrogé lors d’un entretien sur les conditions qu’avait dû accepter MSF-Suisse pour intervenir en Birmanie, le chef de mission ne mentionna que le protocole d’accord négocié avec les autorités, et soutint qu’il n’était pas différent de ce qui existait dans d’autres pays : « La junte militaire a le droit de surveiller nos activités, exactement comme le gouvernement le ferait en France. » Il remisa les inquiétudes sur les conditions de travail des ONG au rang de fausse rumeur et affirma que MSF savait comment travailler en Birmanie : « Nous sommes très conscients des pratiques en vigueur dans ce pays. Nous savons quel ton adopter quand nous voulons intervenir dans des zones sinistrées, mais nous savons aussi dénoncer [les choses qui] ne fonctionnent pas comme elles le devraient. » Il conclut l’interview en comparant la vie des Birmans à celle de « presque tous les [habitants des] pays en développement » et accusa les médias étrangers d’« exagérer » le caractère misérable des conditions de vie du peuple.« Les conditions de vie des Birmans ne sont pas aussi catastrophiques qu’au Darfour », interview conduite par Christelle Magnout, TV5 Monde, «Birmanie. L’humanitaire toléré», http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redact... .
Dans la même veine, le chef de mission d’AZG afficha un désintérêt marqué pour le sort des moines et des autres manifestants blessés pendant la révolte Safran d’octobre 2007. Quand un journaliste de CNN lui demanda si AZG avait l’obligation morale d’exiger l’accès aux blessés et aux prisonniers, il se contenta de répondre : « S’ils viennent à nous ou si nous savons où ils se trouvent, nous les traiterons comme n’importe qui d’autre. » Manifestement surpris par cette réponse, le journaliste reposa sa question. Cette fois la réponse fut plus élaborée : « Vous comprenez, nous avons un très gros programme. Nous avons traité l’an dernier plus d’un million de patients, pour le paludisme, le sida. Ces activités se poursuivent. Nous nous occupons des maladies mortelles. Il est donc très important pour nous de continuer à soigner ces patients, et c’est à quoi s’emploient nos personnels dans ces cliniques qui ont pris en charge plus d’un million de personnes. »CNN Newsroom Transcripts, 7 octobre 2007, http://archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/0710/07/cnr.03.html .
« S’occuper des maladies mortelles », et non des victimes des conflits et de l’oppression. Le revirement d’AZG, de la préoccupation pour les victimes à la préoccupation pour les maladies, était achevé.
Ce qui émerge de cette analyse est que les trois sections de MSF ont adopté des stratégies très différentes pour travailler sur le territoire birman, avec plus ou moins de succès. Au départ, AZG voulait venir en aide aux populations touchées par les conflits en témoignant de leur sort, mais au bout de plusieurs années de tentatives infructueuses, après avoir remporté un succès plus marqué sur le front médical, et constaté que la prise de parole publique risquait de mettre un terme à ses projets, elle a reporté ses efforts sur le terrain moins controversé de la maladie. Étant donné l’état de la santé publique en Birmanie et la mort certaine qui attendait les personnes infectées par le VIH, le paludisme sévère et la tuberculose multirésistante, il est difficile de décréter que ce choix n’était pas légitime. De plus, en ouvrant des dispensaires dans les régions minières à haut risque, AZG a sans doute aidé de nombreuses personnes déplacées par le conflit dans ces zones.
Mais le revers de la médaille est qu’elle a dû fermer les yeux sur la situation générale. Vu sous l’angle étroit du train-train des programmes médicaux, le contexte devenait « normal » et l’inadmissible acceptable, comme le travail forcé dans la rue observé depuis le dispensaire ou la répression contre les moines protestataires.
MSF-Suisse, pour sa part, ne renonça jamais à essayer d’aider les victimes des politiques brutales du régime, qu’elle pensait trouver dans les régions frontalières qui étaient les théâtres des conflits. Pendant quatre années, elle déploya une énergie et des ressources inouïes afin d’atteindre les zones sensibles de l’État de Kayah. Mais un an à peine après avoir enfin réussi, MSF-Suisse transférait ses programmes à une autre ONG, faute de patients. On comprend qu’elle ait hésité à croire les assertions de la junte selon lesquelles très peu d’habitants demeuraient dans ces zones, préférant faire confiance aux estimations données par les groupes activistes basés à la frontière. Mais ces chiffres avaient été gonflés, légitimant a posteriori le choix d’AZG de se concentrer sur les régions où auraient pu aller les déplacés, comme les villes minières. En conséquence, MSF-Suisse suit maintenant les traces d’AZG, s’attaquant aux maladies infectieuses dans ses dispensaires et dans les prisons de Birmanie.
La stratégie de la section française en Birmanie, ou son absence, fut la plus déroutante. La décision de fermer les opérations en Birmanie ne suscita que peu de débats à Paris et, contrairement à d’autres contextes, comme celui des camps de réfugiés rwandais du Zaïre, il n’y eut aucune réflexion sur la manière dont le retrait de l’association pouvait être utilisé à l’avantage des organisations humanitaires qui choisissaient de rester. Rares furent celles qui en ont même été informées. Il a manqué à MSF-France l’imagination et la passion dont elle a fait preuve ailleurs pour trouver des moyens alternatifs d’atteindre les populations malgré les menaces des autorités. Au lieu de renforcer les opérations clandestines existantes, les Français ont arrêté leurs incursions médicales dans l’État de Môn menées depuis la Thaïlande ainsi que tous leurs programmes, à l’exception d’un petit projet tuberculose dans les camps thaïlandais. Nous étions loin de leur détermination à poursuivre l’assistance aux Nord-Coréens après que MSF s’était retirée du pays en 1998, lorsqu’elle avait su innover pour aider les réfugiés en Chine en dépit de l’opposition de Pékin. En masquant son inertie opérationnelle sous le prétexte d’avoir été « crédule en pensant qu’il existait là un espace de travail pour une organisation humanitaire« La section française de MSF met un terme à ses activités en Birmanie », entretien avec le directeur du programme, 30 mars 2006. », MSF-France a apporté de l’eau au moulin de ceux qui estimaient que l’aide internationale à ce pays devait être suspendue.
Les adversaires de l’aide en Birmanie ont tort quand ils affirment que cette assistance renforce le régime birman, ou qu’il s’agit d’un contexte dans lequel les difficultés d’intervention sont sans équivalent. Néanmoins, les organisations humanitaires font quelques concessions importantes quand elles travaillent dans le pays, en particulier concernant les populations qu’elles sont autorisées à aider. Pendant que sur le terrain les équipes de MSF se débattent avec leurs dilemmes et les difficultés de toutes sortes, il ne semble pas y avoir de discussions, ni au sein des sections ni surtout entre elles, sur les critères ou les bornes à partir desquels un compromis est jugé acceptable ou inacceptable. MSF se contente de voguer d’une concession ou d’une victoire à l’autre sans vraiment analyser ses succès et ses échecs, et sans plan d’ensemble. MSF-Suisse et AZG mènent des activités médicales significatives sur le terrain, soignant un grand nombre de malades. Mais, au lieu de voir cela comme une fin en soi, MSF en général et AZG en particulier doivent repenser les moyens d’utiliser cette influence pour améliorer le sort de populations dont le problème essentiel n’est pas la maladie elle-même, mais la répression et les privations qui en sont la source. Le défi pour MSF est de trouver un moyen de plaider en faveur du changement sans exposer ses patients, son personnel et ses alliés au sein du régime à des représailles si elle devait s’attirer les foudres des dirigeants.
***
Nigéria. Relations (de santé) publiques
CLAIRE MAGONE
Début février 1996, le siège de la section fran çaise de MSF découvre par une dépêche de l’Agence France-Presse qu’une épidémie de méningite cérébro-spinale frappe le nord-est et le nord-ouest du Nigériae Nigéria est divisé en six zones politico-administratives appelées zones géopolitiques : Sud-Sud ; Sud-Est ; Sud-Ouest ; Nord-Central ; Nord Ouest ; Nord-Est. Ce chapitre s’intéresse plus particulièrement aux États de Kano et de Katsina, tous deux appartenant à la zone Nord-Ouest. Dans le cadre d’un nouveau dispositif d’intervention appelé « l’équipe d’urgence » (Emergency Team), « dont le but affiché est de construire une équipe sans nationalité avec le label MSFConseil d’administration de MSF-France, 22 décembre 1995.», les sections opérationnelles de MSF à Amsterdam, Barcelone, Bruxelles et Paris organisent une réponse d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de l’association : quatre-vingt-dix expatriés sont déployés dans trois des États nigérians les plus touchés – Kano, Bauchi et Katsina –, vaccinent 2,9 millions de personnes et prennent en charge environ 30 000 patients entre mars et mai 1996.
Avec cette opération, MSF s’affirme comme un acteur important de la scène internationale pour ce qui relève de la réponse aux épidémies en « situation ouverte » (par opposition aux contextes fermés que constituent les camps de déplacés ou de réfugiés). Ainsi, en 1996, l’association organise un colloque international consacré à la « réponse opérationnelle aux épidémies dans les pays en développement » à l’occasion des vingt cinq ans de l’associationColloque médical international : « Réponses opérationnelles aux épidémies dans les pays en développement » – Épicentre et Fondation MSF, organisé le 25 octobre 1996 à la faculté de médecine Lariboisière.. Début 1997, elle crée avec l’OMS, l’Unicef et la Fédération internationale de la Croix-Rouge le GIC (Groupe international de coordination), qui se donne pour objectif d’assurer l’approvisionnement en vaccins poly saccharidiques anti-méningococciques, le Nigéria ayant épuisé les stocks mondiaux. L’engagement de MSF fait écho à celui de l’OMS, qui, en 1996, consacre son rapport annuel sur la santé mondiale à la résurgence et à l’apparition de nouvelles formes de maladies infectieuses, annonçant l’imminence d’une « crise globale»OMS, « Combattre la maladie ; promouvoir le développement », rapport annuel, 1996..

Si cet engagement reflète alors la volonté de l’association de se donner les moyens de répondre à l’« épidémie d’épidémies»Impact médecin hebdo, nº 339, 25 octobre 1996., à laquelle ses équipes sont de plus en plus confrontées depuis le début des années 1990 – choléra au Mali, en Côte d’Ivoire, au Libéria, au Cap-Vert, au Sénégal, en Somalie ; fièvre jaune au Libéria ; fièvre Ébola au Zaïre (République démocratique du Congo) ; méningite au Niger –, il représente également une possibilité de développement pour MSF. À cette époque, comme le souligne Philippe Biberson, alors président de MSF-France, « les missions d’assistance aux réfugiés ne représentent plus […] qu’une toute petite proportion des projets MSF […], une grande partie du savoir-faire et de l’expérience accumulés sont de peu d’utilité pour les missions qui se développent ». Le champ de la réponse aux épidémies en situation ouverte offre donc à l’organisation la possibilité de développer de nouveaux projets et de continuer à déployer son expertise médicale et logistique construite dans les camps de réfugiés.
Mais ce transfert de savoir-faire d’un contexte d’intervention à un autre impose à MSF une réflexion sur ses relations avec les autorités politico-administratives nationales. En effet, dans les situations d’exception que constituent les camps de réfugiés, l’État est souvent en retrait, l’administration sanitaire des populations est déléguée à des agences internationales et à des ONG. L’association jouit ainsi d’une sorte de privilège d’extraterritorialité et sa marge de manœuvre est accrue par sa capacité à prendre rapidement le contrôle de l’ensemble des étapes de la réponse à une épidémie : établissement et suivi d’un système de surveillance permettant la collecte continue de données sanitaires, investigation de l’épidémie (incluant la confirmation du diagnostic, au besoin par des tests biologiques), mesures destinées à réduire le nombre de malades et la mortalité (détection précoce et prise en charge des cas, isolation, vaccination, contrôle des vecteurs).
Dans une situation ouverte, chacune de ces étapes doit en principe être autorisée par l’État hôte. En d’autres termes, la volonté de MSF de prendre le contrôle de la réponse à une épidémie se superpose aux prérogatives nationales. Faut-il en conclure, comme l’a souligné le président de MSF-France en 1997, que « la liberté d’action [de MSF dans ce type de contexte] est pratiquement nulle, [et que] de la qualité des relations nouées avec les autorités administratives dépend presque 100 % de la qualité du secours apporté»Rapport moral MSF, 1998. ? La coopération entre l’association et les autorités politico-administratives nationales doit elle être appréhendée par ses équipes comme une contrainte, une nécessité tactique, un objectif en soi ? Dans quelle mesure, à quelles conditions, avec quelles conséquences les priorités sanitaires d’un État peuvent-elles rejoindre celles que se fixe un acteur médical humanitaire comme MSF dans la gestion d’une épidémie ?
Ce chapitre aborde ces questions en s’intéressant à trois moments de l’histoire des interventions de MSF – MSF-Hollande et MSF-France – dans le nord du Nigéria (1996-2001, 2005, 2009), dans les États de Kano et de Katsina. Précisons que les interventions de l’association au Nigéria ne sont pas réductibles à ces épisodes : MSF-Hollande, dont nous racontons les mésaventures dans l’État de Kano, a répondu à plusieurs urgences médicales dans d’autres États du nord du Nigéria à partir de 2005. Elle a également mené pendant plusieurs années un programme offrant des soins et des traitements aux personnes infectées par le VIH à Lagos. MSF-France, dont les opérations à Katsina sont décrites ici, a ouvert en 2004 un centre de traumatologie à Port Harcourt, dans le delta du Niger. Dans l’État de Jigawa, elle mène un programme obstétrique depuis 2008 et des activités de traitement de la malnutrition depuis 2010. Ce chapitre ne rend donc compte que d’une réalité partielle, celle des tentatives de réponse de MSF aux épidémies dans des États où les négociations se sont révélées particulièrement complexes.
Les épidémies, une fatalité entretenue ?
Renforcée par la conférence d’Alma-Alta puis l’initiative de Bamako, la décentralisation des services de santé nigérians s’inscrit dans un mouvement plus vaste de décentralisation des structures politico-administratives du pays, qui donne lieu à un remaniement constant du territoire : douze États fédérés en 1967, vingt et un en 1988, trente-six en 1996. Chaque État est composé de zones de gouvernement local (Local Government Areas, créées en 1976), collectivités territoriales dotées d’un budget et d’une assemblée locale. Leur nombre est passé de 301 en 1989 à 774 en 1999. Ce morcellement continu favorise la compétition et les frictions entre ces différentes structures, d’autant que les gouvernements locaux, « au lieu de correspondre à une communauté cohérente, [peuvent constituer] un champ de confrontation entre fractions arbitrairement associées, opposant “majorités” et “minorités”, chefferies, clientèles diverses, noyaux activistes»Guy NICOLAS, « Géopolitique et religions au Nigéria », Hérodote, La Découverte, Paris, 2002, p. 81-122.. La concurrence entre structures sanitaires locales, fédérales et nationales est particulièrement visible dans deux domaines cruciaux de la réponse aux épidémies : les services de vaccination et le système de surveillance épidémiologique.
En 1990, les soins de santé primaires sont officiellement confiés aux gouvernements locaux. L’approvisionnement en vaccins est décentralisé, conduisant dans les faits à une diminution drastique de leur disponibilité, les gouvernements locaux négligeant d’y consacrer une part de leur budget. Alors qu’au cours de la première moitié du régime militaire de Babangida (1985-1993), une politique volontariste – incarnée par le ministre de la Santé de l’époque, Olikoye Ransome-Kuti, connu au Nigéria comme le « père des soins de santé primaires » – avait permis d’améliorer la couverture vaccinale, cette dernière ne va cesser de chuter à partir de 1990. De 1996 à 2005, le NPI (National Programon Immunization, Programme national de vaccination), qui canalise les moyens colossaux –100 millions de dollars en 2006Unicef, fiche d’informations, 2006.– de la campagne d’éradication de la poliomyélite coordonnée par l’IMEP (Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite), est dirigé par le Dr Awosika, amie personnelle de l’épouse du président Obasanjo, dont il est de notoriété publique qu’elle détourna les subventions du programme« Why Dr Dere Awosika should go », Daily Trust, novembre 2005. Sous la pression des bailleurs de fonds, elle est contrainte de quitter son poste en décembre 2005, laissant un piteux bilan : moins de 13 % des enfants de moins d’un an bénéficient d’une couverture vaccinale complète à l’échelle nationaleNational immunization coverage survey (NICS) 2003, Nigeria. Résultats d’une enquête sur la couverture vaccinale des enfants de douze à vingt-trois mois., alors que le NPI est « de loin le programme de vaccination le plus coûteux des pays en développement»« The state of routine immunisation services in Nigeria and reasons for current problems », FBA Health System Analysts, Nigeria, 2005.. Appelé par les bailleurs de fonds internationaux à « restaurer sa dignité et son honneur dans l’arène de la santé publique internationale»Ibid., le Nigéria tente de nouvelles réformes. Les initiatives financées par des bailleurs de fonds internationaux, destinées à relancer les soins primaires et la vaccination de routine, se multiplient à partir de 2006, notamment dans le nord du Nigéria, où la situation est particulièrement désastreuse, puisque la couverture vaccinale complète des enfants ne dépassait pas 4 % en 2005. Trois ans plus tard, elle n’atteint toujours que 6 %, et les flambées de cas de rougeole continuent de faire partie de l’ordinaire des Nigérians du Nord.
Le dispositif de surveillance épidémiologique nigérian est également le reflet d’un cumul inarticulé d’acteurs publics et privés. De l’aveu du ministère fédéral de la Santé, il se caractérise en effet par une « grande duplication dans la collecte, l’entrée et l’analyse des données – pas moins de cinquante formulaires différents sont utilisés au niveau fédéral – des canaux de remontée multiples, une absence de définition des cas, des responsabilités mal définies concernant la soumission des données»Ministère fédéral de la Santé, National Health Management Information System (NHMIS), 2006, « Revised policy-programme and strategic plan of action ». Sites sentinelles, système de notification des maladies infectieuses mis en place par l’OMS, données recueillies dans les hôpitaux et dans les centres de santé par l’intermédiaire des unités épidémiologiques, statistiques démographiques, données NPI, informations exigées par les partenaires internationaux… créent une cacophonie silencieuse. Les alertes sanitaires sont donc rarement révélées par les voies officielles, mais, le plus souvent trop tard, par la presse ou par des individus qui s’extraient du système, tel cet employé de l’OMS qui fournira à MSF de 1996 à 2009 des données sanitaires off the record, plaçant dans l’organisation l’espoir que « ces données […] serviront à l’A-C-T-I-O-N».E-mail envoyé au chef de mission de MSF, 2004.
À cette complexité s’ajoute la particularité du fédéralisme fiscal nigérian, qui favorise une gestion opaque des fonds publics. La grande majorité des crédits fédéraux destinés aux deux autres échelons du pays est portée sur un compte joint – Local and State Joint Account – que doivent ensuite se « partager » les États et les gouvernements locaux. Cette disposition constitutionnelle nourrit des relations clientélistes, États et gouvernements locaux n’ayant à se rendre des comptes que l’un à l’autre, et engendre des « petites histoires d’horreur»15. Murray LAST, « The peculiarly political problem behind Nigeria’s primary health care provision », University College London, Londres, 2010. de détournements de fonds. Ainsi, en 1996, des crédits viennent d’être mis à disposition des gouvernements locaux de l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, pour lutter contre l’épidémie de méningite. Face à du personnel médical gouvernemental venu lui demander des moyens pour lutter contre l’augmentation du nombre de cas enregistrés dans plusieurs villages, le responsable local de la santé déclare n’avoir ni vaccins ni médicaments, avant de suggérer de faire à la population des « injections à l’eau pour leur satisfaction psychologique».Elisha P. RENNE, « The limits to health intervention », Health Transition Review 7, 73-107, 1997, p. 91-94.
L’absence de contrôle, de coordination, d’efficacité du système crée ainsi des failles dans lesquelles des intérêts très éloignés de la santé publique peuvent s’exprimer, avec une impunité qui s’exacerbe dans les grands moments de désorganisation que constituent les épidémies au Nigéria. MSF en fut directement témoin en avril 1995 lors d’une épidémie de méningite au Niger, pendant laquelle ses équipes furent amenées à utiliser une partie des 88 000 vaccins offerts le mois précédent par le gouvernement nigérian et l’État de Sokoto au Programme de vaccination nigérien. Constatant rapidement des problèmes de dilution et la présence de filaments dans les vaccins, les équipes refusèrent de les utiliser. Alertés par MSF, les laboratoires Mérieux, dont la marque figurait sur les vaccins, procédèrent à leur analyse : les vaccins – qui, d’après les estimations de l’association, furent administrés à 60 000 personnes – étaient des copies sans principe actif. Une plainte pour contrefaçon internationale fut déposée par les laboratoires Mérieux, suivie du lancement de commissions rogatoires internationales, mais la procédure judiciaire tourna court. Julien CLAUDEL, « Le Niger est victime d’une contrefaçon de vaccins », La Croix, septembre 1996.
En 1996, MSF fut également témoin d’un scandale public qui continue à faire parler de lui quinze ans après. À l’hôpital infectieux de Kano, pendant l’épidémie de méningite, ses équipes côtoyaient celles du laboratoire de la société pharmaceutique américaine Pfizer, qui testaient sur des enfants un médicament toxique, le TrovanL’utilisation du Trovan pour les enfants n’a jamais été approuvée par la FDA (Food and Drugs Administration), et son usage pour les adultes a été restreint en 1999 en raison de sa toxicité hépatique. Le médicament est interdit en Europe.. Quatre ans plus tard, le Washington Post publia un article intitulé « Quand profits et vies sont mis en balance»Joe STEPHENS, « As drug testing spreads, where profits and lives hang in balance », Washington Post, 17 décembre 2000., révélant les conditions dans lesquelles ces tests avaient été conduits, témoignages des équipes de MSF à l’appui. Il reprochait à Pfizer d’avoir utilisé l’épidémie de méningite pour réaliser un test clinique à grande échelle, sans contrôle adéquat, accaparant du personnel médical nigérian déjà débordé, négligeant de recueillir le consentement éclairé de familles dont la détresse ne leur permettait guère d’être en position de libre choix. Un comité d’enquête national fut mis en place en janvier 2001, auquel MSF fut invitée à participer, relayant notamment les témoignages de parents se plaignant de ne pas avoir été informés qu’ils participaient à une recherche. Les familles s’estimant lésées, puis le gouvernement de Kano, lancèrent une procédure judiciaire contre Pfizer, qui aboutira en 2009 à un règlement à l’amiable, l’entreprise pharmaceutique acceptant de payer 35 millions de dollars aux familles des enfants enrôlés dans l’essai et 30 millions de dollars à l’État de Kano, pourtant soupçonné de complaisance pour avoir autorisé Pfizer à conduire l’essai. Selon plusieurs observateurs, certains représentants du gouvernement de Kano personnellement inquiétés par cette affaire gardent rancune à MSF d’avoir contribué à faire éclater ce scandale. Encore en fonction aujourd’hui ou en position d’influence, ils alimenteraient depuis 2001 l’hostilité des autorités de Kano à l’égard de l’association.
Cet aperçu du contexte d’intervention dans lequel MSF évolue de 1996 à 2009 montre combien il est hasardeux de s’appuyer sur le système existant pour espérer qu’une épidémie soit gérée dans le seul souci de ceux qu’elle menace. Au contraire, agir dans l’intérêt des populations nécessite de s’extraire du système et d’y trouver des alliés.
Réformer de l’intérieur
De 1997 à 2001, c’est la section hollandaise qui incarne les ambitions de MSF dans le nord du Nigéria, avec un projet de préparation aux urgences et de réponse aux épidémies. La stratégie opérationnelle initiale est formalisée par une partie de l’équipe ayant coordonné l’intervention de MSF lors de la grande épidémie de méningite de 1996, laquelle est suivie la même année d’une épidémie de rougeole et de choléra. Elle pose le diagnostic suivant : « La motivation de l’État fédéral à gérer les épidémies […] est nulle, à moins [que celles-ci] ne deviennent des enjeux politiques. Le régime [militaire de Sani Abacha] n’est pas prêt à faire face aux conséquences internationales liées à la déclaration des épidémies ni à l’embarras politique d’avoir à déclarer leur incapacité à contrôler la situation. » Les auteurs de la stratégie recommandent que MSF mène des projets ciblés, limités, en prenant garde à ne pas disperser ses moyens. Ils envisagent la coopération avec les autorités comme un mal nécessaire : « En tant que partenaire de mise en œuvre, le ministère de la Santé est un partenaire parfois inévitable, mais non recommandé. »Document interne MSF avril 1997
À son démarrage, en 1997, le projet de l’association consiste à former le personnel des ministères de la Santé, fédéral et étatique, et celui de la Croix-Rouge nationale nigériane, en étroite coordination avec l’Unicef et l’OMS, dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de la prise en charge des maladies infectieuses. En 1997, MSF forme quarante personnes du ministère de la Santé dans quatre États ; en 1998, elle en forme 216 dans dix États, pour conclure que ce programme n’a « aucun impact significatif sur la capacité des États à répondre aux épidémies».Enquête MSF, 1997.
La situation politique dans le nord du Nigéria devient nettement défavorable à la poursuite des objectifs de MSF à partir de 1999. Après treize années de gouvernement militaire, des élections portent Olusegun Obasanjo à la tête du pays, éclipsant de la scène politique fédérale les représentants des États du Nord. De 1999 à 2007, ceux-ci vont saisir toutes les occasions d’affirmer leur identité, menacée par un pouvoir accusé de favoriser les intérêts d’une région (le Sud), d’une ethnie (les Yorubas), d’une religion (le christianisme). Dans ce contexte, le contrôle des initiatives de santé publique va se révéler être un des enjeux du rapport de forces entre l’État fédéral et les États du Nord, dont les ambitions opérationnelles de MSF vont faire les frais.
En 1999, MSF recentre son programme à Kano, où elle établit un « système de surveillance sentinelle ». Celui-ci est à peine mis en œuvre qu’une épidémie de choléra éclate. Alertés par les équipes de l’association, le ministère fédéral de la Santé et le ministère de la Santé de l’État de Kano nient l’apparition du choléra pendant quatre semaines et réfutent les résultats des analyses de laboratoire obtenus par MSF, craignant qu’on ne leur reproche d’avoir gâché la fête de la Fifa (Fédération internationale de football association) des moins de 20 ans, que le Nigéria accueille en avril. Devant ce blocage, MSF décide alors de court-circuiter le système en informant la presse. Ce faisant, elle passe outre la mise en garde que le gouvernement lui avait transmise en 1996 dans la lettre de remerciement du ministère fédéral de la Santé adressée au chef de mission de l’organisation à l’issue de la campagne contre la méningite : « On m’a demandé de vous conseiller de ne publier aucune donnée sur ces épidémies sans la permission du ministère fédéral de la Santé, et vous êtes invité à ne faire aucune déclaration sur ces épidémies qui pourrait embarrasser le gouvernement fédéral du Nigéria. »
Au cours de cette même année, MSF prête main-forte aux équipes de l’hôpital de Kano pour prendre en charge des cas de rougeole, en forte augmentation, et découvre l’utilisation de vaccins dont la date de péremption est expirée dans l’unité de prise en charge des enfants.
En avril 2000, les équipes de MSF diagnostiquent un cas de fièvre jaune à Kano, confirmé par un test dans un laboratoire nigérian. Dès l’ouverture de la mission, le risque d’une épidémie de fièvre jaune avait été identifié : la dernière épidémie datait de 1986 et aucune vaccination de masse n’avait été effectuée depuis. Or il n’y a pas de traitement pour la fièvre jaune, dont le taux de létalité peut dépasser 50 %. Se conformant aux recommandations de l’OMS, MSF propose au ministère de la Santé de Kano de mener une campagne de vaccination pour éviter la propagation de l’épidémie. Le ministère accepte dans un premier temps, puis se rétracte, réfutant la validité du diagnostic établi. La chef de mission sollicite alors le soutien des autorités religieuses de Kanoet de l’OMS, puis celui du gouvernement fédéral pour convaincre les autorités sanitaires. Sans succès. La coexistence, parfois absurde, de volontés contradictoires au sein du système est alors patente : tandis que les équipes de MSF forment le personnel sanitaire de Kano à la vaccination contre la fièvre jaune, le ministère de tutelle refuse d’envisager une telle opération malgré l’alerte. Finalement, l’épidémie redoutée n’aura pas lieu. Comme le résume alors la chef de mission : « Le commissaire à la Santé a pris un énorme pari sur la santé de sa population, et force est de constater qu’il a gagné. »Rapport interne MSF, 1999.
Après deux années de coopération à fonds perdus, suivies d’une épidémie de choléra et d’une menace d’épidémie de fièvre jaune que les autorités sanitaires ont traitée avec nonchalance, la frustration des équipes de MSF atteint son apogée pendant une épidémie de rougeole à Kano, en 2001. Cette dernière illustre autant qu’elle exacerbe de façon dramatique l’ensemble des blocages, retards et négligences d’une chaîne de réactions que cinq années d’efforts de MSF n’ont pas réussi à huiler. Début 2001, une épidémie de rougeole submerge les capacités de prise en charge du principal hôpital public de Kano. En mars, le système de surveillance conjoint du ministère de la Santé de Kano et de MSF reporte près de 9 000 cas en quatre semaines, un nombre plus de dix fois supérieur à celui de la même période l’année précédente. Le ministère de la Santé de Kano tente alors de mener une campagne de vaccination, immédiatement compliquée par les relations tendues qu’il entretient avec le Dr Awosika, la directrice du NPI, qui réquisitionne les équipements médicaux et logistiques nécessaires à la campagne afin de mener les Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite.
Pendant plusieurs semaines, le ministère fédéral de la Santé refuse les importations de médicaments commandés par MSF,et ce n’est qu’en mars 2001 qu’il les autorise, après l’intervention du gouverneur de Kano. En avril, MSF doit mener de longues négociations pour obtenir de la part du ministère de la Santé de Kano la possibilité d’installer une tente dans l’hôpital, alors même que celui-ci, débordé par l’afflux de rougeoleux, a cessé d’admettre des nouveaux cas depuis plusieurs semaines. Les équipes de l’association obtiennent enfin de coordonner la réponse à l’épidémie au sein de l’hôpital, avec les ressources humaines mises à disposition par le ministère. Celle-ci bat alors son plein et MSF peine à superviser les efforts d’équipes de soins peu motivées, dont une partie se met en grève. En mai, devant un taux de létalité hospitalière de la rougeole qui dépasse 25 %, l’association demande l’autorisation au commissaire à la Santé de conduire une campagne de mobilisation afin d’encourager les parents à venir le plus tôt possible à l’hôpital. Celui-ci refuse et fait au contraire une communication publique dans laquelle il minimise le problème sanitaire.
C’en est trop : MSF décide de jeter à la face des autorités sanitaires de Kano l’ensemble de ce qu’elle perçoit comme des manquements graves à leurs responsabilités. Elle envoie une lettre au ministère de la Santé de l’État de Kano qu’elle diffuse largement – NPI, ministère fédéral de la Santé, autorités religieuses de Kano, OMS, bailleurs de fonds internationaux. Il s’agit d’une lettre de rupture, mélange de reproches et de remontrances quant à l’attitude des autorités sanitaires. MSF y fait le bilan amer de cinq années de coopération, constatant un « manque d’engagement politique et de transparence », ainsi qu’« une priorisation des intérêts politiques sur les intérêts humanitaires débouchant sur des pertes humaines inutiles ». L’organisation exprime sa « déception » concernant le manque de coopération des autorités de Kano, qui n’opèrent pas de changements malgré « les nombreuses discussions avec MSF ». La distribution de cette lettre est suivie d’une tournée diplomatique auprès des destinataires. Les principaux concernés accueillent les critiques de MSF avec bonhomie : le ministère de la Santé de Kano remercie l’association pour tout ce qu’elle a fait et annonce qu’il la réinvitera bientôt, le ministère fédéral de la Santé promet de monter un dossier sur les problèmes à Kano, l’OMS lui suggère d’être patiente. Et c’est ainsi que s’achève définitivement l’histoire opérationnelle de MSF à Kano.
De 1997 à 2001, les équipes de MSF ont été prisonnières de leur coopération avec les autorités sanitaires à des moments qui exigeaient qu’elles disposent d’une grande latitude opérationnelle. L’échec de l’organisation à réaliser ses ambitions, d’abord masqué par son assoupissement initial dans le ronron des formations et des collaborations consensuelles, lui a été révélé par son incapacité à agir, ou à convaincre les autorités et parfois le personnel médical gouvernemental de la nécessité d’agir, autrement dit par son incapacité à modifier leurs comportements et leurs priorités.
L’association publiera au cours des années suivantes des articles dénonçant l’absence de volonté politique des autorités de Kano dans le domaine de la santéSally HARGREAVES, « Time to right the wrongs. Improving basic health care in Nigeria », The Lancet, 2002 ; Helen COX et Siobhan ISLES, « The beauty and the beast », The Lancet, 2003.
, ce qui n’aura guère de retentissement dans le débat public nigérian.
Capitulation volontaire
En 2005, la section française de MSF mène quelques mois durant un programme de traitement de la malnutrition pendant une épidémie de rougeole dans l’État d’Adamawa, dans le nord-est du Nigéria. Puis, en juin 2005, alertée par la mission de MSF basée à Maradi, au Niger, qui reçoit un nombre croissant d’enfants malnutris en provenance de Katsina, l’association décide de mener une mission exploratoire dans cet État voisin de celui de Kano. Cette mission révèle une situation préoccupante : la population de Katsina vient d’être touchée par une épidémie de rougeole, dont MSF sait par expérience qu’elle est généralement suivie d’une augmentation des cas de malnutrition, et les prix des céréales ont augmenté dans des proportions beaucoup plus importantes que l’année précédente à la même époque.
MSF obtient en quelques jours les autorisations pour ouvrir un programme de traitement de la malnutrition aiguë sévère à Katsina, après avoir rencontré les autorités sanitaires locales, parmi lesquelles le secrétaire permanent à la Santé, deuxième responsable hiérarchique du ministère. Ce dernier est proche du gouverneur de Katsina, Umaru Yar’Adua, qui se révélera être candidat à l’élection présidentielle prévue en 2007, et dont il est le médecin personnel. L’accueil initial est favorable à l’intervention de l’association : le chef de mission de l’époque estimera a posteriori que les premiers pas de MSF à Katsina s’apparentaient à une « lune de miel avant le mariage ».
Fin juillet, MSF ouvre à Katsina un centre de stabilisation pour la malnutrition aiguë sévère compliquée et six centres ambulatoires pour la malnutrition aiguë sévère simple, admettant plus de 600 enfants par semaine. Les interlocuteurs officiels de MSF montrent rapidement des signes d’inquiétude, car le programme gagne en visibilité, y compris médiatique. L’association cherche à ouvrir d’autres centres de stabilisation, celui de Katsina étant saturé. En août, l’agence de presse Reuters titre « La malnutrition infantile frappe des milliers d’enfants dans le nord du Nigeria », et cite le chef de mission de MSF-France. L’article indique que le Nigeria n’est pas un pays « démuni » comme son voisin nigérien en proie à une grave crise alimentaire et nutritionnelle, mais un pays « rongé par la corruption, qui a échoué à transformer ses ressources pétrolières en services de base pour la population ». Les autorités de Katsina, qui viennent d’annoncer publiquement qu’elles débloquaient des fonds pour aider le Niger« Northern Nigerian states send aid to Niger », AFP, 23 juillet 2005, http://www.afp.com., n’apprécient guère. Pour le secrétaire permanent du ministère de la Santé de Katsina, il est hors de question que des images d’enfants décharnés, mettant en lumière l’incapacité de l’État à prendre soin de sa population, entachent le démarrage de la campagne électorale du gouverneur, qu’il soutient personnellement.
À l’approche de la fin de l’accord qui autorise l’association à intervenir à Katsina et qui s’achève le 13 septembre 2005, la situation se tend. À chaque nouvelle réunion, les interlocuteurs du ministère de la Santé de l’État martèlent un unique message : MSF doit partir le plus vite possible et le programme sera repris par leurs soins. Une sorte de course contre la montre se joue alors, le ministère poussant MSF à former autant de personnel gouvernemental que possible pour prendre le contrôle du programme, MSF cherchant à admettre autant d’enfants que possible pour que le ministère se rende à l’évidence de son incapacité à reprendre le projet, devenu trop important. La coordinatrice du projet de l’association décrit ainsi la situation : « Ils pensent toujours nous mettre dehors à la fin [de l’accord],le 13 septembre, mais si on continue de faire des admissions sur les sept premières zones de gouvernement local, plus quelques autres admissions sur les nouvelles, on aura dans le programme nutritionnel mi-septembre plus de 2 000 personnes, donc il sera impossible pour eux de les gérer et de prendre le relais. On verra à ce moment-là, mais on veut booster à fond le programme pour pouvoir avoir un maximum de bénéficiaires (double objectif : soins et pression) »Correspondance e-mail entre l’équipe de Katsina et l’équipe opérationnelle du siège, 30 août 2005.
Dans cette surenchère, l’équipe brandit explicitement la menace d’une communication publique, et envisage même un temps d’ouvrir de nouveaux centres sans autorisation, après avoir tenté de convaincre les autorités que « sans une intervention rapide et appropriée, 50 % des enfants sévèrement malnutris [mourront]». 26. Rapport MSF « Results and orientation », août 2005.
Au final, la confrontation attendue n’a pas lieu : les autorités concèdent à MSF quelques semaines supplémentaires et le nombre de patients pris en charge diminue dès fin septembre. Les équipes ferment un par un les centres ambulatoires accueillant moins de cent bénéficiaires, ce qui a comme conséquence de diminuer le nombre de références d’enfants malades au centre de stabilisation nutritionnelle de Katsina, et, à partir de cette période, elles suivent à la lettre les critères de décharge des patients. Bientôt, elles n’ont plus besoin de plaider pour l’ouverture d’un nouveau centre de stabilisation.
Après avoir lutté pour maintenir leurs activités nutritionnelles dans le cadre de ce qu’elles percevaient comme une crise sévère, les équipes de MSF semblent de plus en plus convaincues que l’association n’a plus de rôle à jouer dans un contexte de malnutrition désormais « endémique » après avoir été de nature « épidémique ». En novembre, après une réunion à laquelle participent l’équipe de coordination et celle du siège, MSF met en œuvre un plan de fermeture. L’organisation hésite à communiquer publiquement sur la nécessité que soit maintenu un dispositif de prise en charge de la malnutrition, mais quitte finalement l’État de Katsina dans la plus grande discrétion, pour ne pas compromettre un retour éventuel. Les équipes transfèrent les activités aux autorités sans être dupes de leur devenir : « Nous savions que le gouvernement ne reprendrait pas les activités correctement, même si nous avons essayé de nous faire croire le contraire au moment de partir. […] trois jours après notre départ, le centre de stabilisation était vide, et ils avaient arrêté d’admettre les enfants dans le programme ambulatoire, pour qu’il soit fermé à la fin janvier. »Extrait traduit du rapport final de la mission Katsina, janvier 2006.
En fermant précipitamment le programme, le ministère de la Santé de l’État de Katsina a cherché avant tout à ôter de sa vue MSF et ses activités embarrassantes alors que démarrait la campagne électorale du gouverneur pour les présidentielles de 2007, au terme de laquelle ce dernier a effectivement pris la tête du pays.
L’intervention de MSF dans l’État de Katsina a permis que plus de 12 000 enfants soient traités contre la malnutrition, pendant une période extrêmement critique, grâce aux efforts de négociation de ses équipes pour maintenir ses programmes plusieurs semaines après l’échéance fixée par les autorités. Dès que la visibilité opérationnelle et médiatique des activités de MSF est devenue gênante pour les autorités sanitaires, l’association a entretenu un rapport de forces avec elles à l’aide de deux arguments de poids : des milliers de patients qu’elle seule pouvait continuer à traiter, et dont l’abandon soudain aurait pu prendre le gouvernement directement en défaut ; la menace d’une communication publique à laquelle l’agenda électoral rendait les autorités plus sensibles qu’à l’accoutumée. En rendant la malnutrition visible, MSF a pu exercer une influence directe sur les autorités. Mais en acceptant à nouveau de la rendre invisible, y compris à ses propres yeux, elle a renoncé à considérer la malnutrition aiguë sévère comme un problème de santé publique sur lequel exercer son savoir-faire, sa capacité d’innovation et d’influence.
Relations (de santé) publiques
Dans le cadre d’une stratégie plus globale visant à améliorer sa capacité de réponse aux urgences dans le Nord, MSF France met en place en 2006 une équipe de surveillance et de réaction mobile, composée de médecins nigérians. Ce « pool d’urgence » se concentre bientôt sur les États de Jigawa – où les autorités sanitaires se sont montrées coopératives –, de Kano et de Katsina. Ce dispositif est conçu pour être léger et réactif : il s’appuie sur un réseau de personnes de bonne volonté, tissé par MSF à l’intérieur du système de santé nigérian au fil de ses expériences, relayant des alertes que les membres du pool tentent alors de vérifier sur place, en s’appuyant sur d’autres alliés qui leur facilitent l’accès aux données de terrain. Entre 2006 et 2008, tandis qu’elle parvient à répondre à plusieurs urgences médicales dans des États qui s’ouvrent à elle – rougeole et malnutrition dans l’État de Yobe, choléra dans celui de Borno et méningite dans celui de Jigawa –, MSF tente plusieurs fois d’intervenir dans les États de Katsina et de Kano, au hasard des alertes qui lui parviennent. Pendant cette période, en ce qui concerne la rougeole, la malnutrition et le choléra, l’association ne parvient jamais à obtenir l’autorisation officielle de collecter des données ou de mener des enquêtes par elle-même, se retrouvant ainsi privée de la possibilité de justifier objectivement ses propositions d’intervention auprès des autorités sanitaires. En revanche, ces dernières s’ouvrent au dialogue quand il s’agit de méningite. En 2008, MSF vaccine ainsi près de 100 000 personnes dans l’État de Katsina, dans des circonstances peu favorables à l’efficacité de l’opération – intervention tardive, difficultés à établir les priorités vaccinales à cause des incohérences dans les données issues du système de surveillance –, mais avec l’assentiment de l’ensemble des autorités sanitaires. À l’issue d’une visite à Katsina début avril 2008, le coordinateur nigérian du pool d’urgence note ainsi : « Je dois dire que les autorités ont bien accueilli l’idée que MSF participe à la campagne de vaccination contre la méningite. Mais elles s’opposent à toute autre “invasion”, notamment la nutrition. »Rapport interne MSF, avril 2008.
La méningite, qui affecte les enfants comme les adultes, est en effet une maladie à fort bénéfice politique pour les gouvernants. Alors que le choléra et la rougeole révèlent respectivement l’insalubrité des infrastructures sanitaires et les défaillances des programmes vaccinaux de routine, que la malnutrition renvoie à l’incapacité d’un État à nourrir sa population, « [les épidémies de méningite] ne mettent pas en cause l’action des gouvernements quand elles touchent une société […]. Non seulement le pouvoir politique ne peut être tenu pour responsable de l’apparition du fléau, mais il peut aisément se mettre en scène comme bienfaiteur par l’organisation de campagnes de vaccination de masse»Jean-Hervé BRADOL, Marc LEPAPE, « Innovations ? », in Jean-Hervé BRADOL et Claudine VIDAL. (dir.), Innovations médicales en situations humanitaires. Le travail de Médecins Sans Frontières, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 11-25.. On comprend donc que les gouvernements du Nord hésitent d’autant moins à organiser une réponse leur servant d’opération de relations publiques qu’ils peuvent la faire largement sponsoriser par des acteurs extérieurs se portant volontaires tels que MSF.
Cette occasion se présente de nouveau en 2009 lors d’une importante épidémie de méningite au cours de laquelle les sections espagnole, hollandaise et française de MSF vont intervenir simultanément dans neuf États. MSF-France se concentre d’abord sur ceux de Jigawa et Katsina, encerclant l’irréductible Kano, où elle tente en vain d’obtenir l’autorisation d’agir, décidant après deux semaines de négociations infructueuses de se concentrer également sur l’État de Bauchi. En quatre mois, les sections vaccinent plus de 4,7 millions de personnes, dont plus de 1,5 million dans le seul État de Katsina. La couverture vaccinale est bonne, « les relations avec les autorités sont très satisfaisantes, et les autorités sont satisfaites [du] travail de MSF».Compte rendu de réunion, MSF, mai 2009.
À première vue, cette opération est donc un succès : elle a permis aux équipes de MSF d’agir à grande échelle sur un problème de santé publique majeur, avec l’assentiment, puis les félicitations d’autorités sanitaires traditionnellement réticentes aux interventions de l’association. Mais quel est l’impact réel de cette opération dans le contexte nigérian ?
Le vaccin polysaccharidique utilisé par MSF jusqu’à 2009 Il est aujourd’hui progressivement remplacé par un vaccin conjugué censé conférer une plus grande immunité. induit une mémoire immunitaire faible et transitoire – de l’ordre de deux à trois ans ; son pouvoir immunogène est inexistant chez les enfants de moins de deux ans et limité chez les moins de quatre ans ; il n’élimine pas le portageF. Marc LAFORCE, Neil RAVENSCROFT, Mamoudou DJINGAREY, Simonetta VIVIANI, « Epidemic meningitis due to Group A Neisseria meningitidis in the African meningitis belt. A persistent problem with an imminent solution », Vaccine, revue de l’International Society for Vaccines, B13-B19, vol. 27, supplément nº 2, 24 juin 2009.. Dès 1996, à l’issue de la vaccination massive organisée par MSF dans le nord du Nigéria, des recherches menées sur la base des observations recueillies pendant la campagne concluent que la vaccination contre la méningite, intervenue plusieurs semaines après le franchissement des seuils épidémiques, a eu un effet « marginal » puisqu’elle n’a permis d’éviter que 3,3 % des cas dans l’État de KatsinaHans VEEKEN, Koert RITMEIJER et Benson HAUSMAN, « Priority during a meningitis epidemic. Vaccination or treatment », Bulletin de l’OMS, 1998 ; Dr P. FARESE, Dr A. PROCUPET BLAUSTEIN ; Mr J. MARGETS et Dr PEREA, AEDES (Agence européenne pour le développement et la santé), évaluation de l’intervention de MSF dans le nord du Nigeria, 1996.. Le bilan médical tiré de cette opération plaide alors en faveur de campagnes de vaccination précoces et très localisées, plus efficaces qu’une vaccination massive en cours d’épidémie, d’autant que cette dernière stratégie mobilise des moyens humains et matériels considérables qui seraient plus utiles au renforcement de la prise en charge des malades.
Treize ans après ces conclusions, au début de l’épidémie de méningite de 2009, l’association est bien mieux armée pour y répondre efficacement : elle n’est plus en terra incognita et son pool d’urgence de médecins nigérians l’a rendue plus réactive. Mais le bilan de cette opération reste mitigé : une enquête menée par l’association indique que la vaccination dans l’État de Katsina en 2009 n’aura permis d’éviter la survenue que de 4,4 % des casMatthew FERRARI et al., « 2009 Katsina State meningitis outbreak : impact of the mass vaccination campaign » ; rapport Épicentre, mars 2010 ; « Time is (still) of the essence. Quantifying the impact of vaccination response in Katsina State, Nigeria 2009 », rapport Épicentre 2011. Pour permettre la comparaison, nous avons choisi de présenter le pourcentage de cas évités en 1996 et en 2009 à partir de la même méthode de calcul, telle que décrite par Robert W. PINNER et al., « Epidemic meningococcal Disease in Nairobi, Kenya, 1989, in The journal of infectious diseases, 1992, p. 359-364. malgré les efforts déployés par des centaines d’employés de MSF pour vacciner 1,5 million de personnes. De plus, l’impact réel de la vaccination sur le déclin de l’épidémie reste aussi difficile à établir en 2009 qu’en 1996, car l’apparition des pluies dès le mois de mai interrompt la transmission de la bactérie.
La rapidité d’intervention initiale de MSF dans l’État de Katsina, particulièrement remarquable, n’a donc eu qu’un effet marginal sur les résultats de la vaccination. Car « pour être efficace, [une telle] campagne doit être suffisamment sensible pour agir le plus vite possible, mais également assez spécifique pour ne pas s’engager dans une réponse inutileEugénie D’ALESSANDRO, « Méningite, du praticien au prescripteur », in Jean-Hervé BRADOL et Claudine VIDAL, op. cit., p. 102.». Or, au Nigéria, organiser une campagne de vaccination contre la méningite qui réponde à cette double contrainte est une mission impossible. Les faiblesses structurelles du système de surveillance et le délai nécessaire à l’organisation d’une telle opération débouchent sur des interventions inéluctablement tardives, quelle que soit la réactivité des équipes. Selon le coordinateur de l’OMS pour la préparation et la réponse aux épidémies, cette opération a répondu avant tout aux demandes des autorités et de la population, tant la réunion des conditions de l’efficacité d’une campagne de vaccination contre la méningite dans le contexte nigérian « relève de la science-fiction»Entretien, novembre 2010.. En outre, les autorités sanitaires accordent à l’apparente équité de la réponse une importance plus grande qu’à son efficacité : il s’agit de vacciner le plus de gens possible dans le plus d’endroits possible, afin de rassurer l’ensemble de la population. C’est pour satisfaire cette exigence qu’à Katsina, en 2009, les équipes de MSF ont accepté de vacciner certaines zones en dehors de toute considération épidémiologique.
En 1996, lors du colloque médical organisé par l’association sur les maladies infectieuses, le Dr Rey – un des experts de la méningite ayant contribué à la mise au point des traitements aujourd’hui utilisés par MSF – déclarait : « Jusqu’à présent, toutes les vaccinations de masse qui visaient à contrôler une épidémie de méningite ont été entreprises après le pic épidémique. Ce type d’action est rentable sur le plan politique, mais discutable sur le plan de la santé publique. »Dr Michel REY, Ligue française pour la prévention des maladies infectieuses, compte rendu du colloque médical de MSF, 1996.
Quelle a été la « rentabilité politique » de la campagne de vaccination de 2009 au-delà des bénéfices d’une opération de relations publiques ? Les autorités sanitaires de l’État de Kano, dont l’association espérait qu’elles fléchissent devant ses efforts dans les États voisins, sont restées sourdes au dialogue ; en revanche, celles de l’État de Katsina ont fait preuve d’ouverture, et les équipes de MSF ont été invitées ponctuellement à soutenir les structures de santé lors d’épidémies de rougeole et de choléra en 2010. Mais les ambitions opérationnelles de l’organisation ont continué à se limiter aux demandes des autorités sanitaires. Au final, nous faisons l’hypothèse que l’histoire des revers de MSF avec les États les plus récalcitrants du nord du Nigéria ont insensiblement influencé ses objectifs : dans sa volonté de conquérir les autorités sanitaires et politiques, le besoin d’agir l’a emporté sur les raisons d’agir.
Les tentatives de réponse aux épidémies dans le nord du Nigéria, qui sont autant de tentatives d’apprivoiser les pouvoirs, révèlent les limites de la coopération d’un acteur médical humanitaire avec les autorités sanitaires et politiques. Devant des questions de santé publique, les divergences entre ces dernières et MSF ne disparaissent pas par acculturation réciproque, comme le montre l’expérience de l’association à Kano. Leurs priorités ne se rejoignent pas non plus sous l’étendard des vies à sauver, que MSF a brandi en vain à Katsina. L’épisode de la méningite en 2009 montre enfin que la convergence des priorités sanitaires entre des autorités politiques et MSF peut avoir un prix à payer, celui de la pertinence de ses interventions, et fait courir à l’organisation le risque de rétrécir son horizon opérationnel à celui de ses hôtes.
L’alternative au nivellement des ambitions de MSF réside dans sa capacité à construire non pas de bonnes relations avec les autorités, mais les conditions d’un rapport de forces avec elles. Comment ? Peut-être en se montrant moins prévisible, donc moins vulnérable, dans les négociations avec les pouvoirs politico-administratifs nord-nigérians : en refrénant son goût pour l’action quand les raisons d’agir ne s’imposent pas, et en prenant le risque de déplaire aux autorités en osant mettre au jour, y compris publiquement, des enjeux négligés sur lesquels elle a une expertise à faire valoir, tels que le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë ou de la rougeole.
***
Inde. L’expert et le militant
STÉPHANE DOYON
En 2005, dans la région de Maradi, au Niger, MSF confirme à large échelle l’efficacité des nouvelles stratégies de prise en charge ambulatoire de la malnutrition aiguë sévèreLa malnutrition aiguë sévère résulte de la fonte des réserves de graisse et de muscle sous l’effet d’une diminution des apports en énergie et micro- nutriments. Ses tableaux cliniques sont le marasme, amaigrissement sévère qui se définit comme un écart à des normes anthropométriques, et, moins fréquent, le kwashiorkor, caractérisé par la présence d’œdèmes., permise par l’utilisation des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPELes aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) sont le nom géné- rique des pâtes de lait fortifiées en minéraux et en vitamines, en sachets, qui permettent la réhabilitation nutritionnelle de l’enfant malnutri. Le Plumpy’nut, produit par l’entreprise française Nutriset, se compose d’un mélange de lait, d’arachide et de vitamines et minéraux.). Elle prend en charge 60 000 enfants malnutris en quelques mois, dont près de 80 % sortent guéris du programme. Ces résultats étaient impossibles à obtenir avec les anciens protocoles de traitement, qui impliquaient l’hospitalisation de tous les enfants. À partir de 2007, MSF et la Came (Campagne d’accès aux médicaments essentiels)La Campagne d’accès aux médicaments essentiels (Came) est une organisation créée en 1999 par MSF afin d’améliorer l’accès à des outils thérapeutiques et à des traitements adaptés aux pathologies que ses équipes rencontrent sur le terrain.

se donnent pour objectif d’accroître l’accessibilité des ATPE en favorisant l’émergence d’initiatives de production locale de pâtes de lait, par exemple au Niger, et en stimulant les efforts de recherche et développement en ce sens. Les possibilités de traitement de masse qu’offrent les ATPE incitent également MSF à s’impliquer dans des zones où la malnutrition est endémique et à tenter de réformer les politiques nutritionnelles nationales et internationales.
L’Inde, qui compte à elle seule environ 40 % des enfants sévèrement malnutris de toute la planète4. « Maternal and child undernutrition : global and regional exposures and health consequences », The Lancet,http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol371no9608/PIIS0140-6736(08)X6004-0 , pp. 243-260, 19 janvier 2008., ouvre à MSF la perspective de concrétiser ses ambitions politiques et opérationnelles, d’autant plus que la malnutrition est loin d’y être un sujet tabou : en 2007, le jour anniversaire des soixante ans de l’indépendance du pays, Manmohan Singh, le Premier ministre, déclare ainsi : « Le problème de la malnutrition est une honte nationale. Je demande aux forces de la nation de travailler sans retenue pour éradiquer la malnutrition d’ici à cinq ans. »Extrait du discours du Premier ministre cité dans « “Shame” of India in its 60th year », Daily Mail, août 2007.
La persistance, voire l’augmentation, de la malnutrition en Inde est doublement gênante pour le gouvernement. D’une part, elle signifie l’échec de programmes nationaux tels que le Schéma de développement intégré pour l’enfant (Integrated Child Development Scheme), mis en place en 1975 qui est censé offrir aux enfants de moins de six ans des repas préparés dans des centres de santé communautaires, les Anganwadi. D’autre part, elle révèle que la croissance indienne n’a pas permis de faire baisser la malnutrition, problème que soulignent de nombreux observateurs nationaux et internationaux. L’Association des pédiatres indiens note ainsi que « malgré des améliorations dans les secteurs de l’économie et de la santé, les taux d’alphabétisation, les indices sanitaires et nutritionnels, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère [telle que définie par les normes de l’OMS] continue à être à un niveau inacceptable, particulièrement chez les enfants de moins de trois ans »Indian paediatrics, volume 43, 17 février 2006.. La dernière enquête nationale indienne effectuée en 2005 et 2006National Family Health Survey (NFHS) – 3, 2005-2006. montre que, comme le souligne une journaliste indienne spécialisée dans les questions de développementP. CHATTERJEE, « Child malnutrition rises in India despite economic boom », The Lancet, 369, no 9571, pp. 1417-1418., « la malnutrition infantile augmente malgré le boom économique [de l’Inde] Jeremy PAGE, « Indian children suffer more malnutrition than in Ethiopia », The Times, 22 février 2007.» : par exemple, dans l’État d’Haryana, l’un des plus prospères du sous-continent, le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de trois ans est passé de 34,4 % en 1998-1999 à 41,9 % en 2005-2006, et le taux de malnutrition aiguë de 5,3 % à 16,7 % sur la même période. La presse internationale renchérit : « Les résultats [de l’enquête nationale de 2006] sont une illustration choquante de la façon dont la récente croissance économique de l’Inde a su enrichir son élite et ses classes moyennes tout en laissant de côté la moitié de ses 1,1 milliard d’habitants »10. The Right to Food campaign, ci-après dénommée Right to Food. Pour plus d’information : www.righttofoodindia.org., écrit ainsi un journaliste du Times en 2006, dans un article au titre provocateur : « Les enfants indiens souffrent plus de malnutrition que les Éthiopiens ».
Parmi les « forces de la nation » invitées par le Premier ministre à s’atteler au problème de la malnutrition, Right to Food 10, la Campagne pour le droit à l’alimentation indienne, occupe une place à part. Ce mouvement informel de militants, d’experts et d’organisations de défense des droits de l’homme est né en 2001 d’une pétition envoyée à la Cour suprême indienne demandant au gouvernement qu’il utilise ses stocks alimentaires alors qu’une famine menace sa population. Depuis, la Cour suprême, sur la base des alertes que lui relaie la société civile, émet des « ordonnances provisoires » ayant force de loi, qui exigent du gouvernement qu’il protège le droit à l’alimentation, en garantissant notamment l’accès à des programmes nationaux – cantines scolaires, distributions, travail contre nourriture, etc.
Pour Right to Food, la malnutrition doit être traitée sous tous ses aspects : la crise agraire qui s’approfondit, les politiques publiques qui négligent les enfants, les discriminations de genre, le démantèlement du système de distribution public, le système de castes, mais aussi l’influence croissante des intérêts commerciaux dans la fabrication des produits destinés aux bébés, des semences génétiquement modifiées et de l’expérimentation biotechnologique. Ses membres organisent des manifestations, publient des analyses scientifiques, rédigent des propositions de loi afin de modifier le contenu des programmes sociaux et alimentaires nationaux ou la législation. Ses avis ont d’autant plus de poids dans l’évolution des politiques et des lois indiennes que les militants qui les relaient peuvent parfois occuper des fonctions officielles. Ainsi, l’un des architectes de Right to Food, Biraj Patnaik, est le conseiller spécial auprès de la Cour suprême pour le droit à l’alimentation.
La campagne utilise une vaste gamme de stratégies d’influence : activisme légal, mobilisation populaire et contestation, mais aussi concertation et collaboration avec l’État, auquel il accorde une valeur particulière : c’est à celui-ci qu’incombe la responsabilité de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à sa population en améliorant ses services. Ni l’État indien ni Right to Food n’entendent donc laisser le problème de la malnutrition entre les mains d’organisations étrangères, accusées de défendre leurs intérêts au détriment de l’intérêt commun. En 2003, l’Inde a ainsi interdit des donations en aide alimentaire effectuées par des organisations humanitaires américaines, considérant que les farines enrichies distribuées étaient susceptibles de comporter des éléments génétiquement modifiés les rendant impropres à la consommation humaine« India bars entry of NGOs’ modified Corn-Soya Blend », The Indian Express, Express news service, 6 mars 2003.. Des organisations de la société civile indienne y avaient vu la preuve que cette aide étrangère « était un prélude au dumping commercial d’aliments génétiquement modifiés que les multinationales américaines n’arrivent pas à écouler sur les marchés européens ».K.S. JAYARAMAN, « U.S. food aid to India still under GM cloud », Crop- Choice news, in Nature Biotechnology, vol. 21, no 4, avril 2003.
Des conceptions différentes de la malnutrition
La malnutrition, qu’ils semblent avoir pour ennemi commun, ne renvoie cependant ni à la même réalité ni aux mêmes solutions selon MSF et selon Right to Food, comme vont le révéler leurs premières rencontres en 2008. Pour MSF, s’attaquer à ce problème de santé publique, c’est avant tout tenter de répondre à l’urgence médicale que constitue la malnutrition aiguë, épisode pathologique au cours duquel le corps commence à consommer ses propres tissus pour y trouver l’énergie et les nutriments nécessaires à sa survie. Or, en Inde, cette conception n’est pas d’usage : la malnutrition renvoie à un retard du développement de l’enfant, qui révèle que ses besoins alimentaires ne sont pas couverts. En d’autres termes, MSF perçoit dans la malnutrition un risque de mortalité qu’il s’agit de réduire par un traitement approprié alors que Right to Food y voit avant tout le reflet d’une injustice sociale ouvrant droit à des prestations de l’État. Dans cette différence de conception pointe une divergence sur la façon d’envisager les solutions prioritaires au problème de la malnutrition.
Le développement d’un système de réhabilitation nutritionnelle en ambulatoire a fait débat au sein de MSF depuis son expérimentation au Niger, à partir de 2002, et a nécessité un changement de ses pratiques et de ses perceptionsIsabelle DEFOURNY, « Du Plumpy’nut au Plumpy’ doz », Niger 2005, une catastrophe si naturelle, Xavier CROMBÉ, Jean-Hervé JÉZÉQUEL (dir.), Khartala, 2007. : déléguer la plus grande partie de la responsabilité de l’administration du traitement nutritionnel aux mères nécessite de renoncer au suivi médical étroit de l’enfant que permettait son hospitalisation avec les anciens protocoles. Paradoxalement, la médicalisation de la malnutrition est donc passée par une certaine démédicalisation des pratiques de MSF que l’existence des ATPE a rendue acceptable du point de vue de l’efficacité thérapeutique. En effet, le recours aux traitements sous forme de pâtes prêtes à l’emploi ne nécessite plus la préparation soigneuse de rations thérapeutiques à base de lait et d’eau dans des conditions d’hygiène irréprochables, et rend moins nécessaire la présence du soignant dans le parcours de soins de l’enfant. Si celui-ci a de l’appétit, quelle que soit la sévérité de son état nutritionnel, il est autorisé à rentrer chez lui avec des sachets individuels de pâtes de lait. La posologie du traitement est simple et un suivi hebdomadaire suffit à vérifier la progression de sa courbe de poids.
Mais là où MSF voit dans les ATPE la simplification de la distribution, de l’administration et de l’utilisation des traitements nutritionnels, condition sine qua non d’une délégation de sa responsabilité médicale aux familles des enfants malnutris, Right to Food perçoit un risque d’aggravation de la pauvreté et de démobilisation sociale. Pour ses militants, la réponse au problème de la malnutrition passe en effet par la multiplication des points de rencontre entre des catégories marginalisées – les femmes, les basses castes – et le reste de la société. La préparation même des repas destinés aux enfants, qui emploie plus de quatre millions de femmes en IndeLeena MENGHANEY, « Winners and losers in India, a major crisis in a boo- ming economy », mars 2008, www.msf.org., offre cette possibilité de brassage social.
Le Plumpy’nut, l’aliment thérapeutique utilisé par MSF dans la plupart de ses missions, est un produit commercial, breveté dans certains paysLe Plumpy’nut est protégé par deux brevets détenus par l’entreprise Nutriset jusqu’en 2017 et 2021. L’un et/ou l’autre sont déposés dans trente-neuf pays, dont l’Inde ne fait pas partie., fabriqué à l’étranger : il est perçu par une partie des membres de Right to Food comme le cheval de Troie d’une industrie agroalimentaire étrangère, contre laquelle le mouvement est en lutte« Not biscuits, cooked food in mid-day meal scheme : minister », Thain- dian News, 17 mars 2008.. Ainsi, en avril 2008, ses membres feront irruption dans une réunion organisée en Inde par la Gain (Global Alliance for Improved Nutrition), fondation internationale associée aux entreprises privées, dont l’objectif affiché est de réduire la malnutrition en assurant la présence de produits adaptés sur les marchés. Lors de cette réunion, les militants demanderont à la Gain d’« épargner à l’Inde sa stratégie visant à développer des marchés prometteurs pour les multinationales et les industries agroalimentaires [tels que] Unilever, Cargill, Danone et Wockhardt » et féliciteront le gouvernement de n’avoir pas « succombé aux lobbies des fabricants de biscuits et résisté à leurs tentatives de remplacer les repas chauds cuisinés distribués [dans ses programmes nutritionnels] ».« Media brief. People call upon Gain to leave India and government of India to regulate PPPs », CNN report, 16 avril 2008.
La tendance la plus radicale au sein de Right to Food est incarnée par le BPNI (Breastfeeding Promotion Network in India), réseau de promotion de l’allaitement maternel né de la contestation des stratégies commerciales de diffusion de laits artificiels utilisées par Nestlé en Afrique dans les années 1970. Le coordinateur du plus grand réseau mondial de promotion de l’allaitement maternel prête à MSF l’intention de « légitimer des produits commerciaux pour la nutrition des jeunes enfants [...] en créant une solution simpliste au problème de la malnutrition » Arun GUPTA, « Commercialising young child feeding in the globalised world : Time to call for an end ! ! », 2009, www.rtfn-watch.org.
. Sa suspicion est d’autant plus grande que MSF fait part de son intention, dans ses documents de communication publique et au sein des forums scientifiques internationaux, d’utiliser des dérivés d’ATPE pour prévenir la malnutrition. Il déclare ainsi : « L’histoire d’un succès en situation d’urgence [au Niger] devient bien vite une intervention généralisable pour prévenir et traiter la malnutrition sévère. [...] À partir du moment où l’on commence à utiliser les aliments prêts à l’emploi en stratégie préventive, comme le réclament ces agences internationales, la nutrition de l’enfant se transforme en marché. » Ibid.
C’est dans ce contexte que trois approches vont être déclinées par trois acteurs animés d’une même ambition apparente, le traitement de la malnutrition aiguë sévère en Inde : l’action directe et discrète, menée par MSF-Espagne ; l’alliance politique avec Right to Food, incarnée par la Came ; la stratégie du fait accompli à grande échelle, adoptée par l’Unicef à partir de 2008.
Agir et prescrire
En août 2007, l’État du Bihar est frappé par des inondations. MSF-Espagne met en place des consultations mobiles dans le district de Dharbanga pendant deux mois. Durant cette période, ses équipes détectent de nombreux enfants malnutris et prennent en charge environ un millier d’entre eux avec du Plumpy’nut. Après la décrue, l’association ferme son programme, mais décide de mener une enquête nutritionnelle. Celle-ci confirme la situation pressentie par les équipes : 20 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont près de 5 % sévèrement« Retrospective mortality, nutrition and measles vaccination coverage survey. Dharbanga district, Bihar State, India », juin 2008. MSF-Espagne, Épicentre., ce qui correspond à une situation d’urgence d’après les standards internationaux. Une enquête de sécurité alimentaire menée par MSF établit que la malnutrition « n’est pas épisodique et liée aux inondations de 2007, mais un problème endémique et de long terme ».« Livelihoods and risk of malnutrition in Darbhanga, Bihar », rapport MSF, avril 2008.
L’association décide d’ouvrir un programme dans le district de Dharbanga. Son choix géographique est guidé par la gravité de l’état nutritionnel et sanitaire observé au sein de la population, à laquelle aucune réponse locale n’est apportée. C’est donc parce qu’elle y est directement confrontée que MSF-Espagne décide de s’impliquer sur la question de la malnutrition et entame des négociations au niveau local à partir de 2008. Son responsable des programmes décrit ainsi que « ce projet ne répond pas à un agenda politique impulsé depuis les sièges. Il est d’abord né du terrain. [...] On ne sait d’ailleurs pas encore sur quoi il va déboucher, mais il faut accepter cette part de tâtonnement et d’incertitude. L’essentiel aujourd’hui c’est de pouvoir sauver les vies de ces enfants ».Jean-Hervé BRADOL, Jean-Hervé JÉZÉQUEL, « Dénutrition infantile, intérêts et limites de l’approche médicale humanitaire », Cahier du CRASH-MSF, p. 18.
Mais la zone est enclavée, faiblement dotée en infrastructures sociales et médicales, touchée régulièrement par des moussons qui inondent une grande partie de sa superficie, entraînent des déplacements de population, et rendent son accès difficile. Si ces conditions très précaires justifient d’agir, elles sont autant d’entraves à la réalisation d’un objectif de démonstration des résultats du programme de MSF, qui exige un suivi permanent des patients, jusque dans leurs foyers, afin d’être en mesure d’établir les « preuves scientifiques » susceptibles de convaincre la société indienne.
La section espagnole de MSF ne revendique pas en première intention un objectif de démonstration de l’efficacité de sa stratégie ni de transformation de la prise en charge nutritionnelle des enfants à l’échelle du pays, mais une action immédiate et locale. La modestie de ses intentions traduit une volonté de ne pas répéter son expérience récente dans le traitement d’une autre pathologie, la leishmaniose viscérale, endémique en Inde, et dont le Bihar abrite entre 80 % et 90 % des malades recensés dans le pays. Poursuivant l’ambition de faire évoluer le protocole national de prise en charge, MSF avait travaillé en association étroite avec le ministère de la Santé, un institut de recherche indien et les autorités locales et nationales, avec lesquelles elle avait dû longtemps composer et négocier avant d’atteindre une première étape : être autorisée à utiliser le traitement de son choix dans ses programmes. L’association avait jugé ces délais trop longs, comme elle l’avait exprimé publiquement dans les termes suivants : « Après un long processus bureaucratique qui a duré plus d’un an, MSF-Espagne a commencé à accueillir et traiter des patients atteints de leishmaniose viscérale. »MSF, « India : MSF comienza a tratar pacientes de kala azar », commu- niqué de presse, août 2007.
La section espagnole va donc chercher à traiter la malnutrition directement, rapidement, et à contourner le plus possible les contraintes procédurières qu’elle a expérimentées en voulant transformer les pratiques nationales de prise en charge de la leishmaniose. Elle souhaite d’abord limiter la visibilité de ses activités, tout en espérant que, dans un second temps, les résultats du programme parleront d’eux-mêmes, et lui permettront d’envisager des actions de plaidoyer destinées à modifier les pratiques de prise en charge de la malnutrition en Inde.
La Came, qui soutient MSF-France dans sa volonté de démarrer un projet nutritionnel en Inde à partir de 2007, se donne au contraire d’emblée comme objectif de contribuer à transformer les pratiques et les politiques nationales : « Il s’agit d’ouvrir un programme pilote qui montre la possibilité et l’efficacité de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et [...] de contribuer à diffuser cette prise en charge à l’intérieur du pays, en amenant la société civile, les intellectuels et les forces politiques à se l’approprier. »Jean-Hervé BRADOL, Jean-Hervé JÉZÉQUEL, op. cit., p. 39-40.
La section décide de s’appuyer sur le bureau indien de la Came. Cette structure a été créée en 2005 pour plaider en faveur d’un cadre légal et juridique favorable à la production nationale de médicaments génériques à moindre coût, en alliance avec des organisations de la société civile indienne. Proche de Right to Food, l’un de ses membres clés prédit l’échec d’un projet de nature importée et préconise d’associer étroitement les membres de la société civile et le gouvernement afin de trouver une solution au problème de la malnutrition à l’indienne. C’est avec ces réticences qu’il rejoint l’équipe d’évaluation de MSF, composée de deux ardents promoteurs d’une large utilisation des ATPE, qui se rend dans un district de l’État de l’Orissa en juillet 2008. Cette évaluation, destinée à explorer les possibilités d’ouverture d’un projet pilote, va permettre la réconciliation des points de vue autour de l’enfant malnutri : un dépistage rapide des enfants sur la base de l’évaluation de leur périmètre brachial révèle que un sur dix est atteint de malnutrition aiguë sévèreRapport de visite interne, MSF, août 2008. En quête de solutions de prise en charge, les trois membres de la Came constatent que les cantines du programme gouvernemental local n’ont aucune nourriture à offrir. La personne qui représente la Came indienne est consternée par le hiatus entre le dispositif théorique et sa traduction concrète, et décidera même d’alerter la Cour suprême indienne, garante du droit à l’alimentation. Dans les commerces locaux, l’équipe ne trouve que l’équivalent de « traitements compassionnels » de la malnutrition, selon l’expression d’un de ses membres, c’est-à-dire des produits alimentaires dont la composition est inadaptée aux besoins spécifiques de l’enfant malnutri. À l’issue de la mission, les trois membres de MSF partagent la même opinion : ni le gouvernement ni le marché n’offrent de solutions à la malnutrition aiguë sévère bien qu’il existe un réseau d’organisations communautaires locales actives sur lesquelles un dispositif de prise en charge pourrait s’appuyer.
Quelques semaines après cette évaluation, en août 2008, des inondations frappent l’Inde. Le Premier ministre qualifie ce désastre de « calamité nationale » et appelle à l’aide internationale. MSF-France répond en fournissant des soins de santé primaires à la population d’un des districts de la région côtière de l’Orissa et entame de longues négociations avec les autorités locales dans une perspective d’ouverture d’un programme nutritionnel.
En parallèle, le dialogue entre MSF et les militants du droit à l’alimentation se renforce de rencontre en rencontre. Malgré leurs divergences de vues initiales, les militants accordent leur confiance à MSF : ils connaissent son combat contre les laboratoires pharmaceutiques pour l’accès aux médicaments génériques et sont de plus en plus sensibles à la nécessité de développer une approche curative pour les quelque huit millions d’enfants indiens touchés par la malnutrition aiguë sévère. Cette sensibilité fait écho au plaidoyer de l’Association des pédiatres indiens pour l’adoption d’un modèle de prise en charge ambulatoire : « En Inde, il n’y a que 900 000 lits d’hospitalisation. L’admission de tous ces enfants [malnutris] est donc infaisable du point de vue opérationnel, ce qui fait des stratégies de prise en charge à domicile une alternative inévitable. »Indian Paediatrics, vol. 43, 17 février 2006.
En décembre 2008, Right to Food organise une réunion afin de débattre de la question de la prise en charge de la malnutrition aiguë en Inde avec MSF. Y participent ses membres les plus impliqués dans les questions nutritionnelles et un médecin de l’Institut de recherche nutritionnelle indien invité pour ajouter une contre-expertise scientifique à celle de MSF et discuter des possibilités d’une documentation d’expérience conjointe. Les discussions achoppent à nouveau sur la question du traitement : pour Right to Food, il est hors de question d’accepter l’importation d’ATPE. MSF pense alors faire un pas dans la bonne direction en annonçant qu’une production locale devrait voir prochainement le jour avec des entreprises implantées en Inde, tels Cipla ou CompactCipla est un laboratoire pharmaceutique indien spécialisé dans la pro- duction de médicaments génériques. Compact est une entreprise norvé- gienne spécialisée dans la production de biscuits protéinés et de produits nutritionnels, avec lesquelles elle a entamé des négociations. Mais les militants ne veulent pas que des intérêts commerciaux soient associés à la production d’un bien public : le modèle économique qu’ils seraient prêts à soutenir est celui d’une structure communautaire, coopérative ou publique, de préférence à taille humaine. C’est à cet impératif de production que devra s’adapter le contenu du produit, et non l’inverse. MSF avance que la fabrication industrielle et centralisée des ATPE offre les meilleures garanties de qualité – standardisation du contenu et du conditionnement du produit, contrôle des conditions d’hygiène –, mais les militants estiment qu’à l’échelle du sous-continent mieux vaut courir le risque de problèmes de qualité récurrents mais localisés que celui d’un accident industriel sur une chaîne de production unique.
MSF s’engage donc à stimuler les initiatives de production indienne préconisées par Right to Food. Cependant, elle revendique aussi d’introduire la prise en charge de la malnutrition à l’aide de produits importés en invoquant qu’« il y a urgence à traiter les enfants et qu’il faut utiliser les produits thérapeutiques disponibles afin de ne pas retarder le traitement, car mettre au point une nouvelle recette locale demandera beaucoup de temps »Rapport de visite MSF, décembre 2008.. À la fin de la réunion, ce droit lui est accordé : sensibles à la nécessité de faire quelque chose face à un problème dont ils déplorent la persistance, les militants acceptent que MSF démarre des activités nutritionnelles intégrant des ATPE importés, à condition que ces activités n’interfèrent pas avec les programmes nationaux, et l’enjoignent à faire la preuve scientifique que les stratégies qu’elle préconise sont adaptées à la réalité de la malnutrition indienne.
Mais, tandis que MSF-France et MSF-Espagne sont en cours de négociation pour l’ouverture de leurs projets respectifs dans l’État du Bihar et de l’Orissa, les conséquences d’une stratégie plus offensive adoptée par l’Unicef vont changer la donne.
Coup d’État médical
Depuis 2006, l’Unicef mène un programme de prise en charge de la malnutrition sévère dans l’État du Madhya Pradesh. Ce programme est hybride : il compose avec les normes de détection et de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère conçues par l’OMS et avec les pratiques indiennes, qui diffèrent notamment sur les critères d’identification de la malnutrition. Il consiste en centres de réhabilitation nutritionnelle, où sont hospitalisés et soignés durant quinze jours les enfants souffrant de malnutrition selon les standards indiens, c’est-à-dire les enfants chroniquement malnutris – présentant un écart à la norme entre leur poids et leur âge – et les enfants très émaciés. Les autorités sanitaires du Madhya Pradesh sont sensibles à la nouveauté introduite par l’Unicef, c’est-à-dire à la médicalisation du traitement de la malnutrition, et contribuent à développer ce système : ainsi, fin 2008, l’État du Madhya Pradesh compte 182 centres de réhabilitation nutritionnelle.
Mais, pour le nouveau représentant nutritionnel de l’Unicef arrivé en Inde en 2008, Victor Aguayo, conseiller régional en nutrition pour l’agence des Nations unies au Niger en 2005, ce modèle présente de trop nombreuses limites : il nécessite l’hospitalisation d’un grand nombre d’enfants qui pourraient être pris en charge en ambulatoire ; il n’offre pas de solutions adaptées à ceux souffrant de malnutrition chronique ; enfin, les aliments ne sont pas produits de façon standardisée, mais sur place avec de la nourriture achetée localement, qui n’est donc pas enrichie des minéraux et vitamines nécessaires à la récupération de l’enfant. Ces constats sont corroborés par deux experts internationaux de la nutrition invités par l’Unicef pour faire un bilan du programme. L’agence des Nations unies décide alors de modifier les protocoles du programme en y introduisant des produits importés dont elle peut garantir la qualité. Ses représentants choisissent ainsi de passer outre l’opposition de Right to Food à l’utilisation d’ATPE industriels et étrangers. Ainsi que le révèlent plusieurs discussions entre des responsables de MSF et de l’Unicef en 2008, l’agence des Nations unies, témoin de l’action coup de poing de Right to Food lors de la réunion organisée par la fondation Gain, perçoit cette alliance issue de la société civile comme un mouvement radical, dont l’hétérogénéité idéologique limite l’influence. L’Unicef décide donc de s’en tenir à des relations avec les représentants de l’État et, pour justifier sa volonté de réforme, recourt à des arguments d’autorité. Son représentant dans l’État du Madhya Pradesh déclare ainsi : « Les ATPE ont été une véritable révolution. L’Inde ne peut tout simplement pas dire non à leur utilisation. »« India tries new way to reach its underfed children », Reuters, 18 mars 2008.
C’est paradoxalement Right to Food qui va offrir à l’organisation des Nations unies une occasion de mettre en œuvre sa réforme. Au démarrage de la campagne pour les élections législatives du Madhya Pradesh prévues fin 2008, la section locale de Right to Food tente de mettre la malnutrition à l’ordre du jour. Cet État est réputé comme le plus affecté par la malnutrition sévère, avec un nombre de cas annuel estimé à 1,26 million d’enfantsNFHS-3. 2005-6., et il est cette année-là frappé par la sécheresse. Les militants stigmatisent alors le « gouvernement du Madhya Pradesh, [qui] semble sourd à toutes ces informations concernant le fléau de la faim dans son État [et] refuse constamment de reconnaître la situation en déclarant que la véritable raison de la mort de ces enfants n’est pas la malnutrition »Right to Food Campaign Madhya Pradesh support group, « Moribund ICDS », pp. 22-23.. Les médias relaient la situation à l’aide des images chocs recueillies dans les centres nutritionnels gouvernementaux appuyés par l’Unicef.
Saisissant cette occasion, l’Unicef propose au gouvernement, mis dans l’embarras par les déclarations de Right to Food, un moyen de sauver la face : autoriser les stratégies de prise en charge intégrant le Plumpy’nut, qui promet des résultats rapides et efficaces. Face à une urgence sanitaire et électorale, le gouvernement du Madhya Pradesh approuve cette initiative, sans toutefois la formaliser dûment. En août 2008, le Plumpy’nut est introduit dans les centres nutritionnels de deux districts où la mort de nombreux enfants a été rapportée dans les médias. Dans la foulée, à la faveur d’inondations qui lui fournissent un autre motif d’exception, l’Unicef introduit le Plumpy’nut dans l’État du Bihar.
Mais, en octobre 2008, les membres de la campagne Right to Food de l’État du Madhya Pradesh découvrent que l’Unicef distribue aux enfants de la nourriture importée et en sachet, du Plumpy’nut, sans autorisation du gouvernement fédéral ni consultation préalable alors que la Cour suprême indienne a interdit l’utilisation d’aliments industriels dans les programmes alimentaires nationaux en 2004.
Une réunion de crise est organisée dans le Madhya Pradesh, à laquelle participent l’Unicef et Right to Food dont Biraj Patnaik, conseiller spécial auprès de la Cour suprême indienne et interlocuteur privilégié de MSF. Il tente d’intercéder en faveur du développement de la prise en charge de la malnutrition avec de nouvelles approches, tout en exigeant que celles-ci soient adaptées au contexte indien. Mais la suspicion des militants à l’égard de l’Unicef est forte : l’organisation est accusée d’avoir violé les principes de souveraineté nationale en important le Plumpy’nut et en mettant en place un protocole inexistant en Inde sans concertation avec les autorités nationales. Sa proximité avec la fondation Gain nourrit l’idée qu’elle cherche avant tout à ouvrir un marché pour des multinationales agroalimentaires. Comme la Constitution indienne lui en offre la possibilité, Right to Food lance une procédure de demande d’information au gouvernement, réclamant qu’une enquête soit menée sur les conditions d’introduction des ATPE et la responsabilité de l’État indien dans ce processus.
En février 2009, le ministère en charge d’approuver le plan d’activité de l’Unicef lui demande de retirer les ATPE de son budget, car ils ne sont pas acceptés par le gouvernement. L’approvisionnement des programmes de l’agence des Nations unies est bloqué. Au même moment, apparemment alerté par les membres les plus radicaux du BPNI, un député interpelle le ministre de la Santé au cours d’une séance de l’Assemblée nationale : « Le ministère est-il au courant que l’Unicef et MSF ont importé sans accord gouvernemental des produits nutritionnels industriels ? » Incité publiquement à faire preuve d’une fermeté exemplaire, le gouvernement fédéral somme l’Unicef de s’expliquer. L’agence des Nations unies se retranche derrière l’impérieuse nécessité d’agir en urgence à laquelle ont conduit les inondations dans le Bihar et la sécheresse dans le Madhya Pradesh. En mai 2009, le ministère de la Santé lui rappelle dans une lettre qu’elle est soumise aux règles nationales et qu’elle doit notamment respecter la souveraineté du gouvernement sur les questions nutritionnelles et la réponse aux urgences. Il exige non seulement qu’elle mette fin à l’utilisation des ATPE, mais aussi qu’elle réexporte le stock restant et qu’elle en restitue sous forme de programme l’équivalent de la valeur marchande.
Les conséquences de ce coup de théâtre sont immédiates pour MSF-France. Les négociations avec les autorités locales de l’Orissa, qui traînaient en longueur depuis quelques mois, avortent. Celles-ci refusent en effet de se mettre en porte-à-faux avec le gouvernement fédéral et invitent MSF à tenter de résoudre le problème à Delhi. Après un an de discussions qui paraissaient déjà trop longues pour la plupart de ses responsables opérationnels au siège, MSF décide de rapatrier l’équipe et d’abandonner son projet d’ouverture.
MSF-Espagne a quant à elle réussi à signer un accord pour le démarrage d’un projet avec les autorités sanitaires du district de Dharbanga début 2009. Certes sa portée initiale est limitée au traitement de la malnutrition aiguë sévère avec des ATPE, l’accord ne prévoyant pas d’activité de recherche. La section espagnole a privilégié l’aboutissement d’un accord local lui permettant de mettre en place ses activités de traitement le plus rapidement possible. Protégé par la discrétion de ses activités, la modestie de ses ambitions affichées, le confinement de son programme dans une zone reculée, mais aussi par un pacte implicite de non-agression avec Right to Food, le programme de la section espagnole n’est pas affecté par les déboires de l’Unicef.
Échec opérationnel et succès de santé publique
La controverse autour du Plumpy’nut a provoqué l’arrêt des activités nutritionnelles de l’Unicef mais a alimenté un débat national, largement relayé par les médias indiens, sur les possibilités d’« indianiser » le traitement de la malnutrition sévère, auquel MSF continue de participer, à côté de l’Institut indien de formation et de recherche médicale, de l’Association des pédiatres indiens, de Right to Food et des représentants du gouvernement. Pour limiter la polémique sur les liaisons dangereuses entre le produit et l’industrie agroalimentaire, les ATPE ont été rebaptisés « thérapies médicales nutritionnelles ». Lors d’une réunion de consensus organisée en novembre 2009, le commissaire à la santé du Madhya Pradesh, un des initiateurs de la prise en charge de la malnutrition sévère dans cet État, présente les résultats du programme mis en place avec l’Unicef – grâce auquel plus de 33 000 enfants ont été traités entre 2006 et 2008 –, qui plaident en faveur de l’utilisation des pâtes de lait enrichies. C’est donc sur la base d’un programme dont la clandestinité a été dénoncée par Right to Food que le premier retour d’expérience indienne est discuté et, paradoxalement, défendu par ceux-là mêmes qui ont poussé l’Unicef vers la sortie, la section Right to Food du Madhya Pradesh.
Le compte rendu de la réunion, publié dans la revue Indian PaediatricsIndian Pediatrics, vol. 47, 17 août 2010., recommande de considérer la prise en charge de la malnutrition avec des « thérapies médicales nutritionnelles » à condition que ces traitements soient produits en Inde et que les protocoles soient revus par des experts nationaux. L’éditorial de la revue mentionne : « Il y a des différences philosophiques évidentes concernant le choix des interventions communautaires. Certains favorisent la seule adoption de mesures de promotion et de prévention (assurer les besoins nutritionnels et de santé de base, notamment la promotion de l’allaitement maternel et des pratiques d’alimentation complémentaire appropriées) sans mettre l’accent sur la détection active et la prise en charge nutritionnelle des enfants sévèrement malnutris. [...] Nous pensons sérieusement que les actions de santé publique concernant la malnutrition aiguë sévère doivent simultanément se focaliser sur les actions de prévention, de promotion et d’intervention thérapeutique dans les communautés. »Ibid.
L’indianisation de la prise en charge de la malnutrition est donc en cours, à un rythme dépendant de l’élaboration de consensus entre activistes, représentants gouvernementaux, chercheurs et experts invités, dont MSF fait partie. Tous s’accordent aujourd’hui sur la nécessité de traiter la malnutrition aiguë sévère en Inde, mais de nombreuses étapes restent à franchir avant que la malnutrition cesse d’être une « honte nationale » pour devenir un problème de santé publique contrôlé. En premier lieu, les acteurs nutritionnels nationaux insistent pour que les critères anthropométriques d’identification de la malnutrition soient adaptés au contexte indien, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de mettre des enfants maigres à des normes de corpulence internationalement admises, mais bien de limiter la mortalité et les séquelles associées à cette pathologie. En outre, les ministères de la Santé et de la Protection de la famille, en collaboration avec des structures de recherche indiennes, ont lancé des initiatives destinées à tester et à comparer des modèles de prise en charge « communautaire » qui puissent se fondre au système national, c’est-à-dire n’exigeant ni sa transformation brutale ni des moyens humains qu’il ne souhaite pas y consacrer. Dans ce débat de santé publique, MSF pourrait jouer un rôle de catalyseur à condition d’apporter des éléments de réponse aux questions en suspens sur la base des résultats de son programme dans l’État du Bihar, dans lequel plus de 6 500 enfants ont déjà été pris en charge entre mars 2009 et février 2011.
Reste enfin la question du traitement, qui continue de radicaliser les positions, y compris au sein de Right to Food : elle pourrait bien avancer sous l’impulsion d’une alliance d’acteurs de nature très différente. Début 2011, les autorités sanitaires et l’antenne locale de Right to Food du Madhya Pradesh discutaient avec les experts internationaux ayant développé le concept des ATPE de la possibilité de mettre au point une recette locale indienne. Cette alliance avait pris contact avec des institutions locales, des entreprises publiques ou des coopératives nationales agro-alimentaires, dont l’une d’elles, qui regroupe 2,9 millions de petits producteurs, affiche un slogan explicite : « The taste of India ».
***
Afrique du Sud. MSF, une association africaine ?
MICHAËL NEUMAN
À la veille des années 2000, MSF lance des programmes d’accès aux ARV (traitements antirétroviraux) à destination de patients séropositifs au VIH. Le contexte est tout à la fois celui d’une évolution rapide des initiatives nationales et internationales en faveur de l’accès aux traitements et de la persistance d’obstacles majeurs concernant les pays les plus pauvres, l’Afrique au premier chef. La prévention y reste la priorité, notamment parce que les prix des médicaments sont élevés (de 10 000 à 15 000 dollars par traitement et par an en 2000 pour les trithérapies), et que les niveaux d’infrastructures et d’éducation ne sont pas jugés à la hauteurPour une analyse plus complète, voir Jean-Hervé BRADOL et Élizabeth SZUMILIN, « Sida, nouvelle pandémie, nouvelles pratiques médicales et politiques », Jean-Hervé BRADOL et Claudine VIDAL (dir.), Innovations médicales en situations humanitaires. Le travail de Médecins Sans Frontières, L’Harmattan, Paris, 2009.. Certains arguent que « les Africains ne peuvent pas prendre les médicaments quand il faut, parce qu’ils n’ont pas de montre»John DONNELLY, « Prevention urged in AIDS fight. Natsios says fund should spend less on HIV treatment », Boston Globe, 7 juin 2001.. MSF voit en l’Afrique du Sud, qui dispose d’infrastructures médicales solides, un environnement dans lequel la possibilité de soigner des malades peut être démontrée. Plus de 5 millions de personnes y sont infectées par le VIH alors que seules quelques structures privées disposent de traitements.
Le Dr Éric Goemaere, ancien directeur général de la section belge de MSF, arrive en Afrique du Sud en 1999 pour explorer les possibilités d’ouverture d’un projet visant à prévenir la transmission du virus entre la mère et l’enfant (PTME). Après s’être heurté une première fois à un blocage des autorités nationales, il rencontre Zackie Achmat, l’un des fondateurs de la TAC (Treatment Action Campaign), une organisation fondée l’année précédente par un petit groupe de militants issus du mouvement antiapartheid afin de lutter pour la mise en place de traitements destinés aux malades du sida. Zackie Achmat met Éric Goemaere sur la piste de Khayelitsha, un bidonville de la ville du Cap dans lequel les autorités médicales de la province du Cap-Occidental ont initié à l’insu du ministère de la Santé sud-africain un projet pilote de PTME. Khayelitsha compte plus de 500 000 habitants, la prévalence du VIH parmi les femmes enceintes y est de 15 %, soit près de deux fois celle enregistrée dans l’ensemble de la provinceKhayelitsha annual activity report 2008-2009, Médecins Sans Frontières/University of Cape Town.. L’intérêt de MSF pour le Cap-Occidental tient également à sa position politique singulière. La province est en effet passée aux mains de l’opposition, ce qui laisse entrevoir à l’association la possibilité de bénéficier d’un espace politique. En effet, les nouvelles autorités provinciales voient dans le manque d’accès aux ARV une occasion d’étayer leurs critiques à l’égard de l’ANC (African National Congress).
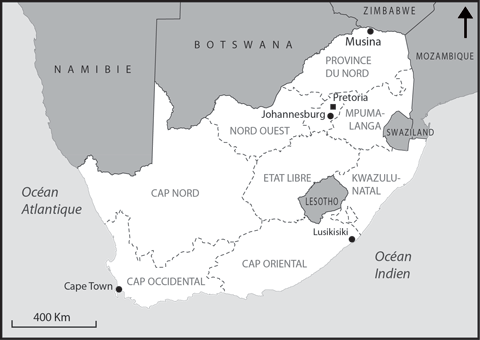
En février 2000, MSF et la TAC s’associent afin de mettre en place un programme de traitement des maladies opportunistes, articulé à un projet d’éducation et d’information sur le sida, impliquant les patients eux-mêmes. Pour obliger les autorités sud-africaines à élargir l’offre de soins en matière de VIH/sida, il importe à MSF et à la TAC que le projet soit porté par des malades, pauvres, noirs, considérés par ces deux organisations comme la voix légitime de la contestation en ce domaine. En ce sens, la TAC, inspirée par des contacts avec des associations comme Act Up, prend la suite de ceux qui, dans les années 1980 en Europe et aux États-Unis, entendaient « ébranler la relation asymétrique entre médecins et patients, investir la sphère de compétence des premiers pour faire des seconds des acteurs de leur propre prise en charge»Jean-Pierre DOZON, « De l’intolérable et du tolérable dans l’épidémie de sida. Un parallèle entre l’Occident et l’Afrique », Didier FASSIN et Patrice BOURDELAIS (dir.), Les Constructions de l’intolérable. Études d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral, La Découverte, Paris, 2005, p. 195-224.. Il prend une ampleur toute particulière, au cœur de la société sud-africaine, dont la politisation et la capacité de mobilisation sont héritières de la lutte contre l’apartheid.
Quand le combat justifie l’alliance
En 2001, les compagnies pharmaceutiques internationales qui avaient intenté trois ans plus tôt un procès au gouvernement sud-africain, l’accusant de ne pas respecter les règles internationales de protection de la propriété intellectuelle, abandonnent la procédure. Cette victoire du « procès de Pretoria », qui ouvre ainsi la voie à l’utilisation de médicaments génériques, permet d’écarter l’obstacle du coût des médicaments mis en avant dans les arguments du gouvernement sud-africain.
Dès lors, il devient clair que c’est bien la politique des autorités sud-africaines elles-mêmes qui est à l’origine de l’absence de traitements dans les structures sanitaires publiques. Le président Thabo Mbeki et sa ministre de la Santé, le Dr Manto Tshabalala-Msimang, soutiennent en effet de plus en plus ouvertement les thèses qui nient la relation entre sida et VIH et font la promotion de remèdes « naturels ».
Cette « politique du déni »En anglais, on parle de « denialism », un terme directement inspiré du négationnisme de l’extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. trouve un écho particulièrement favorable au sein de certains éléments de la classe dirigeante sudafricaine, engagés dans la chimère du développement de son propre médicament et imprégnés d’une lecture raciale du sida, perçu comme un moyen pour les Blancs de perpétuer leur dominationVoir notamment Kerry CULLINAN et Anso THOM (dir.), The Virus, Vitamins and Vegetables. The South African Aids mystery, Jacana, Johannesburg, 2009.. C’est sur ce front que se poursuit la lutte de la TAC, à laquelle MSF apporte sa légitimité médicale fondée sur le projet de Khayelitsha en plein développement, ainsi que sa visibilité internationale et sa capacité financière. Les antirétroviraux à destination des malades sont introduits dans le projet en mai 2001 : c’est la première fois que des ARV sont accessibles aux malades du sida dans des structures publiques sud-africaines.
Tant pour Fareed Abdullah, le directeur provincial des programmes sida de la province du Cap, que pour MSF et la TAC, l’alliance devient une condition du succès de cette lutte, décisive pour élargir la mise sous traitement des patients. L’UCT (université du Cap) apporte la caution scientifique de son école de santé publique, qui devient copropriétaire des données produites dans le cadre du projet. Le Cap-Occidental est alors la seule province contrôlée par l’opposition politique à l’ANC, constituée de libéraux majoritairement blancs issus du mouvement antiapartheid. Les risques de récupération politique du projet sont réels. Mais ni MSF ni la TAC ne s’opposent à l’ANC : Fareed Abdullah en est un ancien cadre et c’est à ce titre qu’il a démarré le projet pilote de Khayelitsha, alors que l’ANC contrôlait encore la province. MSF joue ainsi la carte du multipartisme, laissant différents représentants politiques revendiquer une part du mérite. Nelson Mandela apporte lui aussi une contribution considérable : il appuie non seulement les revendications de la TAC, mais se rend dès 2002, en pleine controverse, à Khayelitsha, où il visite le projet de MSF, défiant ouvertement la politique du gouvernement. Ensemble, MSF et la fondation Nelson Mandela œuvrent à l’ouverture en 2003 d’un projet de prise en charge des personnes infectées par le VIH à Lusikisiki, dans la province rurale du Cap-Oriental – contrôlée par l’ANC.
La TAC et Zackie Achmat en particulier, qui font de leur allégeance de longue date à l’ANC un argument pour s’opposer au gouvernement et qui réussissent à créer un mouvement social large autour de leur combat, multiplient manifestations, rassemblements et campagnes de désobéissance civile – incluant notamment des occupations de bâtiments publics. S’appuyant sur la Constitution sud-africaine très progressiste de 1996, l’organisation remporte plusieurs batailles, dont la mise en place d’un programme national de PTME (2001-2002) et celle d’un programme national de lutte contre le sida (2004). Car la Constitution affirme un droit à la santé, opposable devant les tribunaux, ce qui permet aux activistes de faire de ceux-ci une arène politique. MSF reste en retrait de la plupart de ces combats, au moins publiquement – ce qui pose parfois des problèmes avec ses partenaires qui comprennent mal cette distance. Mais l’agenda propre à la TAC, ainsi que saproximité avec des organes aux orientationspolitiques très marquées, à l’instar de Cosatu (Congress of South Africain Trade Unions, Congrès des syndicats sud-africains), une puissante fédération syndicale proche de l’ANC, justifient cette mise à distance aux yeux de l’organisation. De plus, MSF fait face à de multiples accusations d’interférence politique, comme ce fut le cas en 2002, lorsqu’un porte-parole de la présidence décrivit l’importation d’antirétroviraux génériques du Brésil par MSF comme une « forme de guerre bactériologique »« ANC fears “bio warfare” in aids drug imports », The Star, 31 janvier 2002.. L’association est également accusée de manipuler la TAC par le biais du financement de ses activités à Khayelitsha puis à LusikisikiEntretien avec Éric Goemaere, janvier 2011..
Cet attelage hétéroclite – un classique de la lutte antiapartheid – était une condition de la réussite pour MSF. Alors que le pays venait de se débarrasser de son pouvoir blanc, la légitimité de l’association ne pouvait pas s’appuyer sur son identité d’organisation « du Nord ». Dans ce contexte, les alliances bâties par MSF lui permettent de construire l’espace dans lequel développer son activité et ses demandes d’accès aux traitements. Elles deviendront également un bouclier politique essentiel contre les tentatives de déstabilisation du programme de Khayelitsha par le gouvernement sud-africain. Ce sont ainsi les associations de patients qui répondent par courrier et par voie de presse à Thabo Mbeki lors des attaques de son porte-parole« In response to SA government’s reluctancy towards Brazilian ARV drugs », 6 février 2002.
.
Quand l’alliance justifie le combat
L’intérêt que retire MSF de sa collaboration et des relations développées avec la société civile sud-africaine va l’encourager à approfondir l’expérience en décidant la création d’un bureau en Afrique du Sud, basé à Johannesburg, en 2007. La démarche s’inscrit dans une volonté du siège bruxellois d’internationaliser MSF, un mouvement dont les multiples centres sont très majoritairement situés au « Nord » (Europe, États-Unis, Canada). Localement, il s’agit de faire participer la société sud-africaine, et plus largement celle de la sous-région d’Afrique australe, aux activités de MSF et « de continuer à puiser dans le réservoir d’idées d’une société mobilisée autour des enjeux de santé publique»Entretien le directeur des opérations, MSF-Belgique, janvier 2011. L’Afrique du Sud devient un laboratoire pour l’organisation, qui va tester « jusqu’où [elle peut] aller dans l’engagement militant»Ibid.. Bruxelles décide de confier la direction du nouveau bureau à une Sud-Africaine, très investie dans les luttes sociales et politiques, ancienne militante antiapartheid, très liée à la TAC ainsi qu’à Cosatu. Tout en gardant un lien de subordination fort avec le siège, le bureau de Johannesburg est ancré dans la société civile, dont il est une émanation. Mais il n’a pas de contrôle sur les opérations de MSF en Afrique du Sud, qui sont toujours dirigées par le siège en Belgique.
Jusqu’alors uniquement engagée dans la lutte contre le sida, MSF en Afrique du Sud va évoluer profondément au contact de la question des migrants zimbabwéens, qui alimente une controverse récurrente au sein de l’association : jusqu’où celle-ci peut-elle s’engager dans le militantisme au nom de son expertise médicale et humanitaire ? À partir de 2006, fuyant les difficultés économiques, la répression et les violences politiques, entre 1,5 et 3 millions de Zimbabwéens émigrent en Afrique du Sud. Parmi eux, des dizaines de milliers sont refoulés à la frontière, d’autres s’installent de façon précaire dans le pays. À partir de décembre 2007, MSF ouvre des projets d’assistance à la frontière zimbabwéenne ainsi qu’à Johannesburg. Elle y offre des consultations médicales à 2 000 à 3 000 Zimbabwéens ayant trouvé refuge dans une église méthodiste et dans des bâtiments abandonnés des environs.
Les discussions de MSF et de ses partenaires vont rapidement quitter le strict domaine de l’accès aux soins. Celui-ci est juridiquement garanti pour les étrangers depuis 2007, mais reste limité du fait de leur peur d’être arrêtés, du manque de personnel, de la barrière de la langue parfois utilisée comme prétexte pour leur refuser l’accès aux structures médicales. Entre 2008 et 2010, dans le cadre d’une alliance avec des organisations de juristes (Lawyers for Human Rights, Aids Law Project notamment) et avec le prêtre méthodiste de l’église, MSF va donc s’impliquer sur la question des droits des migrants pour faire entendre leur voix. Le projet est établi avec « un objectif explicite de changement politique »Rapport d’évaluation, 2007.. Les partenaires se répartissent les tâches : à MSF la constitution de l’expertise médicale, aux juristes la capacité de mener des campagnes sur la base des informations qui leur sont fournies. Le réseau issu des luttes antérieures, contre le sida notamment, est mobilisé à cette occasion. La Constitution sud-africaine, de nouveau, fournit les armes d’une contestation politique utilisant les tribunaux comme arène.
À plusieurs reprises entre 2008 et 2010, MSF s’engage aux côtés de ses alliés dans la promotion des droits des migrants. En 2009, à la suite d’interpellations de migrants aux abords de l’église, dont certains faisaient la queue pour une consultation, la coordinatrice du projet donne son accord pour signer un témoignage écrit à verser aux dossiers décrivant les conditions médicales des personnes arrêtées, afin que les organisations de défense des droits de l’homme puissent porter plainte contre la ville et la police. C’est également en s’appuyant sur la Constitution sud-africaine que les organisations parviendront à faire cesser les arrestations pour vagabondage. Cette action va culminer lors des violences xénophobes à partir de mai 2008, lorsque des étrangers regroupés dans des camps de déplacés seront menacés d’expulsion. MSF se voit alors interdire l’accès aux camps dans lesquels ses équipes organisaient des consultations mobiles quotidiennes. Un communiqué de presse de MSF dénonce l’apathie du HCR et sa position fondée sur les conventions internationales« No refugee, access denied. Medical and humanitarian needs of Zimbabweans in South Africa », MSF, juin 2009., alors que MSF et ses alliés nationaux se réfèrent plutôt à la Constitution sud-africaine. À chacune de ces occasions, des controverses apparaissent au sein même de la mission, ainsi qu’entre la mission, le bureau sud-africain et le siège bruxellois sur les limites du rôle et des responsabilités de MSF.
Son soutien éventuel à une « Déclaration concernant la résolution de la crise des réfugiés », initiée par Aids Law Project, Lawyers for Human Rights et Legal Resources Center, auxquels s’est associé un groupe très large et très hétérogène d’associations, fait notamment l’objet de vives discussions en décembre 2009. Alors que le bureau sud-africain souhaite rallier MSF au texte, qui appelle au respect des droits des Zimbabwéens vivant au Zimbabwe et à la condamnation des actions du président Mugabe, le siège belge de l’organisation s’y oppose en arguant que « ce serait franchir la ligne»Communication électronique, décembre 2009.. Tant la mission que Bruxelles critiquent notamment l’attaque dirigée contre le régime zimbabwéen, le caractère hétérogène des signataires, et indiquent enfin que la posture d’opposition au régime de Harare met en danger les activités de MSF au Zimbabwe. Pour sa part, le bureau de Johannes burg explique que quitter la coalition pourrait être préjudiciable à l’ancrage de MSF en Afrique du Sud en l’éloignant des combats progressistes portés par ses alliés traditionnels. Pour ceux-là en effet, il ressort que défendre les droits des migrants ou les droits au traitement des malades est cohérent avec leur intention d’investir l’ensemble du champ sociopolitique sud-africain. MSF, qui n’a pas encore franchi ce pas, n’appuie pas le communiqué mais fait paraître le sien propre. Il a été estimé que le périmère d’intervention légitime de l’organisation avait été franchi.
***
France. Gérer les indésirables ?
MICHAËL NEUMAN Nous empruntons ce titre à Michel Agier, auteur de Gérer les indésirables, Flammarion, Paris, 2008.
À partir de 1987, Médecins Sans Frontières investit le champ médical et politique en France, dans le contexte de la découverte d’une « nouvelle pauvreté »Voir notamment le rapport au Conseil économique et social du père Joseph Wresinski, février 1987.. Développant des activités de soins médicaux et dentaires gratuits, de prévention du saturnisme, MSF, « en tant que médecins français et en tant qu’organisation médicale active sur le terrain français »MSF-France, conseil d’administration, 16 décembre 1994, se donne pour objectif d’alerter les pouvoirs publics sur les carences en matière d’accès aux soins pour la population, française ou étrangère, la plus précaire. L’association se refuse à se substituer à l’État. Elle limite donc son nombre de centres de soins, qui reste suffisant pour lui permettre de jouer un rôle d’alerte auprès des (ou face aux) pouvoirs publics. Les prises de position se succèdent : demande de généralisation de l’assurance-maladie à toutes les catégories de la population en 1991, dénonciation du refus d’hospitalisation des non-assurés sociaux en 1993, opposition, en 1994, à la création des lits infirmiersLes lits infirmiers étaient destinés aux personnes sans domicile, insuffi- samment malades pour être admises aux urgences de l’hôpital, mais trop mal en point pour être admises dans les structures d’hébergement d’urgence., considérés comme un dispositif de soins parallèle destiné aux pauvres, alors que MSF entend réintégrer ces derniers dans le régime de droit commun, etc.
L’ouverture en 1996 d’un nouveau projet d’« accueil social et de soutien juridique aux personnes étrangères résidant en France » confirme une volonté de l’association de « rompre avec le caritatif » – volonté qui l’anime depuis son démarrage –, quitte à s’engager sur un terrain « non médical et inhabituel »MSF-France, conseil d’administration, 4 octobre 1996.. Elle s’implique activement dans le soutien juridique aux personnes privées d’accès aux soins et la réforme du dispositif législatif : accompagnement de l’élaboration de la loi pour l’instauration de la CMU (couverture maladie universelle), recours aux tribunaux pour l’application des droits des personnes à l’aide médicale lors de procédures intentées notamment contre le conseil général du Nord et celui des Bouches-du-Rhône.

L’adoption de la CMU en juillet 1999La couverture maladie universelle de base permet l’accès à l’assurance- maladie pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance- maladie à un autre titre. constitue l’apogée d’un programme porté par des personnes déterminées à se confronter aux pouvoirs publics. Près de 4 millions de personnes bénéficient de la loi CMU, qui règle la plupart des problèmes d’accès aux soins. Mais dès lors que l’enjeu de santé publique se dissipe, la question de la réorientation de la mission est posée. Dès 2001, il est noté que « l’accès aux droits restera une activité importante des programmes de MSF, mais [que] cette question ne justifie plus, à elle seule, ni le maintien des programmes existants ni l’ouverture de nouveaux centres »MSF-France, rapport annuel 2000-2001.. MSF développe de nouvelles activités, notamment dans le domaine de l’hébergement, et continue à surveiller l’application de l’AMEDepuis l’adoption de la loi CMU, ce dispositif existant depuis la fin du XIXe siècle sous le nom d’AMG (aide médicale gratuite) et qui prévoit la fourniture de soins gratuits pour les démunis est réservé aux immigrés sans titre de séjour. (aide médicale d’État) et les conséquences de ses réformes successives. À partir de 2003, la mission France connaît des changements radicaux justifiés entre autres par une volonté de réduire les coûts des projets. Cette évolution coïncide avec une révision à la baisse des ambitions de l’association dans les programmes dits « d’accès aux soins et d’exclusion » et un recadrage des politiques opérationnelles en direction des « victimes directes de violence », considérées comme prioritaires dans l’allocation des ressources.
Les projets sont donc fermés les uns après les autres, l’organisation n’observant pas alors de « drame sanitaire »MSF-France, plan annuel 2006. qui justifierait la mise en place d’activités médicales. Les grandes questions de santé publique telles qu’elles se posaient au milieu des années 1980 ont été dans l’ensemble résolues : la CMU et l’AME, malgré des dysfonctionnements et l’adoption de mesures restrictives, jouent leur rôle ; depuis 1998, environ 400 Pass (permanences d’accès aux soins) ont été établies au sein des hôpitaux publics dans toute la France afin de permettre aux plus démunis de se faire soigner. Dans ces conditions, il aurait été concevable de ne plus intervenir, mais le durcissement des politiques d’asile observées en France et en Europe et ses conséquences sur la santé des migrants vont au contraire justifier de nouvelles initiatives. En 2006, MSF met en place un service de consultation à Sangatte à destination des réfugiés, puis se retire après l’ouverture d’une Pass à l’hôpital de Calais, à laquelle elle a contribué. Puis un « centre d’écoute et de soins » s’ouvre à Paris en 2007. Il est destiné à fournir une aide psychologique aux demandeurs d’asile (en particulier non francophones), et intègre en son sein un volet d’orientation sociale et juridique. Des évaluations menées par MSF ont en effet révélé des insuffisances dans le dispositif public de prise en charge des cas de traumatisme chez les demandeurs d’asile, traumatisme dont l’origine peut être liée à leur histoire personnelle, mais aussi à leur parcours administratif.
La dimension politique assumée du projet s’appuie sur la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et qui définit les droits des demandeurs d’asile, notamment en matière de non-refoulement. Pour ses promoteurs, il s’agit de rendre visible « cette problématique humanitaire [...] en mettant l’accent sur l’interaction entre la situation médicale et l’accès au refuge »MSF-France, conseil d’administration, 15 décembre 2006.. Pour sa part, le président de l’association s’oppose au projet, mettant en doute l’existence d’une « crise de l’asile », questionnant le réalisme des objectifs médicaux et pointant du doigt les incohérences des choix opérationnels : accepter aujourd’hui ce qu’on semblait refuser hier, à savoir soigner peu de gens à des coûts élevés – motif parmi d’autres de la fermeture des projets précédentsMSF-France, conseil d’administration, 15 décembre 2006.. D’autres remettent en cause la légitimité de MSF à se positionner sur la question du droit d’asile et par extension sur la politique d’immigration du gouvernement, indiquant le haut degré de division de l’association sur le sujet.
Les débats qui précèdent l’ouverture du projet prédisent ses difficultés à venir, témoignant des divergences quant à la question de savoir si l’association est légitime pour glisser du terrain humanitaire au terrain social. En réponse aux craintes de certains membres de l’association que MSF ne s’engage dans un combat politique trop éloigné de son champ de compétence, les animateurs du projet vont tout faire pour ne pas apparaître comme engagés dans une démarche d’opposition à la politique du gouvernement en matière d’immigrationEntretien avec la chef de mission, novembre 2010.. Limitant les confrontations avec les autorités publiques, ils vont multiplier les consultations médicales afin de gagner en légitimité et accumuler expérience et informations. L’activité médico-psychologique permet d’apporter une réponse à des problèmes réels, soit ici des troubles fonctionnels, ne serait-ce qu’auprès d’un nombre restreint de personnes (900 personnes entre mars 2007 et décembre 2010). En outre, la capacité de l’institution de se « mettre en tension » avec les pouvoirs publics va se trouver limitée par l’étroitesse du champ médical sur lequel l’association peut s’appuyer. Dans les faits, quelques occasions de confrontation avec les autorités seront saisies, mais sans qu’elles trouvent un cadre plus général dans lequel s’inscrire. En ce sens, le filet sanitaire tendu par les autorités rend particulièrement complexe la position du projet. Car il est peu contestable qu’aux yeux du gouvernement français il n’a jamais été question de laisser mourir les sans-papiers.
Comme Éric Besson, alors ministre de l’Immigration, le rappelait au printemps 2009 : « L’action humanitaire en direction des étrangers en détresse, quelle que soit leur situation au regard du droit au séjour, est parfaitement légale. »Discours d’Éric Besson à Calais, jeudi 23 avril 2009. Voir http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=actus&id_rubrique=254&id_ar....
Dans une lettre aux associations, il précisait ainsi que l’État « [apportait], avec les collectivités locales, un important soutien technique et financier, plus de 20 millions d’euros par an, aux associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière, dont le rôle humanitaire est indispensable »www.la-croix.com.. Le gouvernement opère ainsi une distinction de plus en plus nette entre les « bonnes » organisations humanitaires, dociles et silencieuses, inscrites dans l’assistance et la gestion compassionnelle des populations « en trop », et les « mauvaises », militantes et politiques, qui cherchent à « faire entendre la plainte des exclus »Didier FASSIN, La Raison humanitaire, Hautes Études-Gallimard-Le Seuil, Paris, 2010, p. 61.. L’action humanitaire est donc acceptable à condition de n’impliquer aucune critique des politiques publiques Voir également Aurélie WINDELS et Éric FASSIN, « Éric Besson et le délit de solidarité. La loi et la jungle », Politis, 20 avril 2009..
En traitant la souffrance des individus On compte trente et une occurrences du mot « souffrance » dans le rap- port d’activité 2009 du projet « Centre d’écoute et de soins ». sans trop questionner ses origines politiques et sociales, MSF ne tient-elle pas exclusivement le rôle qui est attendu d’elle par les pouvoirs publics, à savoir administrer des territoires relégués ? Pour sortir de ce régime de cogestion des populations indésirables, il faut aller au-delà du soin et mettre à profit l’expertise de MSF en produisant un discours critique à partir de sa pratique. Or l’étendue du filet sanitaire en France restreint ce potentiel. À l’automne 2010, les offensives parlementaires et gouvernementales contre l’AME et le droit au séjour pour raison médicale redonnent néanmoins à MSF l’occasion de prendre position sur un terrain où elle se sent légitime. Ses prises de parole se justifient à la fois en raison de son rôle dans la mise en place de certains de ces dispositifs, et par la crainte des conséquences que les réformes font peser sur la santé des personnes.
Période
Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter afin de rester informé des publications du CRASH.
Un auteur vous intéresse en particulier ? Inscrivez-vous à nos alertes emails.
