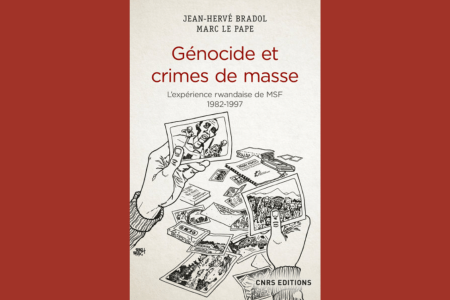Rwanda, Kibeho 1995, un massacre impensable
Jean-Hervé Bradol
Dans cet article paru dans le numéro "Mémoire, histoire et politique" de la revue Socio, Jean-Hervé Bradol analyse le massacre du camp de Kibeho et la mémoire collective qui l'entoure.
Résumé :
En avril 1995, un an après le génocide tutsi, le nouveau régime rwandais veut fermer les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Ces camps, notamment celui de Kibeho, regroupent dans le sud-ouest des centaines de milliers de Hutus encadrés par les auteurs du génocide. L’existence de ces camps constitue une menace pour la sécurité du pays selon le gouvernement. Après des mois de tergiversations, c’est par un massacre de plusieurs milliers de déplacés que l‘Armée patriotique rwandaise ferme le camp de Kibeho qui abrite alors 100 000 personnes. Au cours de cet événement périssent aussi plusieurs centaines de patients et plusieurs dizaines de Rwandais travaillant avec Médecins sans frontières. Les tueries se déroulent devant des centaines de témoins rwandais et étrangers : diplomates, militaires, journalistes, promoteurs des droits humains, humanitaires, habitants de la région… Les nouvelles autorités rwandaises parlent de 300 morts présentés comme les membres d’un hypothétique « noyau dur » de génocidaires. Les membres de la commission d’enquête internationale mise en place acquiescent. Ainsi, la mémoire d’un fait majeur permettant de saisir la place que le régime entend réserver à l’usage de la violence est effacée de la mémoire collective.
Plan :
Le contexte historique
1990-1994 : l’attaque du FPR et le génocide des Tutsis
Après la victoire du FPR : la question des camps de déplacés
L’attaque du camp de Kibeho
Texte intégral :
L'événement dont j’ai choisi de traiter est un massacre survenu en avril 1995 au sud-ouest du Rwanda (préfecture de Gikongoro, site de Kibeho dans la commune de Mubuga). Je commencerai par expliciter la nature de ma participation à cette histoire et à la constitution de sa mémoire. Puis je résumerai les principaux aspects du contexte sociopolitique dans lequel les faits se sont produits. Je décrirai dans ses grandes lignes ce crime de masse en m’appuyant sur les documents, internes ou externes, archivés par les équipes de Médecins sans frontières (MSF) impliquées sur ce terrain. Enfin, j’essaierai de dire en quoi la mémoire de la tuerie de Kibeho est l’une des clefs de compréhension de la nature du régime rwandais actuel ainsi que de la mansuétude à son égard dont font preuve ses soutiens étrangers.
Médecin urgentiste et tropicaliste de formation, je travaille avec MSF depuis 1989. Aujourd’hui, j’occupe la fonction de directeur d’études au Crash, un centre de réflexion de MSF sur l’action et les savoirs humanitairesSes principaux domaines d’activités sont le conseil, la représentation, les études d’un point de vue de praticien, les retours sur expériences et la formation des cadres. .
À l’époque des faits, j’étais chargé des opérations de MSF France au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie comme responsable de programme (desk officer) pour la région des Grands Lacs africains et également pour six autres pays. J’exerçais dans un triple cadre collégial : avec mes collègues de terrain sur le travail desquels j’avais autorité en cas de besoin ; avec l’équipe des opérations au siège, mes pairs desk officers sous la responsabilité de la directrice des opérations qui était chargée de l’entièreté des missions de terrain pour la section française de MSF ; avec mes homologues des autres sections opérationnelles de MSF, notamment belge, hollandaise, suisse et espagnole.
Entre l’été 1993 et l’été 1997, j’ai effectué six séjours dans la région. Le Rwanda retenait l’essentiel de mon attention en raison de la gravité des situations. Des séjours où, souvent, je prenais « à la volée » la direction des activités sur le terrain pour tenter de les ajuster à ce que je percevais alors comme les évolutions de nos différents contextes d’interventions. Je n’étais pas au Rwanda au moment du massacre de Kibeho, en avril 1995. Je visitais des camps de réfugiés birmans en Thaïlande. À mon retour à Paris, mes collègues desk officers basés à Bruxelles, Amsterdam, Barcelone et Genève me confièrent la tâche de produire un rapport sur les événements dont nous parlons aujourd’hui.
Le contexte historique
Le Rwanda est un petit pays enclavé de la région des Grands Lacs africains, 26 000 kilomètres carrés de collines, qui comptait une très forte densité de population, 250 personnes par kilomètre carré à l’époque des faits. La population s’élevait à 7,1 millions d’individus selon le recensement de 1991. La grande majorité (93 %) était constituée de ruraux. Croissance importante de la population, étroitesse du territoire et possibilités d’émigrations limitées par le contexte politique régional concouraient à la réduction de la taille des parcelles familiales (déjà moins d’un hectare en moyenne par famille à cette époque). Dans ces conditions, un enfant sur deux souffrait de malnutrition chronique.
Trois groupes composaient la population du pays : les Hutus (85 %), les Tutsis (14 %) et les Twas (peuple de la forêt, 1 %). Avant la colonisation, le Rwanda était un royaume. La noblesse était issue de quelques grandes familles tutsies mais tous les Tutsis n’étaient pas nobles. À la fin de la Première Guerre mondiale, le colonisateur belge évinça son prédécesseur allemand et s’appuya sur les Tutsis de l’aristocratie pour gouverner. Les Twas étaient peu présents dans la vie politique rwandaise.
Hutus et Tutsis habitaient les mêmes territoires, parlaient la même langue, partageaient les mêmes croyances religieuses. Les intermariages n’étaient pas rares. Ce sont des différences de position dans le système monarchique, puis des discriminations attisées par la colonisation et enfin des violences massives répétées suivies d’exil de Tutsis dans les pays limitrophes qui ont cimenté les identités hutues et tutsies plutôt que des « différences ethniques ».
À l’approche de la décolonisation, le colonisateur belge changea d’alliance. La monarchie fut renversée en 1959. Au moment de l’indépendance en 1962, les membres des élites hutues furent désormais privilégiés. De la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1970, se succédèrent plusieurs cycles de violences : stigmatisation et massacres de Tutsis, fuites d’opposants et de Tutsis à l’étranger, tentatives de retour par la force de certains d’entre eux. En 1973, dans un contexte de violences à l’encontre des Tutsis, la Première République fut renversée par un militaire, Juvénal Habyarimana. Cette prise de pouvoir s’accompagna d’une baisse des violences contre les Tutsis qui cependant demeurèrent victimes de fortes discriminations. En 1975, la France s’impliqua dans le soutien au régime d’Habyarimana.
1990-1994 : l'attaque du FPR et le génocide des Tutsis
En octobre 1990, après des années de discussions avec le pouvoir en place sans trouver d’accord sur le retour des réfugiés, un mouvement de rébellion armée, le Front patriotique rwandais (FPR) et sa branche militaire, l’Armée patriotique rwandaise (APR) formés dans les camps de réfugiés en Ouganda lancent une offensive sur le Rwanda. Une intervention militaire française évite de justesse l’effondrement de l’armée et du régime d’Habyarimana. Les Nations unies obtiennent, à Arusha en 1993, l’accord des belligérants pour un partage du pouvoir, en particulier au sein de l’armée nationale. Un contingent de casques bleus se déploie et les troupes françaises se retirent du pays. Le 6 avril 1994, alors que la mise en œuvre des accords d’Arusha n’avance pas, l’avion transportant le président Habyarimana est abattu, en approche pour atterrir à Kigali.
Dans les suites immédiates de cet attentat dont l’identité des auteurs demeure toujours discutée, la guerre civile reprend et les massacres de Tutsis à l’échelle nationale débutent. Les forces armées des Nations unies ne s’y opposent pas. L’échec de l’intervention internationale en Somalie qui se termine en mars 1995 n’incite pas les Nations unies à lancer une nouvelle opération militaire internationale pour des raisons humanitaires. En conséquence, le nombre de casques bleus est réduit de 2 500 à 500 hommes. Les forces armées étrangères arrivées à Kigali, dont celles de la France, limitent leurs opérations à l’évacuation de leurs ressortissants. Les Tutsis sont abandonnés à leur sort et, en quelques semaines, plusieurs centaines de milliers sont tués. Les auteurs de cette extermination, les Forces armées rwandaises (FAR) et les milices associées, sont mis en déroute par l’APR et fuient dans les pays voisins. Dans leur sillage, ils entraînent des centaines de milliers de Hutus qui se regroupent dans d’immenses camps en Tanzanie, au Burundi, au Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo, RDC) et dans des camps à l’intérieur du pays, notamment au sud-ouest. Les populations réfugiées sont encadrées par les auteurs du génocide des Tutsis qui préparent la reconquête du pays.
Au même moment (début mai 1994), l’élection de Nelson Mandela et la situation des enclaves bosniennes assiégées retiennent toute l’attention sur la scène internationale. Peu après, en juillet 1994, une catastrophe sanitaire meurtrière commence dans les camps de réfugiés (épidémies de choléra, dysenterie…) causant des dizaines de milliers de morts. En juillet 1994 toujours, sur les téléviseurs du monde entier, les images de la situation vécue par les Hutus réfugiés dans les camps renvoient à l’arrière-plan les rares images récentes de l’extermination des Rwandais tutsis. Le FPR remporte la victoire militaire. Plusieurs centaines de milliers de Rwandais tutsis ont été tués. Environ 2 millions de Rwandais hutus sont réfugiés à l’étranger tandis que 2,5 millions de Hutus sont réunis dans des camps de déplacés internes.
C’est le moment (juin à août 1994) que choisit la France pour revenir au Rwanda, avec un mandat des Nations unies autorisant une « intervention humanitaire neutre ». L’armée française arrive dans le sud-ouest qui n’est pas encore aux mains de la rébellion. Elle protège plusieurs milliers de Tutsis. D’autres sont abandonnés à leurs bourreaux. Les troupes françaises empêchent la prise de contrôle par le FPR des camps de déplacés internes du sud-ouest qui hébergent des Hutus n’ayant pas pris la fuite au Zaïre. Pour le FPR, ces camps de déplacés sur le territoire national et de réfugiés dans les pays limitrophes constituent une atteinte à la souveraineté nationale et surtout une menace pour la sécurité du nouveau régime. En outre, le FPR dénonce cette présence militaire étrangère soi-disant neutre dont la composante française a été pendant des années le principal soutien militaire d’un régime avec lequel il était en conflit et qui persécutait les Tutsis. Quand, en août 1994, les troupes françaises cèdent la place aux forces des Nations unies, le FPR met aussi en cause la légitimité de leur présence en soulignant que les casques bleus ne sont pas intervenus pour protéger les Tutsis pendant le génocide.
Après la victoire du FPR : la question des camps de déplacés
La sécurité n’est pas la seule préoccupation du nouveau pouvoir. En effet, les États bailleurs de fonds allouent des budgets importants pour couvrir les besoins des populations rwandaises regroupées dans les camps à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. À l’opposé, le nouveau pouvoir chargé de la relance de l’économie nationale reçoit peu d’aide financière. La situation économique est critique. De plus, elle risque d’être aggravée par le retour de plusieurs centaines de milliers de réfugiés tutsis, venant notamment d’Ouganda et du Burundi, qui avaient quitté le Rwanda par vagues successives depuis l’indépendance.
Comment le FPR pourra-t-il contrôler le pays ? Il faut se souvenir que les effectifs de l’APR de l’époque s’élèvent seulement à quelques milliers d’homme. Certains d’entre eux, élevés en exil, ne connaissent pas du tout le pays. Les violences qui accompagnent l’installation au pouvoir du FPR relèvent-elles de vengeances individuelles ou, au contraire, d’une volonté de gouverner par la violence et la terreur ?
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) commandite une enquête à Robert Gersony, ancien diplomate étasunien, pour savoir si la sécurité de réfugiés éventuellement rapatriés au Rwanda pourrait être assurée. Le travail se déroule au mois d’août 1994. Les conclusions sont inquiétantes. Selon l’auteur et ses enquêteurs, le nombre de personnes exécutées par le FPR depuis le début des hostilités s’élèverait à 30 000 personnes. Le « rapport Gersony » est retiré de la circulation par les Nations unies et les rapatriements de réfugiés réservés seulement à un petit nombre de volontaires. Cela suscite peu de critiques de la part du nouveau régime qui, une fois les mises en cause du rapport Gersony enterrées, n’est pas pressé de voir rentrer des réfugiés parmi lesquels les militaires et miliciens auteurs du génocide sont nombreux.
Mais, en ce qui concerne les camps de déplacés à l’intérieur du Rwanda, les autorités veulent que le démantèlement des camps soit organisé le plus tôt possible. En effet, ces camps sont une manifestation spectaculaire de la terreur éprouvée par des centaines de milliers de Rwandais à l’idée d’être administrés dans leurs communes d’origine par les nouvelles autorités. Ces dernières demandent aux organismes d’aide de convaincre les déplacés de quitter les camps et de rentrer sur leurs collines. La réticence des organismes d’aide, y compris de MSF, repose sur le fait que toutes les évaluations réalisées dans les préfectures où doivent s’effectuer ces retours montrent que les exécutions commises par le FPR sont nombreuses. Le constat est corroboré par les enquêtes d’Amnesty international et de Human Right Watch. Les informations des militants rwandais des droits de l’homme confirment le diagnostic. Les autorités exercent cependant de fortes pressions sur les Nations unies pour organiser conjointement le retour des déplacés. Déjà blâmées pour l’inaction des casques bleus lors du génocide, les Nations unies se voient désormais reprocher de permettre aux génocidaires de trouver refuge dans les camps de déplacés. Ce qui constituerait selon le FPR une menace pour la sécurité publique et un spectacle insoutenable pour les survivants du génocide des Tutsis.
En réalité, peu de suspects d’avoir participé au génocide sont demeurés dans les camps de déplacés depuis que les troupes françaises ont quitté le pays et que celles l’APR se sont déployées dans le sud-ouest. Les auteurs du génocide trouvent de bien meilleures conditions de sécurité et une assistance matérielle équivalente dans les camps de réfugiés au Zaïre (RDC) voisins de quelques dizaines de kilomètres.
Le démantèlement des camps de déplacés commence dans le sud-ouest par la préfecture de Kibuye, dès septembre 1994. Les petits camps sont visés en premier. Les soldats de l’APR mettent le feu aux abris, tirent quelques coups de feu, lancent des grenades. Quand ils se trouvent à proximité, les casques bleus ne réagissent pas.
En novembre 1994, la destruction de camps de plus grande taille s’étend à la préfecture de Gikongoro. C’est le cas du camp de Musebeya où, le 11 novembre, les soldats de l’APR tirent sur les déplacés en faisant 7 morts et 8 blessés graves. Lors d’un rendez-vous, un capitaine de l’APR, occupant la fonction de préfet par intérim, affirme aux membres de MSF que c’est la méthode qui convient au traitement des génocidaires.
Fin novembre, les Nations unies et le gouvernement redéfinissent leur coopération en ce qui concerne le démantèlement des camps de déplacés. Une nouvelle organisation est promue qui place tous les participants sous une coordination commune. Le principe du volontariat au retour est réaffirmé. Pourtant, les fermetures par la menace ou par la force se poursuivent en décembre, atteignant des camps de plus en plus importants comme celui de Kaduha (40 000 déplacés).
L'attaque du camp de Kibeho
Pour ce qui concerne le camp de Kibeho (commune de Mubuga, environ 100 000 déplacés), du 13 au 15 décembre, les casques bleus et les soldats de l’APR mènent une opération de recherche abri par abri de suspects et d’armes. Quelques dizaines de personnes sont arrêtées sans que l’on puisse savoir ce qui leur est reproché. Les seules armes retrouvées sont des machettes, outils de la vie quotidienne. Des armes à feu rudimentaires utilisées pour la chasse sont également confisquées. Aucun arsenal qui permette de penser que Kibeho puisse être un repaire de génocidaires.
Au mois d’avril 1995, à Kibeho, la présence internationale est forte. Les casques bleus (des soldats zambiens, renforcés plus tard par des assistants médicaux australiens et néo-zélandais) occupent deux positions sur le site. Des membres de l’Office international des migrations, du HCR, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, de l’Union européenne, du mouvement Croix rouge, de Caritas, de Save the children, d’Oxfam, de MSF (200 personnes dont 15 étrangers), de nombreux journalistes (y compris deux photographes et un vidéaste) venus pour la première commémoration du génocide des Tutsis sont présents pendant la journée. Les casques bleus et les employés rwandais des organismes d’aide affectés au camp dorment sur place. Des personnels d’organismes internationaux sont également prêts à intervenir sur les routes et dans les centres par lesquels les retours doivent s’effectuer.
Le 15 avril, excédée par l’absence de progrès vers la fermeture du camp, l’APR exige des organismes d’aide l’arrêt des distributions de nourriture. Ces derniers sont blâmés pour leur incapacité à convaincre les réfugiés de quitter le camp pour rentrer dans des communes situées en majorité dans la préfecture voisine de Butare. Les raisons invoquées pour ne pas bouger sont la crainte des exécutions et le manque d’assistance sur place. Les évaluations réalisées par deux juristes de MSF montrent que ces appréhensions sont fondées.
Dans la nuit du 17 au 18 avril, environ 2 500 soldats de l’APR entrent dans le camp et regroupent les déplacés sur les collines du centre du camp. Contrairement à tous les accords passés entre les Nations unies et le gouvernement, il s’agit de contraindre les occupants du camp au retour en coupant l’approvisionnement en eau et en nourriture. Pendant les quatre premiers jours de cette opération, les déplacés grelottent, affamés, debout sous une pluie battante. Les incursions de l’APR dans l’hôpital du camp se font plus fréquentes. Le 21 avril au matin, quand les équipes internationales arrivent à l’hôpital, elles y trouvent les corps d’une vingtaine de personnes, seize d’entre elles ont été tuées par balles.
Du 18 au 21 avril, 10 000 personnes sont emmenées en dehors des camps. Le rythme est jugé trop lent par l’APR. Il est décidé d’arrêter de contrôler les identités de ces personnes forcées de quitter le camp et de remplir le plus massivement et le plus vite possible les moyens de transport fournis par les agences des Nations unies. Le travail des employés des Nations unies consiste alors à éviter que des soldats de l’APR ne « bourrent » les transports au point de provoquer la mort par suffocation de nombreuses personnes. Dans sa volonté d’accélérer les départs, l’APR décide qu’une partie des déplacés fera le voyage à pied. Ils sont en partie lynchés durant le trajet. Certains sont emmenés dans des maisons sur le bas-côté de la route pour y être tués. Des employés locaux de MSF sont membres du cortège, d’autres sur le bord de la route sont témoins du sort de leurs collègues.
Le 22 avril, l’APR, qui essuie des jets de pierre, commence à tirer sur la foule avec des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des grenades, des roquettes antichars et un mortier de petit calibre. Les militaires tirent sur les déplacés durant trois séquences d’au moins trois heures, dans la période de 7 heures à 18 heures. Les déplacés n’ont que de faibles possibilités de s’échapper si ce n’est quelques failles dans le dispositif d’encerclement. Un soldat australien témoigne :
"Les soldats de l’APR n’étaient pas des tireurs d’élite : ils étaient parfois à moins de 10 mètres de leur proie et la manquaient quand même. S’ils réussissaient à blesser quelques malheureux fuyards, ils économisaient leurs précieuses balles, achevaient leur victime à la baïonnette(Jordan, 2011 [traduction de l’auteur])."
"Ce qui était des coups de feu sporadiques s’intensifia plusieurs fois et alors, cet après-midi, l’APR sortit de l’église et déchaîna un déluge de feu sur une foule en haillons avec des armes légères et des armes lourdes, des lance-roquettes et des mortiers de 60 millimètres(O’Halloran, 2010 : 92)."
Un médecin, un logisticien de MSF et une équipe de casques bleus parviennent à se rendre à l’hôpital du camp où seuls huit nourrissons ont été épargnés. Les locaux ont été pillés.
En début d’après-midi, des milliers de déplacés sous le feu des hommes de l’APR envahissent l’une des deux positions militaires des Nations unies dans laquelle se sont aussi réfugiés les membres de l’équipe de MSF. Pour arriver sur cette position et s’enfermer dans un bâtiment en dur, les membres de MSF ont dû marcher sur plusieurs couches de cadavres. Un réalisateur australien, George Gittoes, venu couvrir la première commémoration du génocide des Tutsis, et plusieurs photographes documentent les faits : Paul Lowe de l’agence Magnum, Mark Cuthbert pour l’armée australienne et un employé des Nations unies. Les médias rwandais et internationaux sont témoins ou informés de la situation.
Le 23 avril, l’APR interdit l’accès au camp aux équipes de MSF. Le 24 avril, les casques bleus (zambiens et australiens) comptent les corps. Quand la nuit tombe et qu’ils doivent arrêter leur travail, ils ont dénombré 4 050 cadavres et estiment qu’il en reste plusieurs milliers qui n’ont pas été comptés.
"Jordo et Scotty avaient déjà compté environ 4 000 morts et 650 blessés quand ils furent arrêtés à mi-chemin. L’APR les força à arrêter quand elle réalisa ce qui se passait. Il y avait des corps allongés sur toute la place bien que l’APR ait essayé de s’en débarrasser pendant la nuit (Pickard, 2008 : 80 [traduction de l’auteur])."
Parmi les 193 employés rwandais de MSF, le décès de 29 est constaté et le sort de 48 d’entre eux est inconnu.
Ce même jour, le 24 mai, Seth Sendashonga ministre de l’Intérieur et Alphonse Marie Nkubito ministre de la Justice, accompagnés de William Clarance, chef de la mission des Nations unies pour les droits de l’homme visitent le site du massacre. En fin d’après-midi, le gouvernement publie un communiqué de presse dans lequel il plaide pour la plus grande fermeté à l’encontre des déplacés qui sont tous assimilés à des génocidaires« Déclaration du gouvernement rwandais sur la décision de fermeture des camps de déplacés de Gikongoro », Kigali, le 24 mai 1995..
Le 27 avril, Paul Kagame, l’homme fort du pays (vice-président et ministre de la Défense), se rend à Kibeho. Il est accompagné du président Pasteur Bizimungu, du représentant spécial des Nations unies Shaharyar M. Khan, d’un groupe d’ambassadeurs, des représentants des diverses agences des Nations unies, d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales et de journalistes. Les autorités rwandaises affirment sans aucun élément pour soutenir cette version que ces morts sont dues aux attaques contre les soldats de l’APR menées par un « noyau dur » dont personne n’a jamais entendu parlerRapport de la commission internationale indépendante d’enquête sur les événements de Kibeho, 18 mai 1995, Kigali, p. 10.. Dans le même temps, l’APR ne déclare ni blessés ni morts pendant cette opération. Lors de la visite, plusieurs fosses communes sont ouvertes et 338 corps sont exposés. Ce nombre, plus de dix fois inférieur à celui établi par les soldats australiens des Nations unies, est désormais celui retenu par les autorités.
Le soir même, le vice-président du pays annonce la création d’une commission d’enquête internationale, qui se réunit pour la première fois le 8 mai. Elle comprend dix membres : un procureur français, un diplomate canadien, un professeur de droit international belge, un diplomate allemand, un diplomate onusien, un médecin légiste britannique, un juriste américain, un expert militaire de l’Organisation de l’unité africaine, un procureur néerlandais et une juriste rwandaise. Cette dernière, Christine Umutoni, est alors la directrice de cabinet du ministre de la Réhabilitation. La commission fonctionne au consensus, ce qui donne à Christine Umutoni un droit de veto sur le rapport final remis au président de la République le 18 mai. Dans ce document, nul nombre de morts n’est donné. Les soldats de l’APR se voient reprocher d’avoir ouvert le feu sans faire de différence entre éléments hostiles et non hostiles. L’existence d’un « noyau dur » est imputée à l’insuffisance du travail des casques bleus. Les ONG sont blâmées pour ne pas avoir convaincu les déplacés de rentrer chez eux. Le commandant de l’APR écope de trois mois de prison avec sursis et d’une amende de 23 dollars (Vidal, 2004).
Un privilège d'impunité
L’étude du massacre de Kibeho, perpétré en 1995, fournit une réponse sans ambiguïté du nouveau pouvoir rwandais à la question de savoir quel usage il réserve alors à la violence politique. Quand, après le 6 avril 1994, l’offensive de l’APR pour conquérir le pouvoir est lancée, ses dirigeants ne sont pas des débutants en matière de crimes de masse. Leurs antécédents sont déjà connus des observateurs avertis : massacres de non-combattants au cours des guerres civiles ougandaises (années 1980) en association avec les guérilleros de Yoweri Museveni après la chute d’Idi Amin Dada, purges internes meurtrières en son sein dans les années 1990, exécutions de paysans et d’élus communaux dans les zones occupées du Rwanda, massacres de paysans rwandais et de réfugiés burundais au cours de la conquête du pouvoir après la mort d’Habyarimana. Mais la mémoire de ces faits guerriers était fragmentaire, enchâssée dans des discours de spécialistes souvent contradictoires, incertaine au point de faire difficilement histoire. Les réponses du FPR étaient bien rodées : négations des faits, actes de malveillance d’individus diffuseurs de rumeurs, violences marginales provoquées par les comportements de leurs victimes.
Face à ces incertitudes, la connaissance de l’histoire de Kibeho (1995) apporte une visibilité mondiale au récit quasi instantané d’un massacre commis durant plusieurs jours devant des centaines de témoins étrangers qui regardent disparaître par milliers des déplacés dont le seul crime est d’avoir peur de ce qui les attend une fois rentrés chez eux. Devant cette profusion de témoins et de documents, il semble impossible de dévaluer la mémoire de l’événement, au point de la presque effacer, une fois de plus. C’est pourtant ce petit miracle que réussissent les acteurs politiques.
Les Nations unies et les pays qui créditent le FPR d’avoir arrêté le génocide et d’en représenter les victimes avaient-ils les ressources politiques et morales pour s’opposer à Kigali quand le régime se livrait à la répétition des crimes de masse ? En réalité les auteurs de ces crimes ont souvent bénéficié non seulement d’une forme d’amnésie et d’immunité mais aussi de récompenses matérielles et symboliques. Dans cet exemple, après la remise du rapport de la commission d’enquête internationale, le Rwanda a reçu l’aide financière dont il avait besoin, le commandant de l’APR, qui avait dirigé la tuerie de Kibeho, a été envoyé au Darfour, comme chef des casques bleus et responsable des opérations militaires des Nations unies, et est devenu Secrétaire général des Nations unies.
Les enseignements de cette triste histoire restent malheureusement toujours vrais aujourd’hui. Trente ans plus tard, l’armée rwandaise et ses associés n’ont pas cessé de mener des offensives meurtrières en République démocratique du Congo et personne, aucune instance, ne semble en mesure de s’y opposer.

Bibliographie
Jordan, Paul, 2011, « Witness to genocide, a personal account of the 1995 massacre », 28 mars : <www.anzacday.org.au>.
O’Halloran, Kevin, 2010, Pure Massacre. Aussie Soldiers Reflect on the Rwandan Genocide, Newport, Big Sky Publishing.
Pickard, Terry, 2008, Combat medic. An Australian’s eyewitness account of Kibeho massacre, Wavell Heights, Big Sky Publishing.
« Déclaration du gouvernement rwandais sur la décision de fermeture des camps de déplacés de Gikongoro », Kigali, le 24 mai 1995.
Rapport de la commission internationale indépendante d’enquête sur les événements de Kibeho, 18 mai 1995, Kigali : <http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/rapportONU/N9515255-ONU-Kibeho.pdf>.
Vidal, Claudine, 2004, « Les humanitaires, témoins pour l’histoire », Les Temps modernes, no 627, p. 92-107.
DOI : 10.3917/ltm.627.0092
Pour citer ce contenu :
Jean-Hervé Bradol, « Rwanda, Kibeho 1995, un massacre impensable », 25 octobre 2024, URL : https://msf-crash.org/fr/guerre-et-humanitaire/rwanda-kibeho-1995-un-massacre-impensable
Si vous souhaitez réagir à cet article, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous contacter ici :
Contribuer