
Jean-Hervé Bradol, Francisco Diaz, Marc Le Pape & Jérome Léglise

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).
Ancien directeur du département logistique de Médecins Sans Frontières en France

Marc Le Pape a été chercheur au CNRS et à l'EHESS. Il est actuellement membre du comité scientifique du CRASH et chercheur associé à l’IMAF. Il a effectué des recherches en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages : Côte d'Ivoire, l'année terrible 1999-2000 (2003), Crises extrêmes (2006) et dans le cadre de MSF : Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (2001) et Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997 (2016).
Référent eau, assainissement et hygiène à Médecins Sans Frontières, basé à Paris
PARTIE 1 Journée d’étude du CRASH : L’eau humanitaire est-elle potable ?
INTRODUCTION
Francisco Diaz, directeur de la logistique, MSF Paris
– Mon expérience des activités eau, hygiène et assainissement (EHA ou « watsan »)Watsan, pour « water and sanitation ». C’est devenu, dans le jargon professionnel, le terme qui désigne les activités de fourniture d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA).me vient de deux types de situation : les urgences (Darfour, Niger, Ouganda, Zambie, Érythrée, Éthiopie, Sri Lanka et Pakistan) et l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement au sein d’une population de bidonville (Guatemala, 1987-1997).
Pour MSF, l’expérience des camps de déplacés éthiopiens des années 1980 est décisive. L’absence de compétences en EHA au sein de MSF a conduit à se tourner vers OxfamOxfam pour Oxford Committee for Famine Relief, une organisation caritative fondée en Grande-Bretagne en 1942. et le CICRComité international de la Croix-Rouge. afin d’acquérir rapidement des savoir-faire.
À partir du début des années 1990, nous disposons d’une certaine autonomie dans ce domaine d’activité. L’implication systématique de MSF dans l’aide aux réfugiés met en relief l’importance de la qualité de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement pour contrôler la morbidité et la mortalité dans les camps. À côté des soins médicaux (curatifs et préventifs), l’EHA devient la deuxième activité opérationnelle de MSF.
Les pollutions physico-chimiques des eaux en Thaïlande et au Bangladesh, dans les camps de réfugiés, ont justifié un regain d’attention médicale à propos de la qualité de l’eau produite et distribuée dans les contextes des interventions humanitaires. Le simple fait que ce type de pollution n’ait pas été pas pris en considération par les procédures en vigueur dans notre milieu professionnel (Sphère,Le Pro jet Sphère a été lancé en 1997 dans le but d’améliorer la qualité de l’aide apportée aux populations sinistrées. Des milliers de personnes appartenant à des centaines d’organisations (des ONG nationales et internationales, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des institutions des Nations unies, des agences donatrices, des gouvernements hôtes ainsi que des représentants des populations sinistrées) représentant plus de 80 pays ont participé à différents aspects du Projet Sphère (la conception et la révision du manuel, la supervision du déroulement du projet et la formation).1997) nous a conduits à nous interroger sur les origines et les limites de ces standards. Cette réflexion, le département de la logistique a souhaité la mener avec l’équipe du Crash.
Dans mon esprit, l’objectif de cette journée de travail est de ne pas se résigner à ce que l’eau que nous produisons et distribuons soit l’objet de pollutions récurrentes (fécales ou physicochimiques) ayant un impact sanitaire négatif parce que nos équipes ne sont capables ni de les prévenir ni de les traiter (par exemple, le virus de l’hépatite E).
Jean-Hervé Bradol, Crash, MSF Paris
– L’intention première de cette journée est de mieux formuler les questions posées par les contaminations mentionnées par Francisco Diaz. C’est une étape préalable à la recherche de solutions. La journée sera divisée en trois sessions.
Lors de la première, nous essaierons de comprendre à partir de quelles situations de terrain et de quelles difficultés nous entamons cette réflexion. Rebecca Freeman Grais, épidémiologiste, directrice du département recherche d’Épicentre, nous présentera l’épidémie d’hépatite E survenue l’été 2004 dans le camp de Mornay, au Darfour. Étienne Gignoux, ingénieur sanitaire, cadre expérimenté de nos activités EHA sur le terrain comme au siège, nous présentera les principales situations et difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Au cours de la deuxième session, nous essaierons de mieux comprendre l’état des connaissances au sujet de la relation entre l’eau et la santé ainsi que l’étendue de la palette de techniques disponibles pour réduire les risques sanitaires liés à la consommation d’eau. Paul R. Hunter, professeur de microbiologie à l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni), nous éclairera sur la relation entre eau et santé. Joël Mallevialle, ingénieur, dressera un tableau des techniques utilisées dans les entreprises privées et publiques et indiquera celles qui pourraient être compatibles avec les conditions du travail humanitaire.
Pendant la troisième session, nous verrons qui sont les acteurs de l’accès à l’eau et quels en sont les enjeux sociaux, économiques et politiques. Nous examinerons aussi la nature des débats et des oppositions sur la scène internationale. Thierry Ruf, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et Benoît Meribel, président d’Action contre la faim (ACF), présenteront successivement les enjeux locaux et transnationaux de l’approvisionnement en eau des populations.
Cette journée a été préparée conjointement par des membres du département logistique (Francisco Diaz, Jérôme Léglise, Salma Lebcir, Marianne Denolle), au sein duquel les activités EHA sont hébergées, et des membres du Crash (Bérengère Cescau, Brooke Dalury, Jean-Hervé Bradol, Marc Le Pape). Je souhaite également remercier le service d’interprétariat (Agnès Debarge, Eve Dayre), coordonné par Caroline Lopez Serraf, ainsi que l’équipe d’État d’urgence Production (François Dumaine, Simon Rolin, Jérome Etter), qui réalise la vidéo de la journée.
PREMIÈRE SESSION : INTERVENTIONS HUMANITAIRES OÙ L’APPROVISIONNEMENT EN EAU FAIT L’OBJET DE DIFFICULTÉS
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉPIDÉMIES D’HÉPATITE E
REBECCA FREEMAN GRAIS, ÉPIDÉMIOLOGISTE, DIRECTRICE DE RECHERCHE, ÉPICENTRE
– Je remplace Kate Alberti, notre épidémiologiste habituellement chargée de ce sujet, qui est à Haïti pour la flambée de choléra. Ma présentation traite des enseignements tirés de nos expériences de réponse aux épidémies d’hépatite E. Pour commencer, je vous parlerai rapidement de l’hépatite E. Puis, je détaillerai l’exemple de l’épidémie survenue dans le camp de Mornay (2004), dans l’ouest du Darfour, au Soudan, ce que nous avons appris depuis, et ce qu’il nous reste encore à comprendre.
L’hépatite E n’a été reconnue comme maladie à part entière qu’à partir du début des années 1980, ce qui est relativement récent. Avant cette date, on parlait seulement d’hépatite non-A, non-B. Il s’agit d’un virus à ARN monobrin. Le virus de l’hépatite E (VHE) a été détecté chez les primates et d’autres espèces animales. L’homme en est un hôte naturel.
Le mode de transmission primaire est fécal. Les selles contaminent l’eau de boisson. La transmission s’opère également d’homme à homme et par les aliments (par exemple par l’ingestion de fruits de mer crus ou pas assez cuits). Il existe, bien sûr, une possibilité de propagation zoonotique.
Si nous regardons l’épidémiologie de l’hépatite E dans le monde, toutes les estimations font apparaître une séroprévalence assez élevée. Un tiers de la population mondiale possède des anticorps anti-hépatite E, ce qui est énorme. Les pays fortement endémiques sont ceux qui connaissent des flambées avec un taux d’infection ou des estimations de séroprévalence de plus de 25 %, les pays endémiques sont au-dessous de 25 %, et, en blanc, vous avez les pays non endémiques. Comme vous pouvez le constater, le VHE est omniprésent.Boccia Delia, Klovstad Hilde, Guthman Jean-Paul Outbreak of hepatite E Mornay Camp Western Darfur Sudan. Final report. Épicentre, Paris décembre 2004.
« THE TWO FACES OF HEPATITIS E VIRUS», JAMES M. HUGHES, MARY E. WILSON, EYASU H. TESHALE, DALE J. HU, SCOTT D. HOLMBERG, IN THE TWO FACES OF HEPATITIS E VIRUS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, ROYAUME-UNI (1999) (REVUE), 2010, VOL. 51, N°3, PP. 328-334
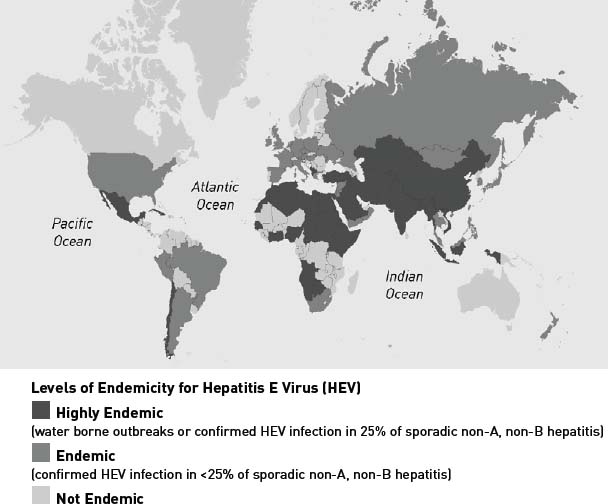
En ce qui concerne le virus lui-même, il existe un sérotype et quatre génotypes. Deux points sont à noter à ce stade. Le virus est présent partout dans le monde et les génotypes sont regroupés géographiquement, avec des différences continentales.
Je vais à présent vous parler de l’exemple que je connais bien : l’épidémie qui s’est produite à Mornay (Darfour occidental, Soudan, 2004), dans un camp de 78 000 personnes déplacées. Les habitants du camp tiraient leur eau du wadi, la rivière, ou des réseaux de canalisations. MSF a également mis en place un système de distribution d’eau à partir du recueil d’une eau de surface traitée par le chlore. Les habitants du camp pouvaient bien sûr obtenir leur eau à partir d’autres sources à l’intérieur du camp (eaux souterraines provenant de forages existants ou eaux de surface non traitées).
Que s’est-il passé ? Fin juin 2004, 6 cas de jaunisse aiguë étaient signalés dans l’ouest du Darfour. La semaine suivante, 18 nouveaux cas étaient déclarés, dont 4 à Mornay, et parmi ces 4 patients, 2 étaient des femmes enceintes qui sont décédées par la suite. Les cas se sont multipliés dans les semaines qui suivirent. Le diagnostic d’hépatite E a été confirmé par le Laboratoire de l’Unité numéro 3 de recherche médicale de la Marine étasunienne, situé au Caire. Dès la première semaine du mois d’août, on dénombrait déjà 1 000 cas dans tout le Darfour, 600 pour le seul État du Darfour occidental, dont 200 à Mornay. Une enquête épidémiologique a donc été lancée afin de documenter l’épidémie et d’analyser les facteurs de risque. Ce travail a été effectué fin août 2004.
Nous avons commencé par examiner les registres et les dossiers des personnes hospitalisées avant de réaliser ce qu’on appelle une étude de cohortes. Nous avons pris en considération les individus de plus de 2 ans qui vivaient à Mornay et qui avaient présenté une jaunisse (définie par une sclérotique jaune) depuis le 1er juillet et au moins l’un des symptômes suivants : état de faiblesse, douleurs abdominales, fièvre ou vomissements. Les témoins, des individus qui ne présentaient aucun de ces symptômes, ont été choisis au hasard parmi les autres résidents. Nous avons ensuite étudié les informations recueillies à propos de toutes ces personnes (cas et témoins), en particulier leurs symptômes cliniques. Nous avons effectué des analyses sérologiques pour les humains (IGG et IGM) et pour les ânes (PCR sur les selles et le sérum). Nous avons également recherché des facteurs de risque potentiels dans les habitations : eau, installations sanitaires et animaux du foyer.
July-Dec 2004: 2621 cases
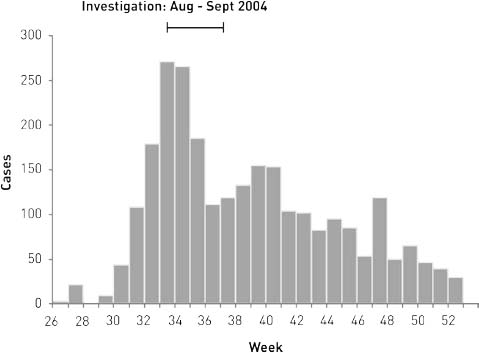
Source : Boccia Delia, Klovstad Hilde, Guthman Jean-Paul Outbreak of hepatite E Mornay Camp Western Darfur Sudan. Final report. Épicentre, Paris, décembre 2004.
Voici donc le profil de cette épidémie. L’enquête a été réalisée en août. Vous voyez que l’épidémie a atteint un pic très élevé, puis que la courbe redescend. C’est cohérent avec ce qu’on appelle un épisode épidémique dont l’origine est une source commune, en l’occurrence hydrique. Parmi les individus que nous avons étudiés, 50 % des cas étaient des adultes (15 à 45 ans) dont une moitié de femmes. Le taux d’attaque était d’environ 3 %. Le taux de létalité, était, dans l’ensemble, assez faible, presque 2 %, mais il était nettement plus élevé chez les femmes enceintes qui représentaient 19 des 45 décès.
Comparé au groupe de référence (0-14 ans), le risque est approximativement double pour les 15-45 ans. Nous avons identifié les facteurs de risque habituellement décrits, mais nous avons aussi découvert que la consommation d’eau de surface chlorée constituait également un facteur de risque potentiel. Sur les 75 cas présentant une jaunisse pour lesquels nous avons recherché des signes biologiques d’hépatite E, 97 % présentaient une hépatite E aiguë, une petite proportion, 3%, d’entre eux avait une immunité antérieure. Plus intéressant encore, nous voyons que 35 % des cas témoins souffraient d’une hépatite E aiguë sans aucun symptôme clinique. Nous avons trouvé un marqueur d’une immunité ancienne chez un quart des cas témoins.
L’analyse des échantillons d’eau que nous avons prélevés dans de l’eau non chlorée, montrait que 5 sur 12 étaient positifs aux coliformes. Par ailleurs, nous avons vérifié que la teneur en chlore était satisfaisante au niveau des robinets d’arrivée d’eau : le chlore résiduel était dans la fourchette requise. Nous avons aussi découvert que 2 des 5 ânes que nous avions testés étaient positifs pour l’hépatite E. Nous n’avons testé que des ânes malades. Cela était sans doute une erreur car un tel échantillon n’est évidemment pas représentatif de toute la population d’ânes.
Ce que nous a appris cette étude correspondait, dans une certaine mesure, à ce que nous savions déjà. La population masculine adulte (15-45 ans) présentait plus de risques. Bien sûr, nous avons aussi constaté chez les femmes enceintes un taux de létalité plus élevé que dans les autres groupes.
Plus surprenant : les analyses ont permis non pas de démontrer (les intervalles de confiance sont légèrement trop grands), mais de suggérer que les résidents qui buvaient de l’eau de surface chlorée présentaient plus de risques. À y repenser aujourd’hui, ces individus auraient pu aussi prendre de l’eau ailleurs, au lieu de s’approvisionner uniquement à partir du réseau chloré, ou encore cela pourrait être du à un autre facteur que nous n’avons pas observé, ou que nous ne pouvons pas vraiment identifier.
L’inactivation de l’hépatite E dans l’eau chlorée requiert des concentrations de chlore anormalement élevées. Mais l’inactivation du virus ne peut être garantie en s’assurant simplement d’une chloration adéquate. La turbidité de l’eau joue un rôle, le pH joue un rôle, et c’est une technique difficile à maîtriser, même dans des conditions optimales avec beaucoup de ressources. Le piège est que le chlore est plus efficace quand le pH est bas, et plus vous ajoutez de chlore, plus vous augmentez le pH de l’eau, ce qui rend plus difficile l’inactivation du virus. C’est une opération délicate, et une simple adjonction de chlore ne garantit pas l’inactivation du VHE.
Dans cette épidémie, il est aussi possible qu’il y ait eu transmission d’homme à homme, même si nous n’avons pas étudié cette éventualité. Nous n’avons regardé que les ânes, nous avons donc un échantillon biaisé par rapport aux autres sources potentielles de contamination. Nous avons conclu que le réseau de distribution d’eau a, bien sûr, permis d’augmenter la disponibilité et la quantité de l’eau. Par contre, le procédé de traitement de l’eau utilisé ne permettait pas de garantir l’inactivation du virus de l’hépatite E et nous devons modifier nos procédés de traitement de l’eau afin de prévenir de futures épidémies. Mais la conclusion essentielle est que le plus important est de fournir de l’eau en quantité suffisante même si sa qualité ne permet pas de garantir l’absence de VHE.
Autre élément : la période d’incubation de l’hépatite E est extrêmement longue – 40 jours en moyenne. Par conséquent, le temps que l’on remarque une augmentation du nombre de cas, le processus est déjà très avancé. Il est trop tard pour réagir en changeant quelque chose à ce stade. Nous avons une fenêtre de temps très courte pour intervenir. Il aurait fallu le faire en amont, au moment de la conception du système de distribution d’eau. C’est donc une épidémie difficile à enrayer une fois que les premiers cas sont apparus dans une population. Depuis ces événements, nous avons connu une autre épidémie dans des camps de déplacés du nord de l’Ouganda (2007-2009). Environ 10 000 cas de jaunisse aiguë ont été signalés et suivis de 160 décès. Or, il y avait une ressemblance avec le génotype de l’hépatite observé au Soudan, également présent au Tchad à la même période dans les régions frontalières. Ce que nos collègues ont découvert d’intéressant en Ouganda, c’est que parmi la population étudiée les enfants présentaient un risque plus élevé de mourir de l’hépatite E, bien qu’ils soient généralement asymptomatiques. Ces décès ont été attribués à l’hépatite E par autopsie verbale. Ce point est un peu délicat à confirmer. Des études antérieures suggèrent que ce phénomène s’est déjà produit, lors d’une épidémie en ex-Union soviétique.
La principale conclusion à laquelle sont parvenus les investigateurs et les auteurs au vu de cette étude, c’est que la transmission au sein des foyers jouait en fait un rôle extrêmement important. Les raisons à cela ne sont pas claires. Il pourrait y avoir une explication d’ordre sociologique ou démographique, les personnes qui vivent ensemble ayant tendance à se servir de la même eau et à utiliser l’eau de la même manière parce qu’ils partagent les mêmes habitudes d’hygiène. On a constaté que les cas étaient regroupés par foyers plutôt que répartis de façon homogène à travers la population. Nous pouvons en déduire qu’il nous faut peut-être envisager des approches visant des lieux d’intervention multiples, à savoir ne pas se contenter de traiter l’eau elle-même, mais cibler également les utilisateurs et la manière dont l’eau est utilisée à l’intérieur d’un foyer.
Alors, que nous reste-t-il à découvrir et sur quoi devons-nous encore travailler ? Eh bien, en fait, quand on regarde la littérature, on s’aperçoit qu’on ne sait pas grand-chose sur l’hépatite E. Comme je le remarquais hier en parcourant la littérature sur le sujet, presque tous les auteurs ne cessent de répéter la même chose et d’ailleurs, ironiquement, si vous allez sur le site Web de l’OMS pour chercher des informations à propos de l’hépatite E, vous verrez que le lien qui renvoie à plus d’information sur l’hépatite E ne fonctionne pas.
Il n’y a rien qui explique vraiment les différences en termes de genre ou d’âge : l’impression que les personnes de 15-45 ans présentent un risque d’infection plus élevé que les autres. Nous ne savons pas grand-chose, non plus, sur une prédisposition différente à une issue fatale. Pourquoi les enfants ? Pourquoi les femmes enceintes ? La période de contagion est encore mal cernée, tout comme le poids épidémiologique de l’hépatite E à travers le monde. Les articles publiés n’apportent guère de preuves scientifiques, et nous ne disposons que de données éparses recueillies dans différents endroits du monde où l’on a observé une augmentation des cas confirmés par des examens de laboratoires.
On ignore aussi quel pourrait être le rôle d’un vaccin. Plusieurs candidats vaccins sont en développement. Une campagne de vaccination a été conduite chez des soldats népalais, et l’autre, menée par le gouvernement chinois, vient de faire l’objet d’une publication dans The Lancet. Ils ont évidemment trouvé 100 % d’efficacité dans la population qu’ils ont étudiée dans un essai de phase trois. Le point intéressant à retenir est qu’il nous faut réfléchir davantage à la vaccination et à son utilisation potentielle. Il s’agit d’un vaccin en trois doses. Ce n’est pas le calendrier vaccinal le plus simple pour immuniser une population. Bien sûr, il n’a pas été testé chez les femmes enceintes ni chez les enfants. Nous serions curieux de connaître l’efficacité du vaccin chez les populations les plus vulnérables.
Un autre aspect que nous devons creuser est le rôle des réservoirs animaux. On connaît des cas dans les pays développés où la transmission s’est faite à partir de porcs, de sangliers, de rats, de cerfs. On a signalé récemment un cas de transmission de l’hépatite E par un paresseux… le risque est faible, mais là encore cela indique que nous ne savons pas vraiment quels sont les porteurs de l’hépatite E, ni quel est le rôle potentiel des réservoirs animaux. Je conclurais que, en premier lieu, nous devons continuer à explorer des approches préventives novatrices et adaptées dans le domaine de l’approvisionnement en eau, pas seulement par rapport à l’hépatite E, mais plus largement en termes de santé publique. Surtout si nous ne pouvons pas disposer d’un système complètement fermé. Il est important de réfléchir aux mesures que nous pouvons mettre en œuvre : vérifier la qualité de l’eau à la source, dans le réseau de distribution, et bien sûr au moment de sa consommation par les utilisateurs. Dans l’ensemble, nous comprenons assez mal le rôle de l’eau dans la transmission de l’hépatite E, comme dans celle des maladies en général. J’espère vraiment que nous continuerons à étudier cette question.
QUESTIONS ET REMARQUES À LA SUITE DE L’INTERVENTION DE REBECCA FREEMAN GRAIS
Fabrice Weissman, Crash, MSF Paris
– Je voudrais avoir des précisions sur les conclusions que tu tires de l’épidémie survenue au nord de l’Ouganda quant aux modes de transmission. Je n’ai pas très bien compris ce que tu expliquais à propos de la transmission entre membres de la même famille.
Rebecca Freeman Grais
– Ils ont attribué l’origine de cette épidémie, ou sa cause principale, à la présence de matières fécales dans la source d’eau. Mais ils ont aussi examiné les taux d’attaque secondaire : ce qui se passait au sein des familles. Certaines familles n’étaient pour l’essentiel pas affectées alors même qu’elles s’approvisionnaient au même point d’eau, par opposition à d’autres familles dont la plupart des membres étaient atteints. On pourrait en conclure deux choses : d’abord, qu’il y avait potentiellement une transmission de personne à personne au sein du foyer, ou qu’il existe un autre facteur au niveau de la manière dont l’eau est utilisée dans la famille qui aurait conduit à cet effet de cas groupés, ce qui est intéressant en termes de mesure témoin. Ce qui signifie qu’il est insuffisant de ne pas savoir comment l’eau est utilisée dans les foyers, ce qui est évident.
Dominique Maison, ingénieur sanitaire, OMS
– Je suis ingénieur sanitaire et je m’occupe des situations d’urgence à l’OMS. J’avais une question, vous avez fort justement spécifié dans votre intervention que l’eau pouvait ne pas tout expliquer. Je pense qu’on en vient très rapidement aux questions de comportements et d’hygiène qui sont une facette très importante dans ce type d’intervention et à plus long terme. Je voulais savoir si vous aviez mené des enquêtes CAP (étude des connaissances, attitudes et pratiques en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène) qui pourraient également contribuer à expliquer ce que vous avez présenté.
Rebecca Freeman Grais
– Non, nous ne l’avons pas fait, mais nous aurions dû, sans doute. J’aurais dû être plus précise sur ce point. C’était en fait notre première grande expérience avec une flambée épidémique de cette ampleur. Je pense que nous avons fait de notre mieux. Si je devais refaire cette investigation, j’étudierais aussi d’autres facteurs annexes, notamment celui-là, bien sûr.
François Mansotte, ingénieur sanitaire, Agence régionale de santé Aquitaine
– J’ai également travaillé en Guyane. Le dernier département français qui ait subi une épidémie de choléra (1991) et qui périodiquement est affecté par des foyers endémiques localisés de typhoïde. Je crois que vous avez insisté sur le fait que vous étiez surprise de voir une eau chlorée, voire normalement chlorée, véhiculer des agents infectieux. Je veux dire que dans aucun pays du monde, non plus qu’en France, le chlore n’inactive les virus ni les parasites. En conséquence, il faut vraiment veiller à la qualité de l’eau que l’on va utiliser et privilégier les eaux souterraines. Ce principe date du XIXe siècle et aura encore de la valeur pendant des siècles.
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES CONTEXTES DU TRAVAIL DE MSF
INTERVENTION D’ÉTIENNE GIGNOUX, INGÉNIEUR SANITAIRE, INTERVENANT SUR LES TERRAINS MSF
– J’ai une expérience de spécialiste en eau, hygiène et assainissement dans le cadre de MSF. Comme je suis le seul intervenant MSF spécialiste en eau, avant de parler des difficultés, je vais essayer de vous présenter ce que l’on fait effectivement sur le terrain.
Les médecins peuvent me contredire, mais, a priori, personne ne meurt de soif sur nos terrains. En revanche, les bouleversements qui sont à l’origine de nos interventions conduisent les gens à accéder à une eau dont la quantité et la qualité ont changé. Donc, ce que l’on va chercher à obtenir, c’est une eau d’une certaine qualité en quantité suffisante pour que tout le monde puisse la consommer.
D’où vient notre culture professionnelle de l’eau ? La plupart du temps, les personnes chargées de cette activité à MSF sont des logisticiens encadrés par des spécialistes qui ont une formation ou ont acquis des compétences dans le traitement et la gestion de l’eau. Ces compétences ont été acquises dans un contexte très différent, par exemple en France, où les systèmes d’eau ont évolué par strates au cours des années. Ils ont évolué en fonction de la croissance démographique et également en fonction des avancées scientifiques et technologiques. Et puis surtout, en France, le patrimoine de l’eau appartient à l’État, à la collectivité. Dans leurs circonstances de travail, les « superplombiers » de l’humanitaire n’ont pas cette maîtrise globale de l’eau. En outre, ils doivent agir très rapidement.
Du point de vue de l’approvisionnement en eau, mon expérience m’amène à distinguer quatre contextes. Les sites de réfugiés ou déplacés par un conflit étaient surtout des contextes d’intervention des années 1990. Au milieu de cette même décennie, nos interventions dans ces contextes deviennent moins fréquentes bien que chaque année nous fassions néanmoins une grosse urgence liée à un déplacement de population où la distribution d’eau est une activité importante. La dernière en date, c’était au Congo pour des populations déplacées par un conflit. Ces interventions restent sporadiques. Mais, quand elles se produisent, elles demandent beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles, et elles concernent des populations de grande taille. Elles ne doivent donc pas être négligées.
Le deuxième contexte que je souhaite évoquer est celui des sites de déplacés ou de sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle. Pourquoi les distinguer des déplacements de populations entraînés par la guerre ? Principalement pour des raisons techniques. En général, les catastrophes naturelles entraînent la formation d’une multitude de sites de petite taille. Dans le cas des déplacés par un conflit, les camps sont parfois énormes : par exemple, le camp de Kalma, au Darfour, abrite 100 000 à 120 000 personnes. Dans la même région, le camp de Mornay comptait 80 000 personnes. Lors d’une catastrophe naturelle, on va avoir quelques gros camps, mais surtout une multitude de petits camps, qui relèvent d’une approche opérationnelle différente. De plus, la catastrophe naturelle a souvent affecté les systèmes d’eau.
Le troisième contexte, après les déplacements de population et les catastrophes naturelles, est constitué par des « situations stables » où l’on souhaite voir la fourniture d’eau évoluer rapidement, par exemple pour répondre à une épidémie. Un exemple courant est l’épidémie de choléra dans une ville. L’absence de guerre ou de catastrophe naturelle conduit à qualifier ces situations de « stables ». Cependant, elles ont en commun avec la réponse aux catastrophes naturelles d’imposer des interventions dans de multiples lieux, sur un large territoire. Enfin, le quatrième contexte, qui ne peut être oublié car il est toujours présent et prioritaire pour MSF, est celui de la gestion de l’eau dans les structures de soin.
Dans la suite de cet exposé, je laisserai de côté, faute de temps, la gestion de l’eau dans les centres de soin car je me concentrerai sur l’approvisionnement en eau des populations. Je n’aborderai pas, faute de temps, les domaines de l’hygiène et de l’assainissement, qui sont pourtant fondamentaux pour la gestion du risque sanitaire lié à l’eau dans les structures de soin. L’impératif de qualité est évident pour l’eau d’un dispensaire ou d’un hôpital. Plus que dans d’autres situations, le système doit être fiable pour qu’il n’y ait pas de rupture. Mais, grosso modo, en matière de fourniture d’eau, les impératifs ne sont pas très différents de ceux des autres contextes. En revanche, en termes d’assainissement et de gestion des déchets, les exigences sont beaucoup plus importantes. Les quantités augmentent en fonction de la taille et de l’activité des structures. Les camps « choléra » et les gros hôpitaux consomment beaucoup. L’hôpital de campagne, sous tentes, mis en place après le tremblement de terre de janvier 2010 à Haïti pour faire de la chirurgie consommait 60 m3, 60 000 litres, par jour. En revanche, les dispensaires consomment beaucoup moins, quelques mètres cubes par jour.
Dans le souci de présenter les circonstances dans lesquelles nous travaillons à ceux qui ne les partagent pas et avec qui nous souhaitons mener cette réflexion, j’ai préparé un modèle type de nos interventions. Supposons un village avec une ressource en eau existante, un puits, par exemple. Il existe également la possibilité de recueillir de l’eau de surface grâce à une rivière dans laquelle des petits trous peuvent être creusés pour collecter l’eau quand elle est à sec.
IMAGE DESSINÉE PAR ÉTIENNE GIGNOUX
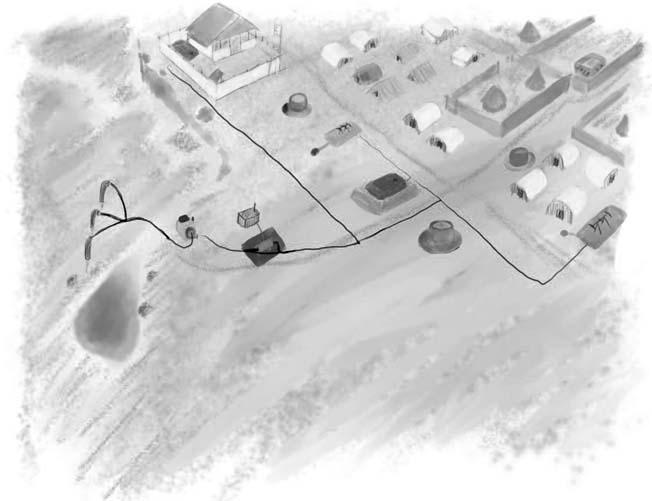
L’arrivée d’une population de déplacés provoque deux choses : la première, c’est que l’accès à l’eau va être réduit parce qu’il y aura plus de monde autour du puits, et la deuxième, c’est la pollution, de l’eau de surface comme de celle du puits. Cela est dû à l’augmentation de la population et des pollutions fécales. Le mélange des populations résidente et déplacée entraîne aussi l’échange de pathogènes d’une population à l’autre.
Pour les techniciens EHA de MSF qui interviennent en réponse à la crise sanitaire provoquée par l’afflux de population déplacée, la priorité est l’approvisionnement en eau des structures de soin. Plusieurs sources s’offrent à eux. Le puits est déjà fortement sollicité depuis l’arrivée des déplacés. Il n’est pas toujours possible de se tourner vers une autre source sur un autre site, par exemple une ville proche, et de transporter l’eau par camion-citerne. Il est probable qu’en première intention ils utilisent ce qu’ils ont sous les yeux, c’est-à-dire l’eau de surface. Le premier objectif du traitement de l’eau de surface est de la rendre claire. C’est probablement l’étape la plus compliquée. Mais nous avons maintenant une expérience suffisamment solide pour baliser la réalisation de ce travail. L’eau est obtenue en faisant très rapidement des forages peu profonds (eau de surface) aux alentours et dans le lit de la rivière. Nous pratiquons la floculation, une sédimentation assistée par l’adjonction d’un produit chimique, dans de grands réservoirs afin d’obtenir une eau claire.
Avant d’être distribuée dans les canalisations qui l’amènent aux consommateurs, l’eau est désinfectée au chlore. Jusqu’à présent, nous pensions que le chlore était suffisant. Comme nous l’avons vu précédemment, notre expérience nous a montré que, dans certains cas, le chlore ne couvrait pas tous les risques épidémiques. En conséquence, lors de certaines interventions, nous avons complété le dispositif par un traitement par rayonnement ultraviolet (UV) qui est assez facile à mettre en œuvre sur nos terrains. En revanche, son efficacité doit être un des sujets de la discussion d’aujourd’hui.
Le traitement de l’eau de surface est-il satisfaisant ? Une fois les premiers besoins assurés, on va pouvoir aller chercher de l’eau souterraine. On préférera les forages aux puits ouverts afin de mieux protéger la ressource et parfois en raison de la profondeur requise. Pourquoi le forage ? Parce que la qualité bactériologique est plus intéressante. Nous supposons que l’eau souterraine est de meilleure qualité que l’eau de surface. Autre problème des eaux de surface, les quantités sont très variables selon la saison. En revanche, les volumes d’eaux souterraines sont plus stables au cours d’une année. Mais forer est relativement compliqué. Cela demande des compétences spécifiques et beaucoup de matériel. Il y a toujours un risque de ne pas trouver d’eau. Néanmoins, cela est faisable. Dans la majorité des cas, la qualité bactériologique de l’eau est meilleure. Il faut garder en tête les exceptions à la règle, mais elles sont peu fréquentes. Du point de vue des pollutions physico-chimiques, on peut avoir de mauvaises surprises qui sont difficiles à prévoir, dont le meilleur exemple est la présence d’arsenic dans les eaux souterraines du Bangladesh.
Voilà, en résumé, la problématique de l’approvisionnement en eau dans le cas d’un afflux de population. Dans l’histoire de MSF, ce contexte a été le premier dans lequel nous avons cherché à acquérir et à mobiliser ces compétences EHA. Mais ces dernières sont-elles mobilisables dans d’autres contextes ? Dans l’exemple du passage du cyclone Nargis (2008) dans le delta de l’Irrawaddy, en Birmanie, nous nous sommes trouvés face à une multitude de sites où les systèmes et les réserves d’eau avaient été touchés par la catastrophe. Donc, l’approche présentée plus haut pour les camps de déplacés n’était pas réalisable. L’eau de pluie est une ressource alternative à l’eau de surface et à l’eau souterraine, elle a été utilisée au début des opérations de secours en réponse au passage de Nargis. L’autre possibilité est de puiser l’eau sur un autre site et de la transporter par camions-citernes. Ce système coûteux est d’une relative complexité en matière de transport et il est fragilisé par les inévitables pannes de camions-citernes.
Les traitements physico-chimiques sont trop compliqués pour nos circonstances de travail en dehors de la correction d’excès en fer. Pour le traitement bactériologique, les possibilités sont plus nombreuses. Mais les quantités nécessaires dans les déplacements de populations imposent de se limiter : à la sédimentation assistée (la floculation), au chlore et au rayonnement ultraviolet. Pour les hôpitaux et les dispensaires, nous pouvons employer les mêmes techniques, mais les volumes inférieurs autorisent aussi l’usage de techniques plus performantes en termes de traitement des pollutions fécales ou physico-chimiques : la microfiltration, l’ultrafiltration et l’osmose inverse.
Reste un domaine technique que nous avons jusqu’à présent peu exploré. Celui du traitement de l’eau à l’intérieur des habitations, au niveau du point de consommation. Une plus grande panoplie de traitements existe. Le chlore et la sédimentation assistée sont toujours possibles. L’usage de l’énergie solaire peut couvrir le traitement par rayonnement UV, la pasteurisation ou même l’ébullition, qui est pratiquée depuis longtemps dans certains groupes de population. La microfiltration (filtre en céramique) et, dans une moindre mesure, l’ultrafiltration (jerrycan muni d’une membrane utlrafiltrante et d’une pompe à main) font également partie des techniques utilisables pour traiter l’eau à domicile, au plus près du point de consommation.
Quelles sont les limites actuelles des traitements que nous utilisons ? L’inefficacité du chlore sur le virus de l’hépatite E est un exemple flagrant. Nous avons réagi en ajoutant le rayonnement ultraviolet au traitement par le chlore. Mais nous n’avons aucune preuve de l’action des UV sur le virus de l’hépatite E, et déjà des éléments pour penser le contraire. L’exemple du virus de l’hépatite E échappant au traitement par le chlore nous a permis de réaliser que nous ne maîtrisons pas les risques liés à un certain nombre d’agents pathogènes présents dans les eaux que nous distribuons.
À l’occasion de cette journée de travail, nous allons passer en revue les technologies existantes et leurs possibles utilisations dans les circonstances des interventions humanitaires. Puis, nous devrons nous poser la question du moment et du lieu où le traitement doit intervenir. À la source, avant distribution à l’ensemble de la population, ou à la maison, avant consommation par les membres du foyer.
L’accès à l’eau doit être examiné au fil des différentes étapes dans le temps d’une urgence. Fournir de l’eau à une structure de santé, c’est souvent l’affaire de quelques heures. Mais fournir un minimum d’eau à la population va être l’affaire de quelques jours, voire de quelques semaines. Fournir suffisamment d’eau à toute la population va être l’affaire de quelques semaines, voire de quelques mois. Ce sont des systèmes qui fonctionnent mais qui nécessitent plusieurs mois de travail pour être réellement efficaces en termes de qualité et de quantité. En cas de catastrophe naturelle, situations épidémiques inclues, par exemple une épidémie de choléra, les sites sont tellement nombreux que nos techniques habituelles montrent toutes leurs limites. En partie parce que nous avons des difficultés à définir les sites prioritaires au sein d’un nombre important de lieux d’intervention possibles. De plus, les systèmes d’approvisionnement en eau que nous avons appris à mettre en place dans les camps de réfugiés ou de déplacés imposent un travail de maintenance plutôt lourd et coûteux.
Ces difficultés font pencher la balance en faveur du traitement de l’eau à domicile par les familles elles-mêmes. Cela pourrait mieux répondre à la contrainte née de la dispersion des sites lors des catastrophes naturelles ou des épidémies survenant en dehors de camps (en « milieu ouvert ») ainsi qu’à la contrainte de la gestion du temps en urgence (les distributions de matériel pour les familles peuvent être plus rapides que l’installation d’un système collectif d’eau). Les coûts comparés des deux approches, traitement domiciliaire ou communautaire, pourraient être sensiblement équivalents. Mais MSF ne possède ni matériel ni stratégie pour le traitement à domicile. Explorer cette piste est un des objectifs de cette journée. L’expérience de l’hépatite E dans le camp de Mornay a montré les limites de nos indicateurs habituels de qualité : clarté, goût compatible avec la consommation, absence de coliformes fécaux et présence de chlore libre en concentration suffisante. Ils sont pertinents pour les contaminations bactériologiques mais non pour celles qui sont virales ou parasitaires. Le problème est identique en Europe, mais les concentrations relatives de virus et de bactéries dans l’eau ne sont pas les mêmes que sous les tropiques, comme le montrent certaines études. Pour la maîtrise des paramètres physico-chimiques, nous disposons d’outils assez commodes d’utilisation. Encore faut-il être renseigné par avance au sujet de la nature des risques dans la région considérée. Le travail de recueil préalable des données épidémiologiques locales et régionales concernant l’eau est trop peu souvent réalisé par les équipes de MSF. Quelle est la meilleure approche ? Faut-il s’acharner à démontrer la qualité de l’eau par de multiples mesures de contrôle ? Ne vaudrait-il pas mieux s’être correctement renseigné sur les données épidémiologiques disponibles à propos des risques physico-chimiques et infectieux présents dans la région ?
Mais les liens entre l’eau et la santé sont loin d’être clairs, et j’aurais peut-être dû commencer ma présentation par cela. En conséquence, comment savoir quelle préférence donner à telle ou telle autre stratégie ? Faut-il privilégier le traitement domiciliaire ? Un système collectif ? Les mesures d’hygiène et d’assainissement ? Les scientifiques sont divisés. Certains, comme Thomas Clasen, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, insistent sur le rôle fondamental joué par l’eau sur la santé et recommandent le traitement à domicile. D’autres, par exemple Sandy Cairncross, qui appartient à la même institution, pensent que la santé dépend plutôt des mesures d’hygiène et d’assainissement que de la quantité et de la qualité de l’eau. Nous reviendrons sur cette controverse au cours de la journée.
QUESTIONS À PROPOS DE L’INTERVENTION D’ÉTIENNE GIGNOUX ET DÉBAT SUR L’ENSEMBLE DES DEUX PRÉSENTATIONS PRÉCÉDENTES
Olivier Falhun, chargé de communication, MSF Paris
– Tu n’as pas abordé, Étienne, la façon dont on gère la norme en termes de quantités. Il existe une norme et pas mal de discussions à son sujet. Je crois que la norme est de 20 litres d’eau par jour et par personne, si je ne fais pas d’erreur. Est-ce un objectif que l’on essaie d’atteindre à tous les coups ?
Étienne Gignoux
– Il est important d’apporter en quantité de l’eau de qualité. Donc, on se fixe comme objectif 20 litres d’eau potable par personne et par jour. En pratique, c’est toujours une source de discussions. On verra aujourd’hui ce que veut dire potable dans nos circonstances de travail.
Francisco Diaz
– Je suis pour l’eau courante. L’eau doit couler du robinet à chaque fois qu’il est sollicité. C’est la meilleure façon de régler le problème de la quantité. Mais l’environnement et le contexte ne le permettent pas toujours. Vingt litres par personne et par jour restent la quantité qui nous satisfait si elle est atteinte assez vite. En réalité, nous tentons d’améliorer la production d’eau par étapes, en espérant atteindre ce seuil dans des délais raisonnables qui sont en rapport avec les situations de camps de réfugiés ou de déplacés. Dans le service de chirurgie d’un hôpital, la norme serait différente : plusieurs centaines de litres par jour et par patient, et cela devra être atteint dès le début de l’intervention.
Claire Magone, Crash, MSF Paris
– C’est une question peu documentée, mais j’ai l’impression que MSF réalise de moins en moins de forages. J’ai même l’impression que l’on n’en fait plus du tout. Par comparaison, pour avoir connu les mêmes contextes d’intervention dans le cas des pratiques d’Action contre la faim, j’ai le sentiment que MSF est moins favorable aux forages que d’autres ONG confrontées aux mêmes situations. Tu parlais tout à l’heure de l’ouverture de la boîte de Pandore des virus à partir de l’exemple de l’hépatite E. Cela ne fait-il pas pencher la balance en faveur des forages ?
Étienne Gignoux
– La remarque est pertinente. Effectivement, les eaux souterraines sont d’une meilleure qualité bactériologique. Cela résout potentiellement le problème des contaminations virales si elles sont jugées inquiétantes. Ce point demeure à éclaircir, mais mon opinion est que nous devons nous en préoccuper. Le forage, c’est l’alternative qui permet de résoudre ce problème car nous avons vu que le chlore ne détruisait pas tous les virus lors du traitement des eaux de surface. Néanmoins, forer dès la première phase d’une urgence, la première semaine, est très difficile. Je n’ai pas souvent rencontré des organismes d’aide capables de forer avec succès dans des délais aussi courts. Les conditions, notamment géologiques, nécessaires pour réussir ne sont pas toujours réunies. C’est pourquoi la tentation d’utiliser une eau de surface reste forte.
Jérôme Léglise, Référent Eau et Assainissement, MSF Paris
– C’est vrai que nous ne faisons pas de forages en ce moment à la suite d’une décision de la direction des opérations. Mais il suffirait de se retrouver dans un contexte où le besoin soit à nouveau identifié pour reprendre cette activité. Forer est possible dans les camps de déplacés ou en « milieu ouvert » mais, bien sûr, dans un deuxième temps, en post-urgence. Nous avons fait quelques campagnes de forage : en Thaïlande, en République démocratique du Congo (RDC) et au Tchad (2007). Depuis lors, l’activité est suspendue. La roue pourrait tourner.
Gilles Roche, médecin, membre de l’Académie de l’eau
– En parlant de norme, avez-vous édicté, en tant que MSF, des spécifications précises audessous desquelles vous ne délivrez pas l’eau ?
Francisco Diaz
– Notre credo : il existe toujours un procédé pour améliorer la qualité. Prenons l’exemple d’une eau de surface, le plus souvent polluée, par définition. La simple décantation, la sédimentation sans adjuvant chimique et son exposition au soleil devraient améliorer sa qualité. Le plus souvent, nous disposons de chlore et de produits chimiques pour amplifier l’effet de la sédimentation. Alors, l’objectif est d’obtenir une eau claire, de faible turbidité (inférieure à 5 Nephelometric Turbidity Unit, NTU) et une concentration résiduelle en chlore libre entre 0,3 et 0,6 gramme par litre. C’est l’objectif que nous essayons d’atteindre partout. Mais quand cela n’est pas possible, il n’y a pas d’autre choix que de donner quand même de l’eau.
Damien Mouly, Institut national de veille sanitaire (INVS)
– Je travaille à l’INVS, notamment sur le sujet « eau et santé ». En comparaison de vos systèmes de traitement de l’eau, il existe beaucoup d’endroits en France où les dispositifs ne sont pas aussi élaborés. Notamment en matière de prétraitement : souvent, l’eau est seulement désinfectée. Il y a donc certaines approches qui pourraient être comparées.
La sécurisation de la qualité de l’eau ne passe pas uniquement par la mesure de la qualité bactériologique ou chimique, mais également par la surveillance de signaux d’alerte. Les signaux d’alerte peuvent être environnementaux, par exemple la pluviométrie. Les incidents en matière de traitement de l’eau sont souvent de bons indicateurs. Beaucoup d’épidémies sont survenues à la suite d’une pollution de la ressource et d’une défaillance simultanée du traitement. Au-delà de la surveillance de la qualité de l’eau, avez-vous une approche globale afin de détecter précocement un risque et prévenir une dégradation ?
Étienne Gignoux
– En France, assurer la qualité de l’eau, c’est sécuriser la ressource. L’établissement de périmètres de sécurité, rapprochés ou étendus, afin de protéger la source dans laquelle l’eau est puisée, est difficile dans nos circonstances de travail.
Cependant, en ce qui concerne les incidents de traitement de l’eau, ils sont enregistrés par écrit et suivis, parfois plusieurs fois par jour. Mais comme vous l’avez fait remarquer, cela reste un indicateur de qualité et non un indicateur permettant de détecter une augmentation du risque. La production et la distribution collectivisées de l’eau peuvent rendre les consommateurs moins vigilants car il est tentant de laisser la responsabilité au système. Passer d’un système d’eau collectif aux systèmes d’eau familiaux implique que la responsabilité en matière de qualité de l’eau soit transférée à la famille. Dans le traitement de l’eau à domicile, il y a un gros risque que les gens ne fassent pas l’entretien nécessaire de leur système. Cela indique la nécessité de systèmes qui soient capables de détecter les problèmes et d’interrompre la production quand la qualité n’est plus assurée.
Pour répondre à la question, j’imagine mal dans les circonstances du travail humanitaire de placer des capteurs un peu partout dans l’environnement pour anticiper les problèmes. En revanche, il est connu que, dans une zone karstique,Le karst est une structure géomorphologique résultant de l’érosion hydro-chimique et hydraulique de formations calcaires. Les structures karstiques concernent environ le cinquième de la superficie continentale de la Terre. Les karsts présentent pour la plupart un paysage tourmenté, un réseau hydrographique essentiellement souterrain et un sous-sol creusé de nombreuses cavités : reliefs ruiniformes, pertes et résurgences de cours d’eau, grottes et gouffres. http://fr.wikipedia.org/wiki/Karstla pluie va avoir une incidence sur la turbidité de l’eau. La solution, c’est d’avoir un système de traitement qui ne soit pas fondé sur un seul procédé mais sur plusieurs, par exemple le chlore et les rayonnements UV. Cela pourrait constituer une sécurité. Quand l’un des deux procédés dysfonctionne, l’autre assure quand même la désinfection.
Peggy Pascal, responsable des référents techniques au siège de Solidarités International
– Je voulais revenir à la question des standards en eau (20 litres d’eau par jour et par personne) et plus largement sur la démarche Sphère. Je pense que ce travail de standardisation a été mené, à l’époque, pour pousser les ONG à homogénéiser leurs pratiques en définissant un cadre afin d’essayer de tirer la qualité vers le haut. Mais cela représente aussi un sérieux danger. Cela peut conduire à oublier les particularités de certains contextes. Dans le cas du Tchad, le danger de vouloir s’en tenir aux normes Sphère est de puiser à l’excès dans les sources fossiles (eaux souterraines collectées quand le climat de la région était différent et qui de ce fait ne sont pas renouvelées). Donc, il ne faut pas oublier l’importance de comprendre d’où vient l’eau parce que, sinon, on se retrouve avec une pénurie d’eau dans les camps. C’est le problème que l’on a aujourd’hui dans certains camps au Tchad, et avec des conséquences dramatiques à long terme pour les populations locales. D’où l’importance de passer du temps sur le diagnostic initial des ressources disponibles.
Au-delà de ses aspects techniques, un forage est aussi un point d’eau permanent. La réalisation d’un tel ouvrage dans le Sahel peut provoquer de sérieux conflits portant sur l’eau et sur le foncier. Dans ce contexte, il existe des droits sur l’eau et sur la terre qui sont extrêmement complexes. Les ONG vont mettre des années à les pointer du doigt et à commencer à les comprendre. Au nord du Mali, des dizaines de morts sont survenues parce que des forages avaient été faits dans des zones à propos desquelles l’importance de prendre en compte le droit à l’eau et le droit du sol n’avait pas été comprise.
Francisco Diaz
– Ces questions sont la réalité du quotidien des acteurs de terrain. Quels choix faire ? Doiton réguler les quantités d’eau en fonction de son origine, de la durabilité de la réserve ou doiton satisfaire le besoin exprimé au détriment d’une gestion à plus long terme de la ressource ? D’où l’importance que ces sujets soient débattus avec les « bénéficiaires » eux-mêmes ainsi qu’avec les autorités, les représentants de l’État et les organismes d’aide. Les choix doivent être réalisés ensemble pour être assumés par tous car il n’y aura pas de « bon » choix si on agit sous la contrainte. C’est plutôt ma perspective. On parlera plus en détail des enjeux sociaux, économiques et politiques locaux lors de la présentation de Thierry Ruf, cette après-midi.
Paul R. Hunter, professeur de microbiologie, Université d’East Anglia, Royaume-Uni
– Premièrement, pour revenir à la question de l’hépatite E, vous avez dit que la courbe de mortalité était assez élevée. Etait-ce la mortalité spécifique pour cette pathologie qui était élevée, ou la mortalité par rapport à l’ensemble de la population ?
Rebecca Freeman Grais
– Dans le nord de l’Ouganda, l’une des conclusions de leurs enquêtes était très intéressante, et possiblement différente de ce qu’on trouve dans d’autres documentations sur l’hépatite E. Mais le problème, bien sûr, est qu’ils ont évalué la mortalité sur la base de rapports d’autopsie oraux. Il s’agit donc d’une attribution rétrospective de décès d’enfants à l’hépatite E chez des enfants asymptomatiques. Par conséquent, je crois qu’il y a potentiellement des problèmes méthodologiques quant à l’attribution de décès d’enfants à l’hépatite E. Surtout dans un contexte où la mortalité infantile est déjà élevée. Il serait plus intéressant d’observer le différentiel entre un nombre normal de décès prévisibles et une surmortalité. Dans le cas qui nous occupe, les décès excédentaires ont été attribués aux morts d’enfants. Mais le seul autre point intéressant, c’est ce précédent de mortalité infantile élevée chez des enfants asymptomatiques en ex-Union soviétique. Il existe donc un autre exemple de ce phénomène.
J’ai parlé hier soir aux personnes qui ont fait cette étude. Elles semblent avoir la même réaction que moi, dans une certaine mesure, avec l’exemple de Mornay. Nous n’avons pas le degré de compréhension suffisant, et ces investigations sont faites par des gens comme moi. Or ce n’est pas mon domaine d’expertise. Parfois, on ne sait même pas ce qu’il faut rechercher. Nous devons travailler à l’élaboration de méthodes épidémiologiques qui soient mieux adaptées à l’étude des épidémies d’origine hydrique.
Paul R. Hunter
– Oui, parce qu’une des choses qui me frappe toujours à propos de l’hépatite E, c’est qu’en de nombreux aspects, à l’exception d’une mortalité accrue, notamment chez les femmes enceintes, elle ressemble beaucoup à l’hépatite A, qui est également très résistante au chlore, résistante aux hautes températures. Et qui cause une infection essentiellement asymptomatique chez les enfants, et seulement un enfant sur vingt va développer une pathologie vraiment grave, et c’est le groupe où l’on voit des formes d’insuffisance hépatique aiguës, ce qui est souvent ce qui tue avec l’hépatite A. Et c’est probablement parce que ces enfants n’avaient pas un très bon système immunitaire, et quand votre système immunitaire est faible, ça vous tue.
L’autre problème, c’est qu’en matière d’approvisionnement en eau, on discute pour savoir ce qui est préférable – la qualité ou la quantité ? Et : pouvons-nous respecter des standards normaux ? Bien que ce débat soit très intéressant, je crois qu’il passe à côté d’une chose très importante. Quoi que nous fassions, nous ne devrions pas nous laisser arrêter par le fait que peut-être nous n’allons pas pouvoir atteindre des normes internationales prédéfinies. On ne pourra jamais avoir une pollution zéro. On n’y arrive pas, et l’on constate de plus en plus qu’en fait, si on commence à apporter des améliorations, cela peut avoir des conséquences non négligeables – bien avant d’atteindre un standard prédéfini, qui de toute façon, peut ne pas être juste ni utile dans un contexte africain. Quand j’ai travaillé à l’OMS, nous nous sommes démenés pour essayer d’obtenir une recommandation internationale qui conseille de ne pas attendre de pouvoir respecter des normes européennes, mais plutôt d’améliorer l’accès, d’améliorer la qualité.
L’autre aspect, c’est que si vous faites quelque chose, il faut que ce soit durable. Et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous contenter d’un système fait pour durer six mois, et qui ensuite va tomber en panne. Et le problème est que beaucoup d’ONG creusent des puits qui marchent bien pendant six mois, puis qui tombent en panne ou cessent de fonctionner pendant la saison sèche, quand on en a le plus besoin. Dans ce cas, vous risquez d’aggraver la situation, vous risquez d’augmenter la charge de la maladie. Si votre projet est d’offrir un accès facile à l’eau, il est possible que de plus en plus de gens décident de s’installer à proximité du point d’eau, et puis il cesse de fonctionner, et tout à coup vous avez dans la région plus de problèmes graves liés à l’eau qu’avant votre intervention. Je crois que c’est quelque chose que beaucoup d’ONG ne veulent pas savoir.
Francisco Diaz
– Peut-être, avant de passer la parole aux autres intervenants, pouvons-nous développer un peu le sujet de l’impératif de stabilité dans le temps d’un système d’eau afin d’éviter les impacts négatifs.
Jérôme Léglise
– Je crois que c’est l’une des raisons d’être de la journée d’aujourd’hui. Mais nous intervenons précisément dans des situations différentes qui ne sont pas « durables, normales, stables, établies ». Où il faut quand même trouver, du moins à moyen terme, un optimum entre cette stabilité, cette durabilité, et l’amélioration rapide de l’état des choses. Parce qu’il s’agit de sauver des vies dans les premiers temps d’une intervention. Le puits durera-t-il plus de six mois, un an, voire plus ? Pour beaucoup de praticiens, se poser de telles questions dans le temps de l’urgence évoque le fait de se perdre en conjectures. Je suis tout à fait d’accord sur les questions de durabilité, c’est une fois de plus un optimum.
Jean-Hervé Bradol, Crash, MSF Paris
– En réalité, dans l’exemple de Mornay, les premières interventions sur ce site démarrent en septembre 2003. L’épidémie, souvenez-vous de la présentation de Rebecca, survient fin juilletdébut août 2004, presque un an après. Je dis cela pour questionner la typologie avec laquelle nous fonctionnons : urgence signifiant courte durée.
Il faut rappeler aussi que ce site était, avant le déplacement de population, un gros bourg commercial. Des forages avaient été réalisés par Oxfam et l’Unicef dans le cadre d’un projet de développement, ce qui nous a permis de comprendre que l’eau qui ne venait pas de ces forages transmettait l’hépatite E : l’eau de surface chlorée et distribuée par MSF. Il faut aussi rappeler que nous avions identifié une entreprise soudanaise de forage qui avait accepté d’opérer dans cette zone dangereuse.
Dernier élément pour épaissir un peu le contexte : rapidement, les équipes des opérations s’interrogent sur le devenir des camps de déplacés. Ne sont-ils pas en train de devenir des lieux d’habitation permanents ? Le territoire a été réaménagé par la violence, mais cela ne veut pas dire que cette nouvelle organisation territoriale disparaîtra avec la fin de la guerre civile.
Marc Laimé, journaliste, Le Monde diplomatique
– Avez-vous pensé à documenter a posteriori l’impact des améliorations que vous mettez en avant ? Que se passe-t-il après, dans la situation de post-crise ? Quelle est la pérennité des équipements mis en place ? Pouvez-vous évaluer l’effet des interventions en urgence sur la période qui suit ?
Second point : à l’occasion de la journée d’aujourd’hui, avez-vous été contactés ou approchés par le gouvernement ou l’Agence française de développement, dans la perspective du 6e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Marseille en 2012 ? En considérant simplement la situation de l’Afrique, on voit aujourd’hui que des centaines d’intervenants en matière d’eau et d’assainissement sont présents. Comment inscrivez-vous votre problématique spécifique dans ce qui a été évoqué tout à l’heure, dans le « global circus » de l’accès à l’eau et à l’assainissement ? En 2012, la France va faire la leçon à la terre entière. Depuis quelques mois, on soutient que l’ONU a adopté un droit universel d’accès à l’eau, ce qui est une vaste plaisanterie.
Francisco Diaz
– Pour répondre à la question de Marc Laimé, il ne nous est pas toujours possible de suivre l’évolution des situations dans la durée tout simplement parce qu’en tant qu’acteurs d’urgence nous sommes déjà partis quand la question de la pérennité de nos installations se pose. La deuxième question de Marc Laimé porte sur le 6e Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille en 2012. Je voudrais dire que nous sommes en dehors de ce « global circus ». Au point de ne pas en saisir les enjeux, ce qui est regrettable. Pour mieux les comprendre, nous avons programmé le sujet pour la troisième session. Il sera introduit par Benoît Miribel.
François Mansotte
– Étienne, j’ai beaucoup apprécié qu’à la fin de votre présentation vous parliez d’une certaine forme de controverse. Je ne suis pas sûr qu’il y ait vraiment une controverse. Il y en a une à condition d’avoir des cultures différentes. Mais à partir du moment où l’on a compris que le danger, c’est de polluer le propre par le sale, la controverse s’estompe. La pollution de la ressource peut intervenir dans différentes situations. Si on puise dans une rivière polluée en amont par des déjections, si on travaille dans une zone karstique ou si le forage n’est pas protégé, alors, on aura bien sûr une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Ensuite, le traitement peut être plus ou moins bien géré, de même que le transport et le stockage de l’eau à domicile, ce qui est un point majeur. Le dernier point est l’hygiène générale des personnes. L’idéal est qu’elles se lavent les mains avant de manger et après défécation. On a une espèce de triangle : l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène générale. Ce triangle peut être plus ou moins en équilibre.
Peut-être, du fait de mon intervention précédente, avez-vous jugé que j’avais un avis négatif sur MSF. Bien au contraire, je trouve que vous faites du bon travail dans un contexte difficile. À partir des indicateurs de qualité de l’eau brute, de qualité du traitement, de qualité du stockage, de qualité de l’hygiène, il est possible de qualifier la situation comme étant relativement sécurisée ou en très grand déséquilibre. Je pense que c’est ça la question de base : le système d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hygiène est-il robuste ? Du fait que vous intervenez sur le court et le moyen terme, si le système est en très grand déséquilibre, vous ne devez pas imaginer faire l’économie d’une épidémie.
Étienne Gignoux
– Je suis tout à fait d’accord avec vous à propos de l’importance du triangle EHA (eau hygiène et assainissement). Effectivement, c’est un ensemble. Mais reprenons l’exemple de Mornay, où nous avons conclu que l’épidémie était propagée par le réseau d’eau. Dans cet exemple, le travail avait été mené dans les trois directions, de concert avec nos partenaires : hygiène (Concern) et assainissement (Unicef). Pourtant, une épidémie s’est propagée. Le système a été pris en défaut. Pour éviter cela, il faudrait faire d’énormes investissements. C’est sur cela que porte la controverse. Faut-il concentrer nos efforts pour réaliser un petit saut qualitatif au prix d’un énorme investissement ? Dans l’exemple de Mornay, la seule solution alternative était le forage. Forer dans ces conditions est assez compliqué. D’où la controverse : cela en vaut-il la peine ? Je n’ai pas la réponse.
Agnès Alexandre-Bird, ingénieur sanitaire, Agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes
– J’ai eu à intervenir en 2004 à la fin d’une épidémie d’hépatite E dans un camp de réfugiés au Tchad. Je ne peux pas dire que j’ai trouvé les causes de cette épidémie. Il y avait, quand je suis arrivée, des puits ouverts, bien gérés mais avec un traitement au chlore mal fait. Ma question concerne l’effet du chlore sur les virus. Vous l’avez posée, mais j’espère qu’elle va recevoir quelques réponses cette après-midi. La littérature nous dit : plus de chlore, plus de concentration et plus de temps de contact. J’imagine que cela a été établi à partir d’études scientifiques. Si cela ne suffit pas, existe-il des connaissances expliquant pourquoi cela n’est pas efficace ?
Joël Mallevialle, ingénieur sanitaire
– Cela me gêne toujours un peu que l’on dise « ce truc ne marche pas » et « cet autre truc marche ». En fait, on est entre les deux, et ça dépend de la qualité de l’eau et de l’hydraulique. À propos du temps de contact, quelque chose est aussi parfois oublié dans les usines en France : le temps de contact ne se calcule pas en divisant le volume par le débit. Pour apprécier le temps de contact, il faut connaître l’hydraulique dans le réacteur où la chloration est faite. Sinon, quand vous pensez avoir dix minutes de temps de contact, cela peut être en réalité une minute, une fois l’hydraulique prise en compte. C’est souvent en raison de ce type d’erreur, se contenter du dosage de chlore résiduel sans correctement prendre en compte les autres paramètres, que le chlore est considéré à tort comme en échec. Par ailleurs, le chlore n’est pas la panacée. Je détaillerai tout cela dans ma présentation cette après-midi.
Gilles Isard, chef de mission de MSF en Chine
– Un aspect n’a pas été évoqué : c’est le coût. J’ai quand même l’impression que c’est une vraie limite, notamment à MSF. Le préjugé commun est de penser que fournir de l’eau doit ne presque rien coûter. Le sentiment est que les dépenses liées à l’eau ne doivent pas peser sur le budget des opérations. J’aimerais connaître le coût des solutions techniques au problème des virus non détruits par les dosages habituels de chlore, par exemple celui de l’osmose inverse. Combien coûte 1 m3 d’eau traitée par osmose inverse ? Est-ce qu’une augmentation du budget attribué au traitement de l’eau en urgence nous permettrait d’être capables d’amener de l’eau en quantité suffisante et d’une qualité bien au-delà de celle d’aujourd’hui ?
Nous sommes capables de dépenser des sommes importantes pour le traitement médical d’un patient, parfois plusieurs centaines d’euros par an, mais on a l’impression que fournir de l’eau à un individu ne devrait pas coûter plus de quelques centimes d’euros. Je ne connais pas les chiffres précis. Mais je pense que si on divisait le coût de la mise en place et de la maintenance de nos systèmes par le nombre de personnes et le nombre de jours, on s’apercevrait alors que la dépense est infime. Je voudrais connaître votre avis sur ce point : la limite n’est-elle pas plus financière que technique ?
Francisco Diaz
– L’aspect financier est peut-être un obstacle, mais ce n’est pas le seul. Si nous mobilisons plus de moyens financiers, aurons-nous plus de résultats au regard des problèmes examinés aujourd’hui ? C’est une question importante. Mais plus que les limites financières, le caractère principalement médical de MSF fait du traitement de l’eau un objectif secondaire. L’absence de nos collègues des opérations et du département médical à cette journée illustre cette difficulté. Gilles, quelle était ton autre question ?
Gilles Isard
– Si l’on veut traiter à la fois les virus, les bactéries et les parasites, l’osmose inverse doit faire partie des solutions techniques possibles. Combien coûte le traitement de l’eau avec l’osmose inverse aujourd’hui avec les procédés existants ? Serait-il possible d’obtenir les quantités dont nous avons besoin ? Est-ce une approche envisageable ou cela est-il complètement hors de prix ?
Francisco Diaz
– On va reprendre le sujet cette après-midi, mais, juste pour vous faire patienter : nous avons fait une étude au moment du conflit au Liberia (2003) lors d’une épidémie de choléra dans la ville de Monrovia. À l’époque, une unité de traitement plutôt faible, un débit de 1 mètre cube par heure, coûtait 20 000 dollars. Le volume de l’unité de traitement, 2 à 3 mètres cubes, tient sur un pick-up. Obtenir des débits plus importants, de l’ordre de 20 mètres cubes par heure, nécessite un dispositif dont le volume est proche de celui d’un camion semi-remorque. Son coût est de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Peter Maes, EHA, MSF Bruxelles
– Le coût doit être en rapport avec l’étendue des responsabilités. Je me rappelle les problèmes qu’on a eus avec la fourniture d’eau aux populations du Soudan pendant la crise nutritionnelle de 1999. J’aurais été très malheureux si nous n’avions pas réussi à prépositionner une machine de forage, même si c’était coûteux. Mais autre chose m’a frappé : l’absence complète de réglementation, en un sens. Par exemple, ce fameux Pur®, une sorte de sachet miracle vendu par une entreprise privée. Si vous avez de l’eau turbide, vous versez le sachet dedans et, normalement, c’est la solution miracle, au final, on obtient un chlore résiduel libre adéquat. Nous l’avons testé partout dans le monde et quelquefois ça marche, mais, très souvent, ça ne marche pas. Et on voit ces sachets expédiés aux quatre coins du monde, dans des conteneurs subventionnés par l’Unicef et autres. C’est vendu par Procter & Gamble®. Il y aurait lieu de faire un peu de plaidoyer dans ce domaine, et MSF est une bonne machine à plaidoyer.
Gilles Roche
– L’animation de diapositives concernant la stratégie MSF de l’accès à l’eau est très bien. C’est simple, clair, opérationnel, et il y a une stratégie. Il est un peu dommage que vous n’ayez pas présenté le pendant en termes d’assainissement, voire de formation à l’hygiène. Comme le disait François Mansotte, ces différents aspects sont complètement liés, notamment en situation pré-épidémique ou épidémique. Pouvez-vous en dire quelques mots ?
Étienne Gignoux
– Nous sommes bien d’accord à propos de ce triangle (eau, hygiène, assainissement). Nous en parlerons un peu cette après-midi, mais nous avions choisi de centrer la journée sur l’eau, et donc je me suis limité à cela dans ma présentation.
Dominique Maison
– Pour rebondir sur la question du coût, je pense qu’elle est en fait plus complexe car il y a beaucoup de facteurs externes. On peut effectivement dépenser beaucoup pour du matériel qui n’est pas nécessairement efficace sur place. Je rejoins tout à fait Peter Maes sur cette question. Il existe encore à mon sens un certain flou quant à savoir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas ainsi que sur les conditions d’utilisation et d’engagement de ces procédés sur les terrains d’intervention humanitaire. Par exemple : la distribution de chlore pour l’usage familial induit-elle une dépendance de la part de la population ? L’approvisionnement serat-il régulier ? Pendant quelle durée ce procédé sera-t-il utilisé ? Combien cela coûte-t-il ? Je prends l’exemple d’Haïti : les autorités locales ont très clairement indiqué dès les deux premiers mois de l’intervention que leur objectif était le retour à la situation antérieure en termes de marché et de distribution de l’eau dans Port-au-Prince. Alors que le système auparavant en place peinait à satisfaire les besoins, malgré les efforts des ONG. Je crois que c’est un point essentiel du plaidoyer : l’intervention ne peut pas se limiter à l’allocation de moyens sur place et à la programmation d’un désengagement en quelques mois. On va avoir un impact direct sur la situation au moment de l’urgence, pendant quelques mois. Mais, si on baisse la garde, si on ne prévoit pas les solutions de rechange et si on ne prévoit pas l’inscription dans la durée, alors, les problèmes initiaux resurgissent. L’étude des coûts doit inclure non seulement la dépense initiale, mais aussi les coûts induits par les conséquences sanitaires d’un échec et ceux qu’impliquent des interventions répétées dues au manque de durabilité du système initialement mis en place. Cet argument est important quand nous plaidons pour une amélioration des systèmes d’eau.
Fabrice Weissman
– Je voudrais revenir sur la question des standards et des forages. En écho à la remarque de notre collègue de Solidarités, je suis tout à fait d’accord avec l’idée qu’il ne faut pas appliquer les standards de façon mécanique. Par exemple, les habitudes de consommation d’eau au Sahel sont très différentes de celles que l’on a pu observer au Sri Lanka. Vingt litres d’eau par personne et par jour pour un nomade du Darfour, c’est beaucoup. Le paysan Sri Lankais vit lui dans une société parfois qualifiée de civilisation hydraulique. Il distingue l’eau de cuisson, celle de lavage, dont la consommation est très importante, et l’eau de boisson. En conséquence, la conception de notre dispositif d’approvisionnement doit tenir compte de ces différences. Je pense que nous essayons d’y prêter attention, mais il faut poursuivre afin d’acquérir une meilleure compréhension des spécificités sociales et culturelles de l’usage de l’eau. Bien entendu, les enjeux politiques liés à la création de points d’eau permanents posent des questions fondamentales.
Les forages me semblent a priori l’une des options les plus accessibles pour répondre à une série de problèmes rencontrés lors du traitement des eaux de surface. Je voudrais savoir quel bilan nous tirons des forages réalisés par MSF. Je pense à ceux qui sont réalisés avec le matériel déplaçable sur un pick-up qui est souvent utilisé par Action Contre la Faim. J’ai aussi le sentiment, d’après ta description, que pour avoir une politique de forage plus efficace, il serait plus pertinent de s’adresser à des compagnies locales qui ont déjà une connaissance du terrain. La disponibilité du matériel augmente la rapidité et les chances de succès. Quel bilan tironsnous des campagnes de forage faites par MSF avec ce matériel de faible encombrement et très mobile ?
Étienne Gignoux
– Si je m’exprimais sur le bilan de nos campagnes de forage, je serais à la fois juge et partie. On pourrait dire qu’il est finalement plus intéressant de travailler avec des entreprises locales. Le seul problème est qu’en urgence, particulièrement dans nos contextes d’intervention, elles ne viennent pas. Le Tchad est un très bon exemple. À Dogdoré (2007), personne ne voulait venir. On les a tous sollicités, mais ils n’étaient pas fous. Ils restent chez eux, dans ces caslà. Par ailleurs, les autres ONG ne voulaient pas venir non plus. La seule option était de le faire nous-mêmes.
Francisco Diaz
– Les difficultés d’accès aux zones où nous intervenons ne sont pas le seul problème. Ce savoir-faire n’existe pas toujours dans la région concernée. Au fin fond du Katanga, ce n’est pas toujours évident de trouver une entreprise disponible et compétente pour faire des forages. Il faut toujours disposer de plusieurs options afin de pouvoir être à l’aise avec une externalisation de l’activité comme avec un développement en interne de ce savoir-faire.
Le problème de fond est l’irrégularité de nos actions, qui ne nous permet pas de maintenir ce savoir-faire. Pour conserver un savoir-faire et le développer de manière ambitieuse, il faut une masse critique d’activité qui constitue la source du savoir. Ensuite, nous devons disposer de ressources humaines compétentes et de matériel « dernier cri », c’est-à-dire adapté à nos besoins spécifiques. Le caractère aléatoire de nos activités rend très difficile de garantir que nous serons capables de répondre quand une nouvelle intervention sera demandée. On nous demande alors d’être excellents, très rapides, innovants (c’est le mot à la mode), et cela n’est pas possible sans avoir des activités régulières dans ce domaine. C’est notre réalité opérationnelle. Ces dernières années, nous avons médicalisé nos opérations. Nous travaillons plus souvent dans des hôpitaux ou en réponse à des épidémies. Dans ces contextes, nos activités sont différentes de celle qui consiste à fournir de l’eau à la population d’un camp de réfugiés. Voilà les données du problème d’organisation que nous avons pour développer et stabiliser nos savoir-faire. À nous de trouver des solutions.
Jean-Hervé Bradol
– Je voudrais revenir sur la question des standards, qui me semblent poser problème d’une part par leur côté statique et d’autre part par leurs faiblesses. Les experts nous disent qu’une gestion dynamique du risque est la meilleure approche. En revanche, dans notre environnement professionnel, les manuels, par exemple le guide de poche de Sphère, nous demandent d’atteindre une certaine quantité et une certaine qualité. Un technicien sanitaire a besoin de certitudes. Ai-je accompli mon travail ou non ? Quand les standards de quantité et de qualité sont respectés, le technicien sanitaire et son superviseur ont souvent l’impression trompeuse que tout risque est écarté. C’est la conséquence de l’utilisation d’un indicateur de qualité, et cela souligne l’intérêt de procéder à une analyse des risques. Les standards en vigueur ne permettent pas de se prémunir de tous les dangers. Des parasites, des virus, des bactéries, des toxines passent au travers des mailles du filet. De même pour les risques chimiques, qui ne sont pas couverts par les standards en usage. L’exemple de la pollution arsenicale des eaux souterraines du Bangladesh rappelle que le danger persiste quand la norme a été respectée. Je partage l’opinion de Gilles Isard à propos d’une relation entre des standards aussi faibles et une forte contrainte économique.
Dominique Maison
– Une petite question de vocabulaire : les mots « référence », « standard » et « norme » ne sont pas interchangeables. Sphère fixe des références. Donc, on est bien dans une attitude de progrès, d’homogénéité et d’amélioration qui correspond aux situations que nous connaissons. Quant aux normes, elles sont définies réglementairement par la plupart des pays. Elles ont un sens régalien, réglementaire. Les contraintes de l’urgence ou la méconnaissance de la réglementation nationale, une mauvaise excuse, entraînent parfois le non-respect de ces normes. Si les intervenants ne sont pas en mesure de les respecter, ils devraient au moins les connaître. La puissance publique est théoriquement capable de les contrôler et de sanctionner. Je ne m’étendrai pas sur les difficultés que rencontrent certains pays dans ce domaine.
Dans notre environnement professionnel, on parle bien de références. Ces références renvoient à un niveau de risque. C’est sur cela que portent les réunions de consensus auxquelles participe le Pr. Paul HunterVoir session suivante. : pour s’accorder sur la bonne référence, le bon indicateur. À propos des références de Sphère, les remarques peuvent être adressées à Oxfam, qui procède en ce moment à une mise à jour du guide sur la partie qui nous intéresse, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Toutes les contributions sont bienvenues.
Une illustration de ces problèmes réglementaires : en Guyane, François Mansotte l’a évoqué, nous avons eu à faire face à une urgence. Une organisation est intervenue et a installé sur place un clarificateur,Grand réservoir où sédimentent les matières organiques en suspension. Le rôle du clarificateur est essentiellement de séparer le floc bactérien de l’eau, et ce par gravitation, les boues se déposant sur le fond, les eaux clarifiées s’évacuant en périphérie.d’un modèle connu, généralement utilisé par Veolia®, et a commencé à délivrer une eau qui ne correspondait pas à la réglementation française. En situation d’urgence, on utilise des dispositifs, des savoir-faire et des personnels qui sont habitués à faire au mieux au regard des circonstances, à apporter un optimum. Mais les pays ont tout à fait le droit d’être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus exigeants sur la qualité de l’eau. On s’affranchit souvent des normes nationales. C’est un sujet qui mériterait d’être creusé. Car il n’y a pas de bonne raison pour que des organisations, ou des personnels originaires de pays exigeants dans ce domaine, baissent nécessairement la garde sous prétexte de l’urgence. Au sujet de la qualité bactériologique, les questions techniques doivent être posées, en gardant les coûts à l’esprit. À propos de la qualité physico-chimique, nous avons parlé de l’arsenic, qui représente un risque grave et immédiat. Mais la question se pose également pour un ensemble d’autres contaminants. Si nous n’arrivons pas à les traiter, il faut au moins avoir étudié la possibilité de le faire en prenant les coûts en considération. Certaines menaces chimiques peuvent être laissées de côté quand le temps d’exposition est court, de l’ordre de quelques mois. C’est le cas actuellement au Pakistan où, les ressources étant rares, on peut avoir accès à une ressource souterraine polluée par l’arsenic mais qui présente un risque bactériologique beaucoup plus faible, en particulier pour le choléra, que les autres sources. Cela est tolérable, à condition que le temps d’exposition à cette eau – qui ne satisfait pas à la norme OMS pour la concentration en arsenic – soit bref. Cela au nom une fois de plus d’un bénéfice sanitaire clairement établi pour l’ensemble de la population.
Pascal Simon, Médecins du Monde
– Pour les associations médicales humanitaires, gérer l’eau n’est pas facile. Au départ, ce n’est pas notre métier. Nos expériences sont surtout liées à la fourniture d’eau dans des institutions de soins. Les solutions techniques existent. Dans l’exemple du Bangladesh, des filtres à arsenic sont disponibles. Chaque pays a des solutions techniques adaptées au contexte. Le problème, c’est toujours le coût. Dans les budgets, il y a rarement des lignes budgétaires libres pour l’eau dans les urgences. La gestion de l’eau à moyen terme est un point important car les crises s’étalent parfois dans la longueur. Les réfugiés birmans sont dans les camps en Thaïlande depuis trente ans. À Kalemie, au bord du lac Tanganyika, en République démocratique du Congo, les épidémies de choléra se répètent. Il faut se poser la question de l’avenir des dispositifs mis en place par les organismes d’aide. Quand ils partiront, comment cela se passera-t-il ? Les forages vont-ils être utilisés ? Ou être vendus ? L’aspect social et politique est important. Par exemple, les réfugiés birmans ont un meilleur accès à l’eau que les populations thaïlandaises voisines, qui doivent souvent se contenter de 5 litres d’eau puisés dans une rivière polluée. Les problèmes peuvent être également économiques. Par exemple, au Darfour, la fourniture gratuite d’eau aux habitants du camp de Kalma par les organismes d’aide a mis au chômage tous les petits vendeurs d’eau. À Haïti, la fourniture d’eau est aussi une activité humanitaire qui dure. Serons-nous capables de penser la gestion de l’eau à moyen et long terme ?
Damien Mouly
– Pour poursuivre au sujet des contaminants physico-chimiques, il faut souligner que l’OMS considère les sous-produits du chlore comme le deuxième problème le plus préoccupant. Ils sont d’autant plus présents que la matière organique est importante. Plus l’eau est turbide, plus il faut mettre de chlore et plus les concentrations des sous-produits du chlore sont élevées. En résumé, plus la ressource est claire, meilleure est l’efficacité du chlore pour contrôler le risque infectieux et plus le risque cancérigène est bas. Pour que le risque cancérigène soit significatif, les durées d’exposition nécessaires correspondent à une autre échelle de temps que celle d’une intervention en urgence.
J’ai une question. L’épidémiologie est un bon outil pour mesurer l’efficacité de cette approche intégrée EHA (eau, hygiène et assainissement). Le recueil de données épidémiologiques peut se faire à partir de la surveillance, des enquêtes et des protocoles de recherche portant sur des questions plus précises. MSF réalise souvent des travaux d’épidémiologie d’intervention en urgence. Comment est-ce que MSF utilise l’épidémiologie pour mesurer l’efficacité sanitaire des mesures prises en amont dans le domaine de l’eau ?
Emmanuel Baron, directeur d’Épicentre
– Malheureusement, l’épidémiologiste ne dispose pas d’autant de possibilités que votre question lui prête. L’épidémiologie nous montre surtout un échec. Elle ne permet pas de connaître l’importance de ces maladies ni leurs modes de transmission. Rebecca Freeman Grais a revu l’enquête réalisée à Mornay en 2004, lors de l’épidémie d’hépatite E. Elle montre de sérieuses limites. Du point de vue de la surveillance, je ne sais même pas si les équipes ont continué à collecter les données pour les cas d’ictères fébriles l’année suivante, en 2005. Où sont les informations ? Avec un peu plus de moyens et de façon assez ciblée, nous pourrions chercher de l’information. J’attends avec impatience la présentation de Pr. Hunter au sujet de l’état des connaissances sur la relation entre l’eau et la santé. Aujourd’hui, en matière d’information, c’est le grand vide.
Rebecca a indiqué un chiffre important : un tiers de la population générale du camp de Mornay possédait des anticorps contre l’hépatite E, selon les résultats de l’étude dans notre échantillon. Cela montre à quel point l’épidémiologie de cette maladie découverte récemment est mal connue. Bien entendu, rien n’est impossible. Nous travaillons aux mesures de surveillance épidémiologique, dont l’information peut être complétée par des enquêtes ponctuelles. On peut travailler aussi pour favoriser la reconnaissance de certains syndromes lors des activités cliniques. Mais je pense que rien ne remplacera la volonté politique de s’intéresser à ces questions, comme le demandent nos collègues du département logistique. Effectivement, le mouvement MSF s’est équipé depuis maintenant plus de vingt ans d’une institution, Épicentre, qui fait de l’épidémiologie. Mais je voudrais quand même rappeler les limites des études portant sur l’impact de mesures prises au sein de grandes populations. Si nous décidons de nous attaquer à ces questions, nous chercherons de nouvelles voies. Je ne suis pas trop pessimiste, mais plutôt prudent.
Gilles Roche
– En ce qui concerne l’analyse de l’eau qui va être distribuée, vous savez qu’il existe et qu’il y a en développement des kits de détection multiparamétrique qui vont mesurer les métaux lourds, les toxines en tout genre, les bactéries, etc. Ils reposent sur la détection d’un signal de nature unique, en général de type photochimique. Ces kits ou ces systèmes sont simples, légers, portables. Ma question : MSF suit-elle ces travaux de recherche ? Est-ce que vous êtes impliqués de façon à mettre votre grain de sel afin que les systèmes en développement puissent répondre à vos demandes le jour où ils sortiront ? Je pense notamment à ce qui se fait à l’École des mines d’Alès et dans d’autres structures de ce type.
Jérôme Léglise
– Nous disposons effectivement d’un kit, un outil de mesure spectrophotométrique.La densité optique des solutions est déterminée par un spectrophotomètre préalablement étalonné sur la longueur d’onde d’absorption de l’espèce chimique à détecter.Contrairement à la qualité bactériologique, la qualité physicochimique ne fait pas l’objet de contrôles systématiques, mais plutôt de contrôles en réaction à la suspicion de la présence d’un contaminant particulier. D’où l’importance du lien avec les équipes médicales, qui nous diront en fonction de leurs observations cliniques quelles intoxications peuvent être suspectées, par exemple celles aux métaux lourds. Dans ce cas-là, on va effectivement envoyer un kit pour faire des analyses avec tel réactif déterminé. Il n’est pas toujours possible d’apporter une solution concrète en termes de traitement parce que dès qu’on touche au physicochimique cela devient extrêmement complexe. Mais cela poussera au moins à chercher une ressource alternative ou à puiser dans la ressource la moins contaminée. MSF-Logistique, à Bordeaux, procède à une veille technologique de routine. Mais nous sommes toujours ouverts à la découverte de nouveaux produits signalés par d’autres.
Gildwen Bodiguel, EHA, MSF sur le terrain
– Je voudrais revenir sur la question des forages. Le forage est-il une solution pérenne ou non ? Souvent, en effet, on installe un forage, on amène quelques pièces de rechange, on repart, et on revient sur les terrains quelque temps après pour trouver des forages installés mais inactifs. De même, quand nous explorons de nouveaux terrains, nous voyons beaucoup de forages dans ce même état. Ils ont été installés, et puis ni la population ni le gouvernement ne peuvent ou ne veulent dépenser l’argent nécessaire pour les réparer. Cette question a-t-elle été étudiée ? Existe-t-il des réponses à ce problème d’entretien des forages après notre départ ?
Étienne Gignoux
Les forages sont-ils pérennes ? Connais-tu une source d’eau pérenne si aucun travail de maintenance n’est effectué ? Même les sources naturelles finissent par s’épuiser quand elles sont utilisées par un grand nombre de personnes sans être entretenues. Existe-t-il un moyen d’obtenir de l’eau de manière pérenne ?
Gildwen Bodiguel
– On dit souvent que les forages sont installés afin de permettre la fourniture d’eau sur du long terme. Je trouve dommage d’installer ou d’investir dans une installation comme cellelà sans qu’elle soit entretenue par la suite. Dommage qu’elle ne puisse servir beaucoup plus longtemps aux populations que les systèmes installés habituellement sur nos terrains.
Francisco Diaz
– On va chercher de l’eau souterraine parce qu’a priori, je dis bien a priori, elle est de meilleure qualité. C’est cette raison qui nous pousse à forer et non la recherche de la durabilité. Grâce au forage, on recueille de l’eau de meilleure qualité pour ne pas avoir à la traiter parce que les traitements seront complexes et pas toujours efficaces.
Par la suite, s’il n’est pas animé et entretenu, le forage, comme n’importe quelle construction, n’importe quel système, dépérit et disparaît. Cela renvoie à d’autres questions (appropriation d’un équipement par une population, développement local) que celle de la fourniture d’eau en urgence.
François Mansotte
– La possibilité d’échanger de l’information technique avec d’autres institutions existe. Je pense qu’il y a au moins deux types d’institutions. D’une part, celles qui ont de l’argent : les fondations Veolia® ou Suez® Environnement. Elles savent en pratique amener à l’étranger des systèmes sophistiqués. Elles n’offrent pas de garanties en matière de pérennité, mais au moins elles savent comment installer rapidement ces équipements à l’étranger et comment suivre la qualité de l’eau. D’autres partenaires prennent de plus en plus d’importance. Par exemple, l’armée française, qui fait partie de l’Otan, intervient beaucoup sur les terrains extérieurs. Elle a développé une réflexion qui a été structurée. Elle prend en compte les coûts comme les autres institutions, mais sa démarche s’appuie beaucoup sur un diagnostic de la ressource. Cela est fondamental. Je ne pense pas qu’ils fassent des forages. Ils traitent l’eau de surface. Ils connaissent les références de Sphère. Mais ils utilisent quelque chose d’intermédiaire entre Sphère et les recommandations de l’OMS. Ce qu’ils sont capables de faire sur le terrain est intéressant. Je pense qu’un partage de culture professionnelle serait intéressant afin d’éviter de faire les mêmes erreurs. Bien sûr, toutes les institutions n’ont pas les mêmes moyens, mais nous avons tous le même objectif : alimenter une population pendant une durée courte ou moyenne avec une eau a priori de meilleure qualité que l’eau habituellement disponible. Les militaires ont un élément supplémentaire à gérer : le risque de malveillance, d’attentat. A priori, ce risque n’existe pas pour les humanitaires.
Olivier Falhun
– Juste une question, par curiosité. Elle est peut-être hors sujet, je m’en excuse par avance. On entend beaucoup parler des conséquences des changements climatiques. Il existe des prévisions un peu alarmistes sur les guerres que pourrait entraîner la raréfaction de l’eau. Étudions-nous spécifiquement ces questions ?
Francisco Diaz
– Nous essayons de réfléchir à ces questions qui ne sont pas aussi hors sujet qu’elles peuvent le paraître de prime abord. Toutes les questions liées à l’environnement intéressent le département logistique. Nous devons établir un échéancier pour les traiter.
Jérôme Léglise
– Pour compléter un petit peu la réponse de Francisco, c’est vrai que nos priorités sont différentes. Pour employer une image, nous ne sommes pas parmi les signataires du Grenelle de l’environnement. Néanmoins, nous nous interrogeons au sujet de l’impact des changements environnementaux sur nos activités. Nous prêtons une attention particulière au traitement de nos déchets médicaux et d’autres déchets spécifiques. On commence par examiner les choses par le bas, c’est la première étape, pour prendre en compte l’impact de nos activités sur l’environnement. Pour suivre le fil de la présentation d’Étienne Gignoux, on sait malgré tout qu’a priori il va y avoir plus de catastrophes naturelles, en particulier des inondations liées au réchauffement climatique. Nous risquons de voir se multiplier ce qu’Étienne décrivait comme le deuxième type de contexte d’intervention : les catastrophes naturelles en milieu ouvert sur de grandes zones géographiques. Ces situations nous éloignent de l’approvisionnement en eau de camps de personnes déplacées ou réfugiées. À mon avis, c’est à cela qu’il faut se préparer dès aujourd’hui. Pour cette raison, la fourniture d’eau potable devrait prendre une plus grande place dans nos opérations à l’avenir.
Dominique Maison
– Cela a été dit, il y a bien lieu maintenant de s’interroger sur l’impact des activités de secours sur l’environnement. Cela doit se faire en amont. Par exemple en étudiant la biodégradabilité de certains produits utilisés au moment des interventions. La deuxième piste est assez directement liée à l’eau. C’est la question de l’énergie : son utilisation, sa pérennité, l’impact des batteries au plomb sur l’environnement et la possibilité d’utiliser du solaire... De nombreux sujets liés à ce thème sont ouverts. Le sujet est à la mode. Je n’aime pas trop le terme, mais cela crée peut-être l’opportunité d’obtenir des budgets, et surtout de développer une réflexion en profitant justement du fait que la question occupe le devant de la scène. La question est très pertinente. Cela a déjà été évoqué précédemment à propos des normes relatives à la fourniture d’eau. Il n’y a pas de raison de se poser des questions chez nous, dans les pays occidentaux où les moyens existent, sans se poser les mêmes une fois passée la frontière.
Gilles Isard
– Je souhaiterais continuer à discuter de la question de la rareté de l’eau. Aujourd’hui, nous intervenons dans certaines situations où, au niveau du bassin versant, l’eau doit être partagée. Parfois, nous donnons la priorité aux déplacés qui viennent d’arriver. Pourtant, ils viennent s’ajouter à une population existante, des agriculteurs, des gens qui ont besoin de ces ressources en eau et qui rencontrent déjà des difficultés, notamment saisonnières, pour s’approvisionner. Parfois, d’une façon autoritaire, les organismes d’aide monopolisent la ressource. Ils décident de donner l’eau en priorité à cette population de déplacés, en estimant qu’elle en a plus besoin que la population résidente. Cela peut mener à des conflits avec la population locale, parfois exacerbés par d’autres paramètres sociaux, notamment ethniques. Je ne sais pas si on prend toujours en considération les besoins en eau des divers utilisateurs. Prêtons-nous suffisamment d’attention à cet aspect ? Arrivons-nous à passer des accords de partage des eaux avec les populations locales dans nos contextes ?
Étienne Gignoux
– Je suis d’accord avec le fait que l’on ne prend pas toujours en compte le contexte local dans le partage de l’eau. Néanmoins, il ne faut quand même pas se tromper de débat. L’eau n’est pas rare. L’eau potable, l’eau domestique représente une infime partie des besoins en eau d’une population. Sans doute la plus petite partie par rapport à l’eau utilisée pour l’irrigation ou pour le bétail. Je ne connais pas de situation où il n’y avait pas une alternative possible pour que tout le monde, déplacés et résidents, puisse être fourni. Je ne pense pas que le réchauffement climatique affectera cette portion congrue, l’eau domestique. On peut trouver des solutions à cela. Je vais revenir un peu sur l’exemple du Tchad (2007). Je suis un peu en désaccord. Je pense qu’effectivement les eaux souterraines existent en quantités limitées. Il est vrai que l’arrivée d’une population déplacée ou réfugiée peut excessivement solliciter la ressource. Cependant, les alternatives pour éviter cela existent. Dans cette partie orientale du Tchad, il pleut autant qu’à Brest, en France.
Gildwen Bodiguel
– Pour prendre un exemple concret, j’ai travaillé sur une situation de camps de réfugiés en Thaïlande. Au niveau du bassin versant, nous avions une population de 8 000 réfugiés. L’eau n’était pas rare, mais mal répartie. Bien sûr qu’il y a de l’eau dans le monde, mais il y a de nombreux endroits où elle fait défaut. Si la rivière irriguant une vallée est utilisée par tout le monde pour l’agriculture, l’arrivée de 8 000 déplacés sur ce petit bassin versant peut provoquer des conflits si l’on ne trouve pas d’alternative.
Francisco Diaz
– Dans ce cas, l’alternative, c’est de se dire que le camp n’est pas au bon endroit. Un des éléments essentiels à évaluer lors de l’établissement d’un camp est l’accès à l’eau. S’il pose problème, cela signifie que le site n’est pas le bon.
Merci pour votre participation très active ce matin.
DEUXIÈME SESSION : EAU ET SANTÉ, ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
MALADIES D’ORIGINE HYDRIQUE ET SÉCURITÉ DE L’EAU
INTERVENTION DE PAUL R. HUNTER, PROFESSEUR DE MICROBIOLOGIE, UNIVERSITÉ D’EAST ANGLIA, ROYAUME-UNI
Tout d’abord, merci de m’avoir demandé de prendre la parole aujourd’hui ; Médecins Sans Frontières et Oxfam sont mes deux organisations humanitaires préférées sur la planète, c’était donc pour moi un grand honneur d’être invité à venir vous parler à l’occasion de cette journée. Quelques mots sur mon travail. On m’a présenté comme microbiologiste, ce que je suis, mais je suis également épidémiologiste. J’ai étudié la médecine, puis je me suis spécialisé en microbiologie médicale et dans les maladies infectieuses. À présent, je me consacre principalement à la recherche épidémiologique, sur les maladies diarrhéiques en particulier. Vous avez tous entendu parler du nombre d’enfants qui meurent chaque année de maladie diarrhéique, mais sachez qu’il y a entre 4 et 8 milliards de cas de maladie diarrhéique par an à travers le monde, et toutes ces diarrhées rassemblées équivaudraient au débit des chutes du Niagara pendant quinze minutes… cette comparaison marche toujours très bien auprès des publics américains, puisque toutes les femmes qui prévoyaient de passer leur lune de miel aux chutes du Niagara se mettent aussitôt à chercher d’autres destinations plus romantiques.
Et de toutes les maladies associées à la consommation d’eau, le choléra est sans doute la plus redoutée, mais c’est la diarrhée infantile, provoquée par l’eau contaminée, qui est presque certainement la plus meurtrière.
Alors, comment savoir si l’eau que l’on consomme est sûre, et sinon, comment pouvonsnous la rendre salubre ? Autrefois, la vie était vraiment simple, puisque jusqu’au milieu des années 1990, lorsque j’ai pris la présidence du comité consultatif sur l’eau du Royaume-Uni, tout ce dont ils discutaient était de savoir comment faire le meilleur test pour les E. coli. Dans le passé, si les coliformes (à l’époque, les coliformes fécaux, puis les coliformes, puis les E. coli thermotolérants, aujourd’hui, les E. coli ou les entérocoques) étaient absents dans 100 ml, alors, l’eau était buvable, et s’ils étaient présents, l’eau était impropre à la consommation. Pourtant, de nombreux problèmes se posent. Premièrement, on voit des flambées épidémiques même en l’absence d’indicateurs fécaux, notamment cryptosporidium et virus, dont celui de l’hépatite E. Plusieurs études et revues systématiques mettent en doute le lien entre ces marqueurs fécaux et les maladies. Ensuite, dans de nombreux réseaux d’adduction d’eau, la présence de pathogènes et d’indicateurs fécaux peut être intermittente, si bien que si vous faites un test hebdomadaire, cela ne vous donnera pas l’indication fiable que cette eau ne présente pas d’indicateurs les six autres jours de la semaine.
L’autre problème, c’est que sur de nombreux terrains, en particulier ceux où intervient Médecins Sans Frontières, il est en réalité impossible d’obtenir zéro indicateur fécal. Et il y a aussi le problème des E. coli sous les tropiques. Donc, selon moi, aucune eau prétendue potable n’est jamais sûre. L’eau du robinet à Paris n’est pas sûre. L’eau du robinet à Londres n’est pas sûre. L’eau du robinet au Darfour n’est certainement pas sûre… mais elle peut être suffisamment sûre. Et si elle ne l’est pas, pouvez-vous la rendre plus sûre ?
Alors voici une étude réalisée par un de mes collègues, Steve Gundry, de l’Université de Bristol.
Il a passé en revue un grand nombre d’articles traitant de la relation entre les maladies diarrhéiques et la présence d’indicateurs. Et, s’il a trouvé une nette corrélation dans le cas du choléra, il n’a pas trouvé de véritable lien entre les indicateurs et le risque de maladies diarrhéiques dans les études qu’il a pu consulter. Alors, pourquoi se donner tant de mal ? Si cela n’a pas d’importance, pourquoi ne pas diriger nos efforts ailleurs ? Eh bien, je pense que ce serait une erreur, et le point essentiel qui revient souvent, et qu’on a abordé ce matin, est résumé dans cet article de Tom Classen, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il est parvenu à la conclusion que le traitement de l’eau au point d’utilisation réduit considérablement les maladies diarrhéiques… d’environ 30 %, 40 %. Donc, une bonne chose, mais ensuite, son patron a publié un article en 2009. Il soulignait que cette revue systématique était fondée sur des études très lacunaires, et que si l’on ne retenait que les études en double-aveugle, l’effet n’était pas démontréSchmidt W., Cairncross S., “Household Water Treatment in Poor Populations: is there enough evidence for scaling up now?” Environmental Science & Technology, vol. 43, n° 4 (2009), p. 986-992. : « Il apparaît que ces estimations pourraient être fortement biaisées. Les chiffres actuels n’excluent pas la possibilité que les réductions du nombre de diarrhées observées soient largement, voire entièrement dues à un biais. Nous en concluons que la promotion généralisée du traitement de l’eau à domicile est prématurée au vu des preuves dont nous disposons. »
(Vous pouvez imaginer, soit dit en passant, les problèmes de relations personnelles. Vous travaillez dans une université et votre patron écrit un article, sans vous en informer, qui dit en gros que le papier que vous avez publié il y a deux ou trois ans, c’est du vent… vous imaginez les difficultés.)
Le coup de grâce a été donné par Waddington :Hugh Waddington, Lorna Fewtrell, Birte Snilstveit, Howard White, Water, Sanitation and Hygiene Interventions to Combat Childhood Diarrhea in Developing Countries, The International Initiative for Impact Evaluation (3ie), New Delhi 2009.
« Ces résultats questionnent la notion selon laquelle un traitement de l’eau de qualité dans les foyers (au point d’utilisation)… est nécessairement l’intervention la plus efficace et la plus durable pour promouvoir la réduction des diarrhées. »
Sandy Cairncross et Waddington n’étaient pas les seuls à produire ce genre de rapports, assez bons dans l’ensemble. Ils ont conclu que ces résultats questionnaient « la notion selon laquelle un traitement de l’eau de qualité dans les foyers, au point d’utilisation, était nécessairement le moyen le plus efficace et le plus durable pour promouvoir la réduction des diarrhées ». Maintenant, si le traitement de l’eau n’est pas efficace – et cette technique fonctionne essentiellement, presque uniquement, en améliorant la qualité de l’eau –, alors, on peut supposer que la qualité de l’eau ne fait pas de différence.
Ils ont aussi étudié des interventions de qualité dans plusieurs communautés et n’ont rien trouvé non plus. Vraiment, c’est assez décevant. Alors, que conclure de tout cela ?
La première chose à faire… et à ce stade, c’est d’agiter le drapeau des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. Si les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sont un moyen structuré d’aider les gens à réfléchir à la qualité de l’eau qu’ils fournissent, à anticiper les problèmes éventuels, à rechercher les failles potentielles du système au regard de ces risques et à concevoir des systèmes capables de prévenir ces risques, alors, ces plans constituent un excellent outil.
Le problème est que je ne dispose que d’une demi-heure, et que si vous vouliez vraiment vous intéresser aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, et à mon avis vous devriez, il nous faudrait toute une journée pour les passer en revue.
Donc, la question demeure. La qualité de l’eau est-elle mesurable (par exemple à travers des indicateurs fécaux ou autre chose) et est-elle importante ? Une bonne partie de mon travail ces dernières années consiste à tenter de répondre à cette unique et simple question.
Voici une étude que nous avons publiée en 2009.Hunter P.R. “Household Water Treatment in Developing Countries: Comparing Different Intervention Types Using Meta-Regression”, Environmental Science Technology n° 43 (2009), p. 8991-8997.Nous avons étudié les mêmes données que celles sur lesquelles Sandy Cairncross et Tom Clasen s’étaient opposés. Mais nous avons regardé autre chose. Nous nous sommes dit que les techniques de traitement de l’eau au domicile n’étaient peut-être pas toutes les mêmes et ne se valaient pas, parce que jusqu’alors tous les auteurs les avaient étudiées ensemble, indifféremment, qu’il s’agisse de désinfection au chlore, de désinfection solaire, de filtres céramiques, de filtre au bio-sable ou autre.
Et voici ce que nous avons découvert : la ligne noire représente le niveau moyen attendu en l’absence totale d’effet, mais il y avait un biais de rappel. Donc, ce qui se trouve au-dessus de la ligne noire n’est pas efficace, et ce qui se trouve sous la ligne noire est efficace.
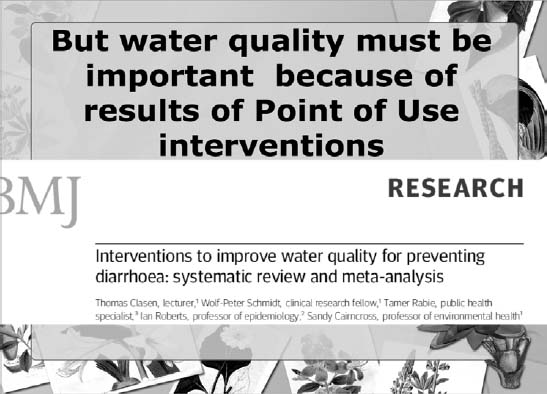
ESTIMATED MEAN RISK OF ILLNESS BY INTERVENTION AND STUDY DURATION
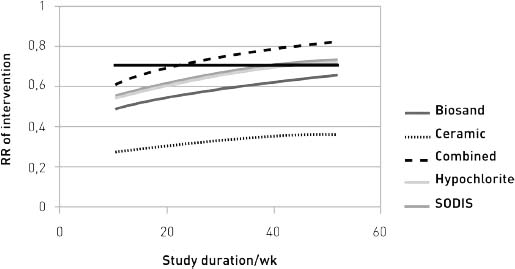
Et vous voyez qu’après les vingt premières semaines environ, aucune technique de désinfection n’était efficace. Cela inclut la chloration au domicile, la désinfection solaire, une combinaison de chloration et de floculation, des filtres à eau du genre PUR®. Au bout des vingt premières semaines, aucune de ces interventions n’était concluante.
Le filtre à bio-sable (Biosand) semblait légèrement mieux, mais en fait pas vraiment, comme vous le voyez. En revanche les filtres céramiques étaient nettement plus efficaces que les autres. Et c’est cohérent avec les commentaires de Sandy Cairncross, qui observait que toutes les études en double-aveugle n’avaient examiné que la chloration. Quand elles étaient correctement conduites et en aveugle, il n’y avait pas d’effet. Donc, je serai d’accord avec Sandy, ces études jettent un doute sérieux sur le traitement de l’eau au domicile. Cependant, je signalerai qu’il existe une catégorie d’intervention qui semble efficace : ce sont les filtres céramiques. Et depuis que j’ai fait ce travail, d’autres études sont sorties qui montrent que les filtres céramiques fonctionnent. On trouve toutes sortes d’autres publications qui suggèrent que la chloration au domicile ne marche pas.
SODIS, désinfection solaire… Pourquoi ces techniques sont-elles inefficaces ? Le Dr Jack Colford, professeur d’épidémiologie à l’Ecole de santé publique de Berkeley, Université de Californie, a effectué avec son groupe une grande étude en Bolivie. Ils sont retournés deux ou trois ans après sur un lieu d’intervention avec désinfection solaire et ils ont découvert que presque personne ne s’en servait. Ceux qui l’utilisaient ne le faisaient pas correctement, et seulement de façon sporadique, et il n’y avait aucune différence au niveau des maladies diarrhéiques. La popularité de la désinfection solaire est fondée sur des études de très, très médiocre qualité qui sont financées par un lobby agressif.
« Que signifient ces résultats ?
Ces résultats indiquent que, en dépit d’une campagne intensive pour promouvoir SODIS, moins d’un tiers des foyers étudiés traitaient régulièrement leur eau conformément aux recommandations. De plus, ces résultats n’apportent pas de preuve solide d’une réduction marquée de l’incidence de diarrhée chez les enfants suite à la mise en place de SODIS, même si certains aspects du protocole d’étude peuvent avoir conduit à sous-estimer l’efficacité de SODIS. Aussi, dans l’attente d’études complémentaires sur l’efficacité de SODIS à mener sur différents terrains, il n’est sans doute pas prudent de poursuivre davantage la promotion mondiale de SODIS et sa généralisation. »
Mäusezahl D, Christen A, Pacheco GD, Tellez FA, Iriarte M, et al. Solar Drinking Water Disinfection (SODIS) to Reduce Childhood Diarrhoea in Rural Bolivia: A Cluster-Randomized, Controlled Trial. PLoS Med 6(8): e1000125, 2009. doi:10.1371/journal.pmed.1000125
Les interventions portant sur l’hygiène ne fonctionnent pas non plus. Et ça ne veut pas dire que l’hygiène n’est pas importante… mais si on ne fournit pas d’eau aux gens, et même si on le fait, on ne va pas obtenir beaucoup de résultats avec des mesures d’hygiène. Je suis médecin consultant en hôpital, et je passe ma vie à essayer de persuader les infirmières et les médecins de se laver correctement les mains. Et si je dois batailler avec eux, comment convaincre des paysans au Soudan de se laver les mains correctement ? C’est complètement illusoire. Le lobby hygiéniste refuse catégoriquement d’admettre cela… Je vois dans la salle des gens qui opinent et d’autres qui ont l’air horrifié.
L’assainissement donne également des résultats, et je suis totalement convaincu de l’importance d’un bon travail d’assainissement au domicile. Les filtres céramiques fonctionnent aussi. Maintenant, pour revenir aux interventions dans les camps ou les villages, l’un des éléments qui peuvent rendre inefficaces les autres techniques de désinfection, c’est l’impact des jours « sans ».
Voici une étude que nous avons publiée il y a plusieurs années, où nous avons examiné le risque en Ouganda. Nous avons pris les données de base d’une enquête ougandaise. Si vous buviez de l’eau municipale correctement traitée, vous aviez environ une chance sur 10 000 par an d’être infecté par des E-coli entérotoxinogènes. Si vous buviez de l’eau brute (non traitée, en milieu rural), vous étiez sûr d’avoir une infection par an. On ne peut pas en avoir plus d’une parce que l’on s’immunise, c’était donc le maximum. Si vous buviez de l’eau brute un jour toutes les deux semaines, vous pouviez vous attendre à une infection garantie à la fin de chaque année. Je vais vous montrer des chiffres qui étaient cette affirmation.
COMPARISON OF HWT WITH OTHER INTERVENTIONS WADDINGTON DATA
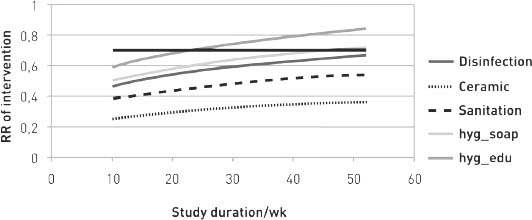
Impact des jours « sans »
• Risque d’Etec en buvant une eau correctement traitée
< 10-5/an
• Risque en buvant de l’eau brute
1,0/an
• Risque en buvant de l’eau brute 1 jour toutes les deux semaines
0,97/an
• Risque en buvant de l’eau brute 1 jour par mois
0,81/an
Voici le papier publié avec les Français Philippe Hartman et Denis Zmirou-Navier. Vous le voyez, pour les E. coli entérotoxinogènes (Etec), un seul jour de consommation d’une eau insalubre était encore 1 000 fois plus risqué que de boire de l’eau traitée pendant six mois d’affilée.
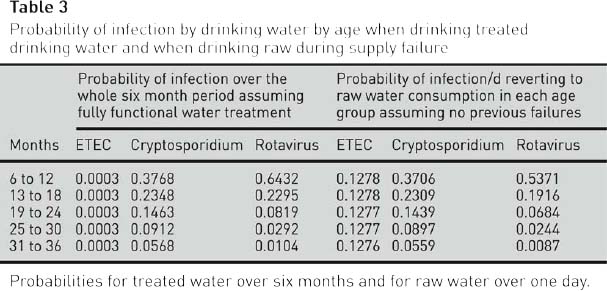
Pour le rotavirus et le cryptosporidium, c’était à peu près la même chose. Si le système de traitement est défaillant et que vous devez de nouveau boire de l’eau brute, le risque est à peu près identique à celui que vous courriez en six mois. Voilà pourquoi j’ai soulevé la question de la durabilité. Le système doit pouvoir durer au-delà de six mois pour que cela en vaille la peine. Cette contrainte s’applique aussi aux situations d’urgence. Si vous ne pouvez fournir de l’eau salubre que treize jours sur quatorze, alors, tous les bénéfices en termes de santé publique qu’apporte cette eau propre risquent d’être évacués dans les latrines. Je ne saurais assez insister sur ce point… Il y a tant d’ONG sur le terrain ! Tout ce qu’elles veulent, c’est dire à leurs donateurs qu’elles ont foré des puits. Elles ne se soucient pas de savoir s’ils continueront de fonctionner après leur départ, et je trouve cela incroyablement néfaste et malhonnête.
Nous nous sommes demandés autre chose : les investigateurs n’avaient peut-être pas posé les bonnes questions ?
Voici une autre étude que nous venons de publier dans l’American Journal of Tropical Hygiene. Nous avons examiné des études portant sur le lien entre la distance à parcourir pour aller chercher de l’eau et le risque de maladie diarrhéique. Vous voyez ici que plus vous habitez loin, plus vous avez de distance à parcourir pour aller chercher de l’eau, plus la probabilité est grande que vos enfants souffrent de diarrhée. Il s’agit sans doute d’une question de disponibilité plutôt que de qualité de l’eau, ou encore un mélange des deux. C’est un domaine qui n’a pas été correctement exploré, à mon avis.
IMPACT OF DISTANCE TO STANDPIPE ON DIARRHOEA RISK
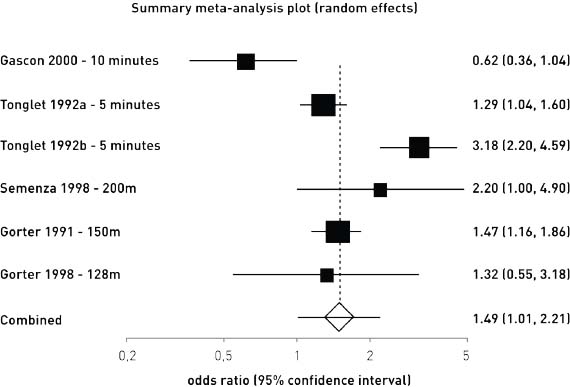
Je voulais juste vous présenter quelques études que nous avons menées dans le monde réel. La première concerne l’Angleterre, pays en développement bien connu, où nous avons étudié des communautés rurales dépendant de petits systèmes d’approvisionnement en eau. Vous constatez ici que dans pratiquement la moitié de l’échantillon, la moitié des réseaux, il y avait des coliformes, et environ un quart contenaient des E. coli et des entérocoques. Avant que vous ne vous rengorgiez, oh, chez nous, en France, c’est mieux, détrompez-vous, nous avons aussi analysé des réseaux d’eau français en milieu rural, et vous êtes aussi mauvais que nous. Alors pas de quoi se vanter.
% Présence d’indicateurs
| 1er échantillon | 2e échantillon | Échantillon aléatoire | |
| Coliformes | 36,3 | 38,1 | 47,0 |
| E. coli | 16,7 | 15,3 | 23,5 |
| Entérocoques | 18,5 | 19,8 | 28,0 |
C’est très décevant, aucun effet. Peu importe qu’il y ait de la merde dans votre eau ou pas. Il n’y a pas d’impact sur les maladies diarrhéiques, hélas, et en fait l’impact sur les E. coli pourrait même être légèrement inverse. Mais si on introduit une autre variable, un paramètre d’interaction pour l’âge, alors, tout à coup, les résultats apparaissent statistiquement significatifs. Ceci est très important. Vous avez ici le risque de maladie diarrhéique lié à la consommation d’eau contaminée. Et le plus remarquable est que les enfants de moins de 10 ans en Angleterre concentrent toute la morbidité excédentaire. Si vous survivez à votre dixième anniversaire, vous êtes tranquille, et vous pouvez même être un peu protégé pour avoir bu de l’eau contaminée. Il est intéressant de noter que dans le groupe des plus de 60 ans, il y a un sous-groupe avec un risque accru. Ce sont les gens qui se sont retirés à la campagne après leur soixantième anniversaire, qui sont passés d’une consommation d’eau urbaine à une consommation d’eau rurale polluée par des excréments, et qui présentent donc un risque plus élevé.
ANALYSE PAR SOUS-GROUPE D’ÂGE
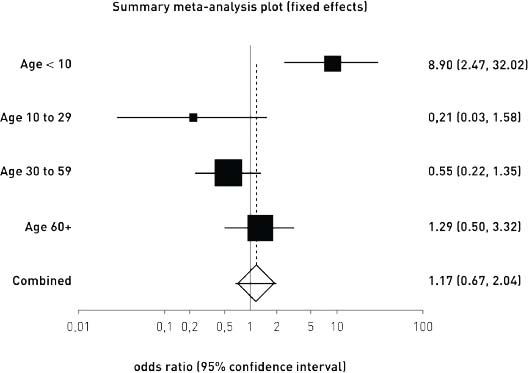
Incidence chez les enfants < 10
• Entérocoque –NEGATIF
1,14 (0,46 – 2,35) épisodes/personne/an
• Entérocoque –POSITIF
5,15 (2,57 – 9,22) épisodes/personne/an
Il s’agit ici d’un pays développé. Par ailleurs, si vous buvez ces eaux contaminées par des fèces en Angleterre, vous avez en gros le même risque annualisé de maladie diarrhéique que beaucoup d’habitants des camps de réfugiés. Dans la plupart des camps de réfugiés en Afrique, les enfants ont en moyenne cinq épisodes de diarrhée par an. Et l’autre chose à retenir dans ce dernier exemple est l’importance d’un bon système d’égout. Si vous avez une évacuation des eaux usées sur site, c’est-à-dire une fosse septique, qui se déverse dans un ruisseau voisin ou un autre système d’évacuation, vous présentez trois fois plus de risques de souffrir de diarrhées dans ce modèle.
Voici à présent un travail que nous avons réalisé dans le delta du Mékong. Nous avons obtenu les mêmes résultats. Voici l’impact de la consommation d’eau améliorée. Si vous avez moins de 5 ans et que vous buvez de l’eau améliorée, le risque diarrhéique est divisé par quatre par rapport à la consommation d’eau contaminée, non traitée. Passé l’âge de 5 ans, cela change, mais pas de manière statistiquement significative, et au-delà de 5 ans, peu importe si vous buvez de l’eau contaminée ou non. Si nous comparons les taux de diarrhée au Vietnam et en Angleterre, vous le voyez, passé l’âge de 2 ans, les taux de morbidité sont similaires dans les deux pays et toute la charge de la maladie est concentrée chez les enfants de moins de 2 ans… l’excédent de morbidité au Vietnam semble concentré chez les enfants de moins de 2 ans.
RR chez les individus buvant de l’eau potable améliorée au Vietnam
| Groupe d’âge | RR | LCI* | UCI* | P |
| < 5 | 0,25 | 0,07 | 0,87 | 0,03 |
| 5 à 15 | 1,75 | 0,20 | 15,1 | 0,61 |
| 16 + | 0,77 | 0,23 | 2,59 | 0,68 |
* LCI : Lower Confidence Interval
* UCI : Upper Confidence Interval
RISQUES DE DIARRHÉE DANS DEUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT, PAR TRANCHES D’ÂGE
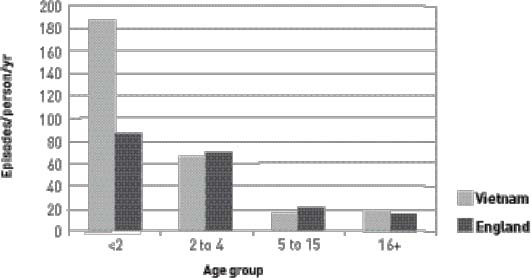
Voici maintenant Puerto Rico, où nous avons réalisé d’autres études d’intervention et, là encore, vous voyez que l’impact de l’intervention était préférentiellement bénéfique chez les enfants de moins de 5 ans, environ deux fois plus efficace.
Etude d’intervention à Puerto Rico
| Groupe d’âge | Risque relatif | IC* < 95 % | IC* > 5 % |
| < 5 ans | 0,382 | 0,077 | 1,895 |
| 5 à 15 ans | 0,657 | 0,228 | 1,891 |
| > 15 ans | 0,687 | 0,317 | 1,483 |
* IC : Intervalle de confiance
Voici la province de Limpopo, en Afrique du Sud. Cela n’apparaît pas aussi clairement dans cette étude, mais nous avons établi que le bénéfice de l’intervention était maximal chez les moins de 5 ans. Mais la conclusion la plus intéressante de ce travail – et nous pensons que c’est accepté, ça va être publié dans l’International Journal of Hygiene – nous ramène à ce que je disais sur la fiabilité des systèmes : tous ces résultats portent sur la période de six mois qui suit l’intervention, mais vous voyez ici que les systèmes moins fiables apportent une légère amélioration dans les communautés témoins, mais à peine, et ce n’était pas statistiquement significatif ; l’intervention plus fiable avait un effet bien plus marqué, donc là encore, nous avons une preuve. Il serait souhaitable d’affiner la qualité des preuves. C’est important. Si vous pouvez mettre en place un système dont vous pouvez garantir le fonctionnement tous les jours de la semaine pendant votre séjour, parfait, sinon vous risquez de gaspiller vos efforts.
Nouveau système d’approvisionnement en eau à Limpopo
| Groupe d’âge | Risque relatif | IC < 95 % CI | IC > 5 % |
| < 5 ans | 0,361 | 0,147 | 0,889 |
| >= 5 ans | 0,460 | 0,219 | 0,967 |
Impact de la fiabilité du système sur la maladie
| Communautés | Incidence/p/an* |
| Communauté témoin | 0,62 (0,48 – 0,80) |
| Intervention plus fiable | 0,17 (0,11 – 0,24) |
| Intervention moins fiable | 0,41 (0,30 – 0,54) |
* Incidence par personne et par an
Pour nous tous, dans cette salle, un épisode de diarrhée, sauf si c’est le choléra, ou chez une femme enceinte, l’hépatite E nous affecterait à peine, probablement. On s’en remettrait. Tous les décès concernent des enfants de moins de 5 ans et ce sont eux qui ont le plus de diarrhées. De surcroît, la diarrhée et la malnutrition vont de pair. Il y a débat dans la littérature quant à savoir si c’est la diarrhée qui est un facteur plus important parce qu’elle entraîne la malnutrition, ou si la malnutrition provoque la diarrhée. Peu m’importe. Je sais seulement que diarrhée et malnutrition se conjuguent pour le pire. Notamment quand le VIH et le paludisme figurent au tableau. Ce ne sont plus seulement les enfants qui meurent. En un sens, la mort d’un enfant est toujours une tragédie, surtout pour la famille. Mais pour l’ensemble de la société, ce n’est peut-être pas si grave parce que les conséquences économiques au long terme ne sont pas si dramatiques. Je ne vois pas les choses ainsi, mais c’est un argument qui a été avancé. Voici ce qui va avoir des répercussions à long terme sur la capacité de la société à prospérer : l’incapacité à se développer harmonieusement, les troubles cognitifs, le retard scolaire sont autant d’éléments qui vont empêcher un enfant de réaliser son potentiel en grandissant et donc de contribuer à la société en s’extrayant de la pauvreté.
Le multiplicateur des décès d’enfants
• Les enfants de moins de 5 ans ont plus de diarrhées
• Une forte proportion de ces diarrhées est due à la consommation d’eau contaminée
• Les enfants présentent beaucoup plus de risques de mourir d’un épisode de maladie diarrhéique
J’aimerais maintenant vous parler d’un autre aspect auquel on pense rarement à propos de l’eau. Il s’agit du transport de l’eau. Pour ceux d’entre nous qui avons travaillé en Afrique, un des souvenirs marquants est que les gens transportent de lourdes charges. Je dirais surtout les femmes, qui portent sur leur tête de lourdes charges, notamment de l’eau. Nous venons de publier un article sur le portage de l’eau dans la province de Limpopo et nous avons en particulier étudié ses répercussions musculo-squelettiques. Je n’ai pas le temps de vous présenter toute l’étude, mais, en bref, nous avons trouvé des niveaux extrêmement élevés de douleurs lombaires autodéclarées. La question n’était pas : « Avez-vous des douleurs de dos ? » mais plutôt : « Parlezmoi du transport de l’eau, quel en est l’impact sur votre quotidien ? », et la réponse était souvent : « … Oh là là, j’ai terriblement mal au dos, au cou. » Nous avons mesuré les forces que supportent les vertèbres cervicales des femmes et des enfants. Ce sont des forces incroyables pour des enfants en pleine croissance obligés de transporter de l’eau pendant parfois plusieurs heures par jour. Il n’est donc pas du tout surprenant qu’ils développent de graves dorsalgies. Et nous avons pu, même dans cette petite étude pilote, documenter des cas pour lesquels ce type de douleur entraînait par la suite toutes sortes d’autres difficultés dans la vie.
Prévalence des douleurs du cou/de la tête, du dos et du rachis (n/ 29)
| Taux de fréquence (rapport douleur/douleur non déclarée) | Prévalence, exprimée en pourcentage | |
| Douleurs cervicales /de la tête | 12/17 | 41,4 % |
| Douleurs lombaires | 11/18 | 37,9 % |
| Douleur vertébrales | 20/9 | 69,0 % |
Le Dr Santaniello-Newton travaillait pour MSF. Je crois qu’elle dirigeait un dispensaire MSF au Soudan au début des années 1990. Elle a rejoint mon équipe et elle avait toutes ces données sur cette flambée épidémique de méningite. Nous avons épluché les données. Nous nous intéressions à l’efficacité du vaccin antiméningococcique comme moyen d’enrayer les épidémies dans les camps de réfugiés. C’était le principal sujet de l’étude. Nous avons découvert un autre résultat intéressant : l’épidémie semblait se transmettre à travers le camp en suivant les trajets empruntés par les porteurs d’eau. Cela tendrait à prouver que les personnes qui se rassemblent autour des points d’eau constituent le foyer de transmission de la méningite méningococcique dans ce camp… dans votre camp.
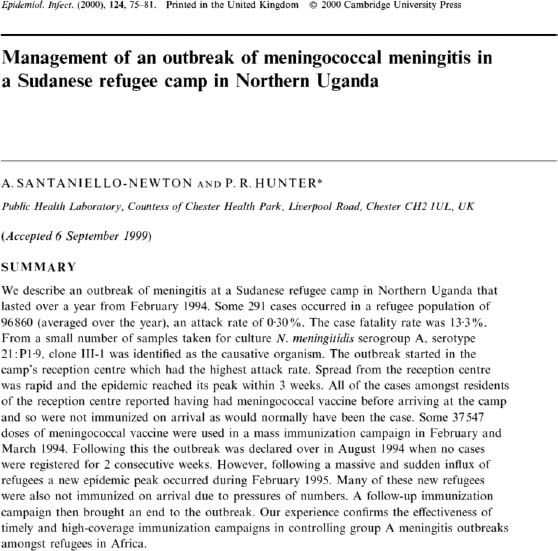
Donc, en conclusion, l’efficacité microbiologique des interventions n’est pas nécessairement corrélée avec un bénéfice en termes de santé publique, et c’est généralement parce que les systèmes ne sont pas fiables. N’ayez aucun doute là-dessus. Pour être efficace, un système doit être fiable et repris à son compte par la population. Vous allez dire : n’importe qui aurait pu trouver ça, rien de fracassant. Pourtant, cette notion semble complètement ignorée par bon nombre d’ONG qui travaillent sur le terrain.
Il est certain que la fourniture d’eau potable constitue une intervention de santé publique essentielle. Et peu importe que l’on parle de quantité ou de qualité. Idéalement, on choisit les deux. Si vous pouvez essayer d’améliorer la quantité, la disponibilité ou la qualité, ça vaut la peine de le faire.
La seule détection des E. coli n’est pas un marqueur suffisant de qualité et il faut recourir à d’autres méthodes, comme les plans de gestion de la sécurité de l’eau. Les entérocoques sont presque certainement un meilleur indicateur en terrain tropical que les E. coli, marqueur plus adapté à l’Europe. Pour être honnête, les tests entérococciques ont toujours été un peu plus difficiles, un peu plus coûteux à réaliser que les tests E. coli. La législation européenne préconise aujourd’hui d’utiliser les deux tests.
En matière de distribution d’eau salubre, je crois que les familles doivent être la cible prioritaire. Si vous ne pouvez pas fournir d’eau potable à tout le monde, concentrez-vous sur les familles avec des enfants de moins de 5 ans, parce que c’est là que vous aurez des morts et c’est là aussi que vous serez le plus efficace dans la réduction des problèmes sanitaires à plus long terme. Peut-être est-ce différent si vous avez des cas d’hépatite E, de typhoïde et de choléra, mais, même dans les épidémies de choléra, ce sont souvent les moins de 5 ans qui succombent le plus vite.
Et attention, je ne dis pas que la désinfection ne sert à rien ; la désinfection des réseaux d’eau à l’échelle communautaire est une bonne chose. C’est une pratique que j’encourage, même si nous connaissons les difficultés que posent l’hépatite E et le cryptosporidium. En revanche, pour ceux qui utilisent des sachets de chlore, des sachets PUR®, ou qui mettent des bouteilles sur le toit, ces méthodes n’ont aucune valeur. Mais tout le monde ne le reconnaît pas, il y a encore des gens qui me diabolisent pour l’avoir même suggéré.
Les filtres céramiques : je n’ai aucun doute que les filtres céramiques au point d’utilisation constituent une intervention publique très précieuse et pérenne quand vous n’avez pas accès à de l’eau de bonne qualité. Et, personnellement, j’utiliserais presque certainement des filtres céramiques pour traiter mon eau si je n’avais pas accès à une source améliorée. La différence entre ces méthodes, très probablement, est que les gens utilisent le filtre céramique régulièrement parce qu’il améliore nettement la qualité gustative de l’eau… elle n’est plus marron, elle ne contient plus de saletés et son goût est meilleur par rapport à l’eau chlorée ou désinfectée par le soleil. Avec la désinfection solaire, l’eau conserve des saletés, une couleur brune et un goût infect. Si vous la chlorez, elle reste pleine de particule, sale, et son goût est particulièrement infect parce que maintenant elle a un goût de chlore. À mon avis, tout le problème est là. La désinfection solaire pose toutes sortes d’autres inconvénients comme : que faire quand le ciel est nuageux ? Vous n’avez plus de système de traitement de l’eau. Avec la désinfection chimique : que faire quand vous n’avez plus de chlore en stock ? Les gars, on n’aura pas de chlore avant demain, tant pis.
Je m’excuse par avance auprès des ingénieurs présents aujourd’hui, parce que je trouve que vous, les ingénieurs, vous êtes tous des gens charmants. Mais je crois que l’un des grands problèmes avec la fourniture d’eau dans les pays en développement est que c’est devenu un service qui fait une trop grande place à l’ingénierie. C’est tout à fait justifié lorsqu’il s’agit de systèmes de grande ou moyenne dimension.
Quand il s’agit de petits systèmes, un ou deux foyers, l’équivalent d’un puits alimentant quelques maisons, je crois que les ingénieurs ont encore un rôle à jouer. Mais les gens qui comptent vraiment sont les sages-femmes, les personnels infirmiers, les médecins. Ceux qui s’occupent des femmes enceintes et de celles qui viennent d’accoucher. Pour ceux qui ont eu des enfants, à quel moment vous et votre femme étiez-vous les plus réceptifs aux conseils qu’on vous prodiguait ? C’était pendant la grossesse ? La plupart des femmes, surtout les primoparturientes, sont plus réceptives à ce qu’on leur conseille de faire qu’à tout autre moment de leur vie. Le problème pour elles est que la sage-femme, le médecin et l’infirmière ont tous des avis différents.
Conclusions
– L’efficacité microbiologique des interventions n’est pas nécessairement corrélée à un bénéfice en termes de santé publique.
– Les interventions doivent être fiables et reprises en charge par la population cible.
– La fourniture d’eau potable est certainement une intervention essentielle de santé publique – à la fois en quantité et en qualité.
– La détection des E. coli n’est pas un marqueur suffisant de qualité.
– Mais elle reste nécessaire, même si les entérocoques seraient probablement un meilleur indicateur sous les tropiques.
– Pour la distribution d’eau salubre, cibler en priorité les familles avec enfants de moins de 5 ans.
– Cependant, s’il y a un risque de choléra, de typhoïde et d’hépatite E, on ne peut pas se permettre de cibler seulement les jeunes enfants.
– Dans les situations d’urgence extrême, le traitement de l’eau au point d’utilisation, quelle que soit la méthode, présente sans doute un intérêt.
– Après les premières semaines, la désinfection au seul point d’utilisation est presque certainement inefficace (notamment contre le choléra).
– Les filtres céramiques au point d’utilisation sont assurément efficaces.
QUESTIONS À PROPOS DE L’INTERVENTION DE PAUL HUNTER
François Mansotte
– Vous avez abordé quelque chose de très important qui n’a pas du tout été évoqué ce matin : le fait, pour une population, qu’obtenir de l’eau au goût de chlore soit associé à la venue d’une ONG. C’est-à-dire que d’un seul coup Big Brother arrive et décide à la place de la population que la meilleure eau est celle qui a un goût de chlore. La population n’a jamais bu d’eau chlorée, donc le goût de produit chimique est horrible. Elle peut faire plus confiance à une eau simplement parce qu’elle a l’habitude de la boire, ou encore à une eau dont elle peut voir où elle est puisée car c’est de l’eau de surface et non de l’eau souterraine.
J’étais en poste en Guyane : on distribuait de l’eau chlorée en dépit du fait que la population n’en boit pas. C’est l’exemple d’une approche technique qui se veut universelle et acceptable par tous alors que la population locale ne l’accepte pas.
Paul R. Hunter
– Oui, je suis totalement, totalement d’accord. C’est certainement un des grands problèmes, et c’est étonnant… si vous regardez qui pousse tel type de traitement à travers le monde. Ce sont principalement les Américains qui poussent à l’utilisation du chlore. Si vous allez à New York, vous remarquerez tout de suite en ouvrant le robinet que vous avez presque envie d’ouvrir la fenêtre et de mettre la tête dehors, tant l’odeur de chlore est envahissante. Et pardon à mes collègues américains dans la salle, beaucoup d’Américains ont grandi en croyant que si l’eau n’a pas une odeur et un goût de chlore, elle n’est pas sûre, car ils s’y sont habitués. Et nous tous, nous préférons l’eau que nous avons bue dans notre enfance. Si l’eau n’a pas le goût que vous aimiez étant enfant, ça ne marche pas. En grande partie pour les raisons que vous évoquez, mais aussi parce que de toute façon ça ne fonctionne pas toujours… ce n’est pas efficace avec l’hépatite E, ce n’est pas efficace avec le cryptosporidium, ni avec certains autres virus ou contaminants. Voilà pourquoi je pense que les filtres sont sans doute préférables, parce qu’ils améliorent l’eau. Parce que même si vous avez grandi en buvant de l’eau souillée, vous préférez qu’elle soit propre. C’est agréable, après avoir avalé un verre d’eau, de pouvoir refermer la bouche sans croquer du sable, n’est-ce pas ? Bonne remarque.
Étienne Gignoux
– Je trouve qu’effectivement certains problèmes concernant le traitement à domicile et la filtration sont très intéressants. Néanmoins, une de nos problématiques est l’hépatite E. Un virus qui nous concerne directement puisque, dans l’exemple de Mornay, l’enquête épidémiologique a montré qu’être un utilisateur du réseau d’eau chlorée de MSF augmentait la probabilité de contracter la maladie. Les filtres céramiques ne sont pas une réponse à ce problème car ce virus les traverse. C’est pourquoi nous avons fait des recherches au sujet de l’ultrafiltration à domicile. Je sais que Thomas Clasen a déjà réalisé une étude. Que pensezvous de cette option ?
Paul R. Hunter
– Oui, vous avez raison, les filtres céramiques ne vont pas éliminer tous les virus. Ils sont quand même plus efficaces qu’on ne le croit généralement parce que les virus ne flottent pas librement partout. Souvent, ils collent à une surface, comme des filaments fécaux, des excréments. Quand on examine au microscope électronique des échantillons de diarrhée humaine, on voit les virus, particulièrement les rotavirus, qui s’agglutinent sur quelque chose. Donc, les filtres céramiques vont réduire une certaine proportion de ces virus, mais pas la totalité. On ne peut pas compter sur les filtres céramiques pour éliminer l’hépatite E. Là où l’hépatite E est un vrai risque, alors, il faut certainement recourir à des techniques d’ultrafiltration ou d’osmose inverse. Personnellement, je n’hésiterais pas à boire une eau traitée par ces méthodes. Le problème est qu’elles sont trop coûteuses pour les interventions humanitaires. Elles consomment aussi beaucoup d’énergie. Si vous en avez les moyens, alors, la question qui se pose est le devenir de l’installation après votre départ. Vous ne serez plus là pour faire de l’osmose inverse ou de l’ultrafiltration. Et dans la phase aiguë d’une flambée d’hépatite E, alors, absolument, à coup sûr, ces techniques sont très utiles. Mais vous ne pouvez pas lancer ce type d’intervention pendant une épidémie et puis, dès la fin de l’épidémie, dire voilà, tout est réglé, on va faire nos valises et partir. Vous risquez alors d’aggraver la situation, parce que si vous étiez sur place depuis quelques années, vous avez arrêté le développement de l’immunité. Si vous deviez revenir à la situation initiale, vous découvririez une population très vulnérable. Il faut donc bien planifier l’intervention et la manière de gérer tout ça. Mais oui, si vous pouvez vous le permettre, les filtres dont vous parlez feront l’affaire. Regardez l’armée, ce qu’emploient les militaires. Ils utilisent ces types de filtres pour purifier leur eau, et ce pour une bonne raison : ils veulent des soldats en bonne santé.
Peggy Pascal
– Une remarque sur le sujet de la conférence d’aujourd’hui « L’eau humanitaire est-elle potable ? ». Je pense que cela dépend du moment où on l’examine. Le moment où les gens vont la chercher ? Au robinet ou au point de collecte de l’eau ? Au moment où ils la consomment ? Est-ce que la question du stockage a été prise en compte dans votre étude ? Les capacités de stockage à domicile sont en rapport avec l’activité de distribution de ce qu’il est convenu d’appeler les non food items (NFI), notamment les bidons. Mais, deuxième question : quel est votre avis sur les programmes d’éducation à l’hygiène et leur impact ? Je n’ai pas bien compris votre exposé à ce propos.
Paul R. Hunter, professor of microbiology, University of East Anglia, United Kingdom :
– Ok, la première question concerne le stockage de l’eau dans les foyers. Ce qui compte, c’est la qualité de l’eau quand elle arrive dans les maisons. Donc, en principe, du moment que l’eau est traitée avant d’être consommée, c’est suffisant. La difficulté est que plus vous êtes près de là où l’eau est traitée, plus il y a d’incertitude. Disons que je dirige le service de l’eau pour la ville. Je peux contrôler ce qui se passe dans le réseau d’eau municipal, mais je ne pourrai jamais contrôler ce que vous faites chez vous. Bon nombre des échecs que l’on constate avec le traitement de l’eau au niveau des foyers, à mon avis, sont dus aux habitudes domestiques.
Et, certainement, l’éducation est importante. Une étude scientifique qui n’a pas encore été publiée, effectuée en Amérique du Sud, montre que si vous utilisez des filtres céramiques il faut apprendre aux gens à s’en servir. Si vous ne le faites pas, les filtres ne seront pas efficaces parce que les gens ne savent pas comment les nettoyer et ils deviennent contaminés, etc. Le problème avec l’hygiène, c’est que… c’est très important, je pense. Un bon lavage des mains est absolument essentiel pour vous protéger, vous et votre famille, des maladies. Le problème est qu’on ne sait pas comment influer au mieux sur les comportements autrement qu’en fournissant aux gens assez d’eau, et du savon s’il y en a, pour qu’ils se lavent les mains. Mon sentiment personnel est que les gens qui vont se laver les mains se laveront les mains s’ils ont de l’eau et du savon à disposition. Et ceux qui n’ont pas cette habitude ne le feront pas, quand bien même vous leur répéterez que c’est important. Regardez simplement autour de vous, dans ce pays. Des chercheurs ont fait une étude, aux Etats-Unis. J’ai mené ma propre enquête dans ce pays, non officielle, mais seulement dans les toilettes pour hommes, pas dans celles des femmes. Et la prochaine fois que vous irez aux toilettes, prenez du temps pour vous laver les mains et comptez les gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Leur nombre va vous déprimer. Dans ce pays… en Amérique du Nord, et je n’ai aucune raison de penser qu’il en aille autrement dans les pays d’Europe. Plus de la moitié des hommes, 60 %, vont aux toilettes sans se laver les mains après. Et c’est à peu près la même chose pour les femmes : 40 % des femmes ne se lavent pas les mains. Or, en Europe et en Amérique du Nord, tout le monde sait qu’il est important de se laver les mains après être allé aux toilettes. Alors comment se fait-il que tant de gens ne le font pas ? Et après, vous avez des types qui affirment pouvoir réduire les maladies diarrhéiques de 40 % uniquement en allant expliquer aux Soudanais les bienfaits du lavage des mains. Vous croyez que ça va marcher ?
Et quand on examine les études sans double-aveugle qui ont montré un effet, elles portent sur de très courtes durées. Nous avons mis en évidence qu’en réalité, quelle que soit la méthode employée, on obtient des effets très très positifs au cours des quelques premières semaines, quoi qu’on fasse avec ces interventions. Ce qui importe vraiment, c’est le devenir des interventions six, douze mois plus tard. Dans beaucoup d’études sur l’hygiène, le suivi est fait sur quelques semaines seulement. Vous allez dans un village une semaine, vous dites aux habitants : c’est très important de vous laver les mains, voici un peu de savon, vous revenez la semaine suivante, vous demandez comment ça s’est passé, et c’est incroyablement pauvre sur le plan scientifique. Dans toute autre discipline médicale, une étude de cet acabit serait la risée générale, personne n’y prêterait attention. Vous ne pourriez même pas la faire publier, mais l’hygiène, le traitement d’eau à domicile, ça, on publie. Essayez de dire ça aux lobbies de l’hygiène et du traitement de l’eau, et ils vont dessiner une croix sur votre porte et mettre des têtes de chevaux coupées dans votre lit la nuit. C’est comme ça.
Emmanuel Baron
– Paul, ne nous dites-vous pas au fond de porter un peu plus d’attention à l’émergence de phénomènes cliniques de masse, observables par l’activité médicale de base que nous pratiquons sur nos terrains, plutôt que d’accorder trop de crédit au suivi d’indicateurs biologiques, quels qu’ils soient ? Au fond, n’est-ce pas le rôle du clinicien que vous soulignez ? La composition de la salle aujourd’hui est d’ailleurs révélatrice de ce point de vue. Il existe un fort déséquilibre entre les professions médicales et non médicales, aux dépens des premières.
Paul R. Hunter
– Avant de devenir professeur, je m’occupais de la prise en charge des maladies infectieuses aux niveaux clinique et communautaire, et de la prise en charge des flambées épidémiques. Vous avez entièrement raison. Notre rôle le plus important, en tant que médecins, si on découvre, comme vous dites, un phénomène clinique émergent, si en médecine générale on commence tout à coup à voir des cas de diarrhée chez des enfants de plus de 5 ans plus nombreux que la normale, il faut le signaler. Si vous n’êtes pas chargé de la santé publique, allez trouver le responsable, parce que, si vous n’êtes pas vigilant en épidémiologie des maladies infectieuses, la situation peut vite se dégrader, on en a vu un exemple flagrant aux Etats-Unis. Excusezmoi de viser encore les Américains. Ce sont des gens bien, honnêtes, mais pendant les années Reagan ils ont drastiquement réduit les budgets des programmes de prévention de la tuberculose, et le résultat c’est qu’au bout de… il y avait aussi d’autres raisons, mais au bout de dix ans, soudain, ils ont dû réinjecter des sommes bien plus considérables dans la prévention de la tuberculose. Même s’il y avait d’autres facteurs en jeu, notamment le VIH, on ne peut pas s’empêcher de penser que s’ils n’avaient pas relâché leur vigilance, ils n’auraient pas aujourd’hui un tel problème avec la tuberculose. La dengue ! La dengue est une maladie très intéressante, et le gouvernement portoricain avait l’un des meilleurs programmes de prévention et de surveillance de la dengue dans toute la Caraïbe jusqu’à il y a environ quinze ans. Puis un chirurgien a été élu gouverneur de Puerto Rico. Il a décidé de réduire tous les programmes de prévention en santé publique. Donc, plus de surveillance pour la dengue, et cette année, en septembre dernier, Puerto Rico a connu une nouvelle épidémie de dengue. Trente-cinq morts au dernier bilan, et ce n’est pas fini. On se dit que, peut-être, s’ils avaient maintenu une surveillance et un suivi de santé publique, ils n’en seraient sans doute pas là. Comme médecin, c’est si facile d’ignorer les implications sur la santé publique de ce qu’on voit en clinique. Mais si nous sommes vigilants, si nous le signalons, que nous réfléchissons à ce que nous voyons et que nous réagissons au début de l’apparition d’un phénomène, alors, bien souvent, nous pouvons contenir une bonne partie des problèmes. Une difficulté que pose l’hépatite E, c’est la période d’incubation. Le temps que vous voyiez votre premier cas, la contamination a fait son chemin à cause des quatre, six, huit semaines d’incubation.
Peter Maes, EHA, MSF Bruxelles
– Je me demandais ce que vous vouliez dire avec cette dernière image à la fin de votre présentation. La photo avec la femme et l’enfant dans un environnement médical. MSF, dans un contexte stable, par exemple en zone de paludisme endémique, va donner une moustiquaire aux patientes qui viennent en consultation prénatale, et l’on ne donne pas une moustiquaire, mais deux, pour s’assurer que les membres vulnérables de la famille seront protégés. Avec cette image, voulez-vous suggérer que face à une énorme charge de mortalité infantile due à la diarrhée, il serait pertinent pour MSF de fournir un type de traitement de l’eau à domicile dans un contexte stable comme celui-ci ?
Paul R. Hunter
– Oui, c’est exactement ce que je suggère si vous ne pouvez pas fournir une eau salubre à échelle collective. Rappelez-vous cette étude anglaise. Nous avons de gros problèmes, comme vous en France, avec les petits réseaux d’eau en milieu rural. Vous allez voir les gens en leur disant : « Il y a des fèces dans votre eau », et ils vous répondent : « Oh ! j’en ai bu toute ma vie, pas de problème, allez-vous en, État Big Brother, laissez tomber. » Ils ne vous croient pas, alors que si vous leur dites : « Il y a des fèces dans votre eau et je sais que vous vous y êtes habitués et que vous allez bien, mais, si vos petits-enfants viennent, vous risquez de les tuer avec cette eau », c’est un message plus juste, et beaucoup plus efficace. Si vous adressez à toute la population des messages qui concernent seulement les enfants de moins de 5 ans, personne ne va vous croire. Ils savent qu’ils boivent cette eau depuis soixante ans et ils ne se rappellent pas la dernière fois qu’elle les a rendus malades. Personne n’arrive à la soixantaine sans avoir connu des épisodes de diarrhée, mais ils vous assurent que c’est le cas. Alors ils ne vous croiront pas quand vous leur direz que leur eau est impropre à la consommation. Mais si vous leur montrez que vous n’êtes pas inquiets pour eux, mais pour leurs petitsenfants, ou leurs enfants, ils vont vous écouter. Sur les terrains où vous ne pouvez pas fournir une eau salubre à toute la communauté, expliquez-leur : « En plus de vous donner des moustiquaires, on va vous aider à rendre l’eau plus saine, voici un filtre céramique simple d’utilisation. Quand vous donnez de l’eau à vos enfants, vous pouvez vous en servir. » Peutêtre pour les femmes enceintes, peut-être au moment où les mères commencent à diluer le lait maternel avec de l’eau. C’est le moment où elles devraient se mettre à utiliser le filtre. Si vous arrivez à les convaincre de s’en servir pendant six mois à compter du sevrage, en supposant que le sevrage ait lieu autour de six mois, vous les persuadez d’utiliser une eau saine, ou plus saine, une eau filtrée, pendant six mois, jusqu’au premier anniversaire, vous diminuerez très notablement la mortalité infantile. Et il y a un bénéfice secondaire : comme l’eau filtrée a un goût plus agréable, il est probable que toute la famille décide de continuer à utiliser le filtre parce que la qualité de l’eau est tellement meilleure. Mais il s’agit là d’une question de qualité. La question de santé se pose chez les très jeunes enfants.
Peter Maes
– Puis-je un instant anticiper la résistance que rencontrera une telle proposition ? Pendant longtemps, les opposants aux moustiquaires ont affirmé qu’elles pouvaient entraîner un effet négatif sur la mortalité si les enfants étaient protégés depuis leur plus jeune âge. Mais bien sûr, même s’ils sont protégés par une moustiquaire, ils seront piqués de temps en temps, donc ils développeront quand même une immunité en dormant sous une moustiquaire. Cet effet négatif sur la mortalité n’a pas pu être identifié dans les études chez les 5 à 15 ans, voire 20 ans. Pensez-vous qu’il en aille de même avec la diarrhée ?
Paul R. Hunter
– Eh bien, c’est encore plus clair dans le cas de la diarrhée. Mis à part le choléra, la diarrhée ne tue pas les enfants de plus de 5 ans, sauf dans des circonstances très très exceptionnelles. Tous ceux qui ont un jour travaillé en pratique clinique dans les pays en développement se souviennent forcément d’un ou deux cas d’enfants de plus de 5 ans morts de diarrhée. La probabilité de décès chute de façon marquée entre l’âge de 1 an et l’âge de 5 ans, c’est bien documenté. Si vous pouvez retarder l’apparition de diarrhée chez un enfant pendant six mois, vous augmenterez nettement ses chances d’atteindre l’âge adulte. Et c’est si évident avec la diarrhée, et l’âge, et la mortalité que la question, avec le paludisme, c’est que les adultes en meurent, alors que normalement les adultes ne meurent pas d’une diarrhée ordinaire. Même s’il y a toujours l’exception qui confirme la règle. On en a tous des exemples. Avant que je devienne professeur, un de mes derniers patients en clinique est mort d’une diarrhée attrapée en mangeant une laitue espagnole contaminée par… une salmonelle.
Étienne Gignoux
– Juste une remarque à la suite de la question de Peter Maes. Cette journée de travail est un début, une introduction. Nous avons commencé à travailler dans la direction de la fourniture de dispositifs de traitement de l’eau à domicile. C’est bien de voir que d’autres sont intéressés. Il faut essayer d’intégrer le traitement de l’eau à domicile dans les situations où nous avons pour objectif de réduire la mortalité infanto-juvénile. Nous devrions profiter du fait d’avoir suffisamment de terrains pour mener à bien ces essais.
Rony Brauman, Crash, MSF Paris
– J’ai une question sur le choléra. Est-il vrai que la baisse de l’acidité gastrique favorise le passage du vibrion dans l’intestin, et donc l’apparition de la maladie ? Et si c’est le cas, estce que la prévention de l’expansion d’une épidémie de choléra ne passerait pas par une meilleure alimentation, pour élever l’acidité gastrique, en plus des mesures habituelles ?
Paul R. Hunter
– Vous avez parfaitement raison. L’acidité gastrique joue un rôle. Les gens atteints d’une maladie appelée achlorhydrie, dans laquelle l’estomac ne sécrète pas d’acide, ou ceux qui prennent des médicaments antiacides présentent nettement plus de risques d’attraper le choléra. Et c’est parce que normalement l’acidité gastrique tue le choléra. Ce n’est pas efficace à 100 %, sinon les gens ordinaires n’auraient pas le choléra, parce que l’acidité gastrique l’éliminerait. Mais les effets s’en trouvent considérablement atténués. Je ne connais aucun moyen de manipuler ça dans la chaîne alimentaire car le choléra peut se transmettre à travers des produits alimentaires. Une récente épidémie de choléra au Chili l’a mis en évidence. Certaines nourritures vendues dans la rue, comme le poisson cru, étaient associées à un risque accru de choléra. En revanche, s’ils consommaient la version locale bien acide du Coca-Cola, ils présentaient moins de risques de contracter le choléra que s’ils buvaient de l’eau. Et d’ailleurs, personne n’en parle, mais, si vous buvez constamment du Coca-Cola, vous n’aurez pas le choléra. Ils sont passés à côté de cet argument de vente, ça m’étonne. On ne voit pas ce genre de pub à la télévision britannique : « Buvez Coca-Cola et vous n’aurez pas le choléra ! », pourtant, c’est absolument vrai si vous ne buvez que ça. La bière n’entraîne probablement pas le même effet, sans compter qu’on ne tient plus debout.
DÉSINFECTION, CLARIFICATION, IRRADIATION UV ET ULTRAFILTRATION
INTERVENTION DE JOËL MALLEVIALLE, INGÉNIEUR SANITAIRE
Jérôme Léglise m’a demandé de parler des membranes et des rayonnements UV, qui ne sont pas des techniques nouvelles. Leurs applications se multiplient ces dernières années. J’ai hésité à parler de la chloration, qui est une technique assez ancienne. Mais les remarques entendues ce matin lors des débats justifient d’en parler au cours de cette présentation.
La désinfection
Je rappellerai quelques paramètres importants, déjà connus mais qui ont tendance à être oubliés, à la fois lors du dimensionnement initial des installations et lors de leur fonctionnement. Les paramètres importants à prendre en compte sont la cinétique chimique et l’hydraulique des réacteurs de contact. Cette dernière est souvent négligée.
La plupart des micro-organismes réagissent selon la loi de Chick et Watson, selon laquelle l’inactivation des germes est directement proportionnelle au produit de la concentration en désinfectant (C en mg/1) par le temps de contact (T en minute). Il existe bien sûr des exceptions. Le problème est que T, le temps de contact, ne correspond pas au volume (V) divisé par le débit
(D) : V/D. Pour comprendre cela, imaginons que nous soyons dans un réacteurDispositif dans le lequel on maintient et dirige des réactions, par exemple celles qui se produisent entre un désinfectant comme le chlore et les micro-organismes. Il s’agit souvent d’un simple réservoir dans les contextes de l’action humanitaire. de chloration dont T, le temps de contact théorique (V/D), est de dix minutes. L’eau arrive pour être traitée par un orifice et sort par un autre, le temps de contact variera en fonction des caractéristiques du circuit compris entre l’entrée et la sortie. Le temps de contact réel, ou « temps hydraulique », sera souvent bien inférieur au temps obtenu par le calcul théorique (T = V/D). Il pourrait être alors très éloigné du temps de contact théorique, par exemple dix minutes, et se situer bien en dessous d’une minute. La solution est de réaliser des chicanes dans les réacteurs de désinfection pour obtenir ce que l’on appelle un comportement piston. Ce dernier est spontanément obtenu dans un tuyau. Il faut se souvenir que si l’on ne prend pas en compte l’hydraulique dans le calcul du temps de contact, alors, on n’obtient pas le résultat escompté.
Le produit C x T, la concentration en chlore multiplié par le temps de contact « hydraulique », permettant l’élimination de plus 99 % (2 logarithmes) des micro-organismes est un paramètre important qui varie énormément d’un micro-organisme à l’autre et d’un réacteur à l’autre. Comparé à celui qui est nécessaire à la destruction d’E. coli, celui qui permet l’élimination du virus de la polio est 300 fois plus élevé. Celui qui est requis pour se débarrasser du parasite de la giardase est 9 000 fois plus élevé que celui qui détruit E. coli. Quant au cryptosporidium, un autre parasite, il est impossible à éliminer à l’aide du chlore. Le CT requis est bien trop élevé. Le calcul du CT nécessaire à l’élimination de 2 logarithmes de micro-organismes prend en compte leur résistance au chlore, la concentration en chlore et le temps de contact « hydraulique ». Il permet de comparer les performances de différents réacteurs de désinfection car il prend en compte le temps de contact en fonction de l’hydraulique spécifique du réacteur et non le temps de contact théorique (V/D).
Le deuxième paramètre important est le pHLe pH désigne l’une des caractéristiques principales d’un liquide : acide, neutre ou basique. Les valeurs du pH se situent entre 0 à 14., qui donne une indication du « degré d’acidité de l’eau ». Le chlore se dissout sous deux formes (ClO- et HClO). HClO est 10 à 100 fois plus efficace que ClO-. Plus le pH est élevé, moins la désinfection est efficace. À pH = 8, le chlore se dissout en donnant 20 à 30 % d’HClO alors qu’à pH = 7 il donne 70 % de HClO. Il existe des régions où le pH de l’eau est élevé, par exemple dans le département du Tarn, en France.
Un autre paramètre important est la concentration en ammoniaque, dont 1 mg neutralise 7 à 10 mg de chlore. Elle varie brutalement en fonction de la dégradation, par exemple, des matières organiques. Si les boues collectées au fond d’un réacteur ne sont pas vidées, alors, elles peuvent produire un pic d’ammoniaque et, pendant la durée de cet événement, l’eau n’est plus désinfectée alors que la concentration en chlore et le temps de contact n’ont pas varié.
Le dernier paramètre important est la turbidité de l’eau, la présence de particules organiques : ainsi, des algues qui passent dans le réacteur de chloration peuvent protéger un virus du désinfectant dans le réacteur lui-même mais aussi à l’intérieur du réseau de distribution.
Un autre désinfectant, plus puissant, l’ozone, n’est pas utilisé dans vos contextes car il ne donne pas la concentration résiduelle nécessaire au traitement des contaminations ultérieures au passage dans le réacteur de désinfection, pendant la distribution et le stockage. Les principes sont les mêmes : le pH ne doit pas être trop élevé pour que l’ozone soit efficace.
Les sels d’argent, utilisés dans les piscines privées, sont cités pour mémoire. Je n’ai pas l’expérience de ces sels et la littérature n’incite pas à leur utilisation dans les contextes humanitaires. En revanche, il existe un consensus pour l’utilisation de ces sels d’argent pour la conservation de l’eau en bouteille ou en bonbonnes.
La clarification
Autre procédé de traitement de l’eau : la clarification « classique », que je considère comme un procédé de désinfection. La turbidité désigne la teneur d’un liquide en matières qui le troublent. La recommandation OMS pour la turbidité de l’eau, mesurée par néphélométrie à l’aide d’un turbidimètre, est de 5 UTN (unités de turbidité néphélométrique, NTU en anglais) dans vos contextes de travail.
Même si l’élimination des micro-organismes par ce procédé est limitée, il constitue souvent une première étape dans une chaîne d’actions (concept de « multi-barrières ») pour améliorer la qualité de l’eau. La clarification permet d’éliminer une partie des micro-organismes liés aux particules organiques. En diminuant la turbidité de l’eau, elle favorise son traitement ultérieur par un désinfectant en évitant, par exemple dans le cas du chlore, que la concentration en chlore libre ne soit diminuée du fait de sa captation par les matières organiques. Les chiffres que je donne sont valables pour une turbidité de 0,5 UTN, qui est la norme française. La recommandation de 5 UTN prévaut dans votre secteur. Elle est compréhensible car il serait difficile d’obtenir partout 0,5 UTN. En revanche, j’ai travaillé sur des projets de petites usines réalisées par des ONG où il était possible d’avoir 0,5 UTN. Ce n’est peut-être pas possible d’assurer cela en permanence et en toutes circonstances, mais il faut inciter les opérateurs à descendre au-dessous de 5 UTN. Le concept de « multi-barrières » est pertinent et la clarification est souvent la première de ces barrières destinées à empêcher le passage des micro-organismes dans l’eau.
L’irradiation
Le rayonnement ultraviolet (UV) est employé depuis assez longtemps. Les UV-C sont utilisés car ils correspondent aux pics d’absorption des protéines, de l’ADN, de l’ARN et de toutes les substances biologiques importantes. Mais l’UV-A, comme les UV visibles, est nettement moins efficace, même s’il conserve une action. Le procédé de désinfection solaire (SODIS) repose sur l’utilisation des UV-A parce que les UV-B ou UV-C nécessitent une paroi en quartz. Les UV-C traversent peu le verre ordinaire. Autrement dit, le procédé SODIS revendique l’action des UV-A, qui est beaucoup moins importante que celle des UV-C. Certes, les UV-A réagissent avec l’oxygène dissout pour former des radicaux oxygènes assez réactifs, mais cela à petite échelle. Les UV infrarouges chauffent également l’eau, et si une température de 55 degrés Celsius est atteinte, ce n’est pas mal. Mais cela prend six heures avec 100 % de soleil et deux jours si l’ensoleillement est de 50 à 100 %. Le procédé de désinfection solaire ne peut être employé s’il pleut ou si l’eau est turbide. Les données disponibles dans la littérature ne sont pas très encourageantes. Les résultats ne seront peut-être pas mauvais les premiers temps. Ensuite, le risque est que les flacons dans lesquels l’eau est exposée au soleil, puis conservée avant d’être consommée, ne soient pas utilisés convenablement dans la durée et qu’ils servent à d’autres usages domestiques.
Exposés au rayonnement UV-C, un certain nombre de micro-organismes réagissent selon la loi de Chick-Watson, mais pas tous. On s’accorde à définir une dose d’UV-C en millijoules par centimètre carré qui correspond à la puissance de la lampe en milliwatts par centimètre carré multiplie par le temps en secondes. Le temps de contact devra être déterminé en tenant compte de l’hydraulique des réacteurs. Deux types de lampes sont disponibles. Les lampes à vapeur de mercure, dites à basse pression ; les lampes réalisées à partir d’un mélange de métaux qui remplacent ou complètent le mercure, dites à moyenne pression. Presque toute l’énergie libérée par les lampes à basse pression, à vapeur de mercure, correspond à la zone de longueur d’onde de 250 nanomètres caractérisant les UV-C. Les lampes à basse pression ont une puissance de 70 à 100 watts. Dans le cas des lampes à moyenne pression, une partie de l’énergie emprunte des longueurs d’ondes différentes, ce qui donne un rayonnement beaucoup moins efficace. Elles sont également de grosses consommatrices d’énergie : plusieurs kilowatts. Les lampes à basse pression disponibles sur le marché pour le traitement de l’eau ont été adaptées pour permettre de diminuer le nombre de lampes nécessaires. Les réacteurs pour le rayonnement UV-C sont tubulaires. Plus on s’éloigne de la lampe, plus l’intensité de la radiation diminue. Il faudra donc s’assurer que toutes les parties de l’eau seront suffisamment irradiées. L’eau qui reste à la surface du contenant est peu irradiée. Pour pallier cela, des dispositifs assurant le mélange de l’eau sont utilisés.
Une puissance de 40 millijoules par centimètre carré permet l’élimination de la majorité des micro-organismes. Pour l’hépatite ENote de l’éditeur : selon des données récentes de la littérature, il semblerait que le virus de l’hépatite E ne soit pas détruit à cette puissance. Mais les données à ce sujet sont rares et peu conclusives., je ne sais pas. Les formes sporulées ou kystiques de certains micro-organismes ne sont pas éliminées par les rayonnements UV-C à cette puissance, notamment giardia et cryptosporidium.
En résumé, pour qu’un désinfectant ou un rayonnement détruise un micro-organisme, il faut d’abord qu’il traverse une lame d’eau qui contient de nombreux éléments, des matières organiques mais aussi des métaux comme le fer. L’idéal est qu’un capteur coupe le pompage quand, en raison de la trop grande concentration de particules en suspension dans l’eau, le rayonnement UV qui traverse le réacteur est insuffisant. Ainsi, quand l’eau n’est pas correctement traitée, sa distribution s’arrête automatiquement. Par exemple dans le cas d’un pic de pollution au cours duquel la turbidité de l’eau augmente, entraînant ainsi une diminution du rayonnement sur les micro-organismes. À la différence du chlore, selon les experts, l’irradiation des UV ne produirait pas de sous-produits de dégradation. Par principe, cela est difficile à admettre car dans ce cas le rayonnement serait sans effet sur la matière biologique qu’il touche. De toute façon, la toxicité des sous-produits de dégradation s’exprime sur un temps long qui n’est pas celui du travail des humanitaires, pour lesquels la priorité est de désinfecter l’eau tout de suite.
Dans les grosses stations d’épuration, les UV sont de plus en plus souvent utilisés à la sortie d’une filtration sur sable. En France, nous rajoutons du chlore à la sortie pour obtenir une concentration de 0,5 milligramme par litre. Le chlore affecte le goût de l’eau à partir d’une concentration de 0,2 milligramme par litre.
À l’échelle familiale, il existe de petits appareils qui comportent des filtres sur cartouche qui s’approchent de la microfiltration (5 et 25 microns) suivis d’un dispositif d’irradiation UV, capable de traiter 2,2 mètres cubes par heure à partir d’une eau peu turbide. Le prix sur Internet est de 520 euros avec deux cartouches d’avance et 380 euros pour le détecteur d’irradiation.
La même chaîne de procédés de traitement (microfiltration et UV) peut être utilisée à l’échelle d’une petite usine villageoise ou de la borne-fontaine d’un quartier (filtre à sable, irradiation UV, débit de 150 litres par heure, panneau solaire de 70 watts, coût initial de 3 800 euros, durée de vie estimée à dix ans). L’énergie nécessaire à la production des UV peut être fournie par des panneaux solaires. Si la turbidité de l’eau est importante, on peut préalablement réaliser une clarification rustique, par exemple dans une grosse amphore agitée après l’ajout du coagulant, suivie d’une filtration rudimentaire sur sable. Dans la mesure où le dispositif comprend une filtration avant irradiation, cela peut donner des résultats satisfaisants, d’après ce que j’ai pu voir. Dans ce cas, le problème du mauvais goût de l’eau en rapport avec le chlore est résolu.
L’ultrafiltration
L’espoir initial, avec les membranes, était de pouvoir traiter l’eau sans utiliser de réactifs chimiques. Nous verrons qu’il s’agit d’un vœu pieu. Les membranes sont considérées comme un filtre absolu dont l’efficacité dépend du diamètre des pores. C’est une philosophie, une culture très différente de la filtration sur sable. Un filtre à sable se crève quand tous ses espaces vides sont remplis par les particules ; alors, l’eau coule, mais la filtration a disparu. Cela explique pourquoi et comment de l’eau turbide peut sortir d’un filtre à sable. Avec les membranes, cela n’est pas possible, sauf si elles se cassent. Dans le cas de la filtration sur membrane, plus la turbidité augmente, plus le débit diminue. Pour avoir travaillé avec des exploitants, je dois dire que faire admettre le changement culturel, l’arrêt du débit quand la membrane filtrante est bouchée, n’est pas facile.
IV – LES MEMBRANES
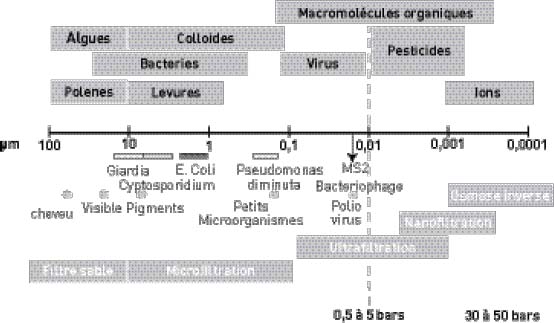
Il ne me viendrait pas à l’esprit de faire de l’osmose inverse pour désinfecter. Il faut en effet entre 30 et 50 bars. En ultrafiltration, 0,5 à 5 bars suffisent. De plus, en osmose inverse et en nanofiltration, vous ne pouvez pas traiter tout le débit et vous éliminez tous les sels minéraux, ce qui n’est pas forcément bon pour la santé. Par le passé, j’ai connu des modules d’osmose inverse qui donnaient de moins bons résultats que la microfiltration, mais cette technique a fait des progrès ces dernières années.
Je vais vous parler des fibres utilisées dans l’ultrafiltration. Il existe deux fabricants en Europe : Aquasource®, en France, et Norit X-Flow®, développé à l’origine en Hollande.
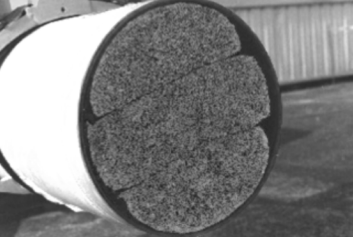
L’eau est envoyée dans un spaghetti qui fait presque un millimètre de diamètre pour une filtration in and out. La pression, 0,5 à 5 bars, permet la diffusion de l’eau à travers les pores. Il existe aussi des membranes qui fonctionnent en sens inverse, out and in, où il faut produire une dépression pour que l’eau traverse les pores. Elles offrent l’avantage de se nettoyer plus facilement. Mais le problème des membranes out an in, comme elles sont libres dans l’eau, est qu’elles doivent être beaucoup plus solides. Elles coûtent plus cher à l’achat et leur débit est moindre.
Les fibres d’ultrafiltration nécessitent d’être collées les unes aux autres, paramètre important, de façon à être étanches. On réalise ainsi des modules dont le diamètre est variable suivant la surface de filtration que l’on veut obtenir. Par exemple, cela peut aller de 7 à 125 mètres carrés par module. Les débits sont de 120 à 150 litres par mètre carré et par heure. Évidemment, plus l’eau est propre, plus le débit est élevé. Au démarrage, la membrane est propre, puis un gâteau se forme et le débit baisse. Quand ce dernier devient trop bas, il faut réaliser un rétrolavage à l’eau propre (backwashing). Au bout d’un certain nombre de semaines ou de mois, le lavage chimique devient obligatoire. Le lavage chimique dépend de la nature de la membrane. Pour du PVDF, un matériau résistant, disons du téflon, mais qui colmate beaucoup, il faut nettoyer à l’acide et à la base. Pour le triacétate de cellulose, une dose de chlore suffit.
Le fait que des installations de grande capacité reposent sur ce procédé indique qu’il est considéré comme fiable.
UNE USINE EN FRANCE, 18 000 MÈTRES CUBES PAR JOUR.

Il existe des appareillages plus simples, sous forme de conteneurs standards, avec différents modules pouvant être installés. Ces installations peuvent atteindre 5 à 25 modules, avec des débits de 30 à 150 mètres cubes par heure. L’un des intérêts des membranes est qu’elles permettent la réalisation d’installations modulables en fonction du débit souhaité.
Il y a deux façons d’utiliser les fibres. Soit on remet l’eau en circulation : cela fonctionne mieux, mais consomme de l’énergie ; soit on fait fonctionner le dispositif en frontal : l’extrémité de la fibre est bouchée et une forte pression est exercée pour que l’eau traverse les pores lors d’un unique passage dans la fibre d’ultrafiltration. Les résultats : selon le fabricant français, l’ultrafiltration élimine 7 logarithmes (99,99999 % des micro-organismes présents au départ) pour les parasites et les bactéries et 6 logarithmes pour les virus.
En conclusion
Aucun des procédés décrits dans cette présentation ne permet d’obtenir le « zéro défaut » car cela n’existe pas. Souvent, l’analyse de la ressource n’est pas réalisée. Par exemple, en France, une entreprise a installé une usine de traitement en aval d’un barrage. Le fonctionnement était satisfaisant. Elle a voulu dupliquer l’installation en installant cette fois l’usine en amont du barrage. Pendant les périodes pluvieuses, la turbidité de l’eau posait problème dans l’usine située en amont du barrage alors qu’en aval ce n’était évidemment pas le cas. Les ressources en amont et en aval du barrage sont différentes et le procédé choisi pour traiter la ressource en aval est dépassé quand la pluie rend l’eau prélevée en amont du barrage plus turbide. En ce qui concerne la distribution et la conservation : l’eau chlorée n’est pas stérile. Dans un récipient contenant de l’eau chlorée, on retrouve 100 000 bactéries, 105, par centimètre carré sur la paroi. Si l’eau n’est pas chlorée, on retrouvera 100 fois plus de bactéries, 107, par centimètre carré sur la paroi.
La pérennité de l’installation et des procédures d’utilisation est un paramètre très important. Malheureusement, leur nature varie tellement d’une installation à l’autre que cela ne permet ni la capitalisation de l’expérience, ni la mutualisation des matériels et des personnels. J’en ai fait l’expérience avec les ONG au Sénégal, où les installations réalisées étaient d’un type différent selon l’ONG. Au bout de deux ans, faute d’un système de contrôle pérenne, la qualité était mauvaise.
QUESTIONS À PROPOS DE L’INTERVENTION DE JOËL MALLEVIALE
François Mansotte
– J’ai trouvé votre présentation très technique. Est-ce qu’il n’y aurait pas intérêt à la compléter par une analyse des types d’installations disponibles suivant l’échelle de population concernée : installation familiale ou collective ? Puis commencer à disqualifier les traitements qui ne sont pas applicables parce qu’ils sont trop chers ou pas assez rustiques, parce qu’ils nécessitent de l’énergie ou des réactifs en grandes quantités. Si on passait tous les systèmes de traitement collectif ou individuel en revue, quels sont ceux qui resteraient ?
Joël Mallevialle
– On m’a demandé une présentation relativement scientifique. Je ne pouvais pas passer en revue tous les prix. Je ne les ai pas tous en tête. Dans ces calculs, il faut considérer l’économie des tâches que permet une installation par rapport à une autre. Puis, suivant le débit que vous demandez, les prix vont aller du simple au double.
Le petit appareil à UV que j’ai présenté en indiquant son prix est un appareil qui est vendu par un homme qui le fabrique dans son garage. Il achète des pièces à droite et à gauche. Et puis il vend son appareil pour traiter l’eau au point de consommation parce que l’eau qui est procurée par ces « cochons de distributeurs d’eau » est mauvaise. Quand je dis « cochons de distributeurs d’eau », cela concerne aussi bien les organismes privés que les organismes publics. L’appareil UV de cette taille fonctionne. L’ultrafiltration à l’échelle familiale se développe. Le problème de ces appareils est la maintenance. Qui s’en occupe ?
François Mansotte
– Si vous voulez, je précise ma question. Elle porte sur un contexte où il n’y a pas forcément d’électricité, où se procurer des batteries, c’est déjà le bout du monde, un contexte très rustique, habituel pour MSF…
Joël Mallevialle
– Plusieurs exemples tirés de ma présentation répondent à la question. Les UV peuvent être alimentés par du solaire. Pour les membranes de filtration, dans les contextes des actions humanitaires, il faut se contenter de la filtration frontale, en bouchant la fibre à son extrémité et en poussant. Le constructeur considère que son installation consomme 100 watts par mètre cube. Cela n’est pas énorme et peut être alimenté par du solaire. Les 100 watts n’englobent ni la consommation du pompage pour arriver à la membrane ni celle du pompage nécessaire à l’alimentation d’un réseau de distribution. Ces deux consommations additionnelles d’énergie peuvent être également couvertes par du solaire.
Jean-Hervé Bradol
– Il me semble que, dans la dernière urgence au Pakistan, nous avons testé la faisabilité de l’usage des membranes à l’échelle familiale, sous la forme d’un jerrycan équipé d’une pompe à main permettant d’exercer une pression suffisante pour le passage de l’eau à travers les pores de la membrane d’ultrafiltration.
Étienne Gignoux
– De nouveaux produits, de nouvelles technologies intéressantes sont disponibles. Nous avons déjà utilisé les UV dans des situations très précaires pour renforcer des systèmes collectifs. Nous découvrons les jerrycans équipés d’une membrane et qui sont actionnables par pression de l’utilisateur.
Jean-Hervé Bradol
– Comment nettoyons-nous les membranes de ces jerrycans ? Faut-il utiliser un produit chimique à un moment ou un autre ?
Étienne Gignoux
– Nous avons fait les tests dans notre centre logistique de Bordeaux. Nous les avons nettoyés à l’eau, tout simplement. Le rétrolavage (backwashing) a été fait manuellement dans un lavabo. Cela pourrait se faire dans le lit d’une rivière. Mais nous n’avons pas encore fait de choix définitif. Aucun matériel ne permet d’espérer un impact sur la qualité de l’eau aussi important que celui qui a été obtenu dans les programmes de nutrition grâce aux nouveaux produits prêts à l’emploi, tel le Plumpy Nut®. On peut aussi se demander si la tentation de résoudre presque tous les problèmes avec un seul objet n’est pas trop forte au sein de MSF.
Joël Mallevialle
– Dans mon expérience professionnelle, le lavage à l’eau fonctionne un certain temps. Et puis il faut autre chose, ou bien changer la membrane. C’est encore plus vrai si l’ultrafiltration est frontale. Imaginez le nettoyage d’une fibre creuse de la taille d’un petit spaghetti, aux parois poreuses !
Étienne Gignoux
– La durée de vie de nos matériels doit correspondre à celle d’une urgence, en imaginant que les gens retournent à une situation antérieure où ils n’aient plus besoin de les utiliser. Par ailleurs, une durée de vie de plusieurs années pourrait avoir un impact sur la santé des jeunes enfants au-delà de l’urgence. Un peu comme dans l’exemple de la distribution de moustiquaires lors d’une urgence ou après une consultation médicale, on peut espérer un bénéfice sanitaire du fait que des familles rentrent à la maison avec un système de traitement de l’eau qui dure un ou deux ans.
Marc Laimé
– N’encourrez-vous pas le risque de céder à, comment dire, une fascination high-tech ? De vous engouffrer dans une espèce de fuite en avant technologique qui rendra encore plus difficile le moment où, effectivement, vous allez quitter le domaine de l’urgence ? Vous allez par hypothèse, pour autant que vous puissiez mobiliser les moyens financiers ou techniques nécessaires, apporter des réponses qui sont vraiment le nec plus ultra aujourd’hui. Quand vous allez partir et que les gens vont devoir retrouver la situation antérieure, le gap sera encore plus violent, encore plus brutal. Comment pensez-vous pouvoir répondre à un gap de ce type ?
Joël Mallevialle
– La présentation que j’ai faite et les modules que j’ai présentés ne sont pas spécialement destinés aux urgences. Je les vois plutôt comme des installations semi-permanentes, c’est-à-dire du provisoire qui va durer quelques années. Ce n’est pas tout à fait de l’urgence. C’est vrai que des modules d’ultrafiltration ont été envoyés en urgence sur différents terrains. Je suis d’accord, le jour où nous partons, il n’y a plus rien. Sinon, on peut essayer de laisser le kit de maintenance, mais cela demande un technicien capable de faire fonctionner le système. L’idéal est que plusieurs villages mutualisent leurs systèmes. À ce moment, cela devient un peu plus viable. Aujourd’hui, c’est considéré comme de la haute technologie car nous n’avons pas l’habitude d’utiliser ces techniques. Mais les rayonnements UV comme les membranes d’ultrafiltration sont d’un fonctionnement relativement simple.
Jean-Hervé Bradol
– Marc Laimé, votre question est un des sujets de la troisième session. Dans notre expérience, nous sommes souvent confrontés à ce problème. Devons-nous atteindre ou non un certain seuil de qualité, par exemple dans le domaine des médicaments anti-infectieux, ou encore dans le domaine de la nutrition, grâce aux nouvelles pâtes thérapeutiques ? Une amélioration de la qualité de l’eau peut permettre d’espérer un effet mesurable, et donc une utilité sociale. Dans l’exemple des médicaments du paludisme, il a fallu passer de quelques dizaines de centimes à plusieurs euros par traitement pour atteindre un certain seuil d’efficacité. Nous avons quand même eu la bonne surprise de voir que ce n’était pas toujours voué à l’échec puisque l’usage de ces nouveaux traitements s’est étendu de manière « pérenne » et leur prix a considérablement baissé, atteignant aujourd’hui la moitié d’un euro pour le traitement d’un enfant. L’introduction d’une nouvelle technique démarre toujours par une évaluation de ce que vous jugez acceptable ou non. Quel nombre de morts et quels types de mort sont-ils acceptables dans des circonstances données ? D’un autre point de vue, quelle est l’importance de l’effort et des risques pour sortir de cette situation ? Quand on commence, la nouvelle pratique paraît toujours difficile à généraliser et à stabiliser. Les premières propositions soulèvent toujours de fortes objections. Dans l’exemple des fameux jerrycans équipés d’une membrane d’ultrafiltration, immédiatement, la question de leur prix élevé, autour de 160 euros, a été présentée comme un obstacle insurmontable par certains de nos collègues. Mais, en travaillant sur les prix, on arrive souvent à les faire évoluer. Par exemple, quand nous avons commencé à vouloir prescrire des antirétroviraux, ils coûtaient autour de 10 000 dollars par an et par patient. Quelques années plus tard, le prix avait été divisé par cent. C’est l’effet qui peut être attendu du traitement politique d’un certain nombre d’obstacles considérés habituellement sous le seul angle technique, sans tenir compte des dynamiques sociales et politiques. Nous nous intéressons à des situations graves, par exemple en raison d’un excès de mortalité des jeunes enfants. Les objectifs en termes de mortalité sont fixés par les États. Nous n’arrivons pas de l’étranger pour dire ce qui doit être fait. Nous étudions les plans nationaux de santé publique des pays concernés. De plus, la filtration, l’irradiation UV sont des procédés qui existent déjà dans les pays où nous travaillons.
Dominique Maison
– D’abord, je commencerai par rappeler ce petit ouvrage d’une fondation néerlandaiseLa fondation NWP Netherlands Water Partnership est un organisme indépendant, établi conjointement par les secteurs public et privé pour servir de point de coordination et d’information national concernant les activités dans le domaine de l’eau aux Pays-Bas et à l’étranger. http://www.nwp.nl/afbeeldingen/WASH/Smart-Disinfections-Solutions.pdf http://www.waterla nd.net/showdownl oad.cfm?objecttype =mark.hive.content objects.download. pdf&objectid=3D5 82856-AA1AD55B-31D0B267 A896B625, qui passe en revue tous les procédés courants. On trouve dans ce document aussi bien le traitement de l’eau contaminée par l’arsenic dont nous avons parlé tout à l’heure avec MDM, si je me souviens bien, qu’une information sur les tablettes pour purifier l’eau. Il répond à la demande de François Mansotte. Les procédés sont classés suivant leur efficacité sur les micro-organismes (bactéries, virus, protozoaires), par rapport au coût unitaire et par rapport à l’échelle de population (le foyer, le village ou l’ensemble d’une région).
Ce petit guide présente un défaut, mais je n’ai malheureusement pas vu mieux jusqu’à présent. Il utilise les données d’efficacité des fabricants. On touche là un autre aspect qui est présent dans l’opération en réponse aux inondations du Pakistan (2010). C’est une bonne illustration du problème posé par certains comportements des fabricants. Ils arrivent et démarchent les organismes d’aide afin de promouvoir des produits pour lesquels il n’existe pas de données solides d’efficacité.
Par ailleurs, je rejoins tout à fait le propos du Pr. Hunter. Le mieux est que les gens s’approprient les moyens qui vont contribuer à l’amélioration de leur état de santé. Il faut prendre en compte le coût de la diffusion de l’information nécessaire à l’appropriation par la population du nouvel équipement. Par exemple, dans le cas du jerrycan à 160 euros, il ne faut pas oublier les 40 euros qui pourraient être nécessaires à la mobilisation sociale, à la compréhension du fonctionnement du matériel par la population.
Il faut également prendre en compte le fonctionnement des circuits locaux de la fourniture d’eau afin de ne pas léser des petits distributeurs ou les petits fabricants, comme à Haïti par exemple. À Port-au-Prince, c’est de l’eau traitée par osmose inverse qui est vendue à la population malgré tout ce que nous venons de dire au sujet de l’efficacité technique et du coût de l’osmose inverse par rapport au gain qu’on peut en attendre.
Je comprends que MSF soit intéressée par un cahier des charges établi pour une durée et pour une efficacité données, ce dont nous avons parlé aujourd’hui. Mais je pense que fractionner, morceler les réflexions sur la question pourrait aboutir à commettre des erreurs sur les terrains. Nous risquons d’être contreproductifs au point de nous exposer aux critiques de la presse à propos des contradictions entre ONG, des interventions peu efficaces et d’un impact sanitaire discutable.
Je pense également que les donateurs doivent prendre leur responsabilité en matière de matériel utilisé sur le terrain et ne pas financer celui qui est inefficace et sans impact sanitaire. Pour terminer, je voudrais souligner l’importance du Water Safety Plan, qui décrit la gestion de l’eau depuis la ressource jusqu’aux consommateurs. Évidemment, le consommateur doit apporter sa contribution à cette gestion.
Jérôme Léglise
– Pour rebondir sur cette dernière intervention, effectivement, la problématique des données produites par les constructeurs est un problème auquel nous devons faire face. Parfois, leurs comportements sont fantaisistes. Les promoteurs du procédé SODIS (solar disinfection) affichent 100 % de réussite !
Parfois, les données n’existent tout simplement pas. Comme dans le cas de l’hépatite E. Au Darfour et au Tchad, nous avons mis en place des systèmes de rayons ultraviolets sans savoir, puisque les données n’existent pas. Les ultraviolets à 254 nanomètres détruisent-ils le virus de l’hépatite E ? Ils sont efficaces contre le virus de l’hépatite A, mais, pour celui de l’hépatite E, la question demeure sans réponse. J’aimerais demander au représentant de l’OMS s’il serait possible d’obtenir des laboratoires de recherche des travaux sur l’hépatite E, qui est une pathologie émergente dans de plus en plus de pays.
AlexandreBrailowsky, médecin, Social Empowerment Director, Suez Environnement
– Je suis un médecin qui a travaillé en entreprise, un collègue de Joël Mallevialle pendant longtemps. Je vais formuler ma question quitte à soulever des réactions diverses. Toutes ces nouvelles technologies sont-elle adaptables à l’humanitaire, à l’urgence, et au développement, qui sont deux cas de figure différents ? Dans quel cadre moral le transfert de technologie pourrait se faire dans une discipline comme l’humanitaire ?
Joël Mallevialle
– Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je voulais donner quelques éléments par rapport à ce qui a été dit avant. On oppose les fabricants aux utilisateurs. Je suis sûr qu’une partie des résultats que j’ai présentés ont été obtenus par des universitaires et non par les fabricants. Les fabricants n’ont pas comme souci de faire quelque chose pour l’humanitaire. Quand une catastrophe se produit (tsunami, Haïti…), les fabricants, les sociétés privées se demandent alors comment montrer qu’ils contribuent à la réponse à la catastrophe. Alors, ils envoient le matériel qu’ils ont. S’il existait une attitude plus constructive de discussion et d’ouverture entre les fabricants et les utilisateurs que vous êtes, vous pourriez aller jusqu’à une collaboration pour le développement de systèmes qui seraient mieux adaptés à vos besoins. La recherche ne va pas changer. Un universitaire qui teste les modules et les membranes peut vous inspirer confiance. Mais le développement du matériel, la baisse des prix, tout cela, vous devez le faire en concertation avec un ou plusieurs fabricants, peu importe.
TROISIÈME SESSION
L’ACCÈS À L’EAU : DIMENSIONS SOCIOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES
Marc Le Pape, Crash, MSF Paris
– Il s’agit maintenant d’examiner ce que les spécialistes appellent la gouvernance de l’eau. Ces questions de gouvernance seront examinées selon deux échelles : l’échelle locale, avec Thierry Ruf, et l’échelle internationale, avec Benoît Miribel.
Ce sera l’occasion d’évoquer les tensions qui peuvent apparaître entre les différents acteurs : entre experts et autorités reconnues localement, entre experts de terrain et experts internationaux producteurs de normes ; tensions aussi entre différentes catégories de la population.
LES ACTEURS DE L’ACCÈS À L’EAU
INTERVENTION DE THIERRY RUF, DIRECTEUR DE RECHERCHE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Enjeux locaux
Pour traiter de la gestion des eaux du point de vue social et institutionnel, je m’appuie sur mon expérience d’agronome et de géographe, observateur des agricultures et des sociétés rurales dans la tradition scientifique de l’agriculture comparée fondée par René Dumont et poursuivie par Marcel Mazoyer et Marc Dufumier à l’Institut national agronomique de Paris-Grignon. Cette approche comparative va au-delà des systèmes agricoles pour s’ouvrir aux secteurs de l’eau potable et de l’eau humanitaire.
D’abord, je traiterai de la gestion sociale de l’eau et de quelques exemples révélateurs des situations de confrontation à propos des ressources ; ensuite, j’évoquerai une histoire particulière permettant d’envisager l’eau comme enjeu social, économique et politique ; puis il sera question des formes possibles de relations entre les acteurs, ensuite d’injustices et enfin de pistes d’action.
La gestion sociale de l’eau
D’une manière générale, dans le développement rural des pays et des petites régions qui les composent, il y a une opposition radicale entre différents types d’usage, notamment entre des modèles de gestion par l’agriculture paysanne familiale et des modèles qui utilisent des technologies bien plus compliquées. Dans les pays du Nord, l’exemple espagnol est très caractéristique de tensions entre ces deux modèles – un modèle familial et un modèle d’entreprise – et d’oppositions liées à l’épuisement des ressources. Dans les pays du Sud, il en existe de nombreux exemples également. En Égypte, on observe cette juxtaposition d’unités qui partagent toutes la même eau, celle du Nil, et dont les fonctionnements obéissent à des logiques très différentes. On le voit aussi dans d’autres exemples, comme en Arabie saoudite et dans la plupart des pays du Proche- et Moyen-Orient.
Aux États-Unis, les plaines centrales sont considérées comme le symbole du développement d’une technologie réputée « économe en eau ». Mais ce modèle y est développé à un tel point qu’on parle d’épuisement complet des nappes d’ici trente ans, y compris d’épuisement des ressources d’eau potable : c’est une dynamique encore plus rapide que dans bien des pays du Sud. Revenons à l’exemple égyptien. La mise en œuvre de modèles économes en eau suppose des capitaux très importants, ces techniques échappent donc en grande partie à la société locale. Celle-ci, cette société de pauvres, se trouve dans une situation où l’eau qui lui reste est une eau en compétition, une eau de la discorde. Les réponses que nous préconisons dans ce cas relèvent d’une approche de l’eau comme un bien commun géré par des associations. C’est la thèse d’Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie 2009, qui a étudié ce type de société.
Ce genre de tensions, nous l’étudions aussi dans d’autres pays, par exemple au Maroc. On y observe des situations où la modernisation de la gestion de l’eau aboutit à ignorer les droits ancestraux des communautés locales, des communautés familiales, et, finalement, à aller à l’encontre de leurs intérêts. La manière de s’en sortir consiste à ne pas traiter ce problème uniquement comme une question technique. Il faut organiser des plates-formes de discussion réunissant l’administration, les associations d’usagers et les chercheurs. Par cette méthode qui s’inspire de la sociologie de l’action collective, nous avons réussi à éviter dans une zone rurale de l’ouest de Marrakech que les tensions ne débouchent sur une guerre locale de l’eau.
L’eau comme enjeu social
J’évoque maintenant l’histoire d’un petit village du sud de la France, où chaque famille avait sa maison et son puits. Un beau jour, l’ensemble des puits du village s’est tari parce que le terroir de ce village (75 % des terres) appartenait à un acteur particulier, une sorte de « latifundiste » (cela ne se passe pas en Amérique latine, mais c’est un peu la même chose) qui avait décidé d’irriguer pratiquement toutes ses terres. En irriguant, il a évidemment prélevé sur la nappe phréatique, abaissé les nappes, asséché les puits des habitants, qui, en outre, travaillaient pour lui. Dans cette situation de conflit, les villageois se sont tournés vers l’État. L’État a adopté une position d’alliance avec les familles afin d’obtenir du grand propriétaire qu’il renonce à utiliser l’un de ses puits pour l’irrigation et qu’il le réserve à la production d’eau potable. Mais l’État a demandé aux familles de payer cet aménagement ; ce sont elles qui ont financé toute l’infrastructure nécessaire à cette transformation. Au final, après une longue confrontation, on aboutit à un arrangement institutionnel où le propriétaire qui avait surexploité l’eau de la nappe se voit finalement être le vendeur d’eau privée à une communauté qui avait payé l’installation de l’infrastructure.
Dans ce village, toutes les étapes de la modernisation des réseaux d’accès à l’eau ont eu lieu, mais on y a manqué le passage par la forme de la coopérative : l’État, au lieu d’aider les gens à s’organiser en association, a restitué finalement le pouvoir de l’eau à la personne qui était à l’origine des problèmes.
Cette histoire correspond à ce qui se passe dans l’ensemble des pays du Sud : un accaparement de l’eau agricole aboutissant à des spoliations pour les agriculteurs (les petits agriculteurs familiaux), mais aussi à des chocs terribles pour l’eau potable et l’eau domestique, puisque les principales conséquences observables sont leur contamination et des raréfactions. L’agriculture familiale est alors critiquée pour sa rusticité, pour son organisation, quand bien même elle n’est pas responsable des logiques qui ont produit ces effets.
Dans cette histoire du petit village français coexistent et entrent en conflit différentes qualifications de l’eau : est-elle un bien public ? Est-ce un bien commun ? Est-ce un bien privé ou est-ce un bien à péage ?
Ce qui nous importe en matière de gestion sociale de l’eau, c’est de réfléchir à la notion de bien commun. Elinor Ostrom a défini huit principes pour gérer de façon durable les ressources ; ils sont applicables à la gestion de l’eau. Il faut d’abord que la population trouve une raison de participer à un processus de traitement d’eau et de s’engager dans un processus de partage d’eau ; il faut donc qu’elle tire du système participatif des avantages proportionnels aux coûts assumés.
Il faut aussi faire des choix collectifs, et il me semble que, dans les interventions humanitaires, cette règle n’est pas mise en œuvre autant qu’il serait souhaitable. Des négociations sont entreprises pour savoir si l’eau va être distribuée de façon continue, discontinue, avec des tours, etc. Il faut laisser aux gens des marges de manœuvre pour pouvoir agir.
Ensuite, il faut élaborer des principes de supervision et de surveillance par les propres acteurs locaux, utilisateurs de l’eau. En outre, la notion de justice, de tribunal des eaux, est très importante dans cette approche. Il y a en effet des incidents, des accidents et des vols, avec un système de sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles communes.
Mais il ne suffit pas d’avoir des règles, il faut encore les faire vivre, donc il faut des instances locales qui veillent à leur application, en même temps qu’une reconnaissance de celles-ci par l’État – cela est surtout valable pour l’agriculture, mais aussi pour l’eau domestique et l’eau potable.
Ce que nous constatons à l’échelon local, c’est que jamais les lois modernes ne sont vraiment les référents absolus ; les institutions locales de l’eau se construisent à partir de l’apprentissage, à partir d’essais et d’erreurs, à partir d’une histoire souvent très riche. Quand on intervient en situation d’urgence, c’est un problème : on ne connaît pas l’histoire du milieu où l’on agit. Peut-être y aurait-il alors urgence à recourir à un « sociologue opérationnel » – je ne sais pas s’il faut le nommer ainsi : il s’agit d’une personne qui s’efforcerait de caractériser le contexte et de situer les problèmes qui peuvent se poser.
D’une manière assez générale, les tensions que connaissent les institutions locales proviennent de plusieurs dynamiques. Il y a, d’une part, l’histoire longue des jeux politiques, des contrôles de territoire, des luttes d’influence, des transformations sociologiques. Mais il y a aussi des divergences actuelles d’intérêt dans la société locale : celle-ci n’est jamais homogène, elle est le lieu de discriminations très fortes. Aussi, des conventions qui étaient acceptées et adaptées lors d’une période plus ancienne peuvent souvent ne plus l’être au moment de l’intervention. Il faut en outre reconnaître la difficulté d’organiser un dialogue entre tous les acteurs, privés, publics et communautaires. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque le pouvoir politique s’affirme maître des eaux en présentant la domanialité de l’eau comme une nécessité tout en reconnaissant un principe de subsidiarité selon lequel l’eau est de gestion locale. Là, on voit tout de suite qu’il y aura des frictions pour savoir quel est l’acteur qui a le plus de légitimité à décider de l’allocation de l’eau : est-ce l’État, est-ce la communauté ou l’instance locale ?
Il reste qu’entre ces composantes se nouent des équilibres. Ces équilibres s’établissent selon des modalités variables : la gestion des ressources de l’eau peut être perçue comme une arène dans laquelle la coopération va s’établir entre des communautés locales, des services de l’État et des acteurs privés. Ce qui ne va pas de soi car, d’une part, les communautés rurales sont différenciées, d’autre part, l’intérêt public est confronté au clientélisme et à la corruption, enfin, les acteurs privés sont eux aussi très hétérogènes, en raison de différences et de divergences de points de vue et d’intérêts.
Plusieurs arrangements sont possibles. Il y a par exemple la forme d’équilibre propre à « l’école française de l’eau » : c’est un modèle où l’État s’estime propriétaire des ressources et délègue à une autorité de droit privé qui passe un contrat avec un client. Il y a aussi la formule très opposée de la gestion centralisée étatique, qui a sévi dans de nombreux pays et lieux au nord comme au sud, même si ce n’est pas ce qui est le plus en vogue actuellement.
En fait, la gestion de l’eau est toujours très compliquée. Je vais encore ajouter une complication liée au fait que les territoires de l’administration de l’eau sont toujours décalés. Décalages entre les pouvoirs qui s’exercent au niveau d’une province ou d’un gouvernement, au niveau d’un bassin versant et au niveau d’une zone d’utilisation concrète de l’eau, décalages entre les pouvoirs autour d’une nappe, autour d’un bassin, autour d’une zone d’usage. C’est l’un des grands défis. Les gens parlent d’infrastructures, mais ils ne parlent pas de la même chose, ni du même territoire, ni des mêmes zones, ni des mêmes réseaux.
Les formes possibles de relations entre acteurs
Essayons de modéliser les relations entre différents acteurs. Souvent, quand on traite de ressources, on parle de planification et de privatisation. On oppose les secteurs privés et les secteurs de l’État, en oubliant un peu que, de toute façon, l’équilibre politique dépend aussi des communautés urbaines et rurales. En général, les gens ne veulent ni une soumission complète à l’État ni une dépendance totale à la privatisation ; en conséquence, une sorte d’équilibre s’établit. Ce que l’on considère moins, c’est le rapport entre la démocratie et le populisme, entre l’État et les citoyens.
Il faut aussi que soit géré l’équilibre entre pouvoir central et mise en œuvre de la subsidiarité. Il faut alors prendre en compte l’influence exercée par les secteurs économiques : ceux-ci ne veulent ni d’une dépendance totale à l’État, ni d’un marché totalement éclaté par des principautés ou des féodalités locales. Dans la recherche d’équilibre interviennent en outre des services publics qui agissent en appliquant un modèle politique de régulation, un modèle social de précaution.
En fait, la gestion d’une ressource comme l’eau devrait être de l’ordre d’un compromis social, complexe, où toutes ces forces (populisme, démocratie, paternalisme, privatisation et planification) s’équilibrent autour des valeurs de l’équité, de la régulation et de l’efficacité. Or nous constatons en agriculture (mais cela concerne peut-être aussi la gouvernance de l’eau humanitaire) que les modèles d’intervention sont généralement très loin de ce compromis : les modèles sont soit très dirigistes, soit populistes, soit attachés à la privatisation et à l’efficacité du marché comme producteur d’équilibres (c’est le cas des modèles préconisés par la Banque mondiale et le FMI). Quant au modèle populiste, il tend à surestimer les capacités locales d’organisation lorsqu’il considère que l’eau ne peut être gérée qu’à l’échelle très locale, sans coordination, sans régulation publique et sans recherche d’efficacité économique.
La démarche que nous proposons vise simplement à ce que les acteurs composent entre eux et discutent des questions techniques, sociales, institutionnelles en se mettant dans une situation d’équilibre où il n’y a pas de dominant : ce n’est pas l’État qui domine le local, ce n’est pas le local qui domine l’agent de l’État ou le secteur privé, il s’agit de recourir à une sorte de plateforme de discussion, de négociation des problèmes.
Je complique encore. Évidemment, ce schéma est simple par rapport à la réalité que chacun vit quand il intervient dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord. Dans chaque pôle, les communautés locales, l’État, le secteur privé, on observe des désaccords entre acteurs, l’absence de vision commune, des résistances aux compromis. Le monde de l’eau est un monde où se confrontent des coalitions composées chacune d’éléments de la communauté rurale, de l’État et des secteurs privés.
Les injustices
Encore un témoignage qui est lié à un programme de recherche et d’échange entre des universitaires, des agents d’États, des communautés organisées de paysans à propos de l’eau dans les pays méditerranéens. Les conclusions de ce programme euro-méditerranéen relèvent des injustices et, en même temps, livrent des pistes d’action.
Les injustices, dans les cas urbains comme dans les situations rurales, tiennent, en premier lieu, à ce que l’on ne prend pas en compte l’histoire ancienne des systèmes de captation. On ne voit pas la coexistence de systèmes de captation d’eau agricole ou d’eau potable anciens et modernes. On n’intègre pas cette complexité historique. C’est la première injustice, l’ignorance des savoirs locaux et l’absence de considération pour les conceptions des gens attachés à leurs droits d’eau et à leurs modes de résolution d’un certain nombre de conflits. Une deuxième conclusion du programme de recherche porte sur l’ensemble des eaux brutes et des eaux potables, et sur tout ce qui touche aux colatures et à l’évacuation des eaux agricoles ou des eaux urbaines : il n’est généralement pas tenu compte de la géographie des territoires, de l’organisation des espaces ; en outre, les citoyens ne sont pas informés de l’origine de l’eau, agricole ou urbaine. Dans le domaine de l’action humanitaire pour l’eau, la question ne peut se limiter à installer et mettre en marche une machine qui va traiter ou distribuer l’eau. Il faut comprendre d’où vient l’eau : de quel réseau fait-elle partie ? Quels sont les territoires connectés à cette circulation de l’eau ? Est-elle souterraine, est-elle de la montagne, est-elle pure, impure… ? Ne pas informer les gens est un manquement majeur qui existe dans les trois champs de la gestion des eaux, l’irrigation, l’eau potable, l’eau humanitaire.
Troisième injustice : les intervenants sur le plan local font abstraction des disparités sociales (et il y en a beaucoup), des différenciations religieuses, politiques, sociales, etc. Il faudrait en tenir compte. On peut aussi constater que, dans le débat mondial sur l’eau, la question des femmes a été souvent mise en avant : le troisième principe adopté à Dublin, en 1992, lors de la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement, reconnaissait leur rôle primordial dans « l’approvisionnement, la gestion et la préservation de l’eau ». Du coup, la question sociale en tant que telle est un peu caricaturale : on a concentré la question sur une seule des dimensions de l’exclusion.
Dernière injustice : les institutions intermédiaires sont très mal reconnues par les États. Dans le cas de l’eau humanitaire, j’ai l’impression que c’est peut-être là que le bât blesse, alors qu’on a besoin, au moment de l’intervention, d’une structure qui se crée, d’une institution qui fixe des règles ; c’est quelque chose qui doit accompagner l’installation et ne pas venir trois semaines après, deux mois après, trois ans après, alors que le dispositif technique est défaillant.
Les pistes d’action
En premier lieu, une mutualisation des connaissances est nécessaire, fondée sur de véritables expériences de terrain. En deuxième lieu, il est tout à fait important que les États clarifient les périmètres d’intervention collective. Sinon il y aura des free riders, des personnes qui s’insèrent dans le réseau et qui ne participeront pas au processus collectif de la manière souhaitable. Troisième élément, l’établissement des règlements intérieurs : il doit être libre et concerté pour aboutir à des textes originaux ; cette démarche est à chaque fois locale, car il n’y aura jamais un modèle qui s’appliquerait à toutes les situations. Quatrième élément : il est bon de fédérer les structures techniques mais aussi d’instituer une sorte de tribunal des eaux afin de construire un suivi des conflits et une jurisprudence acceptée. Enfin (et pour l’eau humanitaire, c’est évidemment un dilemme énorme), il faut beaucoup de temps pour que ces choses soient mises en place. Évidemment, il y a là, dans certains cas, une sorte d’impossibilité. Je crois cependant qu’il faut s’efforcer de mettre en place ces institutions locales viables.
Il faut en outre agréger l’action locale à d’autres échelles. Il faut a minima l’agréger à une échelle provinciale, afin que les expériences locales ne restent ni isolées ni oubliées et contribuent au renforcement des citoyens organisés dans le but de réguler la gestion des eaux. J’ajoute qu’il est nécessaire de ne pas opposer l’eau potable et l’eau agricole, mais de les associer en favorisant les pratiques interinstitutionnelles, les rencontres, l’utilisation de langues adaptées.
Tout cela est évidemment d’une très grande complexité. Il faut être d’autant plus modeste que l’ensemble des problèmes sont interconnectés. Les milieux, la nature, l’agriculture, le climat, les eaux, le marché, la société, les questions de santé sont liés. Dans la mesure où ils travaillent avec les acteurs de terrain, les scientifiques ont encore beaucoup de pain sur la planche pour résoudre l’ensemble des questions liées aux interactions entre ces huit éléments. Merci.
Marc Le Pape
– Merci beaucoup d’avoir complexifié le problème et évoqué l’utilité de la sociologie. Je me posais la question de savoir, par rapport à ce que vous avez décrit, quel était le modèle de gestion de l’eau le plus pratiqué par MSF. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c’est le modèle dirigiste. On pourra sans doute en discuter. Nous allons aborder tout de suite la deuxième échelle d’observation car il serait intéressant que la discussion porte sur l’articulation entre les différentes arènes de débats et d’opérations, à toutes les échelles.
L’ACCÈS À L’EAU : DÉBATS TRANSNATIONAUX
INTERVENTION DE BENOÎT MIRIBEL, PRÉSIDENT D’ACTION CONTRE LA FAIM
Je suis très heureux d’avoir été invité à intervenir ici pour vous parler d’une expérience et d’une réflexion, toujours en cours au sein d’ACF, à propos des débats internationaux sur l’eau, et notamment sur le droit à l’eau.
Pourquoi se lancer dans ces débats ? Je vais évoquer les enjeux du droit à l’eau, au-delà de la déclaration des Nations unies du 28 juillet 2010 sur « le droit à une eau potable salubre et propre » et de sa validation en septembre 2010 par le Conseil des droits de l’homme. Le droit à l’eau et à l’assainissement a donc rejoint les droits de l’homme. Maintenant, il faut, comme pour tous les droits, voir l’application.
Je précise que je ne suis pas le seul d’ACF présent aujourd’hui. Nous avons des anciens d’ACF, bien sûr et, en exercice, Jean Lapègue, responsable ACF de l’eau et de l’assainissement, ainsi que Jean-François Lamoureux, notre vice-président, et d’autres responsables opérationnels. Comment organisons-nous la gestion de l’eau dans les contextes où nous intervenons ? Comment, par exemple, s’organise la gestion des ouvrages d’eau que nous avons réalisés, forages ou autres, en Birmanie, dans les régions du site Weh où nous intervenons chez les Rohingyas qui ont été chassés du Bangladesh ? Selon les contextes, d’un continent à l’autre et d’un puits à l’autre, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Ainsi, en Birmanie, on voit que le chef du village veut absolument le forage à côté de sa maison ; hors de question qu’on le mette ailleurs. On sait par expérience que, pour avoir une bonne maintenance et une bonne pratique, il faut une appropriation par la population. Avant de mettre en œuvre le programme, nous avons donc cherché à voir, par des discussions dans le village, où placer le point d’eau, où le situer en tenant compte des besoins communautaires : ce n’était pas forcément là où le voulait le responsable du village. ACF a en outre développé des comités de gestion de l’eau. Cet exemple montre que, lors de nos interventions, nous ne nous limitons pas à faire un forage, un captage de source ou un réseau gravitaire ; la question qui est posée est aussi celle de l’appropriation par les populations et de la réponse à leurs besoins. Le besoin d’eau, on y répond aussi bien sûr s’il y a des situations d’urgence. Ces réponses doivent-elles, même dans les situations d’urgence, prendre en compte la notion de pérennité ? C’est le cas, si l’on admet que la pérennité répond à une finalité, à un besoin.
Quand on passe du niveau local au niveau national, d’autres enjeux apparaissent. Est-ce que nous cherchons à rendre pérennes ou non nos actions en contexte humanitaire ? Il y a des contextes où l’on sait très bien qu’il n’y a pas de pérennité. C’est le cas aujourd’hui en Somalie : ceux qui interviennent en Somalie savent qu’il n’y a pas de pérennité possible. Néanmoins, on essaie malgré tout d’anticiper, comme si la pérennité allait devenir possible. De manière générale, nous considérons que nous avons le « devoir » ou la responsabilité de rechercher la pérennité, pour autant que cela réponde à une adhésion des populations.
Une autre question nous est posée par les Objectifs du millénaire. En effet, certaines entreprises multinationales se sont emparées de ces objectifs ; reprenant des termes utilisés dans le milieu environnemental, elles disent : « Oui, il faut que les gens aient accès à l’eau, etc. » Nous nous sommes dit qu’il fallait discuter avec ces entreprises pour confronter leur vision et la nôtre. Dans de nombreuses réunions, nous avons dû débattre des chiffres retenus pour les Objectifs du millénaire. En effet, les Objectifs, ce sont des chiffres : il s’agit de réduire de moitié le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement.
La problématique des chiffres a été évoquée lors d’un colloque sur l’eau et la santé que la Fondation Mérieux a organisé en mars 2010 ; l’un des intervenants a rappelé les différences entre les chiffres d’ingénieurs de la Banque mondiale et ceux de médecins de l’OMS : ce ne sont pas du tout les mêmes. Je reviens aux Objectifs du millénaire : dans quelque temps, on présentera des chiffres attestant que l’objectif, « réduire de moitié », a été atteint, car, au Maghreb, en Chine et dans certaines zones, des populations auront accédé à l’eau. Pour notre part, nous considérons que notre responsabilité est d’abord de nous assurer que les plus vulnérables ont accès à l’eau, alors même qu’ils ne sont pas toujours touchés par les programmes actuellement lancés par les Nations unies ou soutenus par des entreprises. Autrement dit, l’annonce de chiffres sur la réduction du nombre de ceux qui n’ont pas accès à l’eau ne fait pas état des disparités dont pâtissent les plus vulnérables. Pourra-t-on se satisfaire, dans quelques années, de dire « regardez, on a globalement amélioré les chiffres d’accès à l’eau sur la planète » ? Nous estimons qu’il faut aussi s’attacher aux facteurs de vulnérabilité et de qualité, c’est-à-dire ne pas se limiter uniquement à des chiffres. C’est dans ce type de débats que nous nous sommes invités lors de tables rondes avec des entreprises : celles-ci montrent qu’elles pourraient contribuer à leur façon aux Objectifs du millénaire et répondre à cet enjeu si les gouvernements et les bailleurs leur en donnaient les moyens. Notre devoir, en tant qu’ONG, c’est de dire : « Attention ! D’accord, mais dans quels pays, pour quelles populations ? » « L’accès à l’eau, c’est quoi d’abord ? » L’accès, est-ce à domicile au robinet ou est-ce une pompe accessible, etc. ? Quand vous parlez d’accès à l’eau, de quoi s’agit-il ? Chacun peut-il s’emparer de la problématique ou y a-t-il une base légale chaque fois ? Quelle est la responsabilité du pays concerné ? Au niveau international, quid du droit à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ? Et je n’aborde pas le débat sur les définitions et les normes OMS. Philippe Hartmann, grand spécialiste des normes de l’eau, explique que, finalement, l’eau pure n’existe pas en tant que telle d’un point de vue biologique, mais que c’est un ensemble de normes que se donne un État. Chaque fois que nous nous sommes invités à ces débats, différents acteurs, voyant une volonté des États et une ouverture internationale, s’emparaient aussi de ces questions avec des enjeux presque identiques aux nôtres : « Oui, nous aussi, nous allons donner l’accès à l’eau, on va faire cela ; de quelle façon le faire ? » Dans les années 1990 – je vais caricaturer un peu –, les équipes eau et assainissement d’ACF étaient plutôt concentrées sur le développement technique. Par exemple lors de l’élaboration d’une foreuse avec les Thaïlandais, la PAT. Cela a progressé – d’ailleurs, Jean-Michel Vouillamoz, qui dirigeait le service eau et assainissement, a fait sa thèse sur la résonance magnétique nucléaire pour essayer de sonder l’eau avant de faire un forage qui pourrait s’avérer vain. À cette époque, nous avons beaucoup progressé au niveau technique et des compétences. Et, dans les années 2000, ACF aborde ces questions de positionnement. Voyant l’importance que prend le Forum mondial de l’eau, je suis allé à Mexico en 2006. Certains ACF disaient : « Vous all ez vous balader à Mexico. À quoi cela sert-il ? » Effectivement, je voulais voir ce qu’était le Forum de l’eau. Nous considérions que nous avions une responsabilité, nous aussi, les ONG, celle de faire entendre notre expérience et notre voix, en nous référant à nos contextes d’intervention. C’est un peu une foire ; on l’a vu encore à Istanbul où se trouvaient beaucoup de marchands d’eau, de techniques. Finalement, des ONG doivent-elles y être présentes ou pas ? Pour faire passer quels messages ? Chaque fois, ce sont des questionnements.
Une évolution est visible dans les années 1990, avec ces débats sur la gouvernance, sur les politiques néolibérales. Des chercheurs ont aussi évolué dans leurs définitions et par rapport aux questions économiques et sociales liées à l’eau. Se pose alors la question de l’eau gratuite. L’eau est-elle gratuite ? Oui, l’eau est gratuite. La question, c’est : « Qui paie le fait que l’eau est rendue accessible, soit par un bidon d’eau, soit par un robinet ? » L’eau est gratuite comme le soleil, elle est là, elle existe… il peut pleuvoir. Mais, demain, quelqu’un peut rendre le soleil payant si l’on est coincé et que ce quelqu’un se met à dire : « Pour le soleil, vous allez sur la terrasse, c’est payant » ; du coup, l’accès au soleil sera payant même si le soleil en tant que tel est gratuit. Danielle Mitterrand dit que l’eau doit être gratuite, mais, de toute façon, l’eau est gratuite ; la question, c’est : « Qui couvre le coût d’exploitation de l’eau ? » C’est sur ce point que portent les enjeux par rapport aux populations vulnérables.
L’accès à l’eau dans les milieux urbains est une problématique sur laquelle ACF a progressé au cours des années 2000 : nous savons en effet que la population vulnérable vivant dans les villes devient et continuera de devenir de plus en plus nombreuse. On observe que l’accès aux réseaux de distribution intègre les personnes, cela a été souligné par des sociologues. Les personnes se sentent exister parce qu’elles reçoivent une « facture » (c’est un autre débat de savoir quel est le montant de la facture, qui soutient ou pas). On l’a vu dans des grandes villes, dans des mégapoles, en Afrique, c’est souligné dans de nombreux articles. On voit que l’eau est un enjeu aussi social, au-delà de la santé, au-delà des aspects qu’on évoque plus régulièrement.
J’ai évoqué les acteurs qui se mobilisent dans ces débats, les bailleurs qui considèrent que cela fait partie de leurs stratégies, les entreprises qui s’en emparent aussi et demandent des fonds pour leurs chantiers d’accès à l’eau dans les pays en développement. Ce n’est pas forcément négatif, mais dans quels contextes ces stratégies vont-elles être mises en œuvre ? Comment sont décidées les attributions de fonds ? Et les ONG de terrain doivent-elles s’engager dans le plaidoyer sur ces questions ? Faut-il rester en dehors parce que ce n’est pas notre domaine, que nous sommes des humanitaires, que nous faisons notre travail et que ça s’arrête là ? Ou bien doit-on intervenir dans ces réflexions parce que cela touche aux droits de l’homme et au principe de responsabilité, parce que c’est aussi se soucier de la dignité des populations, se préoccuper de faire entendre leurs droits ?
Finalement, qu’est-ce que le droit à l’eau ? Il est lié à la déclaration des droits de l’homme sous diverses formes et, le 28 juillet 2010, à la demande de la Bolivie, le « droit à une eau potable salubre et propre » est devenu, pour les Nations unies, un « droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». C’est aussi un aspect du droit humanitaire ; celui-ci considère les réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation comme des biens indispensables à la survie et protégés à ce titre. Bien sûr, audelà du droit, il reste beaucoup d’autres questions et enjeux. En particulier la question de l’accès : l’eau gratuite mais inaccessible financièrement, c’est la question. Il ne faut pas que le droit à l’eau vienne écraser d’autres droits, ce qui n’est pas simple.
On doit aussi considérer la question de la gouvernance locale, que Thierry Ruf vient d’évoquer. Il existe beaucoup de domaines où l’État n’est pas en mesure ou capable d’intervenir, où des partenariats entre public et privé sont nécessaires, mais une responsabilité publique par rapport aux enjeux de dépendance ou de non-dépendance est quand même nécessaire. Il arrive en effet que l’accès à l’eau soit effectif durant un temps limité parce qu’un bailleur y contribue ; deux ou trois ans après, les personnes raccordées sont assommées de factures et dans l’impossibilité de payer. On observe aussi, dans beaucoup de villes, des trafics, une économie parallèle profitant de l’eau. L’impact social et économique local doit être pris en compte, nous devons le faire en tant qu’ONG humanitaire impliquée dans ces contextes.
Mon intervention a été l’occasion de vous montrer que ce débat sur le droit à l’eau reste d’actualité au sein d’ACF. Avant que je sois élu président, en juin 2010, un conseil d’administration a eu lieu, et il n’a pas vraiment adhéré à l’engagement dans le débat du droit ; schématiquement, l’argument du CA était le suivant : « Ce n’est pas votre job d’aller là-dessus. L’opérationnel sur le terrain, c’est là-dessus que vous devez vous concentrer. » Est-ce parce que l’on veut en faire plus sur le plan opérationnel que l’on n’a pas pour autant à s’inviter dans ce débat, y apporter des connaissances du terrain, dans l’intérêt des populations et en particulier des populations vulnérables ? Évidemment, ce serait un danger pour ACF de changer de métier et de se placer uniquement sur le terrain du droit. Mais dans quelle mesure ? Tout en étant de plus en plus efficace opérationnellement, avec des moyens techniques performants, des modes de gouvernance des ouvrages d’eau mis au point sur des années, n’aurions-nous pas à nous intéresser aussi à ces questions d’eau beaucoup plus globales dont d’autres acteurs s’emparent ? La question reste ouverte au sein d’ACF et elle sera traitée dans les CA. C’était l’occasion de l’évoquer avec vous.
DÉBATS À PROPOS DES INTERVENTIONS DE THIERRY RUF ET BENOÎT MIRIBEL
Jean Lapégue
– Quelques remarques à propos du droit à l’eau. D’abord, je trouve rafraîchissant que, dans la sphère humanitaire, soient évoqués des problèmes de droit et de gouvernance. C’est non seulement rafraîchissant, mais nécessaire. En effet, si l’on s’en tient aux Objectifs du millénaire, en termes de couverture en eau, nous savons que 886 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau et que 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à l’assainissement. En tant qu’humanitaires, nous pouvons donc déjà nous poser la question suivante : ce n’est pas avec des programmes classiques tels que nous les avons développés pendant vingt-cinq années chez ACF que nous allons enrayer ce problème.
À ACF, par exemple, nous apportons de l’eau à 1 million de personnes par an, c’est notre « chiffre d’affaires ». Il est évident que c’est une goutte d’eau absolument microscopique face au problème. C’est une première remarque.
La deuxième remarque concerne le CA d’ACF. Je pense que le CA s’est positionné sur un problème de plaidoyer. Il est vrai que, lorsque l’on commence à toucher au droit, l’on s’engage dans des sphères internationales. Nous-mêmes, nous avons été présents au Parlement européen pour défendre le droit à l’eau, évidemment – comme le disait Benoît Miribel – pour défendre l’accès des plus vulnérables à la ressource. Dès que l’on se met à toucher à ces éléments, on sort un peu de notre sacro-sainte neutralité pour aller se mouiller avec des grandes entreprises et avec des politiques. Là, cela concerne l’essence même de l’humanitaire. En fait, nous sommes dans un paradigme : sommes-nous dans une approche interventionniste, mettons-nous des pansements sur des jambes de bois ou essayons-nous de travailler en profondeur, en particulier sur la gouvernance des États ? La décision que nous avions prise depuis Mexico était de travailler sur la gouvernance et d’essayer de faire avancer les États dans cette réflexion. Il se trouve que les décisions qui ont été prises aux Nations unies en juillet 2010, et qui ont été corroborées par le Conseil des droits de l’homme en septembre, montrent que, maintenant, la question ne se pose plus. Le droit à l’eau est effectif et nous n’en sommes plus, à ACF, à nous poser cette question : faut-il ou non le défendre ? Il n’a pas à être défendu, il existe. Maintenant, qu’allons-nous faire pour l’appliquer, en sachant qu’il concerne essentiellement des populations urbaines et des populations vulnérables ? Voilà un point qu’il est, je pense, important de soulever aussi.
Par rapport au droit à l’eau, d’un point de vue pratique, sur le terrain, j’ai deux expériences. Lors de la dernière guerre en Palestine, durant les bombardements israéliens, ACF apportait de l’eau à 50 000 personnes dans la bande de Gaza. En parallèle, avec les Nations unies et avec les bailleurs, nous étions réunis à Amman, en Jordanie, pour travailler sur le droit international à l’eau en situation de guerre. Comme Benoît Miribel l’a rappelé, le droit à l’eau n’est pas une problématique de développement, c’est également une problématique humanitaire. Le DIH traite du droit à l’eau en de multiples points. En tant qu’humanitaires, il ne faut pas nous protéger en disant que ce sont des problématiques de développement ; ce n’est pas vrai. Cela touche également à la sphère humanitaire pure. Voilà un premier point important.
La deuxième expérience concerne notre travail récent en Côte d’Ivoire dans des bidonvilles, en particulier à San Pedro. En fait, là, nous touchons au problème du prix de l’eau et à la vulnérabilité urbaine. Lorsque vous travaillez en milieu urbain et périurbain, l’eau a un prix et cette facture est ou n’est pas assumée par la population. Des mécanismes de régulation existent, ce sont les péréquations sur le prix de l’eau. Travailler en milieu urbain, c’est également travailler avec les institutions, donc avec le gouvernement et avec les compagnies d’eau, sur la notion de vulnérabilité urbaine ; à partir de quel moment une famille doit-elle être soutenue pour avoir accès à l’eau ?
En fait, travailler sur le droit à l’eau, aujourd’hui, en milieu urbain, c’est travailler sur le prix de la ressource et sur des mécanismes de support et de facilitation de l’accès à ces services de base pour les populations les plus vulnérables.
Rony Brauman
– J’ai un commentaire, mais juste pour le goût de la discussion, car je pense que, si nous insistons trop dans cette direction, nous allons nous éloigner de l’axe de la journée.
Mon commentaire est que l’eau est d’abord un besoin : un besoin physiologique, un besoin vital, et il me semble que la confusion entre droit et besoin est plutôt une source d’« embrouillamini » qu’un éclairage. Je pense que les ONG, contrairement à ce qui a été dit, sont enthousiastes à l’idée d’adopter et de s’approprier le lexique des droits. Depuis vingt ans, nous avons assisté à l’empilement infini des droits : droit à l’eau, droit au développement, droit à l’environnement, droit à la culture, etc. Je ne pense pas du tout que ce soit une approche productive. La question n’est donc pas de savoir si une ONG humanitaire doit ou non s’embarquer dans le domaine des droits ; cette question ne me semble pas éclairante. La question est plutôt de savoir jusqu’où l’on empile des droits et à quel point cela éclaire. J’y vois plutôt une source de confusion.
Par ailleurs, que le Conseil des droits de l’homme ait adopté cette résolution, c’est tout de même assez risible. Le Conseil des droits de l’homme est le syndicat des dictatures. Que ses membres aient adopté un droit supplémentaire n’est rien d’autre que du talent rhétorique, cela n’a absolument aucune signification politique. Ce propos était ce que j’appelais « pour le goût de la discussion », mais ce n’est pas forcément lié directement au sujet.
Thierry Ruf
– Je voudrais commenter la question de la gratuité de l’eau. Je voudrais en débattre parce que j’ai plusieurs exemples de discussions dures avec des gens qui m’ont dit : « Ce n’est pas normal que les paysans égyptiens ne payent pas l’eau, ils ont l’eau gratuite. » Les paysans égyptiens ont payé trois fois les infrastructures qu’ils utilisent aujourd’hui. Au XIXe siècle, ce sont eux, par la corvée, qui ont creusé tous les canaux d’irrigation. On a fait des canaux, dans une économie coloniale, afin de produire du coton pour l’Europe. Ensuite, l’Égypte a eu une dette publique qu’elle n’a pas pu payer. Donc, en 1870, nous sommes intervenus de façon coloniale. Il y a eu des ministres européens, il y a eu une conquête. Pendant quarantecinq ans, jusqu’en 1914, ils ont payé par le coton monétarisé, ils ont repayé à la fois la dette accumulée et les infrastructures modernisées de barrages qui ont été faits à l’époque coloniale. Ensuite, ils ont payé, sous Nasser, le barrage d’Assouan, puisqu’ils ont produit du coton pour les Soviétiques. Finalement, tout ce que nous voyons aujourd’hui en infrastructures a été payé par les paysans, et ils le savent très bien.
Le ministre de l’Irrigation, bien que membre du Conseil mondial de l’eau, qui a véhiculé l’idée d’une approche un peu nouvelle du paiement de l’eau, etc. n’a jamais appliqué cela à son pays, parce que les conditions historiques et sociales ne le permettent pas. Je veux dire par là que l’Égypte a trouvé une solution, c’est-à-dire que l’eau n’est pas facturée, les paysans ont la maîtrise de l’eau locale avec le pompage. Ils fournissent une production alimentaire et une production à l’État. L’État se paie donc indirectement et paie indirectement la maintenance. C’est une organisation de l’économie de l’eau qui ne passe pas par l’individu payant une facture. L’individu payant une facture d’eau, cela existe dans d’autres sociétés, c’est admis socialement, cela peut être développé, mais ce n’est pas la vision de tous.
La conférence de Dublin, en 1992, a donné le départ des grandes conférences mondiales de l’eau et a indiqué que l’eau est un bien économique. Eh bien, à Dublin, l’eau potable est gratuite. Au XIXe siècle, la ville de Dublin a choisi une modalité d’équipement : l’impôt sur les bâtiments allait payer les infrastructures et le fonctionnement, il n’y aurait pas de compteurs. Vous avez donc une société qui vit avec de l’eau gratuite, mais pas tout à fait. Bien sûr, il y a des charges, il y a des coûts, et tout cela est assumé. Il faut regarder comment fonctionne le local, il y a différentes formules. La formule d’une gestion volumétrique avec un compteur n’est pas universelle, à mon avis.
Alexandre Brailowsky
– Je voudrais intervenir à propos des Objectifs du millénaire. Si j’ai bien compris lorsque j’étais à Stockholm, les progrès dans certains pays vont permettre d’annoncer des chiffres plus ou moins présentables mais, dans le même temps, si nous les envisageons par continent ou par pays, ils sont beaucoup plus négatifs que cela. L’un de ces chiffres est très alarmant : au cours des huit dernières années, en zone urbaine, la population de ceux qui n’ont pas accès à l’eau a augmenté de 20 %. Cela révèle une manière de présenter ces chiffres qui est très déséquilibrée.
Pour ma part, j’établis un lien entre, d’une part, le fait de dire que le problème est extrêmement complexe, que l’on a du mal à l’expliquer et, d’autre part, cette absence de résultats. Je pense qu’il faut mettre les deux en parallèle. Pourquoi je dis cela ? Selon l’une de vos collègues géographes, Sylvy Jaglin, ce n’est pas tant la gestion de l’eau qui est complexe. Ce qui est complexe, parce que nous ne le faisons pas, c’est de prendre en compte les spécificités des territoires et les spécificités locales ; sinon, le problème de l’eau, considéré de manière universelle, est très simple : il y a une responsabilité organisatrice qui relève de la puissance publique et une gestion assumée par un opérateur. En fait, c’est relativement simple. Il y a un troisième acteur, ce sont les usagers, qui doivent être impliqués le plus en amont possible. Ce n’est donc pas très compliqué. Ce qui me gêne, c’est que, normalement, lorsque l’on comprend quelque chose, on est capable de l’expliquer simplement. Nous avons du mal à ne pas mettre en relation, d’un côté, le fait que la communauté internationale et toutes les personnes qui travaillent sur l’accès à l’eau soient incapables de formuler simplement une question et, d’un autre côté, l’absence de résultats : depuis des années, on annonce des objectifs, mais on ne les atteint jamais ; au début des années 1980, c’était la Décennie de l’Eau ; maintenant, ce sont les Objectifs du millénaire.
Il y a souvent confusion là où la simplicité serait possible. Par exemple sur la question du droit à l’eau : on met dans un même paquet l’eau transfrontalière, l’arbitrage entre les usages agricoles et l’usage domestique, alors que logiquement ce serait tout de même plus simple de parler d’un côté du droit à l’eau, qui est le droit à la ressource, et de l’autre côté du droit au service. Ne serait-ce qu’en le formulant de cette façon, ce serait déjà plus simple.
François Mansotte
– J’ai un commentaire et une question. Le droit à l’eau, en France, ce n’est pas si simple que cela. Nous avons une frange de la population, de plus en plus importante, qui n’a pas accès à l’eau, même si nous bénéficions d’aides publiques qui aident à payer les factures d’eau et d’électricité, dès lors que les personnes ont un compteur d’eau et un compteur d’électricité. Mais lorsque vous vivez dans un squat, lorsque vous vivez en déshérence, vous n’avez pas de compteur, donc, les aides publiques n’existent pas.
Voyons un DOM comme La Guyane, où 15 % de la population ne peuvent pas être aidés en ce qui concerne leur alimentation en eau potable, parce que ces 15 % de la population vivent en bidonville ou en extérieur sans payer de facture d’eau, puisqu’ils n’ont pas de compteur ; des aides publiques existent qui contribueraient à prendre en charge les factures si ces personnes avaient un compteur. C’est un constat.
Ensuite, je vais tenir des propos très sexistes. Les problèmes d’eau, au niveau international et au niveau français, échoient aux femmes – cela dit sans paraphraser Les Misérables de Victor Hugo et la famille Thénardier, où c’est toujours une petite fille qui porte l’eau. Dans tous les pays du monde, ce sont les femmes qui portent l’eau, ce sont les femmes qui soignent les enfants malades ; mais ce ne sont pas les femmes qui sont à l’origine de la décision. Vous n’avez finalement pas trop abordé ce sujet, et je voudrais connaître votre éclairage sur cette question dans le contexte de pays en voie de développement où l’on n’a pas accès à l’eau potable. Dans certains cas, les décisions se prennent toujours par des hommes et la décision concernant l’eau potable n’est peut-être pas toujours prise en priorité.
Benoît Miribel
– Je ne sais pas si l’on peut être aussi catégorique que cela. Les femmes en Afrique jouent un rôle clé, y compris dans la gouvernance.
Cela me fait penser à une anecdote sur le rôle des femmes, citée par le CICR, au colloque « Eau et Santé », en mars. Le CICR menait un programme dans un pays d’Asie : il s’agissait de simplifier la vie de ces femmes qui passaient des heures à aller chercher l’eau. Un an après, l’étude d’impact et d’évaluation révélait que beaucoup de ces femmes étaient devenues un peu alcooliques et fumaient, parce qu’elles étaient à nouveau seules. Lorsqu’elles allaient vers l’ouvrage d’eau, il y avait du social, elles parlaient. Après la réalisation du programme, elles se retrouvaient un peu déconnectées. C’est juste une anecdote critique sur nos schémas d’intervention.
Par ailleurs, je rejoins Rony Brauman dans son constat à propos du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. En tant qu’ACF, au Sri Lanka, nous avons bien vu l’inefficacité totale, l’impuissance de la Commission des droits de l’homme. C’est une tartuferie lorsque l’on est à Genève, que l’on fait tout ce cinéma. Néanmoins, faut-il pour autant laisser tomber le combat à ce niveau-là ?
Marc Le Pape
– Sur le Conseil des droits de l’homme, il y a ici consensus, donc je crois que ce n’est pas la peine d’en discuter beaucoup plus. Il serait intéressant d’avoir aussi la réaction de certains logisticiens, qu’ils soient de MSF ou d’ailleurs, par rapport aux deux exposés. Je pense, par exemple, à ce que Gilles Isard disait ce matin, lorsqu’il parlait d’un conflit potentiel autour du partage de l’eau entre agriculteurs et humanitaires. Il abordait une question qui a été reprise. Ne pourriez-vous pas réagir ? Toutes ces complexités qui ont été évoquées, pensezvous pouvoir en tenir compte, les gérer, devoir les gérer ? Notamment les « compromis sociaux complexes » que Thierrry Ruf a évoqués.
Gilles Isard
– Je vais rappeler rapidement la situation à laquelle j’ai été confronté en Thaïlande. Nous y avons travaillé pendant quelques années dans un camp de réfugiés et, là, nous nous sommes trouvés en conflit au sujet de la répartition de l’accès à l’eau. C’était un petit bassin versant où, à l’origine, vivaient moins d’un millier de personnes, dont beaucoup d’agriculteurs. Le camp de réfugiés s’est installé sur ce bassin versant. Il comptait 8 000 réfugiés et, du coup, MSF a récupéré l’eau de cette petite rivière : nous l’avons utilisée en priorité pour alimenter ces populations. Rapidement, nous nous sommes trouvés en conflit avec les paysans du coin ; pendant la saison des pluies, il y avait beaucoup d’eau dans la rivière, mais pendant la saison sèche, il n’y en avait quasiment plus. C’est à cette période-là, bien sûr, que les paysans ont besoin de l’eau pour irriguer les cultures, parce que c’est la saison sèche et qu’il fait très chaud. Naturellement, il a fallu négocier et trouver des accords pour partager l’eau de façon efficace ; sinon, ils sabotaient nos installations en permanence. Il s’agissait d’un système d’eau gravitaire sur huit kilomètres, il y avait donc l’espace pour saboter les tuyaux. Nous n’avions pas le choix, et c’était très bien. L’erreur que nous avons faite est d’avoir mal appréhendé cette situation au départ. Si nous avions travaillé différemment et de façon plus appropriée, nous aurions pu estimer dès le départ que nous aurions à faire face à ce genre de situation et qu’il fallait trouver un moyen de travailler ensemble afin de voir comment répartir la ressource. En liaison avec les questions de productivité, la valeur de l’eau devient quelque chose de commercial : il s’agit de rechercher comment le mètre cube d’eau rapportera le plus d’argent. De ce fait, l’eau, parce que cela rapporte de l’argent, sera en priorité distribuée à une usine ou affectée à l’irrigation des cultures à haute valeur ajoutée. Et le dernier, au bout de la ligne, c’est le pauvre, celui qui ne peut pas payer : il prend ce qui reste.
Dans les pays en voie de développement, où il n’y a pas beaucoup de contrôle et de régulation, nous pouvons être confrontés à ce problème parce que l’eau y devient une ressource de plus en plus rare, en tout cas de plus en plus mal répartie. Les aménagements sont en effet réalisés en priorité pour ce qu’ils rapportent, et ce n’est pas dans la bouche du malheureux que l’eau rapporte le plus.
Jean-Hervé Bradol
– On prive les populations d’une ressource économique ; sur ce point, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires, ce n’est pas mon domaine. Ce qui m’a frappé dans le milieu de la gouvernance de l’eau, c’est que l’argument médical est souvent utilisé : on intervient en ce domaine pour indirectement promouvoir la santé.
En fait, c’est assez peu évident. Quand on voit s’installer les compteurs individuels dans les familles, on assiste à une baisse de la consommation. La plupart du temps, nous constatons en effet qu’au bout d’un moment le système de paiement individuel familial provoque une pression économique sur la famille qui, très souvent, diminue sa consommation d’eau. De même pour l’électricité. Nous avons vu, dans un certain nombre de villes où il n’y avait pas vraiment de compteurs électriques individuels, des systèmes de cartes prépayées se mettre en place. Quand le crédit de la carte est épuisé, il y a coupure. Finalement, la famille s’autocensure sur sa consommation.
De plus, sur le plan médical, nous avons vu que c’était l’eau ingérée qui était décisive. Nous avons considéré, au cours de la journée, toutes les conditions pour que l’eau produite et distribuée par des systèmes centraux concoure vraiment à la bonne santé : il faut que le système soit quasi parfait, qu’il n’y ait jamais de rupture, et surtout qu’il y ait l’eau courante, ce qui est rarement le cas.
J’ai surtout observé que c’était une politique du rationnement qui était mise en place par des systèmes de production centralisés, assez autoritaires, et que peu de choses étaient faites pour que les systèmes qui améliorent la qualité de l’eau à l’échelle de la famille soient plus accessibles. Ce sont les fameux filtres dont nous parlions cette après-midi. Ils constituent peut-être une chance de faire la différence en termes de maladies et de nombre de morts chez les « vulnérables » dont tout le monde parle, mais dont on a vu que c’étaient surtout des nourrissons. On a parlé de la barre des « moins de 5 ans » parce que c’est souvent cette barrelà qui est utilisée, mais si on regarde encore plus dans le détail, la mortalité touche les enfants les plus jeunes parmi les moins de 5 ans. Alors que leur décès est souvent utilisé pour la mobilisation politique à propos des questions d’eau, dans les solutions proposées, il n’y a pas grand-chose qui va les concerner et dont on puisse espérer un impact pour eux.
Quand j’assiste à ces discussions, je m’interroge sur l’impact sanitaire des mesures prises. Elles ne ciblent pas les « bons vulnérables », si je puis dire. De toute façon, si l’on considère l’ensemble de la famille, ce sont plutôt des politiques de rationnement qui sont mises en œuvre par le biais de systèmes de distribution et de paiement. Voilà pourquoi cela me laisse vraiment perplexe.
Benoît Miribel
– Effectivement, c’est bien ce que j’évoquais. Les questions que tu poses, nous les posons aussi. Les Objectifs du millénaire disent bien « réduire le non-accès à l’eau », ils ne disent pas « réduire la mortalité ». Ils n’ont pas parlé de la mortalité, et en particulier pas de celle des nourrissons, que tu identifies comme les plus vulnérables.
Marc Laimé
– À regarder l’emballement furieux autour du thème du droit à l’eau depuis quelques années, je me demande si nous ne sommes pas en pleine dérive orwellienne. À mesure que l’on constate – ce qui est absolument irréfutable – que les Objectifs du millénaire ne seront pas atteints, que la situation ne cesse de se dégrader partout, que la communauté internationale ne remplit pas ses engagements, il se produit un envahissement de l’espace public par la notion du droit à l’eau.
Je voudrais rappeler simplement quelques faits. Dans l’espace européen, au titre de l’OCDE, tous les anciens pays de l’Est (100 millions de personnes) ne disposent pas aujourd’hui d’un droit d’accès correct à l’eau. L’un des représentants les plus éminents des entreprises françaises, Gérard Payen, contrairement aux chiffres qui ont été rappelés tout à l’heure, a évoqué récemment le chiffre de 4 milliards de personnes qui ne disposeraient pas d’un accès correct à l’eau et à l’assainissement.
Pour finir, la France a voté, en décembre 2006, la troisième grande loi française sur l’eau, dont l’article 1 comporte de manière tout à fait formelle un « droit à l’eau ». Il n’y a absolument aucune effectivité de ce droit à l’eau aujourd’hui. Un débat très fort a lieu, en France même, sur le fait de savoir comment venir en aide aux plus démunis. Cela va aboutir, au terme d’un processus politique et législatif tout à fait complexe, à ce que les usagers solvables prennent en charge les usagers démunis. Il me semble que tout cela devrait nous incliner à beaucoup d’humilité et de prudence, surtout dans la perspective du Forum mondial qui se tiendra à Marseille en 2012, où la France va donner à la terre entière des leçons sur ce thème du droit à l’eau. Ce thème est devenu un instrument, un véritable talisman qui permet précisément de faire l’économie des dimensions politiques et sociales de l’eau, des tensions et conflits d’objectifs qu’évoquait Thierry Ruf.
Thierry Ruf
– Je voudrais revenir sur la question du rôle des femmes dans la gestion de l’eau. Certes, lors de la conférence de Dublin de 1992, préparatoire à celle de Rio dans le domaine de l’eau, la place des femmes fait l’objet du troisième principe parmi les quatre retenus pour orienter les politiques publiques mondiales. Mais justement, ce principe d’inclusion des femmes occulte toutes les autres exclusions sociales. Incidemment, avez-vous remarqué que, dans les grands débats mondiaux sur l’eau, dans les forums ou les conférences intermédiaires, siègent sur les podiums 95 % ou 99 % d’hommes pour parler de cette question ? Les dirigeants de l’eau sont presque tous des hommes. Pourquoi, au niveau des responsabilités politiques, publiques ou des entreprises, cette domination existe-t-elle toujours ?
Dans les sociétés locales, la situation des femmes par rapport à l’accès aux ressources comme la terre et l’eau pose parfois d’énormes problèmes d’adaptation. Ces questions ont d’ailleurs été régulièrement abordées par les Hollandais, qui portent une attention particulière à ce sujet. Dans les pays andins où l’irrigation montagnarde est très développée et constitue un mode d’organisation sociale et politique qui croise des points de vue communautaires indiens et des points de vue de planification et d’intégration aux marchés des gouvernements, les recherches-actions menées par des ONG, des universitaires et des associations locales de développement ont modifié les paradigmes de l’organisation hydraulique et sociale. Il y a maintenant des communautés indiennes où les femmes sont leaders des associations, dans le cadre d’une lutte globale contre la pauvreté et l’exclusion. Ainsi, les situations évoluent, et souvent plus vite que dans les instances de pouvoir et de lobby. Ceux qui donnent des leçons sur les femmes dans l’organisation économique de l’eau devraient se les appliquer à eux-mêmes.
Un deuxième volet me tient à cœur. J’observe, dans les banlieues des grandes villes marocaines, une opération de transformation des fontaines publiques qui donnaient de l’eau gratuite aux résidents des bidonvilles, personnes généralement sans papiers ni statut ; on a délégué le service à une entreprise privée, française. Cette entreprise a substitué à ces bornes des appareils à cartes numériques à codes, délivrant de l’eau selon différents barèmes. Cela pose un problème éthique et économique. Les gens doivent se déclarer à l’administration, donc faire un acte d’inscription, alors qu’ils étaient méconnus. Est-ce positif ou pas, je ne le sais pas. C’est un contrôle sur la population qui s’opère par le biais de l’eau. Un quota de 40 litres par personne est délivré par la carte électronique : on répond au besoin vital. Une fois épuisé ce quota, on passe à l’achat d’eau. Est-ce que les trésoreries familiales le permettront ? La possession ou la perte de la carte vont devenir des enjeux. Les dynamismes familiaux (mobilité, accueils, vie sociale) entraînent des besoins journaliers très fluctuants.
Évidemment, cela va créer des discriminations, parce qu’une partie de la population ne pourra pas entrer dans ce système de contractualisation de l’accès à l’eau. Comme cette partie de la population n’aura plus accès à l’eau gratuite des bornes-fontaines, sur quoi va-t-elle se reporter ? Sur l’eau de mauvais puits provenant de la nappe phréatique. Or, dans ces périphéries de ville polluées depuis des dizaines d’années, il n’y a pas de pire eau du point de vue sanitaire et de la santé publique. Finalement, l’application des principes de Dublin dans ce contexte répond au problème d’équilibre financier du gestionnaire de l’eau, qui affiche dans les médias son autosatisfaction alors même que rien n’a été évalué en termes d’efficacité financière et d’impact social et médical. Or, les défauts prévisibles du système de cartes à puce pourraient engendrer des coûts directs et des surcoûts indirects de santé publique, qui ne sont pas incorporés dans la présentation des bilans actuels. Ce sont des coûts décalés de dix ou quinze ans, lorsque l’on prendra conscience de tous ces problèmes. La génération suivante devra y faire face. Aujourd’hui, on s’en tient le plus souvent à une appréciation du prix de l’eau facturée au mètre cube délivré, comme si c’était en quelque sorte un produit marchand. Mais les systèmes d’accès à l’eau ont une histoire, un capital hydraulique plus ou moins ancien ou renouvelé, hérité mais mal évalué en termes financiers. Les dysfonctionnements, les exclusions, les corruptions aussi devront être corrigés dans le futur proche et lointain et ses aménités sont difficilement quantifiables. En quelque sorte, en réduisant à l’état de marchandises les eaux potables et bientôt les eaux agricoles, on va transmettre aux générations futures des conflits que nous ne voulons pas résoudre aujourd’hui. Les eaux sont souvent accaparées par les puissants dans une société humaine. La politique sert à contenir les appétits de domination et à réintroduire des dimensions équitables et humaines pour l’accès aux ressources.
Si l’on retient les idées du politologue Ohlsson, la gestion de l’eau passerait par trois phases successives de tour de vis. L’épopée hydraulique arrive en premier lieu, c’est-à-dire la mission qui consiste à offrir de l’eau à la société tout entière par une mobilisation des forces et des savoirs : on canalise, on capte, on offre l’eau. Le deuxième tour de vis intervient quand on estime que certains secteurs de la société n’utilisent pas bien l’eau qui leur est attribuée. C’est le temps du productivisme de l’eau : il faut la réserver aux acteurs qui produisent le plus de biens physiques avec une goutte d’eau. En agriculture, l’attribution des eaux ira aux agriculteurs les plus intensifs ayant les plus hauts rendements agricoles. Dans le monde urbain, ce sera sans doute les villes les plus actives, au développement remarquable. Une sourde exclusion s’opère et touche évidemment les populations les plus vulnérables, sans moyen de production ou d’habitation « à niveau ». Mais cette première gestion de la demande ne suffit pas. La concurrence des usages joue toujours. Dans un troisième tour de vis, on retient le critère de l’efficacité économique de la goutte d’eau. Cette option néolibérale s’appuie sur une régulation par les prix et sur les avantages comparatifs. Mieux vaut donner l’eau chère à ceux qui produisent le plus de valeur ajoutée. En agriculture, on retire des droits anciens aux paysanneries pauvres pour les allouer aux entrepreneurs libérés des contraintes collectives par les progrès technologiques. L’eau payée sert des intérêts individuels. Dans le monde urbain, les quartiers deviennent des zones de discrimination puisque certains regroupent des familles aisées qui exigent un haut niveau de services tandis que les bidonvilles expérimentent les cartes à puce. À l’interface entre ces mondes urbains et ruraux, on va même retirer les ressources d’une communauté paysanne pour favoriser l’installation d’un golf (dont on n’est même pas sûr qu’il paiera l’eau chère au bout du processus) ou bien pour mettre en place une industrie d’eau minérale, quand la source s’y prête, mais sans associer les anciens usagers à cette transformation radicale et violente. Si, partout dans le monde, les trois tours de vis se produisent, les trois quarts de l’humanité se verront exclus de l’accès à l’eau pour la consommation, mais aussi pour l’alimentation.
Évidemment, dans le cadre des actions humanitaires qui suivent des catastrophes, on pourrait penser que l’essentiel est d’équiper en matériel de traitement des eaux les populations accablées. Ce faisant, on est bien dans l’épopée initiale. Mais les deux autres tours de vis ne sont pas loin, et ils risquent fort de s’opérer aux dépens des plus fragiles, ceux que l’on souhaite aider par-dessus tout. C’est la raison pour laquelle j’estime très important d’intervenir sur le plan social et organisationnel en même temps que sur le plan technique et de maintenir une certaine veille, une fois passée l’urgence, pour que le nouveau réseau installé soit géré en bien commun et non soumis aux mécanismes d’exclusion sociale.
Dominique Maison
– Juste pour rebondir sur ce point, puis je reviendrai à une remarque précédente. Effectivement, il me semble remarquer une zone d’ombre qui se trouve peut-être à la confluence des situations d’urgence et de ce que nous avons développé en termes de droit : des actions peut-être à plus long terme ou, en tout cas, qui s’inscrivent plus dans la durée, dans une gouvernance, une structure ou des institutions données. Cela rejoint la question de la situation des quartiers périurbains qui, souvent, accueillent ceux qui viennent d’ailleurs, de la campagne, d’un autre pays, ceux qui sont déplacés, qui sont réfugiés, etc. Là se trouve peut-être une grosse zone grise, dans la mesure où c’est justement de ceux-là dont nous n’avons pas forcément envie de nous occuper, parce que nous n’avons pas forcément envie de les voir – confer les bidonvilles d’ici ou d’ailleurs. Et je pense que chacun a des images à mettre derrière cela.
Ma deuxième remarque est relative à ce qui a été dit tout à l’heure sur la question des filtres. Je comprends bien que l’on ait évoqué cela en termes d’efficacité par rapport à une situation particulière. Pour ma part, j’ai peut-être été trop formaté par un système français, centralisateur, positiviste, issu du XIXe siècle, etc., mais l’équipement collectif en eau, c’est un peu un credo. Je peux comprendre l’utilité des filtres, etc. Ce que je crains, et l’on en revient aux questions de droit d’accès à l’eau, c’est une déprise de la puissance publique sur un moyen de procurer l’accès, et à mon avis c’est un devoir pour une société de procurer cet accès.
Quand on parle de filtres ou de solutions individuelles, on risque effectivement cette déprise de la puissance publique. Par exemple, justement, ces périurbains : si une ONG ou qui que ce soit veut procurer des filtres, on dit : « Qu’il le fasse, moi je n’ai pas à équiper, je n’ai pas à tirer la ligne, je n’ai pas à procurer l’accès. Si c’est fait par d’autres, tant mieux. Et regardez, ça marche, c’est excellent ! » Mais ce succès reçoit sa punition : on crée encore beaucoup plus d’inégalité, à mon sens, parce que cette inégalité est interne au foyer, ou interne aux populations vulnérables (femmes, enfants, etc.). En tout cas, ce n’est pas dans ce sens que s’est faite, du moins en France, cette révolution sanitaire par les équipements publics de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui, rappelez-vous, était destinée à répondre aux grosses épidémies de choléra, parce qu’étaient en jeu une stabilité sociale ainsi qu’un système politique. C’est de cette manière que nos sociétés se sont un peu élevées, au moins sur le plan sanitaire, et avec des inégalités entre catégories sociales, entre communautés.
Enfin, une autre question : impliquer le social, c’est effectivement une idée, mais, en tant qu’ingénieurs, nous n’avons pas toujours les outils pour le faire, c’est-à-dire que nous n’avons pas forcément un schéma indiquant sur quel type de société ou quel type de structuration sociale il est possible d’intervenir.
Je vais terminer par un exemple. Lorsque nous avons, après un tsunami ou après une autre série catastrophique, des sociétés qui sont déstructurées, qui sont en mouvement, où 10 %, 20 % ou 30 % de la population a été décimée, et peut-être parfois des leaders d’opinion, des leaders religieux, tous ceux par qui l’on est censés passer pour faciliter des mises en place, comment fait-on ? Les accès sociaux sont-ils à créer ou à recréer ? Faut-il attendre une stabilité du groupe sur lequel on intervient ? Ou, malgré tout, bon an mal an, faut-il tout de même essayer de promouvoir des solutions techniques, pas forcément très interactives ? Il faut tout de même mettre quelque chose en place, dans ces cas-là.
Francisco Diaz
– Concernant cette intervention, je pense que les deux approches, urgence et moyen terme, ne sont pas incompatibles, au contraire. Tout l’enjeu de nos interventions est justement d’être capables de changer de braquet selon ce qui se passe, en milieu urbain également. J’ai travaillé dix ans dans un bidonville au Guatemala, où l’on a mis en place un système de production et de gestion d’eau, administré à travers une coopérative locale. Cela fonctionne, c’est possible. Il faut prendre du temps. Il y a d’énormes conflits à résoudre avec de nombreux acteurs, publics et externes.
L’un des éléments fondamentaux, à mon avis, pour le succès de ce type d’approche, c’est la notion même de projet. Il faut que les populations, qu’elles soient rurales ou urbaines, aient une projection, une envie de quelque chose d’autre, d’amélioration ou en tout cas de changement.
CONCLUSION
Marie-Pierre Allié, présidente de MSF
Bonsoir. Je voulais d’abord remercier l’ensemble des intervenants et l’ensemble des participants qui ont permis d’avoir des échanges très riches au cours de la journée.
Ces débats confirment bien que la question de l’eau reste fondamentale pour une organisation humanitaire comme MSF. On en a vu l’illustration avec la présentation sur l’épidémie d’hépatite E à Mornay, mais aussi avec celle du Pr. Hunter, qui traitait de l’impact des maladies diarrhéiques sur la mortalité des jeunes enfants. L’importance de cette question est aussi liée à la nécessité de distribuer de l’eau, non seulement de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Je pense que cela a été rappelé ; il ne faut pas l’oublier même si on a beaucoup parlé de la qualité.
Ce constat fait, il n’en reste pas moins que les possibilités d’intervention, les modalités d’action, les réponses opérationnelles soulèvent une multitude de défis pour les acteurs humanitaires. Ces enjeux sont d’abord techniques, certes, on l’a vu dans les discussions aujourd’hui : certaines solutions existent, mais beaucoup restent à trouver. L’enjeu, c’est aussi et surtout la recherche des stratégies opérationnelles les plus adaptées dans la durée et qui soient efficaces en termes d’impact sur les populations auprès desquelles nous intervenons.
Je pense qu’il émerge de cette journée pas mal d’idées sur lesquelles nous pouvons encore progresser. Pour ma part, j’estime que c’est un champ important sur lequel MSF a certainement besoin de s’investir plus que nous ne l’avons fait au cours des dernières années, même si la distribution d’eau a déjà représenté durant les années passées une part importante de nos activités.
Une fois de plus, je remercie l’ensemble d’entre vous pour cette journée.
LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES MSF FOURNIT DE L’EAU
Le camp de personnes déplacées durant la guerre civile éthiopienne, au milieu des années 1980, est la première situation où MSF s’est impliquée dans la fourniture d’eau à une population. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques, les individus privés d’eau et de nourriture : prodiguer des soins perdait tout son sens. Le camp de réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays était alors le contexte d’intervention où MSF avait acquis une bonne partie de sa culture technique, médicale ou non. La fin de la guerre froide et l’évolution des politiques à l’égard des réfugiés ont réduit la fréquence des interventions dans des camps de déplacés ou de réfugiés. Cependant, il est rare qu’une année se termine sans qu’une grande opération de ce type n’ait eu lieu.
Les structures de soins, les institutions médico-sociales et les institutions carcérales ou semi-carcérales (par exemple le centre de détention pour mineurs) sont le deuxième type de contexte dans lequel MSF prend parfois la responsabilité de l’approvisionnement en eau.
Les groupes de populations affectés par des catastrophes naturelles, épidémies comprises, sont un autre type de contexte où interviennent les techniciens et ingénieurs sanitaires de MSF. En raison de la taille plus réduite des groupes de population et de leur dispersion sur de vastes territoires, les techniques développées pour des camps sont peu adaptées. Or la fréquence des interventions en réponse à des catastrophes dites naturelles est en hausse, notamment pour les cas d’inondation, qui entraînent inévitablement la pollution des ressources en eau. D’autre part, les opérations de MSF pour répondre aux épidémies connaissent un fort développement en nombre et en amplitude depuis le milieu des années 1990, comme en témoigne l’opération en cours à Haïti en réponse à une épidémie de choléra au cours de laquelle 250 000 malades ont déjà été traités.
Enfin, les situations où la mortalité infanto-juvénile est élevée de manière aiguë ou chronique font l’objet d’un regain d’activité et de réflexion depuis le début des années 2000. Et la part prise par les maladies diarrhéiques liées à la qualité de l’eau dans la mortalité des jeunes enfants est considérable.
Période
Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter afin de rester informé des publications du CRASH.
Un auteur vous intéresse en particulier ? Inscrivez-vous à nos alertes emails.
